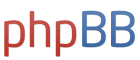Articles sur la santé
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2507
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
La France se dote d’une loi anti-ondes et consacre le principe de « sobriété »
L’assemblée nationale a adopté ce jeudi la proposition de loi du député écologiste du Val de Marne, Laurence Abeille, « relative à la sobriété, à la transparence, et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques », mettant fin à un parcours parlementaire de 2 ans.
Le texte initial avait été renvoyé en commission à l’initiative des socialistes en 2013 ( les Verts reprochant au gouvernement d’avoir cédé aux « lobbies »), avant de revenir devant l'Assemblée nationale en janvier 2014, sous une forme édulcorée, puis d'être adoptée en première lecture par le Sénat, en juin 2014, dans une version encore remaniée. Le groupe écologiste a décidé de faire voter le texte en l'état pour éviter son renvoi devant la haute assemblée. Son adoption est donc définitive et « les décrets d'application vont pouvoir être pris sans plus attendre » s’est félicitée Mme Abeille.
Ce texte a finalement été voté par les socialistes, les radicaux de gauche, et le Front de Gauche. L’UDI s’est abstenu (à l’exception d’un député qui a voté pour). Les députés UMP, notamment Lionel Tardy, à l’origine d’une vingtaine d’amendements qui ont été rejetés, ont jugé (dans la lignée de l’Académie de médecine) le texte anxiogène et contraire aux objectifs de développement numérique.
Le secrétaire d’État chargé du numérique Axelle Lemaire a insisté sur le fait que « ce texte n’était pas une manière pour le gouvernement de considérer les ondes électromagnétiques comme dangereuses » ni de freiner l’utilisation d’objets connectés. « C’est un texte de méthode, qui vise à crever l’abcès des anxiétés irrationnelles véhiculées dans le débat public à l’heure actuelle du fait d’absence de mécanisme de consultation efficace de la population au moment de l’installation d’antennes relais ».
Cette loi intervient dans le contexte du développement des sources d'ondes électromagnétiques, notamment avec le déploiement de la téléphonie mobile à très haut débit, la 4G. Au 1er janvier 2015, indique l'ANFR (Agence Nationale des FRéquences), le nombre de sites d'antennes-relais autorisés en France pour la 4G s'élevait à 18 699 contre 12 525 un an plus tôt.
Sobriété, information, transparence
C’est la première fois qu’on introduit en France le principe de « sobriété », et ce, pour l'exposition du public aux champs électromagnétiques
Ce principe reste toutefois vague et non contraignant. Il n'est ainsi plus question de ramener les valeurs limites d'exposition en vigueur, comprises, selon les fréquences utilisées, entre 41 et 61 volts par mètre (V/m). Néanmoins, le texte interdit effectivement le wifi dans les crèches, limite aux activités pédagogiques son usage dans les écoles, interdit la publicité pour les téléphones portables vendus sans oreillette.
D’autre part, cette nouvelle législation oblige le fabricant à faire mesurer et rendre public le débit d’absorption spécifique (DAS) pour tout équipement radioélectrique, de donner une information claire sur l’accès sans fil à internet dans la notice, et d’informer les occupants d’un local d’habitation en cas de présence d’un émetteur de champs électromagnétique d’un niveau supérieur au seuil fixé par décret.
Au chapitre de la transparence, l'installation d'antennes-relais devra désormais faire l'objet d'une information préalable des maires et des présidents de structures intercommunales, qui pourront organiser une concertation avec les habitants. En outre, une campagne « de sensibilisation et d'information concernant l'usage responsable et raisonné des terminaux mobiles » sera menée.
De son côté, chaque année, l’ANFR se devra de modérer les « points atypiques » où les taux d’expositions du public sont supérieurs à la moyenne nationale (1 V/m).
Enfin, un rapport sur l'électro-hypersensibilité devra être réalisé par le gouvernement.
Un premier pas, mais peut mieux faire !
Les associations « anti-ondes » se sont félicitées du vote. « C’est un premier pas très symbolique car il y a eu un lobbying énorme pendant deux ans contre cette loi (…) Cela ouvre la voie à une réduction de l’exposition de la population, et introduit plus de transparence et de démocratie dans le développement des nouvelles technologies ». explique Etienne Cendrier, porte-parole de l’association Robin des toits, qui souhaite toutefois aller plus loin : « il faut réduire l’exposition au public et tendre vers le 0.6 V/m tel que préconisé par le Conseil de l’Europe ».
« Ce texte, qui est le premier dédié au dossier des ondes électromagnétiques et de leur impact sur l'environnement et la santé, marque une première étape dans la reconnaissance par la loi de la nécessité de réguler le développement de la téléphonie mobile et de toutes les applications sans fil », commente quant à elle l'association Pour une réglementation des antennes-relais de téléphonie mobile (Priartem). A ses yeux, « ce premier effort législatif doit être un encouragement pour aller plus loin dans le protection des populations ».
Une loi malgré l’absence de consensus scientifique
Rappelons qu’à ce jour la dangerosité des ondes électromagnétiques sur la santé n’a jamais été confirmée scientifiquement et que l’application du principe de précaution (dont cette loi est une nouvelle manifestation), pour répondre aux inquiétudes exprimées dans la société, ne saurait être assimilée à une quelconque preuve de l’existence d’un risque avéré. En octobre 2013, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), en conclusion d’une large revue de la littérature, indiquait que les ondes pouvaient « provoquer des modifications biologiques » mais que « les conclusions de l'évaluation des risques ne mettaient pas en évidence d'effets sanitaires avérés ».
L’Agence « recommandait néanmoins de limiter l'exposition aux ondes, en particulier celles des téléphones mobiles, surtout pour les enfants et les utilisateurs intensifs ».
Frédéric Haroche jim.fr
L’assemblée nationale a adopté ce jeudi la proposition de loi du député écologiste du Val de Marne, Laurence Abeille, « relative à la sobriété, à la transparence, et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques », mettant fin à un parcours parlementaire de 2 ans.
Le texte initial avait été renvoyé en commission à l’initiative des socialistes en 2013 ( les Verts reprochant au gouvernement d’avoir cédé aux « lobbies »), avant de revenir devant l'Assemblée nationale en janvier 2014, sous une forme édulcorée, puis d'être adoptée en première lecture par le Sénat, en juin 2014, dans une version encore remaniée. Le groupe écologiste a décidé de faire voter le texte en l'état pour éviter son renvoi devant la haute assemblée. Son adoption est donc définitive et « les décrets d'application vont pouvoir être pris sans plus attendre » s’est félicitée Mme Abeille.
Ce texte a finalement été voté par les socialistes, les radicaux de gauche, et le Front de Gauche. L’UDI s’est abstenu (à l’exception d’un député qui a voté pour). Les députés UMP, notamment Lionel Tardy, à l’origine d’une vingtaine d’amendements qui ont été rejetés, ont jugé (dans la lignée de l’Académie de médecine) le texte anxiogène et contraire aux objectifs de développement numérique.
Le secrétaire d’État chargé du numérique Axelle Lemaire a insisté sur le fait que « ce texte n’était pas une manière pour le gouvernement de considérer les ondes électromagnétiques comme dangereuses » ni de freiner l’utilisation d’objets connectés. « C’est un texte de méthode, qui vise à crever l’abcès des anxiétés irrationnelles véhiculées dans le débat public à l’heure actuelle du fait d’absence de mécanisme de consultation efficace de la population au moment de l’installation d’antennes relais ».
Cette loi intervient dans le contexte du développement des sources d'ondes électromagnétiques, notamment avec le déploiement de la téléphonie mobile à très haut débit, la 4G. Au 1er janvier 2015, indique l'ANFR (Agence Nationale des FRéquences), le nombre de sites d'antennes-relais autorisés en France pour la 4G s'élevait à 18 699 contre 12 525 un an plus tôt.
Sobriété, information, transparence
C’est la première fois qu’on introduit en France le principe de « sobriété », et ce, pour l'exposition du public aux champs électromagnétiques
Ce principe reste toutefois vague et non contraignant. Il n'est ainsi plus question de ramener les valeurs limites d'exposition en vigueur, comprises, selon les fréquences utilisées, entre 41 et 61 volts par mètre (V/m). Néanmoins, le texte interdit effectivement le wifi dans les crèches, limite aux activités pédagogiques son usage dans les écoles, interdit la publicité pour les téléphones portables vendus sans oreillette.
D’autre part, cette nouvelle législation oblige le fabricant à faire mesurer et rendre public le débit d’absorption spécifique (DAS) pour tout équipement radioélectrique, de donner une information claire sur l’accès sans fil à internet dans la notice, et d’informer les occupants d’un local d’habitation en cas de présence d’un émetteur de champs électromagnétique d’un niveau supérieur au seuil fixé par décret.
Au chapitre de la transparence, l'installation d'antennes-relais devra désormais faire l'objet d'une information préalable des maires et des présidents de structures intercommunales, qui pourront organiser une concertation avec les habitants. En outre, une campagne « de sensibilisation et d'information concernant l'usage responsable et raisonné des terminaux mobiles » sera menée.
De son côté, chaque année, l’ANFR se devra de modérer les « points atypiques » où les taux d’expositions du public sont supérieurs à la moyenne nationale (1 V/m).
Enfin, un rapport sur l'électro-hypersensibilité devra être réalisé par le gouvernement.
Un premier pas, mais peut mieux faire !
Les associations « anti-ondes » se sont félicitées du vote. « C’est un premier pas très symbolique car il y a eu un lobbying énorme pendant deux ans contre cette loi (…) Cela ouvre la voie à une réduction de l’exposition de la population, et introduit plus de transparence et de démocratie dans le développement des nouvelles technologies ». explique Etienne Cendrier, porte-parole de l’association Robin des toits, qui souhaite toutefois aller plus loin : « il faut réduire l’exposition au public et tendre vers le 0.6 V/m tel que préconisé par le Conseil de l’Europe ».
« Ce texte, qui est le premier dédié au dossier des ondes électromagnétiques et de leur impact sur l'environnement et la santé, marque une première étape dans la reconnaissance par la loi de la nécessité de réguler le développement de la téléphonie mobile et de toutes les applications sans fil », commente quant à elle l'association Pour une réglementation des antennes-relais de téléphonie mobile (Priartem). A ses yeux, « ce premier effort législatif doit être un encouragement pour aller plus loin dans le protection des populations ».
Une loi malgré l’absence de consensus scientifique
Rappelons qu’à ce jour la dangerosité des ondes électromagnétiques sur la santé n’a jamais été confirmée scientifiquement et que l’application du principe de précaution (dont cette loi est une nouvelle manifestation), pour répondre aux inquiétudes exprimées dans la société, ne saurait être assimilée à une quelconque preuve de l’existence d’un risque avéré. En octobre 2013, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), en conclusion d’une large revue de la littérature, indiquait que les ondes pouvaient « provoquer des modifications biologiques » mais que « les conclusions de l'évaluation des risques ne mettaient pas en évidence d'effets sanitaires avérés ».
L’Agence « recommandait néanmoins de limiter l'exposition aux ondes, en particulier celles des téléphones mobiles, surtout pour les enfants et les utilisateurs intensifs ».
Frédéric Haroche jim.fr
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2507
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Faut-il publier les taux d’infection et de mortalité des hôpitaux ?
Sur le thème des accidents médicaux, la première table ronde des Etats Généraux du Lien a été animée par Alain-Michel Ceretti avec comme slogan : « Peut-on continuer d’avancer les yeux bandés ? ». En cette journée du 5 février le président d'honneur et fondateur de l’association interroge d’emblée le panel des experts sur le pourquoi de l’absence de données fiables et publiques concernant les accidents médicaux et la mortalité associée ?
Un éternel sujet, déjà évoqué dans nos colonnes. Rien que « la iatrogénèse médicamenteuse nosocomiale représente environ entre 12 000 et 24 000 décès par an passés sous silence », avait dénoncé le SNPHPU (Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires) l’an dernier, appelant à un Plan national iatrogénèse pour les établissements de santé. Graves ou non, les événements indésirables sont encore trop fréquents, avec plus de 300 000 cas par an en France, avaient souligné la direction générale de l’offre de soins (DGOS) et la Haute autorité de santé (HAS) à l’occasion de la Semaine des patients 2014 en communiquant les résultats des différents indicateurs de qualité et de sécurité des soins des établissements de santé, diffusés publiquement sur le site Scope Santé. Mais on sait la pauvreté des études nationales, leur absence de données récentes, et que les objectifs toujours annoncés de réduction des évènements indésirables graves se retrouvent souvent enlisés sous la technocratie.
Enlisée aussi l’informatisation des établissements de santé ?
Jean-Luc Harousseau, président de la HAS, a défendu les indicateurs soulignant tous les progrès accomplis dans ce domaine ainsi que dans celui de la transparence avec le site Scope santé pour informer les usagers. Il est aussi resté prudent sur les indicateurs de mortalité « qui peuvent entrainer de la part des établissements un refus de prise en charge des patients les plus à risque », indique le Lien dans son compte-rendu de la journée. Le président de la HAS précise également que seuls 15% des établissements de santé français sont considérés comme totalement informatisés ! C’est pourtant la base pour produire des indicateurs de performance.
Alain-Michel Ceretti a rappelé les obstacles qui s’étaient opposés au tableau de bord des infections nosocomiales avant sa parution et qu’en 2008, « le Président Sarkozy avait réclamé la publication de taux d’infection et de mortalité qui ne sont hélas jamais venus, démontrant une capacité de résistance des professionnels qui pose question ». Rappelons de notre côté qu’en 2014, trois indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales et sept indicateurs qualité et sécurité sont diffusés, et que l’apparition de nouveaux indicateurs chaque année accroit le travail administratif des soignants.
Revalider régulièrement les compétences médicales ?
Le problème de l’existence de quelques médecins « dangereux » a été évoqué. Pour le Pr Guy Vallancien, de l'Académie Nationale de Médecine et de l'Académie Nationale de Chirurgie, « la transparence n’est inquiétante que pour les mauvais », et il affirme que « l’objectif devrait être de ‘couper les pattes’ aux praticiens dangereux ». Il souligne le niveau remarquable de la chirurgie en France mais considère qu’il faudrait ré-orienter un faible pourcentage de chirurgiens n’ayant pas les aptitudes requises et ré-évaluer périodiquement les compétences. Sur ce sujet le Pr René Amalberti, directeur de la gestion des risques pour l’assureur MACSF, explique qu’aux Etats-Unis les médecins connaissent une revalidation tous les dix ans de leur capacité à exercer.
En clotûrant les Etats Généraux Marisol Touraine rappelle l'élaboration d'un portail internet commun de recueil des déclarations d’évènements indésirables émanant des patients, professionnels de santé et industriels. D’autre part l’augmentation de la prise en charge ambulatoire permettra pour elle de diminuer le risque d’infection nosocomiale, de confusion de médicaments et d’erreurs au lit du patient.
Dominique Monnier jim.fr
§§§
Identification d’une nouvelle souche du VIH très virulente à Cuba
Paris, le mercredi 18 février 2015 - Des chercheurs de l’université catholique de Louvain et de l’Institut de médecine tropicale Pedro Kouri de la Havane révèlent dans la revue EBio Medicine que des patients récemment infectés par le VIH à Cuba sont touchés par une souche beaucoup plus virulente que celles habituellement présentes dans l’île. Cette mutation se caractérise par « une progression rapide de la maladie » explique le docteur Hector Bolivar, spécialiste des maladies infectieuses à l’Ecole de médecine Miller de Miami. Ces données inquiètent les épidémiologistes, même si le petit nombre d’échantillons analysés (73 patients récemment infectés, dont 52 déjà au stade Sida) permet en partie de limiter les craintes.
M.P.
Sur le thème des accidents médicaux, la première table ronde des Etats Généraux du Lien a été animée par Alain-Michel Ceretti avec comme slogan : « Peut-on continuer d’avancer les yeux bandés ? ». En cette journée du 5 février le président d'honneur et fondateur de l’association interroge d’emblée le panel des experts sur le pourquoi de l’absence de données fiables et publiques concernant les accidents médicaux et la mortalité associée ?
Un éternel sujet, déjà évoqué dans nos colonnes. Rien que « la iatrogénèse médicamenteuse nosocomiale représente environ entre 12 000 et 24 000 décès par an passés sous silence », avait dénoncé le SNPHPU (Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires) l’an dernier, appelant à un Plan national iatrogénèse pour les établissements de santé. Graves ou non, les événements indésirables sont encore trop fréquents, avec plus de 300 000 cas par an en France, avaient souligné la direction générale de l’offre de soins (DGOS) et la Haute autorité de santé (HAS) à l’occasion de la Semaine des patients 2014 en communiquant les résultats des différents indicateurs de qualité et de sécurité des soins des établissements de santé, diffusés publiquement sur le site Scope Santé. Mais on sait la pauvreté des études nationales, leur absence de données récentes, et que les objectifs toujours annoncés de réduction des évènements indésirables graves se retrouvent souvent enlisés sous la technocratie.
Enlisée aussi l’informatisation des établissements de santé ?
Jean-Luc Harousseau, président de la HAS, a défendu les indicateurs soulignant tous les progrès accomplis dans ce domaine ainsi que dans celui de la transparence avec le site Scope santé pour informer les usagers. Il est aussi resté prudent sur les indicateurs de mortalité « qui peuvent entrainer de la part des établissements un refus de prise en charge des patients les plus à risque », indique le Lien dans son compte-rendu de la journée. Le président de la HAS précise également que seuls 15% des établissements de santé français sont considérés comme totalement informatisés ! C’est pourtant la base pour produire des indicateurs de performance.
Alain-Michel Ceretti a rappelé les obstacles qui s’étaient opposés au tableau de bord des infections nosocomiales avant sa parution et qu’en 2008, « le Président Sarkozy avait réclamé la publication de taux d’infection et de mortalité qui ne sont hélas jamais venus, démontrant une capacité de résistance des professionnels qui pose question ». Rappelons de notre côté qu’en 2014, trois indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales et sept indicateurs qualité et sécurité sont diffusés, et que l’apparition de nouveaux indicateurs chaque année accroit le travail administratif des soignants.
Revalider régulièrement les compétences médicales ?
Le problème de l’existence de quelques médecins « dangereux » a été évoqué. Pour le Pr Guy Vallancien, de l'Académie Nationale de Médecine et de l'Académie Nationale de Chirurgie, « la transparence n’est inquiétante que pour les mauvais », et il affirme que « l’objectif devrait être de ‘couper les pattes’ aux praticiens dangereux ». Il souligne le niveau remarquable de la chirurgie en France mais considère qu’il faudrait ré-orienter un faible pourcentage de chirurgiens n’ayant pas les aptitudes requises et ré-évaluer périodiquement les compétences. Sur ce sujet le Pr René Amalberti, directeur de la gestion des risques pour l’assureur MACSF, explique qu’aux Etats-Unis les médecins connaissent une revalidation tous les dix ans de leur capacité à exercer.
En clotûrant les Etats Généraux Marisol Touraine rappelle l'élaboration d'un portail internet commun de recueil des déclarations d’évènements indésirables émanant des patients, professionnels de santé et industriels. D’autre part l’augmentation de la prise en charge ambulatoire permettra pour elle de diminuer le risque d’infection nosocomiale, de confusion de médicaments et d’erreurs au lit du patient.
Dominique Monnier jim.fr
§§§
Identification d’une nouvelle souche du VIH très virulente à Cuba
Paris, le mercredi 18 février 2015 - Des chercheurs de l’université catholique de Louvain et de l’Institut de médecine tropicale Pedro Kouri de la Havane révèlent dans la revue EBio Medicine que des patients récemment infectés par le VIH à Cuba sont touchés par une souche beaucoup plus virulente que celles habituellement présentes dans l’île. Cette mutation se caractérise par « une progression rapide de la maladie » explique le docteur Hector Bolivar, spécialiste des maladies infectieuses à l’Ecole de médecine Miller de Miami. Ces données inquiètent les épidémiologistes, même si le petit nombre d’échantillons analysés (73 patients récemment infectés, dont 52 déjà au stade Sida) permet en partie de limiter les craintes.
M.P.
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2507
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
La sécurité des injections, nouveau défi de l’Organisation mondiale de la Santé
Des pratiques dangereuses évitables, notamment la réutilisation de matériel à usage unique pour réaliser des injections, ont encore cours quotidiennement dans le monde, dans les pays à faible revenu mais pas uniquement, et contribuent à la propagation à grande échelle d’un certain nombre de maladies infectieuses. C’est pourquoi l’Organisation mondiale de la santé (OMS) lance aujourd’hui une nouvelle politique de sécurité des injections qui fait appel à un usage exclusif de seringues « intelligentes » sécurisées.
Des nouveaux cas d’hépatite et de VIH par milliers
En 2000, au début de son programme d’innocuité des injections, l'Organisation estimait que 40% des injections étaient réalisées avec du matériel réutilisé, pratiques ayant conduit à 21 millions de nouveaux cas d’hépatite B (32% de tous les cas), deux millions d’hépatite C (40% de tous les cas) et environ 260 000 cas d’infections à VIH (5% de tous les cas) (1). Plus récemment une étude menée en 2014 avec le parrainage de l’OMS sur les toutes dernières données disponibles, estime jusqu’à 1,7 million le nombre de personnes contaminées par le virus de l’hépatite B en une année, 315 000 par le virus de l’hépatite C et 33 800 par le VIH à la suite d’une injection à risque.
Les piqûres accidentelles et la manipulation d’objets tranchants infectés avant et après leur élimination, sont également à haut risque pour les professionnels de santé, et l’OMS évaluait en 2003 que trois millions de piqûres d’aiguilles accidentelles avaient contribué pour 37% aux nouveaux cas de VHB chez les professionnels, pour 39% à ceux de VHC et à environ 5% des nouveaux cas d’infections à VIH (2).
L’OMS estime aussi que dans bien des cas, les injections par voie intramusculaire, sous-cutanée ou intradermique ne sont pas nécessaires et pourraient être remplacées par l’administration par voie orale.
Des progrès considérables devraient pouvoir être réalisés. Déjà, entre 2000 et 2010, à mesure que les campagnes de sécurité se sont amplifiées, la réutilisation de dispositifs d’injection dans les pays en développement a diminué d’un facteur sept, constate l’Organisation (3). Dans le même intervalle, le nombre d’injections inutiles a lui aussi baissé de 3,4 à 2,9 injections par personne en moyenne dans les pays en développement.
Des seringues « intelligentes »
Dans ses nouvelles lignes directrices et sa nouvelle politique de sécurité des injections, l’OMS fait des recommandations détaillées et insiste sur l’utilité des dispositifs de sécurité des seringues qui protègent contre le risque infectieux. Elle recommande d’adopter de nouvelles seringues sécurisées « intelligentes » pourvues de mécanismes qui empêchent leur réutilisation. Dans son communiqué l’OMS décrit que sur certains modèles, le piston présente une partie frangible qui se casse si l’on essaie de tirer sur le piston après l’injection. D’autres ont un clip métallique qui bloque le piston une fois qu’il est enfoncé, et sur d’autres modèles encore, l’aiguille se rétracte dans le corps de la seringue à la fin de l’injection. Les seringues sont aussi équipées de dispositifs qui protègent les professionnels de santé contre les piqûres d’aiguille. Une gaine ou un capuchon descend le long de l’aiguille et la recouvre entièrement après l’injection pour éviter que l’utilisateur ne se blesse accidentellement s’exposant ainsi à un risque d’infection.
L’OMS exhorte tous les pays à passer, d’ici 2020, à l’usage exclusif de ces nouvelles seringues « intelligentes », sauf dans les rares circonstances où une seringue autobloquante empêcherait d’effectuer un acte médical (par exemple pompe intraveineuse utilisant une seringue). Elle incite à adopter des politiques et des normes en matière d’achat, d’utilisation et d’élimination sans risque des seringues réutilisables pour les cas où leur usage resterait nécessaire. Elle recommande à nouveau la formation continue des professionnels de santé à la sécurité des injections. L’OMS lance un appel aux fabricants pour qu’ils commencent ou augmentent dès que possible la production de seringues « intelligentes » répondant aux normes de performance, de qualité et de sécurité de l’Organisation. Ces nouvelles seringues coûtant au moins le double des seringues non sécurisées, elle fait également appel aux donateurs pour qu’ils facilitent l’adoption de ce matériel, comptant que les prix baisseront à mesure que la demande augmentera.
Dominique Monnier
Références
(1) Hauri A et col.. The global burden of disease attributable to contaminated injections given in health care settings. Int J STD AIDS. 2004; 15(1):7–16.
(2) Pruss-Ustun A et col. Sharps injuries: Global burden of disease from sharps injuries to health-care workers. Environmental burden of disease series N° 3, WHO 2003
(3) Pépin J et col. Evolution of the global burden of viral infections from unsafe medical injections, 2000-2010 PLoS One. 2014 Jun 9;9(6):e99677. doi: 10.1371/journal.pone.0099677.
jim.fr
----
Le gouvernement démine le dossier toxique des emprunts à risque contractés par les hôpitaux
Paris, le mercredi 25 février 2015 –
La découverte depuis 2011 de la souscription par de nombreux hôpitaux d’emprunts à hauts risques, également souvent qualifiés de « toxiques », empoisonne la Fédération hospitalière de France (FHF) qui face à la dette abyssale de nombre d’établissements n’avait guère besoin de cet obstacle supplémentaire. Or, devant cette situation, la réponse du gouvernement a été jugée plus qu’insuffisante : un fonds de 100 millions d’euros d’aides, en échange de la promesse par les bénéficiaires de ne pas engager de poursuites judiciaires, a été mis en place l’année dernière (et n’est pas encore entré en action). Une somme et un mécanisme fortement critiqués par les responsables des hôpitaux. Leur colère a été ravivée par la récente hausse du franc suisse, qui a entraîné une augmentation automatique de l’encours d’une partie de leurs emprunts, dont certains avaient été indexés sur le taux de change entre l’euro et la devise helvète. Selon les calculs de la FHF, le surplus s’élève à 500 millions d’euros, un montant qui une fois encore met en évidence les limites des aides promises. Aussi, s’estimant « les grands oubliés » du gouvernement pour soutenir les victimes de la crise financière, les hôpitaux menaçaient, à l’instar de nombreuses collectivités locales, de former un recours devant la justice européenne pour dénoncer la loi empêchant toute poursuite judiciaire contre les banques en l’échange de la perception des aides.
Aider les petits hôpitaux en priorité
Face à cette fronde, le gouvernement a rapidement réagi. Hier, le ministre de la Santé a annoncé que le fonds serait augmenté de 300 millions d’euros, grâce à une augmentation de la taxe sur le risque systémique, dont doivent s’acquitter les banques. A la différence des 100 premiers millions d’euros, cette hausse sera entièrement financée grâce aux banques et non en partie grâce à un prélèvement sur l’Assurance maladie. Marisol Touraine a expliqué ce choix en martelant : « Après tout, ce sont les banques qui sont responsables de cette situation ». Par ailleurs, ce fonds sera pérennisé sur dix ans, contre trois dans sa version « originale ». Dans une interview accordée aux Echos, le ministre précise encore que ces aides concerneront prioritairement les petits établissements « qui ont contracté une grande quantité d’emprunts, et qui sont aujourd’hui étranglés par la dette. Ces dernières semaines, nous avons commencé à faire remonter les dossiers via les Agences régionales de santé (ARS). Les hôpitaux vont entrer dans le dispositif comme prévu (…), il y en aura des dizaines, peut-être 50,70,80… Ils seront aidés pour payer les intérêts, mais aussi le coût de sortie de l’emprunt » détaille Marisol Touraine dans les colonnes du journal économique.
Des délais bienvenus
A cette hausse très importante, s’ajoute un communiqué de la Société de financement local (SFIL), établissement public qui a succédé à la banque Dexia, qui précise qu’elle va proposer « un dispositif de délai de paiement pour les emprunteurs ayant déposé un dossier auprès des Fonds » et qu’il n’y aura pas de « facturation des intérêts qui auraient été contractuellement dus au titre de ce décalage de paiement, dans la mesure où le dossier fera bien l’objet d’un accord transactionnel ». Cette mesure devrait permettre de « neutraliser la montée brutale du franc suisse » se félicite la FHF, qui espère que les autres banques concernées emboîteront le pas de la SFIL. Enfin, autre mesure en gestation : le déplafonnement de l’aide, actuellement fixée à 45 % de l’encourt de la dette en cas de remboursement anticipé est l’objet de réflexions au ministère du Budget et de toutes les attentions de la FHF.
Les hôpitaux n'auraient pas compris les contrats qu'ils signaient !
Cette dernière se montre à la fois satisfaite et attentive. « C’est une aide sérieuse pour financer les frais que génère la volatilité des taux d’intérêts » s’est ainsi félicité le patron de la FHF, Frédéric Valletoux. Cependant, dans son communiqué officiel, l’organisation apparaît moins enthousiaste notant que cet « engagement gouvernemental, s’il apaise momentanément la situation, ne met pas un point final à cet épisode douloureux pour les établissements de santé ». Surtout, dans ce texte, elle n’indique pas clairement si le geste du gouvernement met un terme définitif à ses velléités de poursuites judiciaires. On notera enfin qu’une nouvelle fois la FHF tente de dédouaner de toute responsabilité les patrons des hôpitaux, en qualifiant les produits bancaires concernés « d’illisibles et dangereux ».
Signalons cependant, comme beaucoup d'observateurs, que dans un contrat la responsabilité des deux parties signataires est engagée et qu'il appartient aux emprunteurs de ne pas signer de contrats qu'ils estiment dangereux (ce qui était les cas à l'évidence pour un emprunt indexé sur le Franc Suisse pour quiconque suivait très vaguement l'actualité) ou bien évidemment illisible (ce qui est bien le moins pour un directeur financier d'un organisme public).
Malgré tout ne cherchons à faire jouer cette jurisprudence "bienveillante" lorsque nous ne parvenons pas à remplir nos obligations contractuelles personnelles...
Aurélie Haroche
jim.fr
Des pratiques dangereuses évitables, notamment la réutilisation de matériel à usage unique pour réaliser des injections, ont encore cours quotidiennement dans le monde, dans les pays à faible revenu mais pas uniquement, et contribuent à la propagation à grande échelle d’un certain nombre de maladies infectieuses. C’est pourquoi l’Organisation mondiale de la santé (OMS) lance aujourd’hui une nouvelle politique de sécurité des injections qui fait appel à un usage exclusif de seringues « intelligentes » sécurisées.
Des nouveaux cas d’hépatite et de VIH par milliers
En 2000, au début de son programme d’innocuité des injections, l'Organisation estimait que 40% des injections étaient réalisées avec du matériel réutilisé, pratiques ayant conduit à 21 millions de nouveaux cas d’hépatite B (32% de tous les cas), deux millions d’hépatite C (40% de tous les cas) et environ 260 000 cas d’infections à VIH (5% de tous les cas) (1). Plus récemment une étude menée en 2014 avec le parrainage de l’OMS sur les toutes dernières données disponibles, estime jusqu’à 1,7 million le nombre de personnes contaminées par le virus de l’hépatite B en une année, 315 000 par le virus de l’hépatite C et 33 800 par le VIH à la suite d’une injection à risque.
Les piqûres accidentelles et la manipulation d’objets tranchants infectés avant et après leur élimination, sont également à haut risque pour les professionnels de santé, et l’OMS évaluait en 2003 que trois millions de piqûres d’aiguilles accidentelles avaient contribué pour 37% aux nouveaux cas de VHB chez les professionnels, pour 39% à ceux de VHC et à environ 5% des nouveaux cas d’infections à VIH (2).
L’OMS estime aussi que dans bien des cas, les injections par voie intramusculaire, sous-cutanée ou intradermique ne sont pas nécessaires et pourraient être remplacées par l’administration par voie orale.
Des progrès considérables devraient pouvoir être réalisés. Déjà, entre 2000 et 2010, à mesure que les campagnes de sécurité se sont amplifiées, la réutilisation de dispositifs d’injection dans les pays en développement a diminué d’un facteur sept, constate l’Organisation (3). Dans le même intervalle, le nombre d’injections inutiles a lui aussi baissé de 3,4 à 2,9 injections par personne en moyenne dans les pays en développement.
Des seringues « intelligentes »
Dans ses nouvelles lignes directrices et sa nouvelle politique de sécurité des injections, l’OMS fait des recommandations détaillées et insiste sur l’utilité des dispositifs de sécurité des seringues qui protègent contre le risque infectieux. Elle recommande d’adopter de nouvelles seringues sécurisées « intelligentes » pourvues de mécanismes qui empêchent leur réutilisation. Dans son communiqué l’OMS décrit que sur certains modèles, le piston présente une partie frangible qui se casse si l’on essaie de tirer sur le piston après l’injection. D’autres ont un clip métallique qui bloque le piston une fois qu’il est enfoncé, et sur d’autres modèles encore, l’aiguille se rétracte dans le corps de la seringue à la fin de l’injection. Les seringues sont aussi équipées de dispositifs qui protègent les professionnels de santé contre les piqûres d’aiguille. Une gaine ou un capuchon descend le long de l’aiguille et la recouvre entièrement après l’injection pour éviter que l’utilisateur ne se blesse accidentellement s’exposant ainsi à un risque d’infection.
L’OMS exhorte tous les pays à passer, d’ici 2020, à l’usage exclusif de ces nouvelles seringues « intelligentes », sauf dans les rares circonstances où une seringue autobloquante empêcherait d’effectuer un acte médical (par exemple pompe intraveineuse utilisant une seringue). Elle incite à adopter des politiques et des normes en matière d’achat, d’utilisation et d’élimination sans risque des seringues réutilisables pour les cas où leur usage resterait nécessaire. Elle recommande à nouveau la formation continue des professionnels de santé à la sécurité des injections. L’OMS lance un appel aux fabricants pour qu’ils commencent ou augmentent dès que possible la production de seringues « intelligentes » répondant aux normes de performance, de qualité et de sécurité de l’Organisation. Ces nouvelles seringues coûtant au moins le double des seringues non sécurisées, elle fait également appel aux donateurs pour qu’ils facilitent l’adoption de ce matériel, comptant que les prix baisseront à mesure que la demande augmentera.
Dominique Monnier
Références
(1) Hauri A et col.. The global burden of disease attributable to contaminated injections given in health care settings. Int J STD AIDS. 2004; 15(1):7–16.
(2) Pruss-Ustun A et col. Sharps injuries: Global burden of disease from sharps injuries to health-care workers. Environmental burden of disease series N° 3, WHO 2003
(3) Pépin J et col. Evolution of the global burden of viral infections from unsafe medical injections, 2000-2010 PLoS One. 2014 Jun 9;9(6):e99677. doi: 10.1371/journal.pone.0099677.
jim.fr
----
Le gouvernement démine le dossier toxique des emprunts à risque contractés par les hôpitaux
Paris, le mercredi 25 février 2015 –
La découverte depuis 2011 de la souscription par de nombreux hôpitaux d’emprunts à hauts risques, également souvent qualifiés de « toxiques », empoisonne la Fédération hospitalière de France (FHF) qui face à la dette abyssale de nombre d’établissements n’avait guère besoin de cet obstacle supplémentaire. Or, devant cette situation, la réponse du gouvernement a été jugée plus qu’insuffisante : un fonds de 100 millions d’euros d’aides, en échange de la promesse par les bénéficiaires de ne pas engager de poursuites judiciaires, a été mis en place l’année dernière (et n’est pas encore entré en action). Une somme et un mécanisme fortement critiqués par les responsables des hôpitaux. Leur colère a été ravivée par la récente hausse du franc suisse, qui a entraîné une augmentation automatique de l’encours d’une partie de leurs emprunts, dont certains avaient été indexés sur le taux de change entre l’euro et la devise helvète. Selon les calculs de la FHF, le surplus s’élève à 500 millions d’euros, un montant qui une fois encore met en évidence les limites des aides promises. Aussi, s’estimant « les grands oubliés » du gouvernement pour soutenir les victimes de la crise financière, les hôpitaux menaçaient, à l’instar de nombreuses collectivités locales, de former un recours devant la justice européenne pour dénoncer la loi empêchant toute poursuite judiciaire contre les banques en l’échange de la perception des aides.
Aider les petits hôpitaux en priorité
Face à cette fronde, le gouvernement a rapidement réagi. Hier, le ministre de la Santé a annoncé que le fonds serait augmenté de 300 millions d’euros, grâce à une augmentation de la taxe sur le risque systémique, dont doivent s’acquitter les banques. A la différence des 100 premiers millions d’euros, cette hausse sera entièrement financée grâce aux banques et non en partie grâce à un prélèvement sur l’Assurance maladie. Marisol Touraine a expliqué ce choix en martelant : « Après tout, ce sont les banques qui sont responsables de cette situation ». Par ailleurs, ce fonds sera pérennisé sur dix ans, contre trois dans sa version « originale ». Dans une interview accordée aux Echos, le ministre précise encore que ces aides concerneront prioritairement les petits établissements « qui ont contracté une grande quantité d’emprunts, et qui sont aujourd’hui étranglés par la dette. Ces dernières semaines, nous avons commencé à faire remonter les dossiers via les Agences régionales de santé (ARS). Les hôpitaux vont entrer dans le dispositif comme prévu (…), il y en aura des dizaines, peut-être 50,70,80… Ils seront aidés pour payer les intérêts, mais aussi le coût de sortie de l’emprunt » détaille Marisol Touraine dans les colonnes du journal économique.
Des délais bienvenus
A cette hausse très importante, s’ajoute un communiqué de la Société de financement local (SFIL), établissement public qui a succédé à la banque Dexia, qui précise qu’elle va proposer « un dispositif de délai de paiement pour les emprunteurs ayant déposé un dossier auprès des Fonds » et qu’il n’y aura pas de « facturation des intérêts qui auraient été contractuellement dus au titre de ce décalage de paiement, dans la mesure où le dossier fera bien l’objet d’un accord transactionnel ». Cette mesure devrait permettre de « neutraliser la montée brutale du franc suisse » se félicite la FHF, qui espère que les autres banques concernées emboîteront le pas de la SFIL. Enfin, autre mesure en gestation : le déplafonnement de l’aide, actuellement fixée à 45 % de l’encourt de la dette en cas de remboursement anticipé est l’objet de réflexions au ministère du Budget et de toutes les attentions de la FHF.
Les hôpitaux n'auraient pas compris les contrats qu'ils signaient !
Cette dernière se montre à la fois satisfaite et attentive. « C’est une aide sérieuse pour financer les frais que génère la volatilité des taux d’intérêts » s’est ainsi félicité le patron de la FHF, Frédéric Valletoux. Cependant, dans son communiqué officiel, l’organisation apparaît moins enthousiaste notant que cet « engagement gouvernemental, s’il apaise momentanément la situation, ne met pas un point final à cet épisode douloureux pour les établissements de santé ». Surtout, dans ce texte, elle n’indique pas clairement si le geste du gouvernement met un terme définitif à ses velléités de poursuites judiciaires. On notera enfin qu’une nouvelle fois la FHF tente de dédouaner de toute responsabilité les patrons des hôpitaux, en qualifiant les produits bancaires concernés « d’illisibles et dangereux ».
Signalons cependant, comme beaucoup d'observateurs, que dans un contrat la responsabilité des deux parties signataires est engagée et qu'il appartient aux emprunteurs de ne pas signer de contrats qu'ils estiment dangereux (ce qui était les cas à l'évidence pour un emprunt indexé sur le Franc Suisse pour quiconque suivait très vaguement l'actualité) ou bien évidemment illisible (ce qui est bien le moins pour un directeur financier d'un organisme public).
Malgré tout ne cherchons à faire jouer cette jurisprudence "bienveillante" lorsque nous ne parvenons pas à remplir nos obligations contractuelles personnelles...
Aurélie Haroche
jim.fr
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2507
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Le rémifentanil moins performant que la péridurale pour contrôler la douleur de l’accouchement
Le rémifentanil est proposé dans la prise en charge de la douleur au cours du travail. Dispensé par voie veineuse, cette analgésie peut être contrôlée par la patiente elle-même et représente une alternative à l’analgésie péridurale. Certaines femmes présentent en effet des contre-indications à celle-ci ou préfèrent une méthode d’analgésie moins invasive.
Le rémifentanil est un morphinique puissant, agoniste des récepteurs µ, dont la particularité est un délai d’action court et une élimination rapide et constante.
Une équipe hollandaise a réalisé une étude randomisée dans le but d’évaluer la satisfaction des patientes ayant accouché avec l’analgésie contrôlée par rémifentanil en comparaison de celle des patientes ayant accouché avec une analgésie péridurale. Au total 1 414 patientes ont été randomisées, divisées en 2 groupes selon le mode d’analgésie qui leur était proposé. Leur satisfaction concernant la sédation de la douleur était évaluée toutes les heures avec une échelle visuelle analogique.
Bien que le contrôle de l’analgésie soit réalisé par la patiente elle-même, laissant présager des scores de satisfaction supérieurs, c’est l’inverse qui est constaté. L’analgésie contrôlée avec le rémifentanil n’est en effet pas équivalente à l’analgésie péridurale en ce qui concerne la satisfaction de la patiente sur le total soulagement de la douleur (différence -2,8 ; intervalle de confiance à 95 % -6,9 à 1,3) et l’analgésie péridurale permet d’obtenir de meilleurs scores de douleur.
Notons qu’une proportion plus importante de patientes a demandé à recourir à l’analgésie dans le « groupe rémifentanil » (65 % vs 52 %) peut-être parce que la méthode apparaît moins invasive et plus facilement disponible. Le temps entre la demande et le début de l’analgésie est d’ailleurs inférieur dans ce groupe, sans doute parce que la présence d’un anesthésiste n’est pas nécessaire.
En ce qui concerne les critères secondaires d’évaluation, les auteurs précisent que le taux de césarienne est identique dans les deux groupes, ainsi que le taux de morbidité et de mortalité maternelle et infantile. En revanche, les désaturations sont plus fréquentes dans le groupe sous analgésie par rémifentanil (38 % en dessous de 95 % de SpO2 et 18 % en dessous de 92 % vs 12 % et 5 %).
Dr Roseline Péluchon
Références
Freeman LM et coll. : Patient controlled analgesia with remifentanil versus epidural analgesia in labour: randomized multicentre equivalence trial.
BMJ 2015; 350: h846
Jim.fr
Le rémifentanil est proposé dans la prise en charge de la douleur au cours du travail. Dispensé par voie veineuse, cette analgésie peut être contrôlée par la patiente elle-même et représente une alternative à l’analgésie péridurale. Certaines femmes présentent en effet des contre-indications à celle-ci ou préfèrent une méthode d’analgésie moins invasive.
Le rémifentanil est un morphinique puissant, agoniste des récepteurs µ, dont la particularité est un délai d’action court et une élimination rapide et constante.
Une équipe hollandaise a réalisé une étude randomisée dans le but d’évaluer la satisfaction des patientes ayant accouché avec l’analgésie contrôlée par rémifentanil en comparaison de celle des patientes ayant accouché avec une analgésie péridurale. Au total 1 414 patientes ont été randomisées, divisées en 2 groupes selon le mode d’analgésie qui leur était proposé. Leur satisfaction concernant la sédation de la douleur était évaluée toutes les heures avec une échelle visuelle analogique.
Bien que le contrôle de l’analgésie soit réalisé par la patiente elle-même, laissant présager des scores de satisfaction supérieurs, c’est l’inverse qui est constaté. L’analgésie contrôlée avec le rémifentanil n’est en effet pas équivalente à l’analgésie péridurale en ce qui concerne la satisfaction de la patiente sur le total soulagement de la douleur (différence -2,8 ; intervalle de confiance à 95 % -6,9 à 1,3) et l’analgésie péridurale permet d’obtenir de meilleurs scores de douleur.
Notons qu’une proportion plus importante de patientes a demandé à recourir à l’analgésie dans le « groupe rémifentanil » (65 % vs 52 %) peut-être parce que la méthode apparaît moins invasive et plus facilement disponible. Le temps entre la demande et le début de l’analgésie est d’ailleurs inférieur dans ce groupe, sans doute parce que la présence d’un anesthésiste n’est pas nécessaire.
En ce qui concerne les critères secondaires d’évaluation, les auteurs précisent que le taux de césarienne est identique dans les deux groupes, ainsi que le taux de morbidité et de mortalité maternelle et infantile. En revanche, les désaturations sont plus fréquentes dans le groupe sous analgésie par rémifentanil (38 % en dessous de 95 % de SpO2 et 18 % en dessous de 92 % vs 12 % et 5 %).
Dr Roseline Péluchon
Références
Freeman LM et coll. : Patient controlled analgesia with remifentanil versus epidural analgesia in labour: randomized multicentre equivalence trial.
BMJ 2015; 350: h846
Jim.fr
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2507
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Prise prolongée de paracétamol à haute dose : une étude anglaise pointe de possibles risques qui nécessitent confirmation
Par Jean-Philippe RIVIERE -
Le paracétamol est l’antalgique le plus utilisé au monde. Il est reconnu comme efficace et bien toléré, à la dose de 3-4 grammes par jour. En cas de surdosage, volontaire (tentative de suicide) ou non (facteurs de risques individuels), les risques sont connus et documentés (risque hépatique aigu).
Par contre, aucun risque n'est mentionné en cas d'utilisation chronique à dose maximale. Mais y aurait-il d'éventuels risques non encore détectés ?
Le Pr Philip Conaghan et ses collaborateurs ont tenté d’estimer ces éventuels risques en analysant plusieurs études publiées sur ce sujet. Lesur analyse montre une association statistique entre l’augmentation de la mortalité, la survenue de certains problèmes de santé (gastro-intestinaux, cardiovasculaires, rénaux) et la prise au long cours et/ou à doses quotidiennes élevées de paracétamol.
Cependant, il n'est pas possible de conclure sur un lien de cause à effet : une personne qui prend beaucoup de paracétamol a souvent d’autres soucis de santé et prend d’autres médicaments, ce qui biaise l’interprétation de ces associations statistiques et ne permet pas de conclure à la responsabilité du paracétamol. De plus, peu d’études "de qualité" ont été réalisées sur ce sujet et il est possible que l’utilisation de paracétamol ait été mal estimée (automédication fréquente).
Cette analyse, largement répercutée dans les médias, ne permet donc pas de conclure formellement à de nouveaux risques directement liés à la prise chronique élevée de paracétamol.
Par contre, indépendamment de la causalité de ces risques, cette analyse est l'occasion de rappeler la nécessaire prudence, valable aussi pour d'autres médicaments, avec l'administration au long cours de paracétamol à dose élevée, en particulier en cas d'antécédents personnels gastriques, cardiaques ou rénaux.
En cas de douleur non soulagée par des mesures non médicamenteuses, le paracétamol est la molécule indiquée en première intention (illustration).
Un médicament utilisé dans le monde entier mais encore mal connu
Le paracétamol est l'antalgique le plus prescrit et utilisé en automédication au monde. Son utilisation est d'ailleurs recommandée en première intention contre la douleur aiguë ou chronique, que ce soit par l'OMS, les autorités sanitaires ou sociétés savantes françaises et internationales (cf. VIDAL Reco Douleur de l'adulte).
Par contre, son mécanisme d'action est encore mal connu, que ce soit au niveau du système nerveux central ou au niveau des tissus périphériques.
Plusieurs études récentes, rappellent Conaghan P et coll., suggèrent cependant que le paracétamol diminuerait la production de prostaglandines au niveau central et périphérique en agissant sur la cyclooxygénase 2 (COX-2).
Cette inhibition de la COX-2 pourrait expliquer la meilleure tolérance gastrique au long cours par rapport à celle des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), mais pourrait aussi augmenter le risque cardiovasculaire (Hinz et Brune, 2012).
Analyse du suivi de centaines de milliers de patients
Afin de tenter d'étayer d'éventuels surrisques avec une prise prolongée de paracétamol, Le Pr Philip Conaghan et ses collègues ont donc analysé les études publiées. Sur les 1 888 études retenues lors d'une première sélection, ils n'en n'ont retenu que 8, dans lesquelles les personnes majeures prenant du paracétamol à doses recommandées (prise de 500 mg à 1 g toutes les 4 à 6 heures sans dépasser 4 grammes par jour) ont été comparées (mortalité, survenue de maladies, suivi biologique, etc.) à des personnes ne prenant pas de paracétamol.
Il s'agit de 5 études de cohorte américaines (Chan et coll., 2006, Curhan et coll., 2002, Dedier et coll., 2002, Curhan et coll., 2004, Kurth et coll., 2003), d'une étude anglaise (De Vries et coll., 2010), d'une suédoise (Evans et coll., 2009) et d'une danoise (Lipworth et coll., 2003).
Ces études ont suivi, en tout, plus de 650 000 patients, sur des périodes allant de 2 à 20 ans.
Une augmentation de la mortalité dans les groupes "paracétamol", mais est-elle liée à ce médicament ?
Deux des 8 études analysées (Lipworth et coll., 2003 et De Vries et coll., 2010) ont étudié l'éventuel impact de la prise de paracétamol sur la mortalité toutes causes confondues. Ces deux études montrent une légère augmentation de la mortalité dans les groupes "paracétamol", augmentation plus sensible en cas d'usage prolongé à doses élevées.
Mais les preuves formelles de causalité manquent : une personne soufrant de multiples douleurs, régulièrement, prenant donc beaucoup de paracétamol, a plus de chances d'être malade qu'une personne sans douleurs, ce qui va influer sur le risque de mortalité toutes causes confondues. De plus, cette personne va prendre d'autres médicaments, y compris des AINS (prise concomitante non évaluée dans les 2 études citées), ce qui influe peut-être davantage sur la mortalité que le paracétamol.
Un surrisque cardiovasculaire retrouvé dans 4 études
Deux des études analysées (Chan et coll., 2006 et De Vries et coll., 2010) mentionnent une association dose-dépendante entre augmentation du risque cardiovasculaire (infarctus, AVC) et prise de paracétamol (comparativement aux personnes n'en prenant pas). Selon Chan et coll., la prise hebdomadaire de 15 comprimés ou plus est associée à une augmentation du risque cardiovasculaire (+ 68 %) comparable à celle retrouvée lors d'une prise chronique d'AINS. Deux autres études (Curhan et coll., 2002 et Dedier et coll., 2002) montrent que les patients prenant du paracétamol sont davantage hypertendus.
A chaque fois, le risque retrouvé est plus élevé lorsque la prise de paracétamol est fréquente et/ou à dose quotidienne élevée.
Comme pour le surrisque de mortalité, les biais d'interprétation de ces études sont multiples et la causalité du paracétamol n'est pas démontrée. Cependant, l'inhibition de la COX-2 découverte récemment (cf. supra) pourrait expliquer cet éventuel surrisque cardiovasculaire (inhibition prolongée de la production de prostaglandines, ce qui pourrait favoriser la vasoconstriction et la formation de caillots sanguins).
Un risque gastro-intestinal à confirmer et à quantifier
L'étude anglaise, qui a suivi 383 404 patients pendant 20 ans (De Vries et coll., 2010), a montré une association entre la prise chronique de paracétamol et l'augmentation du risque de survenue de problèmes gastro-intestinaux (ulcères, hémorragies).
Ce risque augmente en particulier en cas d'"usage répété à doses élevées" (+ 49 %), mais ne tient pas compte de l'éventuelle prise concomitante d'AINS, dont les risques gastriques sont bien connus.
Néanmoins, les auteurs précisent qu'une autre étude (Rahme et coll., 2008) a montré que la prise d'AINS et de paracétamol, chez des personnes âgées canadiennes, est associée à davantage d'hospitalisations pour effets indésirables gastriques que l'utilisation d'AINS seuls. De plus, la prise de médicaments protecteurs gastriques (inhibiteurs de la pompe à protons) conjointement à la prise de paracétamol est associée à une diminution de la survenue de tels incidents.
L'ensemble de ces données suggère donc que la prise chronique, à dose élevée, de paracétamol pourrait affecter la muqueuse oeso-gastrique, mais cette augmentation du risque n'est pas chiffrable : est-ce une augmentation minime d'un risque absolu déjà faible, ou y-a-t-il un vrai surrisque imposant de modifier les précautions d'emploi de ces médicaments ? D'autres études sont nécessaires pour conclure…
Un surrisque rénal dose-dépendant ?
Quatre études, sur les 8, ont analysé l'éventuel impact rénal de la prise prolongée de paracétamol.
L'une d'entre elles (Evans et coll., 2009) ne montre pas d'impact sur la progression d'une insuffisance rénale existante, ni sur le délai avant la mise en place d'une dialyse.
Une autre étude (Curhan et coll., 2004) montre une diminution plus rapide du débit de filtration glomérulaire dans le groupe "paracétamol", diminution plus sensible lorsque la dose cumulative de paracétamol est élevée.
L'étude de De Vries et coll. montre davantage d'insuffisances rénales aiguës dans le groupe "paracétamol".
Enfin l'étude de Kurth et coll. montre une association entre prise de paracétamol et augmentation des marqueurs biologiques de l'insuffisance rénale.
Ces surrisques, constatés à doses élevées et répétés, sont également à confirmer, les personnes prenant beaucoup de paracétamol pouvant être affecté par d'autres pathologies, prendre d'autrres traitements qui influent sur la fonction rénale.
Rappel : l'élimination du paracétamol se fait essentiellement par voie urinaire (90 % de la dose administrée est éliminée par le rein en 24 heures), ce qui peut exposer à des risques de surdosage en cas de défaillance rénale. Il est recommandé de ne pas dépasser 3 grammes par jour en cas d'insuffisance rénale sévère.
En conclusion, prudence avant éventuelle confirmation, ou infirmation, de la causalité
Ces surrisques constatés par Connaghan et coll. chez les personnes prenant beaucoup de paracétamol ne sont pas forcément liés à la prise chronique de ce médicament. De plus, ces surrisques sont modérés, et les risques eux-mêmes sont faibles. Enfin, au-delà des biais empêchant de conclure sur une causalité directe, le peu d'études de qualité rend difficile leur interprétation.
Cette étude ne doit donc pas empêcher le grand public d'utiliser, sur prescription ou non, le paracétamol, en cas de douleurs aiguës ou chroniques, aux doses recommandées, en évitant tout surdosage aigu ou dose cumulative massive, comme pour tout médicament d'ailleurs...
Cependant, l'aspect dose-dépendant systématique des surrisques retrouvés, en faveur d'une possible causalité, et l'éventuelle influence de facteurs de risque individuels (antécédents cardiovasculaires, rénaux, gastro-intestinaux, prise simultanée d'autres médicaments) devraient, selon les auteurs, inciter à la prudence, à la personnalisation du conseil… et à la réalisation de nouvelles études : "nous estimons que les risques de la prescription du paracétamol sont plus élevés qu'habituellement estimé par la communauté médicale. Au vu de son usage massif et de sa disponibilité en libre accès, une revue systématique de l'efficacité et de la tolérance du paracétamol en fonction des conditions individuelles est nécessaire".
En savoir plus :
L'étude objet de cet article :
Paracetamol: not as safe as we thought? A systematic literature review of observational studies, Conaghan PG, Roberts E et coll., Annals of the Rheumatic Diseases (BMJ), 2 mars 2015
Les 8 études "de bonne qualité méthodologique" retenues par les auteurs :
Autres études citées par les auteurs et mentionnées dans cet article :
Paracetamol and cyclooxygenase inhibition: is there a cause for concern?, Hinz B et Brune K, Annals of the Rheumatic Diseases, janvier 2012
Hospitalizations for upper and lower GI events associated with traditional NSAIDs and acetaminophen among the elderly in Quebec, Canada, Rahme E et coll., American Journal of Gastroenterology, avril 2008
Sources : BMJ
Par Jean-Philippe RIVIERE -
Le paracétamol est l’antalgique le plus utilisé au monde. Il est reconnu comme efficace et bien toléré, à la dose de 3-4 grammes par jour. En cas de surdosage, volontaire (tentative de suicide) ou non (facteurs de risques individuels), les risques sont connus et documentés (risque hépatique aigu).
Par contre, aucun risque n'est mentionné en cas d'utilisation chronique à dose maximale. Mais y aurait-il d'éventuels risques non encore détectés ?
Le Pr Philip Conaghan et ses collaborateurs ont tenté d’estimer ces éventuels risques en analysant plusieurs études publiées sur ce sujet. Lesur analyse montre une association statistique entre l’augmentation de la mortalité, la survenue de certains problèmes de santé (gastro-intestinaux, cardiovasculaires, rénaux) et la prise au long cours et/ou à doses quotidiennes élevées de paracétamol.
Cependant, il n'est pas possible de conclure sur un lien de cause à effet : une personne qui prend beaucoup de paracétamol a souvent d’autres soucis de santé et prend d’autres médicaments, ce qui biaise l’interprétation de ces associations statistiques et ne permet pas de conclure à la responsabilité du paracétamol. De plus, peu d’études "de qualité" ont été réalisées sur ce sujet et il est possible que l’utilisation de paracétamol ait été mal estimée (automédication fréquente).
Cette analyse, largement répercutée dans les médias, ne permet donc pas de conclure formellement à de nouveaux risques directement liés à la prise chronique élevée de paracétamol.
Par contre, indépendamment de la causalité de ces risques, cette analyse est l'occasion de rappeler la nécessaire prudence, valable aussi pour d'autres médicaments, avec l'administration au long cours de paracétamol à dose élevée, en particulier en cas d'antécédents personnels gastriques, cardiaques ou rénaux.
En cas de douleur non soulagée par des mesures non médicamenteuses, le paracétamol est la molécule indiquée en première intention (illustration).
Un médicament utilisé dans le monde entier mais encore mal connu
Le paracétamol est l'antalgique le plus prescrit et utilisé en automédication au monde. Son utilisation est d'ailleurs recommandée en première intention contre la douleur aiguë ou chronique, que ce soit par l'OMS, les autorités sanitaires ou sociétés savantes françaises et internationales (cf. VIDAL Reco Douleur de l'adulte).
Par contre, son mécanisme d'action est encore mal connu, que ce soit au niveau du système nerveux central ou au niveau des tissus périphériques.
Plusieurs études récentes, rappellent Conaghan P et coll., suggèrent cependant que le paracétamol diminuerait la production de prostaglandines au niveau central et périphérique en agissant sur la cyclooxygénase 2 (COX-2).
Cette inhibition de la COX-2 pourrait expliquer la meilleure tolérance gastrique au long cours par rapport à celle des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), mais pourrait aussi augmenter le risque cardiovasculaire (Hinz et Brune, 2012).
Analyse du suivi de centaines de milliers de patients
Afin de tenter d'étayer d'éventuels surrisques avec une prise prolongée de paracétamol, Le Pr Philip Conaghan et ses collègues ont donc analysé les études publiées. Sur les 1 888 études retenues lors d'une première sélection, ils n'en n'ont retenu que 8, dans lesquelles les personnes majeures prenant du paracétamol à doses recommandées (prise de 500 mg à 1 g toutes les 4 à 6 heures sans dépasser 4 grammes par jour) ont été comparées (mortalité, survenue de maladies, suivi biologique, etc.) à des personnes ne prenant pas de paracétamol.
Il s'agit de 5 études de cohorte américaines (Chan et coll., 2006, Curhan et coll., 2002, Dedier et coll., 2002, Curhan et coll., 2004, Kurth et coll., 2003), d'une étude anglaise (De Vries et coll., 2010), d'une suédoise (Evans et coll., 2009) et d'une danoise (Lipworth et coll., 2003).
Ces études ont suivi, en tout, plus de 650 000 patients, sur des périodes allant de 2 à 20 ans.
Une augmentation de la mortalité dans les groupes "paracétamol", mais est-elle liée à ce médicament ?
Deux des 8 études analysées (Lipworth et coll., 2003 et De Vries et coll., 2010) ont étudié l'éventuel impact de la prise de paracétamol sur la mortalité toutes causes confondues. Ces deux études montrent une légère augmentation de la mortalité dans les groupes "paracétamol", augmentation plus sensible en cas d'usage prolongé à doses élevées.
Mais les preuves formelles de causalité manquent : une personne soufrant de multiples douleurs, régulièrement, prenant donc beaucoup de paracétamol, a plus de chances d'être malade qu'une personne sans douleurs, ce qui va influer sur le risque de mortalité toutes causes confondues. De plus, cette personne va prendre d'autres médicaments, y compris des AINS (prise concomitante non évaluée dans les 2 études citées), ce qui influe peut-être davantage sur la mortalité que le paracétamol.
Un surrisque cardiovasculaire retrouvé dans 4 études
Deux des études analysées (Chan et coll., 2006 et De Vries et coll., 2010) mentionnent une association dose-dépendante entre augmentation du risque cardiovasculaire (infarctus, AVC) et prise de paracétamol (comparativement aux personnes n'en prenant pas). Selon Chan et coll., la prise hebdomadaire de 15 comprimés ou plus est associée à une augmentation du risque cardiovasculaire (+ 68 %) comparable à celle retrouvée lors d'une prise chronique d'AINS. Deux autres études (Curhan et coll., 2002 et Dedier et coll., 2002) montrent que les patients prenant du paracétamol sont davantage hypertendus.
A chaque fois, le risque retrouvé est plus élevé lorsque la prise de paracétamol est fréquente et/ou à dose quotidienne élevée.
Comme pour le surrisque de mortalité, les biais d'interprétation de ces études sont multiples et la causalité du paracétamol n'est pas démontrée. Cependant, l'inhibition de la COX-2 découverte récemment (cf. supra) pourrait expliquer cet éventuel surrisque cardiovasculaire (inhibition prolongée de la production de prostaglandines, ce qui pourrait favoriser la vasoconstriction et la formation de caillots sanguins).
Un risque gastro-intestinal à confirmer et à quantifier
L'étude anglaise, qui a suivi 383 404 patients pendant 20 ans (De Vries et coll., 2010), a montré une association entre la prise chronique de paracétamol et l'augmentation du risque de survenue de problèmes gastro-intestinaux (ulcères, hémorragies).
Ce risque augmente en particulier en cas d'"usage répété à doses élevées" (+ 49 %), mais ne tient pas compte de l'éventuelle prise concomitante d'AINS, dont les risques gastriques sont bien connus.
Néanmoins, les auteurs précisent qu'une autre étude (Rahme et coll., 2008) a montré que la prise d'AINS et de paracétamol, chez des personnes âgées canadiennes, est associée à davantage d'hospitalisations pour effets indésirables gastriques que l'utilisation d'AINS seuls. De plus, la prise de médicaments protecteurs gastriques (inhibiteurs de la pompe à protons) conjointement à la prise de paracétamol est associée à une diminution de la survenue de tels incidents.
L'ensemble de ces données suggère donc que la prise chronique, à dose élevée, de paracétamol pourrait affecter la muqueuse oeso-gastrique, mais cette augmentation du risque n'est pas chiffrable : est-ce une augmentation minime d'un risque absolu déjà faible, ou y-a-t-il un vrai surrisque imposant de modifier les précautions d'emploi de ces médicaments ? D'autres études sont nécessaires pour conclure…
Un surrisque rénal dose-dépendant ?
Quatre études, sur les 8, ont analysé l'éventuel impact rénal de la prise prolongée de paracétamol.
L'une d'entre elles (Evans et coll., 2009) ne montre pas d'impact sur la progression d'une insuffisance rénale existante, ni sur le délai avant la mise en place d'une dialyse.
Une autre étude (Curhan et coll., 2004) montre une diminution plus rapide du débit de filtration glomérulaire dans le groupe "paracétamol", diminution plus sensible lorsque la dose cumulative de paracétamol est élevée.
L'étude de De Vries et coll. montre davantage d'insuffisances rénales aiguës dans le groupe "paracétamol".
Enfin l'étude de Kurth et coll. montre une association entre prise de paracétamol et augmentation des marqueurs biologiques de l'insuffisance rénale.
Ces surrisques, constatés à doses élevées et répétés, sont également à confirmer, les personnes prenant beaucoup de paracétamol pouvant être affecté par d'autres pathologies, prendre d'autrres traitements qui influent sur la fonction rénale.
Rappel : l'élimination du paracétamol se fait essentiellement par voie urinaire (90 % de la dose administrée est éliminée par le rein en 24 heures), ce qui peut exposer à des risques de surdosage en cas de défaillance rénale. Il est recommandé de ne pas dépasser 3 grammes par jour en cas d'insuffisance rénale sévère.
En conclusion, prudence avant éventuelle confirmation, ou infirmation, de la causalité
Ces surrisques constatés par Connaghan et coll. chez les personnes prenant beaucoup de paracétamol ne sont pas forcément liés à la prise chronique de ce médicament. De plus, ces surrisques sont modérés, et les risques eux-mêmes sont faibles. Enfin, au-delà des biais empêchant de conclure sur une causalité directe, le peu d'études de qualité rend difficile leur interprétation.
Cette étude ne doit donc pas empêcher le grand public d'utiliser, sur prescription ou non, le paracétamol, en cas de douleurs aiguës ou chroniques, aux doses recommandées, en évitant tout surdosage aigu ou dose cumulative massive, comme pour tout médicament d'ailleurs...
Cependant, l'aspect dose-dépendant systématique des surrisques retrouvés, en faveur d'une possible causalité, et l'éventuelle influence de facteurs de risque individuels (antécédents cardiovasculaires, rénaux, gastro-intestinaux, prise simultanée d'autres médicaments) devraient, selon les auteurs, inciter à la prudence, à la personnalisation du conseil… et à la réalisation de nouvelles études : "nous estimons que les risques de la prescription du paracétamol sont plus élevés qu'habituellement estimé par la communauté médicale. Au vu de son usage massif et de sa disponibilité en libre accès, une revue systématique de l'efficacité et de la tolérance du paracétamol en fonction des conditions individuelles est nécessaire".
En savoir plus :
L'étude objet de cet article :
Paracetamol: not as safe as we thought? A systematic literature review of observational studies, Conaghan PG, Roberts E et coll., Annals of the Rheumatic Diseases (BMJ), 2 mars 2015
Les 8 études "de bonne qualité méthodologique" retenues par les auteurs :
- Concomitant use of ibuprofen and paracetamol and the risk of major clinical safety outcomes, De Vries F et coll., British Journal of Clinical Pharmacology, mai 2010
A population-based cohort study of mortality among adults prescribed paracetamol in Denmark, Lipworth L et coll., Journal of Clinical Epidemiology, août 2003
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, acetaminophen, and the risk of cardiovascular events, Chan AT et coll., Circulation 2006
Frequency of analgesic use and risk of hypertension in younger women, Curhan GC et coll., Archives of Internal Medicine, octobre 2002
Nonnarcotic analgesic use and the risk of hypertension in US women, Dedier J et coll., Hypertension, septembre 2002
Acetaminophen, aspirin and progression of advanced chronic kidney disease, Evans M et coll., Nephrology Dialysis Transplantation, janvier 2009
Lifetime nonnarcotic analgesic use and decline in renal function in women, Curhan GC et coll., Archives of Internal Medicine, juillet 2004
Analgesic use and change in kidney function in apparently healthy men, Kurth T et coll., American Journal of Kidney Diseases, août 2003
Autres études citées par les auteurs et mentionnées dans cet article :
Paracetamol and cyclooxygenase inhibition: is there a cause for concern?, Hinz B et Brune K, Annals of the Rheumatic Diseases, janvier 2012
Hospitalizations for upper and lower GI events associated with traditional NSAIDs and acetaminophen among the elderly in Quebec, Canada, Rahme E et coll., American Journal of Gastroenterology, avril 2008
Sources : BMJ
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2507
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
20 mars : attention les yeux !
Le soleil a rendez-vous avec la lune le 20 mars. Plus précisément, cette dernière va passer entre le soleil et la terre. Les passionnés se rendront en Islande (îles Féroé) ou en Norvège (Svalbard), voire au pôle nord où l’éclipse sera totale. En France elle sera partielle mais on pourra l’admirer de 9h à 12h, mieux dans le nord sur l’axe Brest-Lille (80 %) et à Paris (78 %) que dans le sud (58 % à Ajaccio), avec une observation optimale vers 10h30.
Observer une éclipse solaire est aussi dangereux que regarder directement le soleil sans protection et peut endommager la rétine au niveau de la macula : la DGS s’en inquiète et a souhaité par une note récente que les messages de prévention soient relayés au mieux en amont.
Les complications oculaires liées à l’observation de l’éclipse du 11 août 1999 ont été analysées par l’Institut de veille sanitaire (InVS) : parmi 1024 consultations notifiées, 147 patients présentaient une atteinte rétinienne et 106 une atteinte cornéenne. Pour 17 cas l’atteinte était sévère (acuité visuelle < 2/10ème), bilatérale pour 7 d’entre eux. Cent patients avaient observé l’éclipse à l’œil nu, 74 avaient ôté leurs lunettes, 32 avaient utilisé des moyens inappropriés et 4 patients, présentant une atteinte de la rétine, ont dit avoir utilisé correctement les lunettes spéciales durant toute la phase d’observation de l’éclipse.
Intermittence du spectacle
Le message est donc non seulement de se munir de lunettes spéciales complètement opaques estampillées CE, sans réutiliser d’ancienne lunettes (selon l’association Rétina France, la seule protection absolue et d'utilisation illimitée, recommandée par le Secrétariat d'Etat à la Santé et par l'Académie Nationale de Médecine, est le verre de soudeur grade 14 sur support anti-choc, produit dénommé "Viséclipse Sol Obs 14") mais aussi d’observer l’éclipse de façon intermittente (quelques minutes avec des poses entre chaque observation). Prudence surtout pour les enfants, plus tentés de regarder l’éclipse et pour qui les dommages sont potentiellement plus graves. Ces lunettes devraient être disponibles en pharmacie, chez les opticiens, voire en grande surface.
Si l’on n’a pas de lunette ou que l’on veut admirer l’éclipse en direct et sans interruption, parmi les moyens sûrs on trouvera la télévision, les planétarium et les instituts d’astronomie, ou encore la « caméra à trous d’épingle » qui plaira aux enfants : un trou d’épingle au fond d’une boîte en carton, un « écran » (feuille de papier blanc située à bonne distance selon la taille du trou) ; le soleil brillera par le trou d’épingle et une image (inversée) de l’éclipse sera projetée sur l’écran. Avec cette technique l’observateur ne risque rien puisqu’il est dos au soleil.
A ce jour on trouve très peu de relais de ces messages préventifs, même dans le monde médical… Quant aux médias elles préfèrent parler du redouté black out : en Europe les zones à forte production photovoltaïque comme l’Allemagne risquent d’être en difficulté. En France le photovoltaïque représente 1,1% de la production nationale d’électricité…
Dr Blandine Esquerre
Le soleil a rendez-vous avec la lune le 20 mars. Plus précisément, cette dernière va passer entre le soleil et la terre. Les passionnés se rendront en Islande (îles Féroé) ou en Norvège (Svalbard), voire au pôle nord où l’éclipse sera totale. En France elle sera partielle mais on pourra l’admirer de 9h à 12h, mieux dans le nord sur l’axe Brest-Lille (80 %) et à Paris (78 %) que dans le sud (58 % à Ajaccio), avec une observation optimale vers 10h30.
Observer une éclipse solaire est aussi dangereux que regarder directement le soleil sans protection et peut endommager la rétine au niveau de la macula : la DGS s’en inquiète et a souhaité par une note récente que les messages de prévention soient relayés au mieux en amont.
Les complications oculaires liées à l’observation de l’éclipse du 11 août 1999 ont été analysées par l’Institut de veille sanitaire (InVS) : parmi 1024 consultations notifiées, 147 patients présentaient une atteinte rétinienne et 106 une atteinte cornéenne. Pour 17 cas l’atteinte était sévère (acuité visuelle < 2/10ème), bilatérale pour 7 d’entre eux. Cent patients avaient observé l’éclipse à l’œil nu, 74 avaient ôté leurs lunettes, 32 avaient utilisé des moyens inappropriés et 4 patients, présentant une atteinte de la rétine, ont dit avoir utilisé correctement les lunettes spéciales durant toute la phase d’observation de l’éclipse.
Intermittence du spectacle
Le message est donc non seulement de se munir de lunettes spéciales complètement opaques estampillées CE, sans réutiliser d’ancienne lunettes (selon l’association Rétina France, la seule protection absolue et d'utilisation illimitée, recommandée par le Secrétariat d'Etat à la Santé et par l'Académie Nationale de Médecine, est le verre de soudeur grade 14 sur support anti-choc, produit dénommé "Viséclipse Sol Obs 14") mais aussi d’observer l’éclipse de façon intermittente (quelques minutes avec des poses entre chaque observation). Prudence surtout pour les enfants, plus tentés de regarder l’éclipse et pour qui les dommages sont potentiellement plus graves. Ces lunettes devraient être disponibles en pharmacie, chez les opticiens, voire en grande surface.
Si l’on n’a pas de lunette ou que l’on veut admirer l’éclipse en direct et sans interruption, parmi les moyens sûrs on trouvera la télévision, les planétarium et les instituts d’astronomie, ou encore la « caméra à trous d’épingle » qui plaira aux enfants : un trou d’épingle au fond d’une boîte en carton, un « écran » (feuille de papier blanc située à bonne distance selon la taille du trou) ; le soleil brillera par le trou d’épingle et une image (inversée) de l’éclipse sera projetée sur l’écran. Avec cette technique l’observateur ne risque rien puisqu’il est dos au soleil.
A ce jour on trouve très peu de relais de ces messages préventifs, même dans le monde médical… Quant aux médias elles préfèrent parler du redouté black out : en Europe les zones à forte production photovoltaïque comme l’Allemagne risquent d’être en difficulté. En France le photovoltaïque représente 1,1% de la production nationale d’électricité…
Dr Blandine Esquerre
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2507
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
La logique comptable fait son lit à l’hôpital
ENQUÊTE«Libération» a eu accès à un texte confidentiel qui prévoit des économies drastiques, des coupes dans les effectifs, et accroît la centralisation.
C’est un document à usage confidentiel. Il répond au nom de «Kit de déploiement régional du plan Ondam à destination des ARS». C’est un plan opérationnel sur trois ans, distribué le mois dernier aux directeurs des agences régionales de santé (ARS), avec mention explicite : «diffusion restreinte». La semaine dernière, le magazine Challenges avait fait état d’une version de ce document qui aurait été débattu avec la ministre de la Santé, Marisol Touraine. En tout cas, voilà un plan global décliné en 69 pages, comportant une succession de tableaux et d’indicateurs de performance, avec un seul objectif : 10 milliards d’économie à l’horizon 2017. Et, dans ce lot, la part des restrictions pour l’hôpital tourne autour de 3 milliards d’euros.
L’HÔPITAL DEVRA SE SERRER LA CEINTURE ET RÉDUIRE SES EFFECTIFS
Un bouleversement à venir ? Assurément. Et nul ne conteste la nécessité d’une forte évolution du paysage hospitalier. En France, il y a en effet beaucoup d’hôpitaux, voire trop, et ils coûtent cher. L’hôpital représente 45% des dépenses de santé. Avec près de 3 000 établissements, la France est un pays largement doté, avec 6 lits pour 1 000 habitants, le double de la Suède ou de la Grande-Bretagne. Ces hôpitaux sont en outre souvent mal localisés : trop pour les soins de courte durée, pas assez pour les handicapés et les personnes âgées. Et ils sont trop nombreux dans les grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille.
Mais voilà, est-ce que ce «kit» du ministère de la Santé pour mener à bien cette révolution est la bonne façon de procéder ? «Des économies ? C’est possible», réagit Gérard Vincent, délégué général de la Fédération hospitalière de France. Mais ce responsable, qui rassemble la totalité des hôpitaux de France élève aussitôt le ton : «On a le sentiment d’un double langage. La ministre nous avait promis que ce serait à chaque région, à chaque établissement de s’adapter. Et, là, on voit la technostructure du ministère qui prend le pouvoir.» Et d’enfoncer le clou : «Avec ce plan, on assiste à l’étatisation rampante du système hospitalier. Où est la ministre ?»
Pour agir sur la masse budgétaire des hôpitaux, les pouvoirs publics ont un levier fort : l’Ondam hospitalier (objectif national de dépenses de l’assurance maladie), qui fixe d’une année à l’autre l’augmentation des budgets des hôpitaux. Si rien n’est fait, le budget des hôpitaux augmente automatiquement de 2,9%, et cela en particulier avec les hausses automatiques de salaires. Là, l’objectif est clair : en 2015, l’Ondam sera de 2,1% en 2015, de 2% en 2016 et de 1,9% en 2017.
En conséquence, les budgets des hôpitaux vont baisser fortement de plusieurs centaines de millions d’euros. «Si les hôpitaux ne veulent pas augmenter leur déficit, ils doivent faire des économies. Et le premier poste, ce sont les salaires, la masse salariale représentant 65% des charges des établissements de santé, donc de l’emploi», explique sans faux-fuyant un ancien directeur des hôpitaux. Et on arrive à la question sensible de l’emploi. Le chiffre de 22 000 postes supprimés a été évoqué pour les trois années à venir dans les hôpitaux. Mais, voilà, le gouvernement ne veut pas assumer. Mercredi, la ministre de la Santé a assuré à l’Assemblée nationale que son plan de 3 milliards d’euros d’économies pour les hôpitaux d’ici à 2017 n’avait pas vocation à «baisser les effectifs hospitaliers».
Est-ce bien sûr ? Quand on regarde le détail du «kit», c’est pourtant clair : il est prévu 860 millions d’économies sur la masse salariale pour 2015-2017. Afin d’y arriver, il est proposé tout un ensemble d’indicateurs et de pistes, comme : «la mise à plat des protocoles ARTT, le réexamen des avantages extra statutaires ou non conventionnels, l’optimisation des dépenses de personnel médical, la réduction des coûts liés à l’intérim médical». Les bonnes pratiques sont détaillées : «mettre en place des maquettes organisationnelles par unités en fonction de leur taille et procéder à une harmonisation au sein de l’établissement». Si cela ne veut pas dire… diminuer les effectifs !
L’AVENIR, C’EST L’AMBULATOIRE
Autre axe central de ces économies, la montée en puissance de l’ambulatoire. C’est devenu un refrain ; les hôpitaux de demain ne doivent plus être des lieux de séjour, le patient ne faisant plus que passer. Aujourd’hui, indéniablement l’hôpital public est en retard par rapport au privé dans cette évolution, bien des interventions chirurgicales ne nécessitant pas d’hospitalisations.
Mais la mise en musique de la montée en puissance de l’ambulatoire dans ce plan est purement statistique, sans la moindre référence au coût, ni à l’intérêt en termes de santé publique. Des études indiquent, par exemple, que l’ambulatoire peut engendrer des inégalités d’accès aux soins. Qu’importe, un seul objectif est affiché : économiser un milliard en 3 ans. Et des chiffres : «52,1% en 2015, 54,2% en 2016, 57% en 2017».
8 BLOCS ET 23 ACTIONS
Le plan se décline en 8 blocs, avec 23 actions. Certaines sont pleinement justifiées, comme celui concernant la pertinence des actes médicaux. Pourquoi certaines régions font deux fois de plus de césariennes que d’autres ? Et pourquoi il y a-t-il aussi des variations en chirurgie cardiaque ? «La réduction du nombre d’actes non pertinents est un enjeu fort», souligne le document.
Objectif : 140 millions d’euros, dont 50 millions sur les actes hospitaliers. Mais, là, il ne figure aucun conseil pertinent pour y arriver.
Une action forte est prévue, ensuite, sur les médicaments, avec la montée en puissance des génériques et, surtout, «une maîtrise médicalisée de médicaments de spécialités» : ces derniers sont en effet des médicaments extrêmement chers - comme on l’a vu encore récemment avec celui contre le virus de l’hépatite C (45 000 euros, le traitement sur un mois). Comment limiter les prescriptions sans ouvrir la voie à une médecine à plusieurs vitesses ? Pas de réponse. Là encore, juste un objectif économique à atteindre.
Autres économies : des actions sur le transport sanitaire. Et enfin ce qu’ils appellent les GHT, les groupes hospitaliers de territoire, qui visent à regrouper sur un même territoire des hôpitaux. Objectif : 400 millions d’euros d’économies.
D’aucuns voient dans le «kit» un plan désespérément technocratique, sans le moindre volet sanitaire. «Mais c’est un peu la loi du genre. Le problème est que ce sujet soit porté de façon cohérente», tempère un ancien ministre. Et de prendre un exemple récent : «Un jour, pour cause d’épidémie de grippe, le ministère va affirmer qu’il n’y aura pas de fermeture de lits. Et, en même temps, il fait paraître ces instructions. Comment voulez-vous mobiliser de cette façon-là ?»
Éric Favereau
Libération
ENQUÊTE«Libération» a eu accès à un texte confidentiel qui prévoit des économies drastiques, des coupes dans les effectifs, et accroît la centralisation.
C’est un document à usage confidentiel. Il répond au nom de «Kit de déploiement régional du plan Ondam à destination des ARS». C’est un plan opérationnel sur trois ans, distribué le mois dernier aux directeurs des agences régionales de santé (ARS), avec mention explicite : «diffusion restreinte». La semaine dernière, le magazine Challenges avait fait état d’une version de ce document qui aurait été débattu avec la ministre de la Santé, Marisol Touraine. En tout cas, voilà un plan global décliné en 69 pages, comportant une succession de tableaux et d’indicateurs de performance, avec un seul objectif : 10 milliards d’économie à l’horizon 2017. Et, dans ce lot, la part des restrictions pour l’hôpital tourne autour de 3 milliards d’euros.
L’HÔPITAL DEVRA SE SERRER LA CEINTURE ET RÉDUIRE SES EFFECTIFS
Un bouleversement à venir ? Assurément. Et nul ne conteste la nécessité d’une forte évolution du paysage hospitalier. En France, il y a en effet beaucoup d’hôpitaux, voire trop, et ils coûtent cher. L’hôpital représente 45% des dépenses de santé. Avec près de 3 000 établissements, la France est un pays largement doté, avec 6 lits pour 1 000 habitants, le double de la Suède ou de la Grande-Bretagne. Ces hôpitaux sont en outre souvent mal localisés : trop pour les soins de courte durée, pas assez pour les handicapés et les personnes âgées. Et ils sont trop nombreux dans les grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille.
Mais voilà, est-ce que ce «kit» du ministère de la Santé pour mener à bien cette révolution est la bonne façon de procéder ? «Des économies ? C’est possible», réagit Gérard Vincent, délégué général de la Fédération hospitalière de France. Mais ce responsable, qui rassemble la totalité des hôpitaux de France élève aussitôt le ton : «On a le sentiment d’un double langage. La ministre nous avait promis que ce serait à chaque région, à chaque établissement de s’adapter. Et, là, on voit la technostructure du ministère qui prend le pouvoir.» Et d’enfoncer le clou : «Avec ce plan, on assiste à l’étatisation rampante du système hospitalier. Où est la ministre ?»
Pour agir sur la masse budgétaire des hôpitaux, les pouvoirs publics ont un levier fort : l’Ondam hospitalier (objectif national de dépenses de l’assurance maladie), qui fixe d’une année à l’autre l’augmentation des budgets des hôpitaux. Si rien n’est fait, le budget des hôpitaux augmente automatiquement de 2,9%, et cela en particulier avec les hausses automatiques de salaires. Là, l’objectif est clair : en 2015, l’Ondam sera de 2,1% en 2015, de 2% en 2016 et de 1,9% en 2017.
En conséquence, les budgets des hôpitaux vont baisser fortement de plusieurs centaines de millions d’euros. «Si les hôpitaux ne veulent pas augmenter leur déficit, ils doivent faire des économies. Et le premier poste, ce sont les salaires, la masse salariale représentant 65% des charges des établissements de santé, donc de l’emploi», explique sans faux-fuyant un ancien directeur des hôpitaux. Et on arrive à la question sensible de l’emploi. Le chiffre de 22 000 postes supprimés a été évoqué pour les trois années à venir dans les hôpitaux. Mais, voilà, le gouvernement ne veut pas assumer. Mercredi, la ministre de la Santé a assuré à l’Assemblée nationale que son plan de 3 milliards d’euros d’économies pour les hôpitaux d’ici à 2017 n’avait pas vocation à «baisser les effectifs hospitaliers».
Est-ce bien sûr ? Quand on regarde le détail du «kit», c’est pourtant clair : il est prévu 860 millions d’économies sur la masse salariale pour 2015-2017. Afin d’y arriver, il est proposé tout un ensemble d’indicateurs et de pistes, comme : «la mise à plat des protocoles ARTT, le réexamen des avantages extra statutaires ou non conventionnels, l’optimisation des dépenses de personnel médical, la réduction des coûts liés à l’intérim médical». Les bonnes pratiques sont détaillées : «mettre en place des maquettes organisationnelles par unités en fonction de leur taille et procéder à une harmonisation au sein de l’établissement». Si cela ne veut pas dire… diminuer les effectifs !
L’AVENIR, C’EST L’AMBULATOIRE
Autre axe central de ces économies, la montée en puissance de l’ambulatoire. C’est devenu un refrain ; les hôpitaux de demain ne doivent plus être des lieux de séjour, le patient ne faisant plus que passer. Aujourd’hui, indéniablement l’hôpital public est en retard par rapport au privé dans cette évolution, bien des interventions chirurgicales ne nécessitant pas d’hospitalisations.
Mais la mise en musique de la montée en puissance de l’ambulatoire dans ce plan est purement statistique, sans la moindre référence au coût, ni à l’intérêt en termes de santé publique. Des études indiquent, par exemple, que l’ambulatoire peut engendrer des inégalités d’accès aux soins. Qu’importe, un seul objectif est affiché : économiser un milliard en 3 ans. Et des chiffres : «52,1% en 2015, 54,2% en 2016, 57% en 2017».
8 BLOCS ET 23 ACTIONS
Le plan se décline en 8 blocs, avec 23 actions. Certaines sont pleinement justifiées, comme celui concernant la pertinence des actes médicaux. Pourquoi certaines régions font deux fois de plus de césariennes que d’autres ? Et pourquoi il y a-t-il aussi des variations en chirurgie cardiaque ? «La réduction du nombre d’actes non pertinents est un enjeu fort», souligne le document.
Objectif : 140 millions d’euros, dont 50 millions sur les actes hospitaliers. Mais, là, il ne figure aucun conseil pertinent pour y arriver.
Une action forte est prévue, ensuite, sur les médicaments, avec la montée en puissance des génériques et, surtout, «une maîtrise médicalisée de médicaments de spécialités» : ces derniers sont en effet des médicaments extrêmement chers - comme on l’a vu encore récemment avec celui contre le virus de l’hépatite C (45 000 euros, le traitement sur un mois). Comment limiter les prescriptions sans ouvrir la voie à une médecine à plusieurs vitesses ? Pas de réponse. Là encore, juste un objectif économique à atteindre.
Autres économies : des actions sur le transport sanitaire. Et enfin ce qu’ils appellent les GHT, les groupes hospitaliers de territoire, qui visent à regrouper sur un même territoire des hôpitaux. Objectif : 400 millions d’euros d’économies.
D’aucuns voient dans le «kit» un plan désespérément technocratique, sans le moindre volet sanitaire. «Mais c’est un peu la loi du genre. Le problème est que ce sujet soit porté de façon cohérente», tempère un ancien ministre. Et de prendre un exemple récent : «Un jour, pour cause d’épidémie de grippe, le ministère va affirmer qu’il n’y aura pas de fermeture de lits. Et, en même temps, il fait paraître ces instructions. Comment voulez-vous mobiliser de cette façon-là ?»
Éric Favereau
Libération
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2507
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Pas de calmant avant une anesthésie générale
Sylvie Riou-Milliot (source SCIENCES ET AVENIR)
Une étude française montre que la prise d’anxiolytique avant une opération ne réduit pas la douleur. Elle risque même de retarder le réveil.
Cette étude devrait faire évoluer les pratiques des anesthésistes et inciter les patients à ne pas réclamer ce type de sédation.
Non, l’administration d’un sédatif avant une anesthésie pour calmer le stress n’est pas une bonne chose. Pis, cette pratique — courante dans les établissements de soins — rallonge le temps d’hospitalisation et risque de compliquer le réveil. C’est du moins la conclusion d’une étude menée dans différents hôpitaux français (Marseille, Montpellier, Nîmes, Nice) sur un millier de patients avant une intervention chirurgicale.
Limiter la consommation de benzodiazépines
Ce travail, publié dans la revue Jama, a été réalisé sur un ensemble de patients divisée en trois groupes : ceux qui ont reçu 2,5 mg de lorazépam (Témesta), ceux qui ont eu droit — sans le savoir — à un placebo et enfin ceux qui n’ont reçu que les anesthésiants préopératoires nécessaires. Résultat : aucune différence dans les trois groupes en termes de sensation de douleur liée à l’intervention ! En revanche, chez les patients ayant reçu du lorazépam, le délai entre la fin de l’anesthésie et l’extubation (le moment ou l’anesthésiste retire le tube introduit dans la trachée) était allongé de 5 minutes.
Et ce groupe était aussi le plus lent à récupérer ses fonctions cognitives : 40 minutes après l’opération, ils n’étaient que 51 % à avoir retrouvé toutes leurs aptitudes contre 64 % dans le troisième groupe (aucun sédatif) et 71 % dans le second groupe (placebo) ! Toutefois les auteurs suggèrent que la veille de l’intervention, une prise en charge peut toujours être envisagée pour les plus anxieux.
RECOMMANDATIONS. Cette étude va dans le sens des recommandations officielles visant à limiter la consommation de benzodiazépines, des médicaments loin d’être anodins puisqu’ils entraînent un risque de dépendance et pourraient être à l’origine de maladies neurodégénératives telle Alzheimer comme Sciences et Avenir a été le premier à le révéler (n° 775, octobre 2011). Elle devrait aussi faire évoluer les pratiques des anesthésistes et inciter les patients à ne pas réclamer ce type de sédation.
----
Anesthésie locale : on pourrait réduire le stress des patients
Diane Mottez
Subir une anesthésie locale et rester conscient pendant une intervention est souvent source d’anxiété. On se retrouve dans un univers inconnu, on entend des propos médicaux souvent incompréhensibles, quand ce ne sont pas des bruits d’outils et de machines pour le moins stressant… Or, on sait que le niveau d’anxiété d’un patient a un impact sur sa douleur post opératoire. L’équipe du Dr Briony Hudson, de la School of Psychology de l’université de Surrey en Grande Bretagne, s’est donc intéressée au sujet. Principaux résultats de son étude parue dans l’European Journal of Pain : pouvoir discuter avec un infirmier pendant l’opération, avoir à disposition des balles anti stress ou regarder un DVD réduirait l’anxiété. La musique, elle, contre toute attente, n’a pas calmé les patients ni réduit la douleur post-opératoire.
Pour arriver à ces résultats, les chercheurs ont divisé en cinq groupes 398 patients opérés pour des varices. Le premier groupe écoutait de la musique pendant l’intervention, le 2è regardait un DVD de son choix, le 3è utilisait des balles anti stress, les patients du 4è groupe pouvaient discuter librement avec un infirmier qui restait à côté d’eux, et ceux du dernier groupe étaient les témoins, ils n’avaient donc aucun support durant l’intervention. A l’issue de l’opération, ils ont rempli un questionnaire.
Les patients des groupes 3 (balles anti stress) et 4 (avec un infirmier) ont indiqué une réduction significative de leur anxiété et des douleurs ressenties. Les patients du groupe 2 (DVD) ont également été moins anxieux, mais sans impact sur leur douleur. Quand aux patients ayant écouté de la musique, aucun impact positif n’a été constaté, ni sur l’anxiété, ni sur la douleur.
Distraire un patient de façon simple et parfois peu coûteuse (dans le cas des balles anti stress) pourrait donc avoir un effet positif durant l’intervention : moins de stress et moins de douleurs. Un exemple à suivre ?
NB : au cas où le lien devienne mort...
How the best anaesthetic is a nurse's soothing chat: Conversation found to be better at easing pain then listening to music or watching a film
Growing number of operations are done with local anaesthetic to cut costs
This numbs the pain in the area being operated but patients are still awake
Researchers say calming conversation is 'simple and inexpensive' solution
Patients given various 'distractions' during varicose vein surgery as a test
Showed talking to nurse cut anxiety by 30 per cent and pain by 16 per cent
By Fiona Macrae, Science Correspondent for the Daily Mail
Forget iPods and DVDs, the key to relaxing during surgery could be as simple as a chatty, caring nurse.
A study found conversation and touch to be better at easing the stress and pain of an operation than listening to music or watching a film.
The University of Surrey researchers said that having a nurse chat to a patient while holding their hand could be a 'simple and inexpensive' way of making operations done without a general anaesthetic more pleasant.
A drive to cut costs and save time means that growing numbers of operations are done with a local anaesthetic.
Soothing: A study found conversation and touch to be better at easing the stress and pain of an operation than listening to music or watching a film
Soothing: A study found conversation and touch to be better at easing the stress and pain of an operation than listening to music or watching a film (file photo)
This numbs the pain in the area being cut open but the patient is still wide awake and may become more and more anxious as they hear the surgeons discuss their operation.
Many also fear the injection of local anaesthetic, which can be painful.
Fear and anxiety can lead to some patients putting off their op until their condition gets markedly worse.
In other cases, high levels of worry during surgery can delay recovery.
Various tests, including photographic examination of the womb and bowel are also done while the patient is wide awake.
PhD student Briony Hudson studied more than 400 men and women who were having varicose vein surgery.
The patients were divided into five groups. The first listened to music during their operation, the second watched a film and a third squeezed small 'stress' balls with their hands when they felt uncomfortable.
The fourth group chatted to a nurse, while the final group had no distractions.
Immediately after the operation, they were quizzed on how anxious they had felt and how much pain they had been in.
The DVD, stress balls and chatting to a nurse all eased anxiety. But only the stress balls and conversation reduced pain.
Simple and effective: Talking to a nurse cut anxiety by 30 per cent, compared to having no distractions, and reduced pain by 16 per cent
Simple and effective: Talking to a nurse cut anxiety by 30 per cent, compared to having no distractions, and reduced pain by 16 per cent (file photo)
Talking to a nurse cut anxiety by 30 per cent, compared to having no distractions, and reduced pain by 16 per cent.
Using the stress balls eased anxiety by 18 per cent and cut pain by 22 per cent, the European Journal of Pain reports.
Surprisingly, listening to music didn't help at all.
The researchers aren't sure why this was but it may be because the patients chose music that they knew well and so it didn't provide the necessary level of distraction.
Researcher Jane Ogden said that the results suggest that conversation and touch are particularly effective.
During the study, which is reported in the European Journal of Pain, the nurses were instructed to talk to the patients but not touch them.
However, having a nurse hold the patient's hand while chatting may be even more calming than conversation alone.
Professor Ogden said: 'I was most pleased by the impact of interaction with nurses because it is such a straight forward thing to do.
'If someone asks you what you are going to do at the weekend and where you are going to go on holiday, that is a very effective way of managing pain.'
----
A quels seins se vouer ?
Risque de lymphome et implant mammaire : le retrait n’est pas recommandé… pour l’instant !
Paris, le mardi 17 mars 2015 – L’augmentation du risque de lymphome anaplasique à grandes cellules (LAGC) chez les porteuses d’implants mammaires est étudiée depuis au moins 2011 par les autorités sanitaires de nombreux pays, et notamment par la Food and Drug Administration (FDA). Pour cette dernière, l’existence d’un risque faible ne fait d’ailleurs plus de doute depuis plusieurs années. Ainsi, dans un document intitulé "Cinq choses que les femmes devraient savoir à propos des implants mammaires" réactualisé pour la dernière fois en 2013, l’institution américaine indique clairement au chapitre des "risques" : « La FDA a identifié une association possible entre les implants mammaires et le développement de LAGC ».
Lymphome survenant entre 11 et 15 ans après la pose d’un implant le plus souvent macro-texturé
L’existence de ce risque fait également l’objet d’investigations en France. Ainsi, après le signalement d’un cas de LAGC chez une femme portant un implant mammaire (fabriqué avec le fameux gel PIP), la vigilance des autorités a été renforcée sur ce point. L’identification de plusieurs autres cas a conduit à la constitution d’un groupe de travail au sein de l’Institut national du cancer (InCA) à la demande de la Direction générale de la Santé (DGS). Dans un avis finalisé le 4 mars dernier et qui vient d’être publié sur le site de l’InCA, ces experts font état de la situation épidémiologique en France. Ils rapportent ainsi dix-huit cas français de LAGC signalés à l’ANSM chez des porteuses d’implants mammaires. Parmi elles, huit avaient eu recours à ces prothèses pour des raisons esthétiques et dix autres dans le cadre d’une chirurgie réparatrice après cancer du sein. Les experts de l’INCA observent par ailleurs que le lymphome survient « en moyenne entre 11 à 15 ans après la pose du premier implant. De grandes variations de ce délai sont cependant possibles (2 à 37 ans) ». Ils notent encore que dans la grande majorité des cas (80 %), les implants concernés étaient macrotexturés et non lisses. Selon le Parisien, qui a été le premier à s’intéresser à ce rapport de l’INCA, les implants macrotexturés sont les plus fréquemment commercialisés en France.
Pas d’explantations préventives recommandées
A la lumière de ces résultats, les experts de l’INCA jugent qu’il « existe un lien clairement établi entre la survenue de cette pathologie et le port d’un implant mammaire », bien que la « fréquence de cette complication » soit « très faible ». Une estimation « très approximative », liée à la difficulté à « déterminer le nombre de femmes porteuses d’implants mammaires » est avancée : « elle serait de l’ordre de 1 à 2 pour 100 000 femmes années ». Les auteurs du rapport notent par ailleurs que pour l’heure, en raison du faible nombre de cas, l’existence de facteurs de risque associés est difficile à déterminer. D’une manière générale, les experts soulignent l’incomplétude des données. Néanmoins, ils estiment nécessaire de se pencher plus avant sur la question de la texture des implants. A leurs yeux, leurs résultats ne doivent pas conduire à recommander une explantation préventive, quel que soit le type de prothèse utilisé, mais invitent à poursuivre la surveillance préconisée et à alerter en cas de signes suspects (épanchement, augmentation du volume, douleur, inflammation, masse, ulcération, altération de l’état général). Afin de renforcer cette surveillance, l’INCA estime utile une information spécifique des professionnels de santé. La DGS n’a pas attendu longtemps avant de répondre à cette recommandation : le 10 mars dernier, les professionnels de santé concernés ont reçu un avis les incitant à se montrer vigilants quant au risque de LAGC chez les porteuses d’implants mammaires et leur indiquant la nécessité d’informer les candidates à une pose de prothèse de l’existence de ce risque.
Va-t-on reprendre une étude abandonnée il y a quelques semaines ?
Si l’on en juge par l’avis d’experts mesuré de l’INCA, l’affaire ne devrait pas être considérée comme un "scandale". Néanmoins, elle en avait plus que des allures ce matin, comme en témoignait le déferlement médiatique créé dans le sillon des "révélations" du Parisien (qui concentre une partie de ses remarques sur le fait que les prothèses commercialisées par un fabriquant seraient les plus fréquemment concernées). D’ailleurs, l’annonce de la tenue d’une conférence de presse du ministère de la Santé cet après-midi sur ce sujet confirme la dimension "polémique" du dossier. Marisol Touraine devrait notamment annoncer un renforcement de la surveillance des porteuses d’implant mammaire : les responsables de l’étude LUCIE qui devaient concerner 100 000 femmes porteuses de prothèse et dont le financement a été interrompu sans raisons précises par l’ANSM (comme l’avait révélé en février le Figaro et comme le rappelle aujourd’hui Doctissimo) suivront sans doute de très près les déclarations du ministre sur ce point. Cette intervention de Marisol Touraine sera sans doute également l’occasion de s’interroger sur l’opportunité d’interdire les implants mammaires : dans les colonnes du Parisien, François Hébert responsable de la sécurité des produits de santé au sein de l’ANSM, affirme : « Si on doit les interdire, nous le ferons ».
Il est cependant plus probable que des mesures plus nuancées soient évoquées, visant certains types de prothèse ou concernant le remplacement des implants. Aux Etats-Unis, la FDA a imposé en juin 2012 que tous les implants mammaires à base de silicone soient remplacés tous les dix ans (une décision cependant pas en lien direct avec la question du risque de lymphome).
Aurélie Haroche
Sylvie Riou-Milliot (source SCIENCES ET AVENIR)
Une étude française montre que la prise d’anxiolytique avant une opération ne réduit pas la douleur. Elle risque même de retarder le réveil.
Cette étude devrait faire évoluer les pratiques des anesthésistes et inciter les patients à ne pas réclamer ce type de sédation.
Non, l’administration d’un sédatif avant une anesthésie pour calmer le stress n’est pas une bonne chose. Pis, cette pratique — courante dans les établissements de soins — rallonge le temps d’hospitalisation et risque de compliquer le réveil. C’est du moins la conclusion d’une étude menée dans différents hôpitaux français (Marseille, Montpellier, Nîmes, Nice) sur un millier de patients avant une intervention chirurgicale.
Limiter la consommation de benzodiazépines
Ce travail, publié dans la revue Jama, a été réalisé sur un ensemble de patients divisée en trois groupes : ceux qui ont reçu 2,5 mg de lorazépam (Témesta), ceux qui ont eu droit — sans le savoir — à un placebo et enfin ceux qui n’ont reçu que les anesthésiants préopératoires nécessaires. Résultat : aucune différence dans les trois groupes en termes de sensation de douleur liée à l’intervention ! En revanche, chez les patients ayant reçu du lorazépam, le délai entre la fin de l’anesthésie et l’extubation (le moment ou l’anesthésiste retire le tube introduit dans la trachée) était allongé de 5 minutes.
Et ce groupe était aussi le plus lent à récupérer ses fonctions cognitives : 40 minutes après l’opération, ils n’étaient que 51 % à avoir retrouvé toutes leurs aptitudes contre 64 % dans le troisième groupe (aucun sédatif) et 71 % dans le second groupe (placebo) ! Toutefois les auteurs suggèrent que la veille de l’intervention, une prise en charge peut toujours être envisagée pour les plus anxieux.
RECOMMANDATIONS. Cette étude va dans le sens des recommandations officielles visant à limiter la consommation de benzodiazépines, des médicaments loin d’être anodins puisqu’ils entraînent un risque de dépendance et pourraient être à l’origine de maladies neurodégénératives telle Alzheimer comme Sciences et Avenir a été le premier à le révéler (n° 775, octobre 2011). Elle devrait aussi faire évoluer les pratiques des anesthésistes et inciter les patients à ne pas réclamer ce type de sédation.
----
Anesthésie locale : on pourrait réduire le stress des patients
Diane Mottez
Subir une anesthésie locale et rester conscient pendant une intervention est souvent source d’anxiété. On se retrouve dans un univers inconnu, on entend des propos médicaux souvent incompréhensibles, quand ce ne sont pas des bruits d’outils et de machines pour le moins stressant… Or, on sait que le niveau d’anxiété d’un patient a un impact sur sa douleur post opératoire. L’équipe du Dr Briony Hudson, de la School of Psychology de l’université de Surrey en Grande Bretagne, s’est donc intéressée au sujet. Principaux résultats de son étude parue dans l’European Journal of Pain : pouvoir discuter avec un infirmier pendant l’opération, avoir à disposition des balles anti stress ou regarder un DVD réduirait l’anxiété. La musique, elle, contre toute attente, n’a pas calmé les patients ni réduit la douleur post-opératoire.
Pour arriver à ces résultats, les chercheurs ont divisé en cinq groupes 398 patients opérés pour des varices. Le premier groupe écoutait de la musique pendant l’intervention, le 2è regardait un DVD de son choix, le 3è utilisait des balles anti stress, les patients du 4è groupe pouvaient discuter librement avec un infirmier qui restait à côté d’eux, et ceux du dernier groupe étaient les témoins, ils n’avaient donc aucun support durant l’intervention. A l’issue de l’opération, ils ont rempli un questionnaire.
Les patients des groupes 3 (balles anti stress) et 4 (avec un infirmier) ont indiqué une réduction significative de leur anxiété et des douleurs ressenties. Les patients du groupe 2 (DVD) ont également été moins anxieux, mais sans impact sur leur douleur. Quand aux patients ayant écouté de la musique, aucun impact positif n’a été constaté, ni sur l’anxiété, ni sur la douleur.
Distraire un patient de façon simple et parfois peu coûteuse (dans le cas des balles anti stress) pourrait donc avoir un effet positif durant l’intervention : moins de stress et moins de douleurs. Un exemple à suivre ?
NB : au cas où le lien devienne mort...
How the best anaesthetic is a nurse's soothing chat: Conversation found to be better at easing pain then listening to music or watching a film
Growing number of operations are done with local anaesthetic to cut costs
This numbs the pain in the area being operated but patients are still awake
Researchers say calming conversation is 'simple and inexpensive' solution
Patients given various 'distractions' during varicose vein surgery as a test
Showed talking to nurse cut anxiety by 30 per cent and pain by 16 per cent
By Fiona Macrae, Science Correspondent for the Daily Mail
Forget iPods and DVDs, the key to relaxing during surgery could be as simple as a chatty, caring nurse.
A study found conversation and touch to be better at easing the stress and pain of an operation than listening to music or watching a film.
The University of Surrey researchers said that having a nurse chat to a patient while holding their hand could be a 'simple and inexpensive' way of making operations done without a general anaesthetic more pleasant.
A drive to cut costs and save time means that growing numbers of operations are done with a local anaesthetic.
Soothing: A study found conversation and touch to be better at easing the stress and pain of an operation than listening to music or watching a film
Soothing: A study found conversation and touch to be better at easing the stress and pain of an operation than listening to music or watching a film (file photo)
This numbs the pain in the area being cut open but the patient is still wide awake and may become more and more anxious as they hear the surgeons discuss their operation.
Many also fear the injection of local anaesthetic, which can be painful.
Fear and anxiety can lead to some patients putting off their op until their condition gets markedly worse.
In other cases, high levels of worry during surgery can delay recovery.
Various tests, including photographic examination of the womb and bowel are also done while the patient is wide awake.
PhD student Briony Hudson studied more than 400 men and women who were having varicose vein surgery.
The patients were divided into five groups. The first listened to music during their operation, the second watched a film and a third squeezed small 'stress' balls with their hands when they felt uncomfortable.
The fourth group chatted to a nurse, while the final group had no distractions.
Immediately after the operation, they were quizzed on how anxious they had felt and how much pain they had been in.
The DVD, stress balls and chatting to a nurse all eased anxiety. But only the stress balls and conversation reduced pain.
Simple and effective: Talking to a nurse cut anxiety by 30 per cent, compared to having no distractions, and reduced pain by 16 per cent
Simple and effective: Talking to a nurse cut anxiety by 30 per cent, compared to having no distractions, and reduced pain by 16 per cent (file photo)
Talking to a nurse cut anxiety by 30 per cent, compared to having no distractions, and reduced pain by 16 per cent.
Using the stress balls eased anxiety by 18 per cent and cut pain by 22 per cent, the European Journal of Pain reports.
Surprisingly, listening to music didn't help at all.
The researchers aren't sure why this was but it may be because the patients chose music that they knew well and so it didn't provide the necessary level of distraction.
Researcher Jane Ogden said that the results suggest that conversation and touch are particularly effective.
During the study, which is reported in the European Journal of Pain, the nurses were instructed to talk to the patients but not touch them.
However, having a nurse hold the patient's hand while chatting may be even more calming than conversation alone.
Professor Ogden said: 'I was most pleased by the impact of interaction with nurses because it is such a straight forward thing to do.
'If someone asks you what you are going to do at the weekend and where you are going to go on holiday, that is a very effective way of managing pain.'
----
A quels seins se vouer ?
Risque de lymphome et implant mammaire : le retrait n’est pas recommandé… pour l’instant !
Paris, le mardi 17 mars 2015 – L’augmentation du risque de lymphome anaplasique à grandes cellules (LAGC) chez les porteuses d’implants mammaires est étudiée depuis au moins 2011 par les autorités sanitaires de nombreux pays, et notamment par la Food and Drug Administration (FDA). Pour cette dernière, l’existence d’un risque faible ne fait d’ailleurs plus de doute depuis plusieurs années. Ainsi, dans un document intitulé "Cinq choses que les femmes devraient savoir à propos des implants mammaires" réactualisé pour la dernière fois en 2013, l’institution américaine indique clairement au chapitre des "risques" : « La FDA a identifié une association possible entre les implants mammaires et le développement de LAGC ».
Lymphome survenant entre 11 et 15 ans après la pose d’un implant le plus souvent macro-texturé
L’existence de ce risque fait également l’objet d’investigations en France. Ainsi, après le signalement d’un cas de LAGC chez une femme portant un implant mammaire (fabriqué avec le fameux gel PIP), la vigilance des autorités a été renforcée sur ce point. L’identification de plusieurs autres cas a conduit à la constitution d’un groupe de travail au sein de l’Institut national du cancer (InCA) à la demande de la Direction générale de la Santé (DGS). Dans un avis finalisé le 4 mars dernier et qui vient d’être publié sur le site de l’InCA, ces experts font état de la situation épidémiologique en France. Ils rapportent ainsi dix-huit cas français de LAGC signalés à l’ANSM chez des porteuses d’implants mammaires. Parmi elles, huit avaient eu recours à ces prothèses pour des raisons esthétiques et dix autres dans le cadre d’une chirurgie réparatrice après cancer du sein. Les experts de l’INCA observent par ailleurs que le lymphome survient « en moyenne entre 11 à 15 ans après la pose du premier implant. De grandes variations de ce délai sont cependant possibles (2 à 37 ans) ». Ils notent encore que dans la grande majorité des cas (80 %), les implants concernés étaient macrotexturés et non lisses. Selon le Parisien, qui a été le premier à s’intéresser à ce rapport de l’INCA, les implants macrotexturés sont les plus fréquemment commercialisés en France.
Pas d’explantations préventives recommandées
A la lumière de ces résultats, les experts de l’INCA jugent qu’il « existe un lien clairement établi entre la survenue de cette pathologie et le port d’un implant mammaire », bien que la « fréquence de cette complication » soit « très faible ». Une estimation « très approximative », liée à la difficulté à « déterminer le nombre de femmes porteuses d’implants mammaires » est avancée : « elle serait de l’ordre de 1 à 2 pour 100 000 femmes années ». Les auteurs du rapport notent par ailleurs que pour l’heure, en raison du faible nombre de cas, l’existence de facteurs de risque associés est difficile à déterminer. D’une manière générale, les experts soulignent l’incomplétude des données. Néanmoins, ils estiment nécessaire de se pencher plus avant sur la question de la texture des implants. A leurs yeux, leurs résultats ne doivent pas conduire à recommander une explantation préventive, quel que soit le type de prothèse utilisé, mais invitent à poursuivre la surveillance préconisée et à alerter en cas de signes suspects (épanchement, augmentation du volume, douleur, inflammation, masse, ulcération, altération de l’état général). Afin de renforcer cette surveillance, l’INCA estime utile une information spécifique des professionnels de santé. La DGS n’a pas attendu longtemps avant de répondre à cette recommandation : le 10 mars dernier, les professionnels de santé concernés ont reçu un avis les incitant à se montrer vigilants quant au risque de LAGC chez les porteuses d’implants mammaires et leur indiquant la nécessité d’informer les candidates à une pose de prothèse de l’existence de ce risque.
Va-t-on reprendre une étude abandonnée il y a quelques semaines ?
Si l’on en juge par l’avis d’experts mesuré de l’INCA, l’affaire ne devrait pas être considérée comme un "scandale". Néanmoins, elle en avait plus que des allures ce matin, comme en témoignait le déferlement médiatique créé dans le sillon des "révélations" du Parisien (qui concentre une partie de ses remarques sur le fait que les prothèses commercialisées par un fabriquant seraient les plus fréquemment concernées). D’ailleurs, l’annonce de la tenue d’une conférence de presse du ministère de la Santé cet après-midi sur ce sujet confirme la dimension "polémique" du dossier. Marisol Touraine devrait notamment annoncer un renforcement de la surveillance des porteuses d’implant mammaire : les responsables de l’étude LUCIE qui devaient concerner 100 000 femmes porteuses de prothèse et dont le financement a été interrompu sans raisons précises par l’ANSM (comme l’avait révélé en février le Figaro et comme le rappelle aujourd’hui Doctissimo) suivront sans doute de très près les déclarations du ministre sur ce point. Cette intervention de Marisol Touraine sera sans doute également l’occasion de s’interroger sur l’opportunité d’interdire les implants mammaires : dans les colonnes du Parisien, François Hébert responsable de la sécurité des produits de santé au sein de l’ANSM, affirme : « Si on doit les interdire, nous le ferons ».
Il est cependant plus probable que des mesures plus nuancées soient évoquées, visant certains types de prothèse ou concernant le remplacement des implants. Aux Etats-Unis, la FDA a imposé en juin 2012 que tous les implants mammaires à base de silicone soient remplacés tous les dix ans (une décision cependant pas en lien direct avec la question du risque de lymphome).
Aurélie Haroche
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2507
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Le médecin peut être responsable des conséquences du refus de soin de son patient !
Paris le samedi 14 mars 2015-Lorsqu’un patient estime être la victime d’une erreur médicale ou d’une infection nosocomiale, sa méfiance envers le corps médical peut le conduire à refuser toutes prescriptions émanant de son médecin. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître ce refus peut avoir des conséquences négatives pour le médecin.
En effet, lorsque le médecin a commis une faute mettant en cause sa responsabilité civile, celui-ci est tenu de réparer l’intégralité du préjudice qui est la conséquence directe de son erreur.
Or, le refus de soin du patient en relation avec cette faute est clairement de nature à avoir des conséquences dommageables pour sa santé. Ceci risque mécaniquement d’aggraver considérablement son préjudice financier et… ses demandes en justice.
Lorsque le médecin a commis une faute engageant sa responsabilité, ou lorsqu’une clinique est tenue responsable d’une infection nosocomiale, le juge doit-il limiter le droit à la réparation lorsque le patient a refusé de se soigner envers et contre tout ?
Telle est la question tranchée par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 15 janvier 2015.
Un patient sorti contre avis médical et adepte de médecine traditionnelle
Dans notre affaire, un patient avait bénéficié dans une clinique privée d'une résection endoscopique d’une tumeur de vessie évoluée le 28 février 2005.
En raison d’une hématurie, le malade a dû être hospitalisé de nouveau en urgence le 30 mars 2005.
Refusant de subir d’autres traitements, et après discussions, le patient a quitté la clinique contre avis médical le 8 avril et ceci malgré l’existence d’une hyperthermie. Le médecin lui remettait alors une ordonnance de Dafalgan et de Noroxine.
Le malade est resté par la suite à son domicile où son état de santé s’est considérablement dégradé malgré le choix du patient d'être "traité" par les médecines "traditionnelles" plutôt que de suivre le traitement indiqué.
Le malade sera finalement hospitalisé de nouveau dans la même clinique le 23 avril 2005 dans un état grave.
Une hémoculture a alors permis l’isolement d’une souche de streptocoque du groupe B. Le traitement de cette infection sévère a alors nécessité plusieurs hospitalisations.
C’est dans ce contexte que le patient a demandé des comptes à ses différents médecins, et a saisi les juridictions afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Le médecin est-il responsable de l’aggravation du préjudice lié à un refus de soins ?
L’expertise diligentée par les juridictions a mis en avant la responsabilité de la clinique dans l’infection à streptocoque dont a été victime le patient.
Sur le fondement de ce rapport d’expertise favorable, le patient a demandé la réparation de l’intégralité de son préjudice lié aux nombreuses complications dont il a été la victime.
Or, devant les juges, la clinique a tenté de soulever un moyen de défense ambitieux.
Si la clinique est tenue de réparer les conséquences liées à une infection nosocomiale, il est constaté que le refus de soin du patient a eu pour conséquence l’aggravation de son propre dommage. En conséquence, la clinique ne pouvait pas être tenue de réparer un préjudice qui est, en partie, la conséquence des « erreurs » du patient lui-même.
La Cour d’appel de Bordeaux avait donné droit à cette thèse, de manière extrêmement prudente et circonstanciée. Elle avait estimé « en raison du contexte et des circonstances particulières et eu égard à la capacité de compréhension du patient » (qui en l’espèce, avait suivi des études de médecine !) que la clinique ne devait que réparer les « suites normales » de l’infection nosocomiale.
En d’autres termes, la clinique n’avait pas à payer pour les complications qui résultaient de l’absence de traitement de l’infection pendant plus d’un mois, conséquences du refus de soin du patient.
La Cour d’appel de Bordeaux pour une diminution circonstanciée du droit à l’indemnisation en cas de refus de soins
La Cour d’appel de Bordeaux tentait d’apporter une nuance à un principe fondamental du droit des obligations. En droit français en effet, la victime d’un préjudice n’a pas l’obligation de tout mettre en œuvre pour limiter son dommage.
Par exemple, la victime d’un plombier qui, du fait de sa négligence, aurait commis un dégât des eaux, n’a nullement l’obligation d’appeler un autre technicien pour limiter un dommage ! Le plombier fautif se doit de réparer toutes les conséquences de ses erreurs, même si son client, de mauvaise foi, aurait laissé son appartement être inondé !
La Cour d’appel de Bordeaux, tenait ainsi d’introduire la notion anglaise de « duty of litigation » : la victime d’un dommage doit tout faire pour ne pas nuire à autrui.
Le patient, dont l’indemnité avait été considérablement diminuée par la Cour d'appel, forma alors un pourvoi devant la Cour de cassation.
Revirement avorté ! Pour la Cour de cassation, le droit à l’indemnisation ne peut en aucun cas être diminué !
La Cour de cassation censure sévèrement la position des juges de la Cour d’appel de Bordeaux.
En effet, pour la Haute juridiction, le droit pour le patient de refuser de se faire soigner constitue pour lui une liberté fondamentale consacrée à l’article 16-1 du Code civil et à l’article L.1111-4 du Code de la santé publique : « aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».
L’exercice d’une telle liberté fondamentale ne peut être considéré comme une faute qui limiterait le droit à l’indemnisation.
En d’autres termes, pour la Cour de cassation, le patient n’est pas tenu de limiter son préjudice dans l’intérêt du médecin : le refus de soins n’a aucune incidence sur le droit à sa réparation. De retour devant les juges d’appel, il est donc vraisemblable que la clinique soit appelée à "soutenir" une condamnation plus lourde…
Des soins, toujours des soins, encore des soins, et le procès est évité !
On peut regretter cette lecture rigoriste de la Cour de cassation. En effet, la Cour d’appel de Bordeaux n’avait fait que pencher pour une application plus circonstanciée du principe de réparation intégrale, considérant que dans ce cas très particulier, le refus de soin du patient (qui était aussi professionnel de santé !) constituait en réalité une faute…
Face au refus de soin, le médecin dont la responsabilité risque d’être recherchée se retrouve désormais dans une situation impossible…
Charles Haroche - Avocat (Paris)
source JIM.fr
----
Les conditions de travail se seraient globalement améliorées dans les hôpitaux… selon la DREES
Dans son panorama des établissements de santé de France métropolitaine et des départements d’Outre-mer, rendu public au début du mois, la DREES synthétise les principales données disponibles de l’année 2012 et présente aussi plusieurs dossiers. Celui consacré aux conditions de travail dans les établissements s’attache dans une première partie à montrer, à partir de différentes enquêtes de 2003 à 2013 l’évolution d’une partie d’entre elles dans un secteur hospitalier soumis à de nombreux changements ces dernières années.
Un secteur contraignant
Du fait de la continuité des soins en milieu hospitalier les salariés ont des contraintes telles que celle du travail de nuit : 80% des médecins ou pharmaciens sont amenés à travailler au moins occasionnellement la nuit, il en va de même pour la moitié des infirmiers et des aides soignants, indique la DREES. D’autre part, les demandes exigent souvent des réponses immédiates de la part des salariés, les exposant à des contraintes de rythme de travail très élevées. L’enquête Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels (Sumer) de 2010 a aussi mis en évidence d’autres problèmes de conditions de travail des agents dans la fonction publique hospitalière, notamment des horaires atypiques plus fréquents, une plus grande exposition aux produits chimiques et aux agents biologiques, un manque de moyens matériels et de personnel suffisant.
L’enquête Conditions de travail (CT) réalisée sur les années 2012 et 2013 avait pour objectif d’approfondir selon la profession et selon le statut de l’établissement les différences de conditions de travail perçues par les salariés. Elle a inclus les réponses de 4 300 personnels hospitaliers, 2 750 du secteur public (10,2% de médecins et pharmaciens, 28,9% d’infirmiers et sages-femmes) et 1 550 du privé (4,7% et 29,5% respectivement). La comparaison public et privé montre que 27 % des personnels déclarent souvent travailler la nuit dans les établissements hospitaliers publics, contre 21 % dans le privé. Les salariés du privé déclarent aussi moins souvent être exposés aux situations pénibles.
Des contraintes de rythme de travail en diminution
La bonne nouvelle c’est que les conditions de travail s’améliorent, par rapport à l’enquête CT de 2003 et/ou à l’enquête Changements organisationnels et informatisation (COI-H) de 2006, souligne la DRRES. Statuts public et privé confondus les analyses effectuées par famille professionnelle montrent en effet que les personnels hospitaliers déclarent moins de contraintes physiques que 10 ans auparavant, et que les contraintes de rythme de travail ont globalement diminué (sauf celles liées à l’informatisation) ou sont stables.
La part des professionnels hospitaliers qui déclarent avoir un rythme de travail imposé par des normes de production ou des délais à respecter en moins d'une heure est ainsi passé de 48% en 2003 à 30% en 2013, tout en restant supérieure à l'ensemble des salariés français (27%). Un moins grand nombre de professionnels doit toujours ou souvent se dépêcher (globalement 68% à 64% entre 2003 et 2013, mais 46 % pour l’ensemble des salariés en France), même chez les infirmiers et sages-femmes (de 77, 7% à 76,8%) ainsi que les médecins et pharmaciens (69,% à 63,7%).
Les contraintes horaires se stabilisent, constate d’autre part la DREES, mais sont dans ce secteur plus nombreuses que dans les autres secteurs économiques (travail le samedi, le dimanche, la nuit, astreintes). Le nombre des heures supplémentaires a diminué de moitié par rapport à 2003 (de 70% à environ 30% en 2013).
De nouvelles contraintes
Bien qu’ils aient diminué, les dépassements d’horaires sont moins souvent compensés qu’avant (de 76% en 2006 à 60% en 2013). Les horaires sont aussi plus souvent imposés sans possibilité de modification (69% en 2003, 77% en 2013), ce qui s’explique par la complexité de la mise en place des plannings. Les médecins et pharmaciens, les mieux lotis, sont encore 30% à pourvoir fixer leurs horaires (44% en 2003).
De nouveaux rythmes viennent aussi souvent intensifier le travail. Les salariés doivent plus fréquemment interrompre une tâche pour une autre (de 71,8% à 78,7% entre 2003 et 2013 - 82 à 84,9% pour infirmiers et sages-femmes, 76,1 à 77% pour médecins et pharmaciens), ou bien changer de poste en fonctions des besoins du service (10,4% à 18,9%).
L’informatisation croissante a par ailleurs développé de nouvelles contraintes. Le rythme de travail imposé par un contrôle ou un suivi informatisé s’est accru, le pourcentage de salariés concernés étant passé de 4 à 45,7% depuis 2006 pour les aides soignants, de 9,8 à 45,2% pour les infirmiers et sages-femmes, et de 15,5 à 35,8% pour les médecins et pharmaciens. En moyenne, infirmiers et sages femmes-tout comme médecins et pharmaciens on vu croître de 1h30 leur nombre d’heures quotidiennes d’utilisation de l’informatique. Le personnel administratif reste le premier utilisateur de l’informatique (98% des salariés) suivi de peu des médecins, pharmaciens, infirmiers et sages-femmes (95%).
Globalement les tensions sur les lieux de travail se développent par rapport à 10 ans auparavant, que ce soit avec le public, la hiérarchie ou les collègues, avec des différences selon les métiers de l’hôpital, mais le soutien social et la coopération sont en progression.
Dominique Monnier
Paris le samedi 14 mars 2015-Lorsqu’un patient estime être la victime d’une erreur médicale ou d’une infection nosocomiale, sa méfiance envers le corps médical peut le conduire à refuser toutes prescriptions émanant de son médecin. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître ce refus peut avoir des conséquences négatives pour le médecin.
En effet, lorsque le médecin a commis une faute mettant en cause sa responsabilité civile, celui-ci est tenu de réparer l’intégralité du préjudice qui est la conséquence directe de son erreur.
Or, le refus de soin du patient en relation avec cette faute est clairement de nature à avoir des conséquences dommageables pour sa santé. Ceci risque mécaniquement d’aggraver considérablement son préjudice financier et… ses demandes en justice.
Lorsque le médecin a commis une faute engageant sa responsabilité, ou lorsqu’une clinique est tenue responsable d’une infection nosocomiale, le juge doit-il limiter le droit à la réparation lorsque le patient a refusé de se soigner envers et contre tout ?
Telle est la question tranchée par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 15 janvier 2015.
Un patient sorti contre avis médical et adepte de médecine traditionnelle
Dans notre affaire, un patient avait bénéficié dans une clinique privée d'une résection endoscopique d’une tumeur de vessie évoluée le 28 février 2005.
En raison d’une hématurie, le malade a dû être hospitalisé de nouveau en urgence le 30 mars 2005.
Refusant de subir d’autres traitements, et après discussions, le patient a quitté la clinique contre avis médical le 8 avril et ceci malgré l’existence d’une hyperthermie. Le médecin lui remettait alors une ordonnance de Dafalgan et de Noroxine.
Le malade est resté par la suite à son domicile où son état de santé s’est considérablement dégradé malgré le choix du patient d'être "traité" par les médecines "traditionnelles" plutôt que de suivre le traitement indiqué.
Le malade sera finalement hospitalisé de nouveau dans la même clinique le 23 avril 2005 dans un état grave.
Une hémoculture a alors permis l’isolement d’une souche de streptocoque du groupe B. Le traitement de cette infection sévère a alors nécessité plusieurs hospitalisations.
C’est dans ce contexte que le patient a demandé des comptes à ses différents médecins, et a saisi les juridictions afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Le médecin est-il responsable de l’aggravation du préjudice lié à un refus de soins ?
L’expertise diligentée par les juridictions a mis en avant la responsabilité de la clinique dans l’infection à streptocoque dont a été victime le patient.
Sur le fondement de ce rapport d’expertise favorable, le patient a demandé la réparation de l’intégralité de son préjudice lié aux nombreuses complications dont il a été la victime.
Or, devant les juges, la clinique a tenté de soulever un moyen de défense ambitieux.
Si la clinique est tenue de réparer les conséquences liées à une infection nosocomiale, il est constaté que le refus de soin du patient a eu pour conséquence l’aggravation de son propre dommage. En conséquence, la clinique ne pouvait pas être tenue de réparer un préjudice qui est, en partie, la conséquence des « erreurs » du patient lui-même.
La Cour d’appel de Bordeaux avait donné droit à cette thèse, de manière extrêmement prudente et circonstanciée. Elle avait estimé « en raison du contexte et des circonstances particulières et eu égard à la capacité de compréhension du patient » (qui en l’espèce, avait suivi des études de médecine !) que la clinique ne devait que réparer les « suites normales » de l’infection nosocomiale.
En d’autres termes, la clinique n’avait pas à payer pour les complications qui résultaient de l’absence de traitement de l’infection pendant plus d’un mois, conséquences du refus de soin du patient.
La Cour d’appel de Bordeaux pour une diminution circonstanciée du droit à l’indemnisation en cas de refus de soins
La Cour d’appel de Bordeaux tentait d’apporter une nuance à un principe fondamental du droit des obligations. En droit français en effet, la victime d’un préjudice n’a pas l’obligation de tout mettre en œuvre pour limiter son dommage.
Par exemple, la victime d’un plombier qui, du fait de sa négligence, aurait commis un dégât des eaux, n’a nullement l’obligation d’appeler un autre technicien pour limiter un dommage ! Le plombier fautif se doit de réparer toutes les conséquences de ses erreurs, même si son client, de mauvaise foi, aurait laissé son appartement être inondé !
La Cour d’appel de Bordeaux, tenait ainsi d’introduire la notion anglaise de « duty of litigation » : la victime d’un dommage doit tout faire pour ne pas nuire à autrui.
Le patient, dont l’indemnité avait été considérablement diminuée par la Cour d'appel, forma alors un pourvoi devant la Cour de cassation.
Revirement avorté ! Pour la Cour de cassation, le droit à l’indemnisation ne peut en aucun cas être diminué !
La Cour de cassation censure sévèrement la position des juges de la Cour d’appel de Bordeaux.
En effet, pour la Haute juridiction, le droit pour le patient de refuser de se faire soigner constitue pour lui une liberté fondamentale consacrée à l’article 16-1 du Code civil et à l’article L.1111-4 du Code de la santé publique : « aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».
L’exercice d’une telle liberté fondamentale ne peut être considéré comme une faute qui limiterait le droit à l’indemnisation.
En d’autres termes, pour la Cour de cassation, le patient n’est pas tenu de limiter son préjudice dans l’intérêt du médecin : le refus de soins n’a aucune incidence sur le droit à sa réparation. De retour devant les juges d’appel, il est donc vraisemblable que la clinique soit appelée à "soutenir" une condamnation plus lourde…
Des soins, toujours des soins, encore des soins, et le procès est évité !
On peut regretter cette lecture rigoriste de la Cour de cassation. En effet, la Cour d’appel de Bordeaux n’avait fait que pencher pour une application plus circonstanciée du principe de réparation intégrale, considérant que dans ce cas très particulier, le refus de soin du patient (qui était aussi professionnel de santé !) constituait en réalité une faute…
Face au refus de soin, le médecin dont la responsabilité risque d’être recherchée se retrouve désormais dans une situation impossible…
Charles Haroche - Avocat (Paris)
source JIM.fr
----
Les conditions de travail se seraient globalement améliorées dans les hôpitaux… selon la DREES
Dans son panorama des établissements de santé de France métropolitaine et des départements d’Outre-mer, rendu public au début du mois, la DREES synthétise les principales données disponibles de l’année 2012 et présente aussi plusieurs dossiers. Celui consacré aux conditions de travail dans les établissements s’attache dans une première partie à montrer, à partir de différentes enquêtes de 2003 à 2013 l’évolution d’une partie d’entre elles dans un secteur hospitalier soumis à de nombreux changements ces dernières années.
Un secteur contraignant
Du fait de la continuité des soins en milieu hospitalier les salariés ont des contraintes telles que celle du travail de nuit : 80% des médecins ou pharmaciens sont amenés à travailler au moins occasionnellement la nuit, il en va de même pour la moitié des infirmiers et des aides soignants, indique la DREES. D’autre part, les demandes exigent souvent des réponses immédiates de la part des salariés, les exposant à des contraintes de rythme de travail très élevées. L’enquête Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels (Sumer) de 2010 a aussi mis en évidence d’autres problèmes de conditions de travail des agents dans la fonction publique hospitalière, notamment des horaires atypiques plus fréquents, une plus grande exposition aux produits chimiques et aux agents biologiques, un manque de moyens matériels et de personnel suffisant.
L’enquête Conditions de travail (CT) réalisée sur les années 2012 et 2013 avait pour objectif d’approfondir selon la profession et selon le statut de l’établissement les différences de conditions de travail perçues par les salariés. Elle a inclus les réponses de 4 300 personnels hospitaliers, 2 750 du secteur public (10,2% de médecins et pharmaciens, 28,9% d’infirmiers et sages-femmes) et 1 550 du privé (4,7% et 29,5% respectivement). La comparaison public et privé montre que 27 % des personnels déclarent souvent travailler la nuit dans les établissements hospitaliers publics, contre 21 % dans le privé. Les salariés du privé déclarent aussi moins souvent être exposés aux situations pénibles.
Des contraintes de rythme de travail en diminution
La bonne nouvelle c’est que les conditions de travail s’améliorent, par rapport à l’enquête CT de 2003 et/ou à l’enquête Changements organisationnels et informatisation (COI-H) de 2006, souligne la DRRES. Statuts public et privé confondus les analyses effectuées par famille professionnelle montrent en effet que les personnels hospitaliers déclarent moins de contraintes physiques que 10 ans auparavant, et que les contraintes de rythme de travail ont globalement diminué (sauf celles liées à l’informatisation) ou sont stables.
La part des professionnels hospitaliers qui déclarent avoir un rythme de travail imposé par des normes de production ou des délais à respecter en moins d'une heure est ainsi passé de 48% en 2003 à 30% en 2013, tout en restant supérieure à l'ensemble des salariés français (27%). Un moins grand nombre de professionnels doit toujours ou souvent se dépêcher (globalement 68% à 64% entre 2003 et 2013, mais 46 % pour l’ensemble des salariés en France), même chez les infirmiers et sages-femmes (de 77, 7% à 76,8%) ainsi que les médecins et pharmaciens (69,% à 63,7%).
Les contraintes horaires se stabilisent, constate d’autre part la DREES, mais sont dans ce secteur plus nombreuses que dans les autres secteurs économiques (travail le samedi, le dimanche, la nuit, astreintes). Le nombre des heures supplémentaires a diminué de moitié par rapport à 2003 (de 70% à environ 30% en 2013).
De nouvelles contraintes
Bien qu’ils aient diminué, les dépassements d’horaires sont moins souvent compensés qu’avant (de 76% en 2006 à 60% en 2013). Les horaires sont aussi plus souvent imposés sans possibilité de modification (69% en 2003, 77% en 2013), ce qui s’explique par la complexité de la mise en place des plannings. Les médecins et pharmaciens, les mieux lotis, sont encore 30% à pourvoir fixer leurs horaires (44% en 2003).
De nouveaux rythmes viennent aussi souvent intensifier le travail. Les salariés doivent plus fréquemment interrompre une tâche pour une autre (de 71,8% à 78,7% entre 2003 et 2013 - 82 à 84,9% pour infirmiers et sages-femmes, 76,1 à 77% pour médecins et pharmaciens), ou bien changer de poste en fonctions des besoins du service (10,4% à 18,9%).
L’informatisation croissante a par ailleurs développé de nouvelles contraintes. Le rythme de travail imposé par un contrôle ou un suivi informatisé s’est accru, le pourcentage de salariés concernés étant passé de 4 à 45,7% depuis 2006 pour les aides soignants, de 9,8 à 45,2% pour les infirmiers et sages-femmes, et de 15,5 à 35,8% pour les médecins et pharmaciens. En moyenne, infirmiers et sages femmes-tout comme médecins et pharmaciens on vu croître de 1h30 leur nombre d’heures quotidiennes d’utilisation de l’informatique. Le personnel administratif reste le premier utilisateur de l’informatique (98% des salariés) suivi de peu des médecins, pharmaciens, infirmiers et sages-femmes (95%).
Globalement les tensions sur les lieux de travail se développent par rapport à 10 ans auparavant, que ce soit avec le public, la hiérarchie ou les collègues, avec des différences selon les métiers de l’hôpital, mais le soutien social et la coopération sont en progression.
Dominique Monnier
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2507
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Je l'avais déjà évoqué, en brève, mais ça se poursuit
Peine de mort aux États-Unis : face à la pénurie de barbituriques, le pays tente de trouver comment exécuter ses condamnés
Le HuffPost | Par Maxime Bourdeau
INTERNATIONAL – Alors que se tenait jeudi 10 octobre la journée mondiale contre la peine de mort, les États-Unis exécutaient au même moment leur 30e condamné à mort depuis le début de l'année.
Une coïncidence malheureuse qui n'a pas manqué de relancer le débat sur la peine capitale outre-Atlantique, où les méthodes douteuses utilisées pour faire face à une large pénurie de barbituriques nécessaires aux injections létales sont d'ailleurs sous le feu des critiques.
La controverse est telle que le gouverneur du Missouri a été même été contraint d'annoncer vendredi 11 octobre la suspension d'une exécution prévue pour la fin du mois, la toute première qui devait se faire avec du propofol, l'anesthésiant qui a coûté la vie à Michael Jackson.
La situation est compliquée et amène plusieurs des 32 États où la peine de mort est autorisée à penser à de nouvelles méthodes d'exécution, voire à envisager de revenir à des pratiques d'un autre temps comme la chambre à gaz ou la chaise électrique.
Pour comprendre comment le pays s'est retrouvé dans une telle position, Le HuffPost revient sur l'évolution récente de la peine capitale par injection létale à travers cinq dates-clés.
09/2010 : Fini le "cocktail de la mort"
Le laboratoire pharmaceutique Hospira, le seul aux États-Unis qui fabrique le thiopental, le barbiturique utilisé dans les exécutions par injection mortelle, annonce d'abord en septembre 2010 une rupture de stock. Puis en janvier 2011, l'entreprise explique en fait cesser tout bonnement la production.
Ce laboratoire, le seul à avoir reçu l'approbation de l'Agence américaine du médicament pour fabriquer l'anesthésiant en question, insiste alors qu'elle fabrique ce produit "pour les hôpitaux, pas pour les exécutions capitales, et n'encourage pas son usage dans ce type de procédure".
À cette époque, les exécutions se déroulent de manière quasi-identique sur tout le territoire: un cocktail mortel — composé de trois produits — est injecté aux prisonniers par intraveineuse. D'abord le thiopental endort, puis le pancuronium paralyse et enfin le chlorure de potassium tue. Impossible donc de se passer de l'anesthésiant, cela rendrait cette pratique incroyablement douloureuse donc inconstitutionnelle.
07/2011 : Impossible de trouver un substitut à l'étranger
Les dernières doses fabriquées par Hospira approchent rapidement de leur date de péremption. Pour faire face et ne pas avoir à reporter les exécutions en attendant de trouver une solution, certains États choisissent de changer de barbiturique et optent pour le pentobarbital. Bien qu'il serve habituellement pour euthanasier les animaux, ce produit est alors administré en surdose qui provoque une mort par l'inconscience, remplaçant ainsi le "cocktail de la mort" composé de trois injections.
Mais le Danois Lundbeck, seul laboratoire pharmaceutique européen qui accepte encore d'exporter son pentobarbital, ne tarde pas à céder sous la pression d'associations et d'investisseurs et annonce en juillet 2011 ne plus vouloir que son produit soit utilisé pour l'exécution de prisonniers outre-Atlantique.
Son exportation se complique fortement: une surveillance étroite est mise en place empêchant ainsi les Américains de s'en servir pour infliger les peines capitales. Une fois encore, les États-Unis se retrouvent coincés.
10/2012 : De nouveaux fournisseurs douteux
La pénurie menace donc à nouveau. Pour contourner le problème, certains États du pays se tournent alors vers les sociétés de préparation en pharmacie dont les produits ne sont pas agréés par l'Agence fédérale de contrôle des médicaments.
Dans les faits, dès le mois d'octobre 2012, ces officines — qui ne sont pas de vrais laboratoires — délivrent des anesthésiants qui ne sont pas contrôlés au niveau national. Et cela alors qu'au même moment l'une d'entre elles est pointée du doigt pour ses problèmes d'hygiène à l'origine d'une dramatique épidémie de méningite.
Selon le dernier bilan en date, cette infection a touché 750 personnes et fait plus de 60 morts dans 20 États.
09/2013 : Le Texas tente de s'approvisionner secrètement
Près d'un an plus tard, le Texas — l'État qui détient le record d'exécutions (plus de 500 depuis le rétablissement de la peine de mort en 1977) — annonce être à son tour proche de la pénurie et qu'il manquera de produit d'ici à la fin du mois de septembre 2013. Et ce, alors que plusieurs exécutions sont prévues.
In extremis, les autorités réussissent à se procurer le barbiturique utilisé pour les injections létales mais refusent de divulguer leur fournisseur. Inquiets de la provenance du produit, trois condamnés portent plainte et le Texas se voit contraint de faire la lumière sur l'affaire.
Résultat, l'État du Sud s'est fourni auprès d'une des fameuses sociétés de préparation en pharmacie et a de quoi procéder à toutes les exécutions programmées jusqu'à la fin de l'année. Mais l'entreprise — la Woodlands Compound Pharmacy — est furieuse car elle voulait rester anonyme et ne semble pas assumer sa décision de vendre du pentobarbital:
"Maintenant que cette information est publique, mon nom se retrouve partout sur internet", explique le responsable de la pharmacie. "Si j'avais su [...], je n'aurais jamais accepté de fournir ces médicaments au département de la justice pénale du Texas (TDCJ)".
"Je dois exiger que le TDCJ renvoie immédiatement les fioles de la préparation de pentobarbital en échange d'un remboursement", conclut-il. Ce que le ministère texan de la Justice refuse de faire, avançant que les produits ont été achetés en toute légalité.
10/2013 : Le retour de la chaise électrique et de la chambre à gaz ?
La plainte déposée par des condamnés au Texas est rejetée par la Cour Suprême et l'un d'entre eux est exécuté le 10 octobre, date de la journée mondiale contre la peine de mort. Il s'agit de la 30e exécution cette année aux États-Unis, la 14e pour le Texas à lui seul.
Pour éviter la pénurie de pentobarbital, l'État du Missouri s'était préparé, de son côté, à avoir recours au propofol, l'anesthésiant qui a entraîné la mort de Michael Jackson. Mais entre une controverse sur le produit et l'attention qu'a attiré la peine capitale, son gouverneur annonce vendredi 11 octobre la suspension de la première exécution avec ce produit programmée le 23 octobre.
Selon la presse locale, des élus du Missouri proposent en guise d'alternative de construire une nouvelle chambre à gaz, cette méthode d'exécution — utilisée pour la dernière fois en 1965 — étant toujours possible dans l’État.
Autre hypothèse envisageable, qui semble tout aussi barbare, la chaise électrique. Cette option reste effectivement possible dans une demi-douzaine d'États, si pour une raison ou une autre l'injection létale n'était pas possible. Probablement comme en cas de pénurie de barbituriques.
source :HuffPost
Peine de mort aux États-Unis : face à la pénurie de barbituriques, le pays tente de trouver comment exécuter ses condamnés
Le HuffPost | Par Maxime Bourdeau
INTERNATIONAL – Alors que se tenait jeudi 10 octobre la journée mondiale contre la peine de mort, les États-Unis exécutaient au même moment leur 30e condamné à mort depuis le début de l'année.
Une coïncidence malheureuse qui n'a pas manqué de relancer le débat sur la peine capitale outre-Atlantique, où les méthodes douteuses utilisées pour faire face à une large pénurie de barbituriques nécessaires aux injections létales sont d'ailleurs sous le feu des critiques.
La controverse est telle que le gouverneur du Missouri a été même été contraint d'annoncer vendredi 11 octobre la suspension d'une exécution prévue pour la fin du mois, la toute première qui devait se faire avec du propofol, l'anesthésiant qui a coûté la vie à Michael Jackson.
La situation est compliquée et amène plusieurs des 32 États où la peine de mort est autorisée à penser à de nouvelles méthodes d'exécution, voire à envisager de revenir à des pratiques d'un autre temps comme la chambre à gaz ou la chaise électrique.
Pour comprendre comment le pays s'est retrouvé dans une telle position, Le HuffPost revient sur l'évolution récente de la peine capitale par injection létale à travers cinq dates-clés.
09/2010 : Fini le "cocktail de la mort"
Le laboratoire pharmaceutique Hospira, le seul aux États-Unis qui fabrique le thiopental, le barbiturique utilisé dans les exécutions par injection mortelle, annonce d'abord en septembre 2010 une rupture de stock. Puis en janvier 2011, l'entreprise explique en fait cesser tout bonnement la production.
Ce laboratoire, le seul à avoir reçu l'approbation de l'Agence américaine du médicament pour fabriquer l'anesthésiant en question, insiste alors qu'elle fabrique ce produit "pour les hôpitaux, pas pour les exécutions capitales, et n'encourage pas son usage dans ce type de procédure".
À cette époque, les exécutions se déroulent de manière quasi-identique sur tout le territoire: un cocktail mortel — composé de trois produits — est injecté aux prisonniers par intraveineuse. D'abord le thiopental endort, puis le pancuronium paralyse et enfin le chlorure de potassium tue. Impossible donc de se passer de l'anesthésiant, cela rendrait cette pratique incroyablement douloureuse donc inconstitutionnelle.
07/2011 : Impossible de trouver un substitut à l'étranger
Les dernières doses fabriquées par Hospira approchent rapidement de leur date de péremption. Pour faire face et ne pas avoir à reporter les exécutions en attendant de trouver une solution, certains États choisissent de changer de barbiturique et optent pour le pentobarbital. Bien qu'il serve habituellement pour euthanasier les animaux, ce produit est alors administré en surdose qui provoque une mort par l'inconscience, remplaçant ainsi le "cocktail de la mort" composé de trois injections.
Mais le Danois Lundbeck, seul laboratoire pharmaceutique européen qui accepte encore d'exporter son pentobarbital, ne tarde pas à céder sous la pression d'associations et d'investisseurs et annonce en juillet 2011 ne plus vouloir que son produit soit utilisé pour l'exécution de prisonniers outre-Atlantique.
Son exportation se complique fortement: une surveillance étroite est mise en place empêchant ainsi les Américains de s'en servir pour infliger les peines capitales. Une fois encore, les États-Unis se retrouvent coincés.
10/2012 : De nouveaux fournisseurs douteux
La pénurie menace donc à nouveau. Pour contourner le problème, certains États du pays se tournent alors vers les sociétés de préparation en pharmacie dont les produits ne sont pas agréés par l'Agence fédérale de contrôle des médicaments.
Dans les faits, dès le mois d'octobre 2012, ces officines — qui ne sont pas de vrais laboratoires — délivrent des anesthésiants qui ne sont pas contrôlés au niveau national. Et cela alors qu'au même moment l'une d'entre elles est pointée du doigt pour ses problèmes d'hygiène à l'origine d'une dramatique épidémie de méningite.
Selon le dernier bilan en date, cette infection a touché 750 personnes et fait plus de 60 morts dans 20 États.
09/2013 : Le Texas tente de s'approvisionner secrètement
Près d'un an plus tard, le Texas — l'État qui détient le record d'exécutions (plus de 500 depuis le rétablissement de la peine de mort en 1977) — annonce être à son tour proche de la pénurie et qu'il manquera de produit d'ici à la fin du mois de septembre 2013. Et ce, alors que plusieurs exécutions sont prévues.
In extremis, les autorités réussissent à se procurer le barbiturique utilisé pour les injections létales mais refusent de divulguer leur fournisseur. Inquiets de la provenance du produit, trois condamnés portent plainte et le Texas se voit contraint de faire la lumière sur l'affaire.
Résultat, l'État du Sud s'est fourni auprès d'une des fameuses sociétés de préparation en pharmacie et a de quoi procéder à toutes les exécutions programmées jusqu'à la fin de l'année. Mais l'entreprise — la Woodlands Compound Pharmacy — est furieuse car elle voulait rester anonyme et ne semble pas assumer sa décision de vendre du pentobarbital:
"Maintenant que cette information est publique, mon nom se retrouve partout sur internet", explique le responsable de la pharmacie. "Si j'avais su [...], je n'aurais jamais accepté de fournir ces médicaments au département de la justice pénale du Texas (TDCJ)".
"Je dois exiger que le TDCJ renvoie immédiatement les fioles de la préparation de pentobarbital en échange d'un remboursement", conclut-il. Ce que le ministère texan de la Justice refuse de faire, avançant que les produits ont été achetés en toute légalité.
10/2013 : Le retour de la chaise électrique et de la chambre à gaz ?
La plainte déposée par des condamnés au Texas est rejetée par la Cour Suprême et l'un d'entre eux est exécuté le 10 octobre, date de la journée mondiale contre la peine de mort. Il s'agit de la 30e exécution cette année aux États-Unis, la 14e pour le Texas à lui seul.
Pour éviter la pénurie de pentobarbital, l'État du Missouri s'était préparé, de son côté, à avoir recours au propofol, l'anesthésiant qui a entraîné la mort de Michael Jackson. Mais entre une controverse sur le produit et l'attention qu'a attiré la peine capitale, son gouverneur annonce vendredi 11 octobre la suspension de la première exécution avec ce produit programmée le 23 octobre.
Selon la presse locale, des élus du Missouri proposent en guise d'alternative de construire une nouvelle chambre à gaz, cette méthode d'exécution — utilisée pour la dernière fois en 1965 — étant toujours possible dans l’État.
Autre hypothèse envisageable, qui semble tout aussi barbare, la chaise électrique. Cette option reste effectivement possible dans une demi-douzaine d'États, si pour une raison ou une autre l'injection létale n'était pas possible. Probablement comme en cas de pénurie de barbituriques.
source :HuffPost
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Éric DELMAS
C'est terrible la difficulté qu'ont certains américains pour avoir accès à des médicaments… vitaux !
Quant au risque de méningite pour le condamné à mort, je pense qu'il s'agit d'une cruauté supplémentaire.
Ont-ils pensé à des méthodes alternatives ? Par exemple forcer les condamnés à manger matin midi et soir des hamburgers et à boire du Coca ?
Quant au risque de méningite pour le condamné à mort, je pense qu'il s'agit d'une cruauté supplémentaire.
Ont-ils pensé à des méthodes alternatives ? Par exemple forcer les condamnés à manger matin midi et soir des hamburgers et à boire du Coca ?
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2507
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Publié le 14/04/2015
Une allergie en salle de réveil
Un cas inhabituel de dermatite allergique de contact aéroportée impliquant un anesthésique volatile a été observé chez une femme de 59 ans sans antécédents de pathologie respiratoire ni atopique. La dermatite, localisée à la face et au cou, avait débuté 2 mois plus tôt par une sensation de brûlure et de prurit alors que la patiente venait de débuter un nouveau travail d’infirmière en salle de réveil dans une clinique privée d’ORL au Danemark.
Son travail consistait à surveiller en continu pendant 4 à 5 heures les patients après leur intervention chirurgicale sous anesthésie générale avec du sévoflurane. Elle rentrait dans le bloc chirurgical de temps en temps pour aider à la préparation et au nettoyage entre les interventions.
L’éruption s’améliorait pendant les vacances et s’aggravait los de la reprise du travail dans la salle de réveil. L’interrogatoire a mis par ailleurs en évidence d’autres symptômes légers (manque de souffle, rhinite et difficulté de concentration) spontanément résolutifs lorsqu’elle quittait la salle de réveil.
Des patch-tests ont été réalisés à l’aide de la batterie de base européenne et avec une batterie caoutchouc sur Finn Chambers° sur Scanpor°.
Les tests ont été appliqués sur la partie haute du dos puis enlevés à 48 heures, lus à J2, J3 et J7.
Des réactions douteuses au fragrance mix 1 et au linalol ont été notées mais jugées sans pertinence clinique, la patiente, tout comme son mari, n’utilisant aucun produit parfumé.
Les prick-tests réalisés avec une batterie d’aéroallergènes et avec les protéines du latex étaient tous négatifs.
L’examen de la fonction respiratoire était normal.
La responsabilité du sévoflurane utilisé comme anesthésique a alors été évoquée. La pratique d’un patch-test a été jugée inappropriée en raison de l’extrême volatilité du produit.
La malade a refusé un test de provocation dans une chambre d’exposition.
Un test d’application répété (ROAT) a alors été réalisé par la patiente avec application de 0,5 ml de sévoflurane, à l’aide d’une seringue, 2 fois par jour, sur le pli de flexion du coude sur une surface de 3x3 cm2.
Ce test a provoqué une exacerbation de la dermatite de la face et du cou à J2 et une dermatite sur le pli du coude à J10.
Trois volontaires sains ont pratiqué le même ROAT (2 d’entre eux avaient été en contact avec la molécule au cours de leur activité professionnelle) sans aucune réaction.
Il s’agissait donc bien d’une dermatite de contact aéroportée au sévoflurane.
Dr Geneviève Démonet
Référence
Andersen Y et coll. : Occupational airborne contact dermatitis caused by sevoflurane. Contact Dermatiis 2015; 72: 241-243
Copyright © http://www.jim.fr
-----
Publié le 08/04/2015
Hydroxyéthylamidons et albumine : prudence aussi en chirurgie
L’utilisation des hydroxyéthylamidons a fait l’objet d’intenses débats ces dernières années. Certaines publications ayant fait état d’effets secondaires graves, plusieurs agences du médicament ont émis des réserves quant à leur emploi, allant parfois jusqu’à demander leur suspension. Les effets indésirables incriminés étaient principalement des insuffisances rénales, particulièrement chez les patients présentant une septicémie ou relevant d’une réanimation. A ce jour, il existe toutefois peu de données sur leur sécurité d’emploi en péri-opératoiredans des interventions à risque hémorragique élevé. Ce manque de données favorise les polémiques, chaque camp y allant de ses arguments.
Une étude rétrospective, réalisée dans 510 hôpitaux des Etats-Unis sur des données concernant plus de 1 million de patients, pourrait relancer le débat et surtout illustrer la nécessité urgente d’études prospectives. Les auteurs ont limité leur recherche au contexte d’interventions d’arthroplasties totales de hanche et de genou, et ont comparé le risque de complications péri-opératoires chez ceux qui avaient reçu un soluté de remplissage à base d’hydroxyéthylamidon à 6 % ou d’albumine à 5% , à celui de patients n’ayant pas reçu ces produits.
Le constat est sans appel, puisque les solutés à base d’hydroxyéthylamidons sont associés à une augmentation d’environ 20 % du risque d’insuffisance rénale aiguë (Odds ratio 1,23 ; intervalle de confiance à 95 % 1,13 à 1,34). Quant à l’albumine, elle est associée à une augmentation de 50 % du risque d’insuffisance rénale. Le risque de complications thrombo-emboliques, cardiaques et pulmonaires est lui aussi supérieur chez les sujets ayant reçu ces solutés de remplissage. Les auteurs remarquent une réduction depuis 2013 du recours aux hydroxyéthylamidons, qui est concomitante à une augmentation de l’emploi d’albumine.
Selon les auteurs, ces résultats, bien qu’obtenus à partir d’une étude rétrospective, devraient rendre prudents quant à l’utilisation de ces produits dans ce contexte de chirurgie orthopédique. En tout état de cause, ils justifient que soient entreprises des études prospectives de grande ampleur afin d’établir clairement leur rapport bénéfice-risque. Cela renforcerait le processus décisionnel et exclurait le risque de leur utilisation en routine.
En France, après quelques hésitations, l’AMM des solutés de remplissage à base d’hydroxyéthylamidon a été limitée, en 2014, au traitement de deuxième intention de l’hypovolémie due à des pertes sanguines, quand l’emploi des cristalloïdes seuls est insuffisant.
Dr Roseline Péluchon
Référence
Opperer M et coll. : Use of perioperative hydroxyethylstarch 6 % and albumin 5 % in elective joint arthroplasty and association with adverse outcomes: a retrospective population based analysis. BMJ 2015;350:h1567
Copyright © http://www.jim.fr
Une allergie en salle de réveil
Un cas inhabituel de dermatite allergique de contact aéroportée impliquant un anesthésique volatile a été observé chez une femme de 59 ans sans antécédents de pathologie respiratoire ni atopique. La dermatite, localisée à la face et au cou, avait débuté 2 mois plus tôt par une sensation de brûlure et de prurit alors que la patiente venait de débuter un nouveau travail d’infirmière en salle de réveil dans une clinique privée d’ORL au Danemark.
Son travail consistait à surveiller en continu pendant 4 à 5 heures les patients après leur intervention chirurgicale sous anesthésie générale avec du sévoflurane. Elle rentrait dans le bloc chirurgical de temps en temps pour aider à la préparation et au nettoyage entre les interventions.
L’éruption s’améliorait pendant les vacances et s’aggravait los de la reprise du travail dans la salle de réveil. L’interrogatoire a mis par ailleurs en évidence d’autres symptômes légers (manque de souffle, rhinite et difficulté de concentration) spontanément résolutifs lorsqu’elle quittait la salle de réveil.
Des patch-tests ont été réalisés à l’aide de la batterie de base européenne et avec une batterie caoutchouc sur Finn Chambers° sur Scanpor°.
Les tests ont été appliqués sur la partie haute du dos puis enlevés à 48 heures, lus à J2, J3 et J7.
Des réactions douteuses au fragrance mix 1 et au linalol ont été notées mais jugées sans pertinence clinique, la patiente, tout comme son mari, n’utilisant aucun produit parfumé.
Les prick-tests réalisés avec une batterie d’aéroallergènes et avec les protéines du latex étaient tous négatifs.
L’examen de la fonction respiratoire était normal.
La responsabilité du sévoflurane utilisé comme anesthésique a alors été évoquée. La pratique d’un patch-test a été jugée inappropriée en raison de l’extrême volatilité du produit.
La malade a refusé un test de provocation dans une chambre d’exposition.
Un test d’application répété (ROAT) a alors été réalisé par la patiente avec application de 0,5 ml de sévoflurane, à l’aide d’une seringue, 2 fois par jour, sur le pli de flexion du coude sur une surface de 3x3 cm2.
Ce test a provoqué une exacerbation de la dermatite de la face et du cou à J2 et une dermatite sur le pli du coude à J10.
Trois volontaires sains ont pratiqué le même ROAT (2 d’entre eux avaient été en contact avec la molécule au cours de leur activité professionnelle) sans aucune réaction.
Il s’agissait donc bien d’une dermatite de contact aéroportée au sévoflurane.
Dr Geneviève Démonet
Référence
Andersen Y et coll. : Occupational airborne contact dermatitis caused by sevoflurane. Contact Dermatiis 2015; 72: 241-243
Copyright © http://www.jim.fr
-----
Publié le 08/04/2015
Hydroxyéthylamidons et albumine : prudence aussi en chirurgie
L’utilisation des hydroxyéthylamidons a fait l’objet d’intenses débats ces dernières années. Certaines publications ayant fait état d’effets secondaires graves, plusieurs agences du médicament ont émis des réserves quant à leur emploi, allant parfois jusqu’à demander leur suspension. Les effets indésirables incriminés étaient principalement des insuffisances rénales, particulièrement chez les patients présentant une septicémie ou relevant d’une réanimation. A ce jour, il existe toutefois peu de données sur leur sécurité d’emploi en péri-opératoiredans des interventions à risque hémorragique élevé. Ce manque de données favorise les polémiques, chaque camp y allant de ses arguments.
Une étude rétrospective, réalisée dans 510 hôpitaux des Etats-Unis sur des données concernant plus de 1 million de patients, pourrait relancer le débat et surtout illustrer la nécessité urgente d’études prospectives. Les auteurs ont limité leur recherche au contexte d’interventions d’arthroplasties totales de hanche et de genou, et ont comparé le risque de complications péri-opératoires chez ceux qui avaient reçu un soluté de remplissage à base d’hydroxyéthylamidon à 6 % ou d’albumine à 5% , à celui de patients n’ayant pas reçu ces produits.
Le constat est sans appel, puisque les solutés à base d’hydroxyéthylamidons sont associés à une augmentation d’environ 20 % du risque d’insuffisance rénale aiguë (Odds ratio 1,23 ; intervalle de confiance à 95 % 1,13 à 1,34). Quant à l’albumine, elle est associée à une augmentation de 50 % du risque d’insuffisance rénale. Le risque de complications thrombo-emboliques, cardiaques et pulmonaires est lui aussi supérieur chez les sujets ayant reçu ces solutés de remplissage. Les auteurs remarquent une réduction depuis 2013 du recours aux hydroxyéthylamidons, qui est concomitante à une augmentation de l’emploi d’albumine.
Selon les auteurs, ces résultats, bien qu’obtenus à partir d’une étude rétrospective, devraient rendre prudents quant à l’utilisation de ces produits dans ce contexte de chirurgie orthopédique. En tout état de cause, ils justifient que soient entreprises des études prospectives de grande ampleur afin d’établir clairement leur rapport bénéfice-risque. Cela renforcerait le processus décisionnel et exclurait le risque de leur utilisation en routine.
En France, après quelques hésitations, l’AMM des solutés de remplissage à base d’hydroxyéthylamidon a été limitée, en 2014, au traitement de deuxième intention de l’hypovolémie due à des pertes sanguines, quand l’emploi des cristalloïdes seuls est insuffisant.
Dr Roseline Péluchon
Référence
Opperer M et coll. : Use of perioperative hydroxyethylstarch 6 % and albumin 5 % in elective joint arthroplasty and association with adverse outcomes: a retrospective population based analysis. BMJ 2015;350:h1567
Copyright © http://www.jim.fr
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2507
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Tramadol et codéine : même risque de dépression respiratoire chez l’enfant
Le traitement ambulatoire de la douleur postopératoire devient ardu chez l’enfant. A la suite de la revue de JA Racoosin et coll. (1) la codéine a été contre-indiquée avant 12 ans et, quel que soit l’âge, après une amygdalectomie. Le tramadol, utilisé en remplacement, ne semble pas plus sûr.
G Orliaguet et coll. rapportent un cas de dépression respiratoire chez un garçon de 5 ans et demi qui avait subi une amygdalectomie + une adénoïdectomie pour un syndrome d’apnées obstructives du sommeil (2). L’enfant était rentré chez lui 6 h après l’intervention, et, à domicile, avait absorbé 20 mg de tramadol. Le lendemain, il était hospitalisé dans un état comateux avec une hypoventilation – des apnées et une acidose gazeuse- et un myosis. Il a vite récupéré une conscience et une respiration normales grâce à une brève ventilation nasale et 3 injections de naloxone. Sa dépression respiratoire était due à l’accumulation du métabolite M1 du tramadol. L’enfant était un « métaboliseur ultra-rapide » du tramadol parce qu’il était porteur de trois allèles du gène de l’isoenzyme hépatique CYP2D6 (génotype CYP2D6*2 x 2/ CYP2D6*2).
C’est le CYP2D6 (cytochrome P450 2D6) qui catalyse la transformation du tramadol en métabolite M1 (ou O-desméthyltramadol), agoniste des récepteurs mu du système nerveux central. Cette enzyme est soumise à un grand polymorphisme génétique (environ 80 allèles décrits), avec une variabilité de la répartition des allèles selon les ethnies et de l’efficacité des enzymes selon les allèles. D’après l’efficience de l’enzyme, on distingue des métaboliseurs lents, intermédiaires, rapides et ultra-rapides. Chez ces derniers, qui représentent 5,5 % des habitants de l’Ouest de l’Europe, la production du métabolite M1 est très rapide et fait courir un risque de dépression respiratoire.
Ce cas clinique rappelle que le tramadol expose les enfants au même risque de dépression respiratoire que la codéine et que ce risque n’est pas prévisible, le dépistage anticipé des sujets métaboliseurs ultra-rapides du tramadol ne semblant pas réaliste. Faut-il interdire tous les opioïdes faibles comme analgésiques ? Et dans l’affirmative ne peut-on craindre une régression dans la prise en charge de la douleur postopératoire à domicile ? Pour la Société Française d’ORL (octobre 2014) c’est au clinicien de choisir l’analgésique à rajouter au paracétamol après une amygdalectomie, en préférant le tramadol en cas de risque hémorragique élevé (troubles de l’hémostase, difficultés opératoires …), et les anti-inflammatoires non stéroïdiens en cas de risque de dépression respiratoire élevé (syndrome des apnées obstructives du sommeil, comorbidités…). De son côté, la HAS prépare de nouvelles recommandations sur le sujet.
Dr Jean-Marc Retbi
Références
1. Racoosin JA et coll. : New evidence about an old drug – risk with codeine after adenotonsillectomy. N Engl J Med., 2013; 368: 2155-2157
2. Orliaguet G et coll. : A case of respiratory depression in a child with ultrarapid CYP2D6 metabolism after tramadol. Pediatrics2015; 135: e753-e755
jim.fr
Le traitement ambulatoire de la douleur postopératoire devient ardu chez l’enfant. A la suite de la revue de JA Racoosin et coll. (1) la codéine a été contre-indiquée avant 12 ans et, quel que soit l’âge, après une amygdalectomie. Le tramadol, utilisé en remplacement, ne semble pas plus sûr.
G Orliaguet et coll. rapportent un cas de dépression respiratoire chez un garçon de 5 ans et demi qui avait subi une amygdalectomie + une adénoïdectomie pour un syndrome d’apnées obstructives du sommeil (2). L’enfant était rentré chez lui 6 h après l’intervention, et, à domicile, avait absorbé 20 mg de tramadol. Le lendemain, il était hospitalisé dans un état comateux avec une hypoventilation – des apnées et une acidose gazeuse- et un myosis. Il a vite récupéré une conscience et une respiration normales grâce à une brève ventilation nasale et 3 injections de naloxone. Sa dépression respiratoire était due à l’accumulation du métabolite M1 du tramadol. L’enfant était un « métaboliseur ultra-rapide » du tramadol parce qu’il était porteur de trois allèles du gène de l’isoenzyme hépatique CYP2D6 (génotype CYP2D6*2 x 2/ CYP2D6*2).
C’est le CYP2D6 (cytochrome P450 2D6) qui catalyse la transformation du tramadol en métabolite M1 (ou O-desméthyltramadol), agoniste des récepteurs mu du système nerveux central. Cette enzyme est soumise à un grand polymorphisme génétique (environ 80 allèles décrits), avec une variabilité de la répartition des allèles selon les ethnies et de l’efficacité des enzymes selon les allèles. D’après l’efficience de l’enzyme, on distingue des métaboliseurs lents, intermédiaires, rapides et ultra-rapides. Chez ces derniers, qui représentent 5,5 % des habitants de l’Ouest de l’Europe, la production du métabolite M1 est très rapide et fait courir un risque de dépression respiratoire.
Ce cas clinique rappelle que le tramadol expose les enfants au même risque de dépression respiratoire que la codéine et que ce risque n’est pas prévisible, le dépistage anticipé des sujets métaboliseurs ultra-rapides du tramadol ne semblant pas réaliste. Faut-il interdire tous les opioïdes faibles comme analgésiques ? Et dans l’affirmative ne peut-on craindre une régression dans la prise en charge de la douleur postopératoire à domicile ? Pour la Société Française d’ORL (octobre 2014) c’est au clinicien de choisir l’analgésique à rajouter au paracétamol après une amygdalectomie, en préférant le tramadol en cas de risque hémorragique élevé (troubles de l’hémostase, difficultés opératoires …), et les anti-inflammatoires non stéroïdiens en cas de risque de dépression respiratoire élevé (syndrome des apnées obstructives du sommeil, comorbidités…). De son côté, la HAS prépare de nouvelles recommandations sur le sujet.
Dr Jean-Marc Retbi
Références
1. Racoosin JA et coll. : New evidence about an old drug – risk with codeine after adenotonsillectomy. N Engl J Med., 2013; 368: 2155-2157
2. Orliaguet G et coll. : A case of respiratory depression in a child with ultrarapid CYP2D6 metabolism after tramadol. Pediatrics2015; 135: e753-e755
jim.fr
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2507
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Le Point.fr - Publié le 02/03/15
Dépression : on pourrait anesthésier la souffrance...
Un dépressif sur trois n'est pas convenablement soigné... D'autres médicaments existent, dont un "gaz hilarant", pour retrouver la joie de vivre...
Le gaz hilarant pourrait devenir une solution pour ceux qui ne voient pas le bout du tunnel, malgré les médicaments.
par Anne Jeanblanc
Le constat est sévère : près d'un malade sur trois souffrant d'une dépression grave n'est pas correctement soulagé par les traitements médicamenteux disponibles actuellement. C'est pourquoi des chercheurs explorent de nouvelles pistes, des mécanismes d'action différents de ceux prescrits aujourd'hui. Et donc, d'autres cibles sur lesquelles agir. L'une d'elles semble particulièrement intéressante : elle porte le nom barbare de "récepteur au glutamate N-méthyl-D-aspartate". Le Journal international de médecine (le JIM, réservé aux professionnels de santé) vient de publier deux articles ayant trait à ce fameux NMDA, sur lequel agissent différents anesthésiques, dont le "gaz hilarant", un nom qui pourrait devenir synonyme de bonheur chez ceux qui ont perdu la capacité de rire...
Sous le titre "Kétamine : un coup dans le nez, c'est bon pour le moral", le JIM rappelle que l'efficacité rapide de la kétamine (qui est un anesthésique très utilisé) dans la dépression résistante est largement démontrée. Mais ce produit doit être injecté en intraveineuse, ce qui "limite son accessibilité", peut-on lire. C'est pourquoi des spécialistes ont cherché à l'employer autrement et ils ont comparé les effets de pulvérisations directes de ce médicament dans le nez de patients à ceux d'un simple sérum physiologique. Selon eux, au bout de 24 heures, les symptômes dépressifs ont diminué de moitié chez 44 % des malades (8 sur 18) après une administration de kétamine, contre 6 % avec le traitement placebo. Certes, leur étude n'a porté que sur vingt personnes et les bénéfices ont disparu au bout d'une semaine, mais c'est une première avancée non négligeable.
Le gaz hilarant pour retrouver le moral !
Un autre produit agit sur la même cible (NMDA) et son emploi est très fréquent en pédiatrie et en chirurgie dentaire, c'est le protoxyde d'azote ou "gaz hilarant", connu aussi pour ses propriétés euphorisantes. Le JIM détaille une étude menée là aussi chez 20 patients et contre placebo. Comme avec la kétamine, les malades inhalaient alternativement - une semaine sur deux et évidemment en "aveugle" - la substance thérapeutique ou un placebo. Au bout de 24 heures, 3 patients réellement traités étaient en rémission complète contre aucun dans le groupe placebo et les symptômes étaient diminués de moitié chez 4 patients traités contre 1 seul dans le groupe placebo. Cette fois encore, les effets positifs se sont maintenus une semaine.
Le gaz hilarant pourrait donc devenir une solution pour ceux qui ne voient pas le bout du tunnel, malgré les médicaments. Mais la conclusion du JIM appelle assez logiquement à la plus élémentaire des prudences : "Avant d'envoyer vos patients déprimés chez le dentiste, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une petite étude pilote, qu'il faudra répliquer. Et ici, plus que jamais, malgré toutes les précautions des investigateurs, le maintien de l'aveugle [à savoir si l'on reçoit le vrai produit ou le placebo, NDLR] est difficile, ce traitement entraînant des effets euphorisants immédiats si particuliers." Enfin, les auteurs se demandent si le "gaz hilarant" ne fait pas que masquer la dépression, sans pour autant la traiter. Ce qui serait évidemment moins drôle.
Dépression : on pourrait anesthésier la souffrance...
Un dépressif sur trois n'est pas convenablement soigné... D'autres médicaments existent, dont un "gaz hilarant", pour retrouver la joie de vivre...
Le gaz hilarant pourrait devenir une solution pour ceux qui ne voient pas le bout du tunnel, malgré les médicaments.
par Anne Jeanblanc
Le constat est sévère : près d'un malade sur trois souffrant d'une dépression grave n'est pas correctement soulagé par les traitements médicamenteux disponibles actuellement. C'est pourquoi des chercheurs explorent de nouvelles pistes, des mécanismes d'action différents de ceux prescrits aujourd'hui. Et donc, d'autres cibles sur lesquelles agir. L'une d'elles semble particulièrement intéressante : elle porte le nom barbare de "récepteur au glutamate N-méthyl-D-aspartate". Le Journal international de médecine (le JIM, réservé aux professionnels de santé) vient de publier deux articles ayant trait à ce fameux NMDA, sur lequel agissent différents anesthésiques, dont le "gaz hilarant", un nom qui pourrait devenir synonyme de bonheur chez ceux qui ont perdu la capacité de rire...
Sous le titre "Kétamine : un coup dans le nez, c'est bon pour le moral", le JIM rappelle que l'efficacité rapide de la kétamine (qui est un anesthésique très utilisé) dans la dépression résistante est largement démontrée. Mais ce produit doit être injecté en intraveineuse, ce qui "limite son accessibilité", peut-on lire. C'est pourquoi des spécialistes ont cherché à l'employer autrement et ils ont comparé les effets de pulvérisations directes de ce médicament dans le nez de patients à ceux d'un simple sérum physiologique. Selon eux, au bout de 24 heures, les symptômes dépressifs ont diminué de moitié chez 44 % des malades (8 sur 18) après une administration de kétamine, contre 6 % avec le traitement placebo. Certes, leur étude n'a porté que sur vingt personnes et les bénéfices ont disparu au bout d'une semaine, mais c'est une première avancée non négligeable.
Le gaz hilarant pour retrouver le moral !
Un autre produit agit sur la même cible (NMDA) et son emploi est très fréquent en pédiatrie et en chirurgie dentaire, c'est le protoxyde d'azote ou "gaz hilarant", connu aussi pour ses propriétés euphorisantes. Le JIM détaille une étude menée là aussi chez 20 patients et contre placebo. Comme avec la kétamine, les malades inhalaient alternativement - une semaine sur deux et évidemment en "aveugle" - la substance thérapeutique ou un placebo. Au bout de 24 heures, 3 patients réellement traités étaient en rémission complète contre aucun dans le groupe placebo et les symptômes étaient diminués de moitié chez 4 patients traités contre 1 seul dans le groupe placebo. Cette fois encore, les effets positifs se sont maintenus une semaine.
Le gaz hilarant pourrait donc devenir une solution pour ceux qui ne voient pas le bout du tunnel, malgré les médicaments. Mais la conclusion du JIM appelle assez logiquement à la plus élémentaire des prudences : "Avant d'envoyer vos patients déprimés chez le dentiste, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une petite étude pilote, qu'il faudra répliquer. Et ici, plus que jamais, malgré toutes les précautions des investigateurs, le maintien de l'aveugle [à savoir si l'on reçoit le vrai produit ou le placebo, NDLR] est difficile, ce traitement entraînant des effets euphorisants immédiats si particuliers." Enfin, les auteurs se demandent si le "gaz hilarant" ne fait pas que masquer la dépression, sans pour autant la traiter. Ce qui serait évidemment moins drôle.
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2507
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Une hypothermie après un arrêt cardiaque chez l’enfant ?
Publié le 12/05/2015 (source jim.fr)
L’hypothermie thérapeutique modérée a deux indications : l’encéphalopathie hypoxique-ischémique du nouveau-né à terme et l’arrêt cardio-respiratoire [ACR] de l’adulte. Faut-il l’étendre aux enfants ayant fait un ACR pour améliorer leur pronostic vital et neurocognitif ? Deux essais randomisés ont été montés dans ce but en Amérique du Nord : l’essai THAPCA-OH* pour les ACR survenant hors d’un hôpital, en général accidentels (noyade, strangulation, traumatisme, etc.) et l’essai THAPCA-IH* pour les ACR survenant dans un hôpital, en général au cours de pathologies médicales connues.
L’essai THAPCA-OH est clos et analysé, et ses résultats ont été simultanément présentés au Congrès 2015 des Pediatric Academic Societies à San Diego (USA) et publiés en ligne dans le New England Journal of Medecine (1).
Trente-six unités de réanimation pédiatrique des USA et du Canada ont recruté 295 enfants âgés de 2 jours à 18 ans, victimes d’un ACR, dont la circulation était rétablie après > 2 minutes de massage cardiaque, mais qui restaient comateux et dépendants d’une ventilation mécanique. (Seulement 8 % d’entre eux ont présenté une fibrillation ou une tachycardie ventriculaire).
Dans les 6 h suivant le rétablissement de la circulation, 155 patients ont été affectés par tirage au sort à une « hypothermie thérapeutique » (avec une cible de température centrale de 33°C pendant 48 h, puis de 36°8C pendant 72 h), et 140 à la « normothermie » (avec une cible de température de 36°8C). La température cible était obtenue et maintenue avec des couvertures à circulation d’eau, aussi bien pour l’hypothermie que pour la normothermie, pendant un total de 5 jours, pour prévenir la fièvre, nocive après un ACR. Tous les patients étaient de plus soumis à une curarisation et à une sédation-analgésie.
Des résultats similaires pour les deux stratégies
A l’âge de 1 an, il n’y avait pas de différence significative entre le groupe mis en hypothermie et le groupe maintenu en normothermie :
- concernant la survie (295 enfants) : 38 % de survivants après hypothermie versus 29 % de survivants après normothermie (Relative likelihood : 1,29 ; Intervalle de Confiance 95 % : 0,93-1,79 ; p = 0,13).
- concernant la survie avec un état neurocognitif satisfaisant (260 enfants, pour lesquels l’état pré-ACR était bon) : au VABS-II (Vineland Adaptative Behavior Scale, 2e éd.), un test de comportement adaptatif, 20 % de scores >70 (c’est à dire > - 2 DS) après hypothermie versus 12 % après normothermie (RL : 1,54 ; IC 95 % : 0,86-2,76 ; p = 0,14).
Ainsi, les deux traitements contribuent à contrôler la température centrale et donnent des résultats similaires. En l’absence d’avantage neurocognitif de l’hypothermie à l’âge de 1 an, on peut être tenté de conclure que le transfert d’un enfant victime d’un ACR vers un centre capable de réaliser une hypothermie ne s’impose pas, du moins si l’arrêt cardiaque a eu lieu hors d’un hôpital (THAPCA-IH* n’est pas terminé), et qu’un contrôle strict de la température centrale est suffisant, comme cela a été démontré récemment chez l’adulte (2).
Mais une tendance en faveur de l’hypothermie
Il y a tout de même une tendance en faveur de l’hypothermie thérapeutique. La différence peut avoir été atténuée par la prévention de la fièvre dans le groupe « normothermie » ; il aurait fallu un essai plus puissant. Ou encore, le bénéfice de l’hypothermie peut ne concerner qu’un sous-groupe ; des analyses secondaires auraient été intéressantes. De toute façon, on n’a pas d’autre traitement à proposer. FW Moler, co-investigateur principal de THAPCA-OH, présume que les recommandations de l’ILCOR (International Liaison Committee On Resuscitation) qui paraîtront fin 2015, stipuleront que l’hypothermie thérapeutique et la normothermie sont deux options valables dans les ACR de l’enfant.
* THAPCA : Therapeutic Hypothermia After Pediatric Cardiac Arrest ; OH : out-of-hospital; IH: in-hospital
Dr Jean-Marc Retbi
Références
1. Moler FW et coll. : Therapeutic hypothermia after out-of-hospital cardiac arrest in children. New Engl J Med., 2015 ; publication avancée en ligne du 25 avril. DOI :10.1056/NEJMoa1411480
2. Nielsen N et coll. : Targeted temperature management at 33°C versus 36°C after cardiac arrest. N Engl J Med 2013; 369: 2197-2206
-------------
Aspirine en péri-opératoire : trop de risques hémorragiques
Publié le 16/04/2014
L’infarctus du myocarde reste l’une des complications vasculaires majeures après une intervention chirurgicale non cardiaque. Les mécanismes qui en sont responsables sont complexes, interdépendants et parfois contradictoires : hémorragies, tachycardie, hypertension ou hypotension, spasme coronaire, etc.
La chirurgie non cardiaque est associée à une activation plaquettaire qui elle-même pourrait être à l’origine d’une thrombose des coronaires, provoquant l’infarctus myocardique post-chirurgical. La formation de ce thrombus pourrait être évitée par la prise préventive d’aspirine en péri-opératoire. L’aspirine a bien fait la preuve de son intérêt dans la prévention de l’infarctus du myocarde et d’accidents vasculaires majeurs chez des patients en dehors de situations chirurgicales.
Le New England Journal of Medicine publie les résultats d’une étude réalisée sur plus de 10 000 patients, à risque de complications vasculaires, en attente d’une intervention chirurgicale non cardiaque. Les patients ont été divisés en deux groupes, les uns recevant de l’aspirine (n = 4 998), les autres un placebo (n = 5 012). Le traitement a été débuté à la dose de 200 mg juste avant l’intervention, et poursuivi à 100 mg pendant 30 jours chez les 5 628 patients qui en prenaient pour la première fois ou pendant 7 jours chez ceux qui étaient sous aspirine au long cours qui continuaient ensuite selon leur posologie habituelle. Les auteurs précisent avoir exclu de l’étude les sujets ayant bénéficié de la pose d’un stent nu depuis moins de 6 semaines ou d’un stent actif depuis moins d’1 an.
L’objectif de l’étude était de comparer l’incidence à 30 jours des décès et des infarctus non létaux chez les sujets sous aspirine et ceux sous placebo.
Cette incidence est de 7 % chez les premiers et de 7,1 % chez les seconds (Hazard ratio [HR] 0,99 ; intervalle de confiance à 95 % [IC] 0,86 à 1,15). En revanche, le risque d’hémorragie sévère est significativement augmenté sous aspirine (4,6 % vs 3,8 % ; HR 1,23 ; IC 1,01 à 1,49), le saignement survenant le plus souvent au niveau du site opératoire (78,3 %) ou gastro-intestinal (9,3 %). Les résultats sont les mêmes dans les deux sous-groupes, c’est-à-dire les patients n’ayant jamais pris d’aspirine et ceux en traitement continu.
Les auteurs, estiment que ces résultats suggèrent non seulement que l’aspirine en péri-opératoire ne diminue pas le risque de décès et d’infarctus, mais aussi que les patients sous aspirine au long cours devraient interrompre leur traitement au moins 3 jours avant l’intervention pour le reprendre 8 à 10 jours après, quand le risque hémorragique a diminué. Une attitude qui doit sans doute être revue au cas par cas.
Dr Roseline Péluchon
Références
Devereaux P.J. et coll. : Aspirin in Patients Undergoing Non cardiac Surgery
N Engl J Med., 2014; publication avancée en ligne le 31 mars. DOI: 10.1056/NEJMoa1401105
Copyright © http://www.jim.fr
Publié le 12/05/2015 (source jim.fr)
L’hypothermie thérapeutique modérée a deux indications : l’encéphalopathie hypoxique-ischémique du nouveau-né à terme et l’arrêt cardio-respiratoire [ACR] de l’adulte. Faut-il l’étendre aux enfants ayant fait un ACR pour améliorer leur pronostic vital et neurocognitif ? Deux essais randomisés ont été montés dans ce but en Amérique du Nord : l’essai THAPCA-OH* pour les ACR survenant hors d’un hôpital, en général accidentels (noyade, strangulation, traumatisme, etc.) et l’essai THAPCA-IH* pour les ACR survenant dans un hôpital, en général au cours de pathologies médicales connues.
L’essai THAPCA-OH est clos et analysé, et ses résultats ont été simultanément présentés au Congrès 2015 des Pediatric Academic Societies à San Diego (USA) et publiés en ligne dans le New England Journal of Medecine (1).
Trente-six unités de réanimation pédiatrique des USA et du Canada ont recruté 295 enfants âgés de 2 jours à 18 ans, victimes d’un ACR, dont la circulation était rétablie après > 2 minutes de massage cardiaque, mais qui restaient comateux et dépendants d’une ventilation mécanique. (Seulement 8 % d’entre eux ont présenté une fibrillation ou une tachycardie ventriculaire).
Dans les 6 h suivant le rétablissement de la circulation, 155 patients ont été affectés par tirage au sort à une « hypothermie thérapeutique » (avec une cible de température centrale de 33°C pendant 48 h, puis de 36°8C pendant 72 h), et 140 à la « normothermie » (avec une cible de température de 36°8C). La température cible était obtenue et maintenue avec des couvertures à circulation d’eau, aussi bien pour l’hypothermie que pour la normothermie, pendant un total de 5 jours, pour prévenir la fièvre, nocive après un ACR. Tous les patients étaient de plus soumis à une curarisation et à une sédation-analgésie.
Des résultats similaires pour les deux stratégies
A l’âge de 1 an, il n’y avait pas de différence significative entre le groupe mis en hypothermie et le groupe maintenu en normothermie :
- concernant la survie (295 enfants) : 38 % de survivants après hypothermie versus 29 % de survivants après normothermie (Relative likelihood : 1,29 ; Intervalle de Confiance 95 % : 0,93-1,79 ; p = 0,13).
- concernant la survie avec un état neurocognitif satisfaisant (260 enfants, pour lesquels l’état pré-ACR était bon) : au VABS-II (Vineland Adaptative Behavior Scale, 2e éd.), un test de comportement adaptatif, 20 % de scores >70 (c’est à dire > - 2 DS) après hypothermie versus 12 % après normothermie (RL : 1,54 ; IC 95 % : 0,86-2,76 ; p = 0,14).
Ainsi, les deux traitements contribuent à contrôler la température centrale et donnent des résultats similaires. En l’absence d’avantage neurocognitif de l’hypothermie à l’âge de 1 an, on peut être tenté de conclure que le transfert d’un enfant victime d’un ACR vers un centre capable de réaliser une hypothermie ne s’impose pas, du moins si l’arrêt cardiaque a eu lieu hors d’un hôpital (THAPCA-IH* n’est pas terminé), et qu’un contrôle strict de la température centrale est suffisant, comme cela a été démontré récemment chez l’adulte (2).
Mais une tendance en faveur de l’hypothermie
Il y a tout de même une tendance en faveur de l’hypothermie thérapeutique. La différence peut avoir été atténuée par la prévention de la fièvre dans le groupe « normothermie » ; il aurait fallu un essai plus puissant. Ou encore, le bénéfice de l’hypothermie peut ne concerner qu’un sous-groupe ; des analyses secondaires auraient été intéressantes. De toute façon, on n’a pas d’autre traitement à proposer. FW Moler, co-investigateur principal de THAPCA-OH, présume que les recommandations de l’ILCOR (International Liaison Committee On Resuscitation) qui paraîtront fin 2015, stipuleront que l’hypothermie thérapeutique et la normothermie sont deux options valables dans les ACR de l’enfant.
* THAPCA : Therapeutic Hypothermia After Pediatric Cardiac Arrest ; OH : out-of-hospital; IH: in-hospital
Dr Jean-Marc Retbi
Références
1. Moler FW et coll. : Therapeutic hypothermia after out-of-hospital cardiac arrest in children. New Engl J Med., 2015 ; publication avancée en ligne du 25 avril. DOI :10.1056/NEJMoa1411480
2. Nielsen N et coll. : Targeted temperature management at 33°C versus 36°C after cardiac arrest. N Engl J Med 2013; 369: 2197-2206
-------------
Aspirine en péri-opératoire : trop de risques hémorragiques
Publié le 16/04/2014
L’infarctus du myocarde reste l’une des complications vasculaires majeures après une intervention chirurgicale non cardiaque. Les mécanismes qui en sont responsables sont complexes, interdépendants et parfois contradictoires : hémorragies, tachycardie, hypertension ou hypotension, spasme coronaire, etc.
La chirurgie non cardiaque est associée à une activation plaquettaire qui elle-même pourrait être à l’origine d’une thrombose des coronaires, provoquant l’infarctus myocardique post-chirurgical. La formation de ce thrombus pourrait être évitée par la prise préventive d’aspirine en péri-opératoire. L’aspirine a bien fait la preuve de son intérêt dans la prévention de l’infarctus du myocarde et d’accidents vasculaires majeurs chez des patients en dehors de situations chirurgicales.
Le New England Journal of Medicine publie les résultats d’une étude réalisée sur plus de 10 000 patients, à risque de complications vasculaires, en attente d’une intervention chirurgicale non cardiaque. Les patients ont été divisés en deux groupes, les uns recevant de l’aspirine (n = 4 998), les autres un placebo (n = 5 012). Le traitement a été débuté à la dose de 200 mg juste avant l’intervention, et poursuivi à 100 mg pendant 30 jours chez les 5 628 patients qui en prenaient pour la première fois ou pendant 7 jours chez ceux qui étaient sous aspirine au long cours qui continuaient ensuite selon leur posologie habituelle. Les auteurs précisent avoir exclu de l’étude les sujets ayant bénéficié de la pose d’un stent nu depuis moins de 6 semaines ou d’un stent actif depuis moins d’1 an.
L’objectif de l’étude était de comparer l’incidence à 30 jours des décès et des infarctus non létaux chez les sujets sous aspirine et ceux sous placebo.
Cette incidence est de 7 % chez les premiers et de 7,1 % chez les seconds (Hazard ratio [HR] 0,99 ; intervalle de confiance à 95 % [IC] 0,86 à 1,15). En revanche, le risque d’hémorragie sévère est significativement augmenté sous aspirine (4,6 % vs 3,8 % ; HR 1,23 ; IC 1,01 à 1,49), le saignement survenant le plus souvent au niveau du site opératoire (78,3 %) ou gastro-intestinal (9,3 %). Les résultats sont les mêmes dans les deux sous-groupes, c’est-à-dire les patients n’ayant jamais pris d’aspirine et ceux en traitement continu.
Les auteurs, estiment que ces résultats suggèrent non seulement que l’aspirine en péri-opératoire ne diminue pas le risque de décès et d’infarctus, mais aussi que les patients sous aspirine au long cours devraient interrompre leur traitement au moins 3 jours avant l’intervention pour le reprendre 8 à 10 jours après, quand le risque hémorragique a diminué. Une attitude qui doit sans doute être revue au cas par cas.
Dr Roseline Péluchon
Références
Devereaux P.J. et coll. : Aspirin in Patients Undergoing Non cardiac Surgery
N Engl J Med., 2014; publication avancée en ligne le 31 mars. DOI: 10.1056/NEJMoa1401105
Copyright © http://www.jim.fr
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade