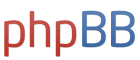Articles sur la santé
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2506
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Publié le 14/08/2023
Vidéo vs Laryngoscopie directe pour l’intubation aux Urgences et en soins critiques : avantage à la vidéo-laryngoscopie
Chaque année aux États-Unis, plus de 1,5 million d'adultes en état critique nécessitent une intubation trachéale dans un cadre autre que celui d’un bloc opératoire. L'échec de l'intubation lors de la première tentative survient dans 20 à 30 % des cas aux urgences ou en unité de soins critiques (USC) et est associé à un risque accru de complications mettant en jeu le pronostic vital. Deux types de laryngoscopes sont couramment utilisés pour réaliser l'intubation trachéale : le « bon vieux » laryngoscope direct et le « fringant » vidéo-laryngoscope.
Ce dernier comprend les mêmes éléments que le laryngoscope direct, mais il est également équipé d'une caméra placée dans la moitié distale de la lame qui transmet les images à un écran. Avec l'aide de l'écran vidéo pour visualiser les cordes vocales (laryngoscopie indirecte), un clinicien peut guider une sonde endotrachéale à travers les cordes vocales sans ligne de visée directe depuis la bouche.
Bien qu'environ 80 % des intubations réalisées dans les services d'urgence et les USC du monde entier soient effectuées à l'aide d'un laryngoscope, l'utilisation des vidéo-laryngoscopes a augmenté au fil du temps. Plusieurs études monocentriques et une étude multicentrique de taille modérée ont été menées afin de comparer les résultats des deux techniques avec des résultats mitigés. De plus, il n'est pas certain que les résultats des études sur la vidéo-laryngoscopie au bloc opératoire s'appliquent aux Urgences et en USC.
Afin de déterminer l'effet de l'utilisation d'un vidéo-laryngoscope par rapport à un laryngoscope direct sur l'incidence d'une intubation trachéale réussie lors de la première tentative chez des adultes aux urgences et en USC, les auteurs ont mené l'essai Direct versus Video Laryngoscope (randomisé multicentrique mené dans 17 services d'Urgences et USC), en émettant l'hypothèse que l'utilisation d'un vidéo-laryngoscope entraînerait une incidence plus élevée d'intubations réussies lors de la première tentative.
Les adultes en état critique ont été répartis de façon aléatoire entre le groupe vidéo-laryngoscope et le groupe laryngoscopie directe. Le résultat principal était la réussite de l'intubation à la première tentative. Le résultat secondaire était la survenue de complications graves pendant l'intubation définies comme une hypoxémie sévère, une hypotension sévère, une utilisation nouvelle ou accrue de vasopresseurs, un arrêt cardiaque ou un décès.
Essai interrompu pour cause d’efficacité
Parmi les 1 417 patients inclus dans l'analyse finale (91,5 % d'entre eux ont subi une intubation effectuée par un résident en médecine d'urgence ou en USC), une intubation réussie à la première tentative a été obtenue chez 600 des 705 patients (85,1 %) du groupe vidéo-laryngoscopie et chez 504 des 712 patients (70,8 %) du groupe laryngoscopie directe (différence de risque absolu, 14,3 points de pourcentage ; IC à 95 %, 9,9 à 18,7 ; p < 0,001).
Au total, 151 patients (21,4 %) du groupe vidéo-laryngoscopie et 149 patients (20,9 %) du groupe laryngoscopie directe ont présenté une complication grave pendant l'intubation (différence de risque absolu, 0,5 point de pourcentage ; IC à 95 %, -3,9 à 4,9). Les résultats en matière de sécurité, y compris l'intubation œsophagienne, les lésions dentaires et l'aspiration, étaient similaires dans les deux groupes.
Parmi les adultes en état critiques soumis à une intubation trachéale dans un service d'Urgences ou en USC, l'utilisation du vidéo-laryngoscope a entraîné une incidence plus élevée d'intubation réussie lors de la première tentative que l'utilisation du laryngoscope traditionnel.
Des limites qui ne permettent pas de généraliser les conclusions
Comme les opérateurs ont choisi la marque du vidéo-laryngoscope et la forme de la lame, ces résultats ne peuvent pas être utilisés pour déterminer les caractéristiques techniques, qui permettraient d'obtenir les meilleurs résultats. De plus, cette étude ne permet pas de déterminer la meilleure technique d’intubation trachéale au bloc opératoire. Notons également que 97 % des opérateurs avaient effectué au préalable moins de 250 intubations trachéales, les résultats obtenus dans cette étude peuvent ne pas s'appliquer à des opérateurs plus expérimentés. Enfin, patients, cliniciens et personnel de l'essai étaient au courant de l'affectation des groupes à l'essai.
Dr Bernard-Alex Gaüzère
Jim.fr
Référence
Prekker ME, et coll. DEVICE Investigators and the Pragmatic Critical Care Research Group. Video versus Direct Laryngoscopy for Tracheal Intubation of Critically Ill Adults. N Engl J Med. 2023 Aug 3;389(5):418-429. doi: 10.1056/NEJMoa2301601. PMID: 37326325.
Le "truc" qui m'amuse toujours autant, dans son manque de logique : globalement l'IADE est pratiquement toujours à la tête, lors d'une induction à 4 mains. Quand il ou elle n'arrive pas à intuber (alors qu'il ou elle a quelques centaines, milliers ou dizaines de milliers d'IOT de pratique) l'iade passe la main au mar (ce qui en soi est bien de ne pas s'acharner, il faut savoir passer la main). Mais concrètement on passe la main à une personne ayant certainement à son tableau de chasse moins de pratique que l'IADE. De là à dire qu'il est fatalement meilleur, c'est un raccourci que je ne prendrai pas, malgré l'omniscience, l'omnipotence et l'omnitout (le fameux toutologue) médical...
C'est juste une réflexion.
_________________
Publié le 23/08/2023
Marcher en comptant ? Hommes et femmes n’ont pas les mêmes priorités !
La double tâche, action d'effectuer deux tâches simultanément, l’une étant dite « primaire » et l’autre « secondaire », est omniprésente dans la vie quotidienne. En particulier, la grande majorité des tâches de mobilité que nous effectuons (par exemple, se tenir debout, marcher) se produisent alors que nous sommes distraits par une autre tâche motrice et/ou cognitive (tâche attentionnelle).
Les performances de l’une ou des deux tâches sont diminuées lors de la simultanéité, la stratégie usuelle étant de prioriser l’une par rapport à l'autre. Cet « effet de double tache » a tendance à augmenter avec l’âge. Dans le contexte de la marche, cela peut conduire à des stratégies dites de « marche prioritaire » ou de « marche secondaire » selon si les personnes portent prioritairement leur attention sur la mobilité ou sur les tâches cognitives, respectivement.
Par exemple certains individus « arrêtent de marcher en parlant », privilégiant ainsi la tâche cognitive (conversation) sur la tâche posturale (marcher). Plusieurs études ont pu montrer que chez les personnes âgées, celles qui adoptent cette stratégie sont plus susceptibles de chuter dans les 6 mois comparativement à celles qui recourent à une « marche prioritaire ». Quels facteurs influencent cette priorisation ?
Certains travaux récents indiquent que le sexe peut jouer un rôle dans la priorisation lors des tâches de mobilité. Une étude a évalué l’impact du sexe sur les performances de la double tâche et la hiérarchisation entre la marche et les stimuli secondaires distrayants, en contrôlant les facteurs de confusion tels que l'âge et la cognition globale (Montreal Cognitive Assessment, MoCA).
Un surrisque de chutes ?
Une centaine de personnes âgées neurotypiques ont participé à cette étude. Le test TUG (Timed Up and Go)* a été réalisé avec et sans tâche cognitive secondaire (compter à rebours 3 par 3). La marche (temps nécessaire pour terminer le TUG) et les performances cognitives (taux de nombres corrects répertoriés) ont été enregistrées pendant les tâches en simple et en double tâche. Les effets de la double tache ont été calculés pour les performances cognitives et de marche.
La priorisation a été calculée comme la différence entre les effets de la simultanéité sur la cognition et la marche. A l’analyse, des effets d'interaction entre le sexe et la condition (simple ou double tâche) ont ainsi été mis en évidence (marche : F1,96=8,7 ; p=0,004 ; cognition : F1,96=5,2 ; p=0,024). Par rapport aux participants masculins, les femmes présentaient des effets de la double tache sur le versant cognitif plus faibles que les hommes mais inversement des effets plus importants sur la marche. De même, les femmes présentaient des scores de priorisation significativement plus élevés (F1,95=10,0, p=0,002), confirmant une priorisation cognitive plus importante par rapport aux hommes.
D’après les résultats de cette étude, la population des femmes âgées, lors d’une double tache, a tendance à prioriser la tache cognitive sur celle de marche. Compte tenu du lien démontré entre les stratégies de posture secondaire et les chutes, ces conclusions suggèrent un risque accru de chute chez les femmes avec l’âge par rapport aux hommes. Des travaux supplémentaires sont néanmoins nécessaires pour confirmer ces conclusions et leur éventuelle pertinence clinique.
*TUG : test d’évaluation de la mobilité et de l’équilibre ; le sujet se met debout à partir d’une chaise, marche une distance de 3 mètres à vitesse confortable et sécuritaire, puis retourne à la chaise en marchant pour se rassoir ; le temps est mesuré depuis l’instruction verbale « go » jusqu’au moment où le sujet retourne en position assise.
Anne-Céline Rigaud
Référence
Peterson DS. Effects of gender on dual-tasking and prioritization in older adults. Gait Posture. 2022 Sep;97:104-108. doi: 10.1016/j.gaitpost.2022.07.247.
Il parait que nous ne sommes pas bons pour faire deux choses à la fois... réponse scientifique à l'appui, la donne change.
Vidéo vs Laryngoscopie directe pour l’intubation aux Urgences et en soins critiques : avantage à la vidéo-laryngoscopie
Chaque année aux États-Unis, plus de 1,5 million d'adultes en état critique nécessitent une intubation trachéale dans un cadre autre que celui d’un bloc opératoire. L'échec de l'intubation lors de la première tentative survient dans 20 à 30 % des cas aux urgences ou en unité de soins critiques (USC) et est associé à un risque accru de complications mettant en jeu le pronostic vital. Deux types de laryngoscopes sont couramment utilisés pour réaliser l'intubation trachéale : le « bon vieux » laryngoscope direct et le « fringant » vidéo-laryngoscope.
Ce dernier comprend les mêmes éléments que le laryngoscope direct, mais il est également équipé d'une caméra placée dans la moitié distale de la lame qui transmet les images à un écran. Avec l'aide de l'écran vidéo pour visualiser les cordes vocales (laryngoscopie indirecte), un clinicien peut guider une sonde endotrachéale à travers les cordes vocales sans ligne de visée directe depuis la bouche.
Bien qu'environ 80 % des intubations réalisées dans les services d'urgence et les USC du monde entier soient effectuées à l'aide d'un laryngoscope, l'utilisation des vidéo-laryngoscopes a augmenté au fil du temps. Plusieurs études monocentriques et une étude multicentrique de taille modérée ont été menées afin de comparer les résultats des deux techniques avec des résultats mitigés. De plus, il n'est pas certain que les résultats des études sur la vidéo-laryngoscopie au bloc opératoire s'appliquent aux Urgences et en USC.
Afin de déterminer l'effet de l'utilisation d'un vidéo-laryngoscope par rapport à un laryngoscope direct sur l'incidence d'une intubation trachéale réussie lors de la première tentative chez des adultes aux urgences et en USC, les auteurs ont mené l'essai Direct versus Video Laryngoscope (randomisé multicentrique mené dans 17 services d'Urgences et USC), en émettant l'hypothèse que l'utilisation d'un vidéo-laryngoscope entraînerait une incidence plus élevée d'intubations réussies lors de la première tentative.
Les adultes en état critique ont été répartis de façon aléatoire entre le groupe vidéo-laryngoscope et le groupe laryngoscopie directe. Le résultat principal était la réussite de l'intubation à la première tentative. Le résultat secondaire était la survenue de complications graves pendant l'intubation définies comme une hypoxémie sévère, une hypotension sévère, une utilisation nouvelle ou accrue de vasopresseurs, un arrêt cardiaque ou un décès.
Essai interrompu pour cause d’efficacité
Parmi les 1 417 patients inclus dans l'analyse finale (91,5 % d'entre eux ont subi une intubation effectuée par un résident en médecine d'urgence ou en USC), une intubation réussie à la première tentative a été obtenue chez 600 des 705 patients (85,1 %) du groupe vidéo-laryngoscopie et chez 504 des 712 patients (70,8 %) du groupe laryngoscopie directe (différence de risque absolu, 14,3 points de pourcentage ; IC à 95 %, 9,9 à 18,7 ; p < 0,001).
Au total, 151 patients (21,4 %) du groupe vidéo-laryngoscopie et 149 patients (20,9 %) du groupe laryngoscopie directe ont présenté une complication grave pendant l'intubation (différence de risque absolu, 0,5 point de pourcentage ; IC à 95 %, -3,9 à 4,9). Les résultats en matière de sécurité, y compris l'intubation œsophagienne, les lésions dentaires et l'aspiration, étaient similaires dans les deux groupes.
Parmi les adultes en état critiques soumis à une intubation trachéale dans un service d'Urgences ou en USC, l'utilisation du vidéo-laryngoscope a entraîné une incidence plus élevée d'intubation réussie lors de la première tentative que l'utilisation du laryngoscope traditionnel.
Des limites qui ne permettent pas de généraliser les conclusions
Comme les opérateurs ont choisi la marque du vidéo-laryngoscope et la forme de la lame, ces résultats ne peuvent pas être utilisés pour déterminer les caractéristiques techniques, qui permettraient d'obtenir les meilleurs résultats. De plus, cette étude ne permet pas de déterminer la meilleure technique d’intubation trachéale au bloc opératoire. Notons également que 97 % des opérateurs avaient effectué au préalable moins de 250 intubations trachéales, les résultats obtenus dans cette étude peuvent ne pas s'appliquer à des opérateurs plus expérimentés. Enfin, patients, cliniciens et personnel de l'essai étaient au courant de l'affectation des groupes à l'essai.
Dr Bernard-Alex Gaüzère
Jim.fr
Référence
Prekker ME, et coll. DEVICE Investigators and the Pragmatic Critical Care Research Group. Video versus Direct Laryngoscopy for Tracheal Intubation of Critically Ill Adults. N Engl J Med. 2023 Aug 3;389(5):418-429. doi: 10.1056/NEJMoa2301601. PMID: 37326325.
Le "truc" qui m'amuse toujours autant, dans son manque de logique : globalement l'IADE est pratiquement toujours à la tête, lors d'une induction à 4 mains. Quand il ou elle n'arrive pas à intuber (alors qu'il ou elle a quelques centaines, milliers ou dizaines de milliers d'IOT de pratique) l'iade passe la main au mar (ce qui en soi est bien de ne pas s'acharner, il faut savoir passer la main). Mais concrètement on passe la main à une personne ayant certainement à son tableau de chasse moins de pratique que l'IADE. De là à dire qu'il est fatalement meilleur, c'est un raccourci que je ne prendrai pas, malgré l'omniscience, l'omnipotence et l'omnitout (le fameux toutologue) médical...
C'est juste une réflexion.
_________________
Publié le 23/08/2023
Marcher en comptant ? Hommes et femmes n’ont pas les mêmes priorités !
La double tâche, action d'effectuer deux tâches simultanément, l’une étant dite « primaire » et l’autre « secondaire », est omniprésente dans la vie quotidienne. En particulier, la grande majorité des tâches de mobilité que nous effectuons (par exemple, se tenir debout, marcher) se produisent alors que nous sommes distraits par une autre tâche motrice et/ou cognitive (tâche attentionnelle).
Les performances de l’une ou des deux tâches sont diminuées lors de la simultanéité, la stratégie usuelle étant de prioriser l’une par rapport à l'autre. Cet « effet de double tache » a tendance à augmenter avec l’âge. Dans le contexte de la marche, cela peut conduire à des stratégies dites de « marche prioritaire » ou de « marche secondaire » selon si les personnes portent prioritairement leur attention sur la mobilité ou sur les tâches cognitives, respectivement.
Par exemple certains individus « arrêtent de marcher en parlant », privilégiant ainsi la tâche cognitive (conversation) sur la tâche posturale (marcher). Plusieurs études ont pu montrer que chez les personnes âgées, celles qui adoptent cette stratégie sont plus susceptibles de chuter dans les 6 mois comparativement à celles qui recourent à une « marche prioritaire ». Quels facteurs influencent cette priorisation ?
Certains travaux récents indiquent que le sexe peut jouer un rôle dans la priorisation lors des tâches de mobilité. Une étude a évalué l’impact du sexe sur les performances de la double tâche et la hiérarchisation entre la marche et les stimuli secondaires distrayants, en contrôlant les facteurs de confusion tels que l'âge et la cognition globale (Montreal Cognitive Assessment, MoCA).
Un surrisque de chutes ?
Une centaine de personnes âgées neurotypiques ont participé à cette étude. Le test TUG (Timed Up and Go)* a été réalisé avec et sans tâche cognitive secondaire (compter à rebours 3 par 3). La marche (temps nécessaire pour terminer le TUG) et les performances cognitives (taux de nombres corrects répertoriés) ont été enregistrées pendant les tâches en simple et en double tâche. Les effets de la double tache ont été calculés pour les performances cognitives et de marche.
La priorisation a été calculée comme la différence entre les effets de la simultanéité sur la cognition et la marche. A l’analyse, des effets d'interaction entre le sexe et la condition (simple ou double tâche) ont ainsi été mis en évidence (marche : F1,96=8,7 ; p=0,004 ; cognition : F1,96=5,2 ; p=0,024). Par rapport aux participants masculins, les femmes présentaient des effets de la double tache sur le versant cognitif plus faibles que les hommes mais inversement des effets plus importants sur la marche. De même, les femmes présentaient des scores de priorisation significativement plus élevés (F1,95=10,0, p=0,002), confirmant une priorisation cognitive plus importante par rapport aux hommes.
D’après les résultats de cette étude, la population des femmes âgées, lors d’une double tache, a tendance à prioriser la tache cognitive sur celle de marche. Compte tenu du lien démontré entre les stratégies de posture secondaire et les chutes, ces conclusions suggèrent un risque accru de chute chez les femmes avec l’âge par rapport aux hommes. Des travaux supplémentaires sont néanmoins nécessaires pour confirmer ces conclusions et leur éventuelle pertinence clinique.
*TUG : test d’évaluation de la mobilité et de l’équilibre ; le sujet se met debout à partir d’une chaise, marche une distance de 3 mètres à vitesse confortable et sécuritaire, puis retourne à la chaise en marchant pour se rassoir ; le temps est mesuré depuis l’instruction verbale « go » jusqu’au moment où le sujet retourne en position assise.
Anne-Céline Rigaud
Référence
Peterson DS. Effects of gender on dual-tasking and prioritization in older adults. Gait Posture. 2022 Sep;97:104-108. doi: 10.1016/j.gaitpost.2022.07.247.
Il parait que nous ne sommes pas bons pour faire deux choses à la fois... réponse scientifique à l'appui, la donne change.
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2506
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Publié le 23/08/2023
Une étude confirme l’effet néfaste de l’exposition aux écrans chez les jeunes enfants
Tokyo, le mercredi 23 août 2023 – Une étude japonaise confirme que plus le temps d’exposition des enfants aux écrans est long, plus le risque de présenter des retards de développement est grand.
« Pas d’écran avant trois ans ». La recommandation à destination des parents pour leurs enfants est bien connue, même si elle est difficilement respectée (selon une étude menée en avril dernier, seulement 13 % des enfants de moins de trois ans ne regardent aucun écran). Si les effets néfastes des écrans sur le développement des enfants est suspecté depuis de nombreuses années, notamment depuis que les écrans, d’ordinateurs ou de smartphones, ont envahi notre quotidien, les conséquences précises d’une exposition aux écrans dès le plus jeune âge sont encore méconnues.
Une étude menée par des chercheurs de l’université de Tokyo et publiée ce lundi dans le Journal of the American Medical Association (JAMA) apporte plus de précisions sur les effets des écrans et permet notamment d’établir un lien entre le temps d’exposition et le risque de présenter des retards de développement. Les chercheurs japonais ont ainsi étudié plus de 7 000 enfants entre 2013 et 2017, divisés en quatre groupes selon leur durée d’exposition quotidienne aux écrans à l’âge d’un an : 48,5 % étaient exposés à une heure ou moins d’écran, 29,5 % entre une et deux heures d’écran, 18 % entre deux et quatre heures et 4 % à quatre heures d’écran ou plus.
Une corrélation entre le temps devant l’écran et le risque de retard de développement
Les chercheurs ont ensuite évalué le niveau de développement des enfants à l’âge de 2 et 4 ans, dans cinq domaines : la communication, la motricité globale, la motricité fine, la résolution de problèmes et les compétences sociales. Selon l’étude, les résultats sont sans appel : plus la durée d’exposition aux écrans à l’âge d’un an est prolongée, plus le risque de retard de développement à l’âge de 2 et 4 ans dans le domaine de la communication et de la résolution de problèmes est grand.
Ainsi, par rapport aux enfants qui n’ont été exposés qu’à une heure ou moins d’écran à l’âge d’un an, ceux qui ont regardé des écrans quotidiennement pendant une à deux heures ont un risque de retard du développement accru de 61 %. Le risque est multiplié par deux entre deux et quatre heures d’écran et par 4,8 au-delà de quatre heures d’exposition quotidienne aux écrans.
En revanche, le lien entre l’exposition aux écrans et un retard de développement moteur est plus ténu. Si les enfants fortement exposés aux écrans semblent plus à risque de présenter un tel retard à 2 ans, cette majoration du risque ne se maintient plus à l’âge de 4 ans. De même, aucun lien clair n’a pu être établi entre une exposition aux écrans et un retard dans le domaine des compétences sociales.
« Des associations ont été systématiquement observées dans les domaines de la communication et de la résolution de problèmes pour les enfants âgés de 2 et 4 ans et non dans le domaine des compétences personnelles et sociales à l'âge de 4 ans » résument les auteurs de l’étude. Selon eux, cela pourrait signifier que les effets de l’exposition des très jeunes enfants peuvent également dépendre du contenu auxquels les enfants sont exposés.
« Bien que le temps passé devant un écran ait été associé à un retard de développement, il peut avoir un aspect éducatif selon les programmes regardés sur les appareils électroniques » concluent les auteurs. Si les parents doivent donc en général ne pas trop exposer leurs très jeunes enfants à des écrans, ils doivent également faire attention au contenu regardé par leurs petites têtes blondes.
Quentin Haroche
JIM.fr
Et pour les adultes, une seule direction : l'application le guide IADE. La plus pertinente et complète application pour les IADE et les étudiants. En page d'accueil du site de la SOFIA version android ou Apple.
Une étude confirme l’effet néfaste de l’exposition aux écrans chez les jeunes enfants
Tokyo, le mercredi 23 août 2023 – Une étude japonaise confirme que plus le temps d’exposition des enfants aux écrans est long, plus le risque de présenter des retards de développement est grand.
« Pas d’écran avant trois ans ». La recommandation à destination des parents pour leurs enfants est bien connue, même si elle est difficilement respectée (selon une étude menée en avril dernier, seulement 13 % des enfants de moins de trois ans ne regardent aucun écran). Si les effets néfastes des écrans sur le développement des enfants est suspecté depuis de nombreuses années, notamment depuis que les écrans, d’ordinateurs ou de smartphones, ont envahi notre quotidien, les conséquences précises d’une exposition aux écrans dès le plus jeune âge sont encore méconnues.
Une étude menée par des chercheurs de l’université de Tokyo et publiée ce lundi dans le Journal of the American Medical Association (JAMA) apporte plus de précisions sur les effets des écrans et permet notamment d’établir un lien entre le temps d’exposition et le risque de présenter des retards de développement. Les chercheurs japonais ont ainsi étudié plus de 7 000 enfants entre 2013 et 2017, divisés en quatre groupes selon leur durée d’exposition quotidienne aux écrans à l’âge d’un an : 48,5 % étaient exposés à une heure ou moins d’écran, 29,5 % entre une et deux heures d’écran, 18 % entre deux et quatre heures et 4 % à quatre heures d’écran ou plus.
Une corrélation entre le temps devant l’écran et le risque de retard de développement
Les chercheurs ont ensuite évalué le niveau de développement des enfants à l’âge de 2 et 4 ans, dans cinq domaines : la communication, la motricité globale, la motricité fine, la résolution de problèmes et les compétences sociales. Selon l’étude, les résultats sont sans appel : plus la durée d’exposition aux écrans à l’âge d’un an est prolongée, plus le risque de retard de développement à l’âge de 2 et 4 ans dans le domaine de la communication et de la résolution de problèmes est grand.
Ainsi, par rapport aux enfants qui n’ont été exposés qu’à une heure ou moins d’écran à l’âge d’un an, ceux qui ont regardé des écrans quotidiennement pendant une à deux heures ont un risque de retard du développement accru de 61 %. Le risque est multiplié par deux entre deux et quatre heures d’écran et par 4,8 au-delà de quatre heures d’exposition quotidienne aux écrans.
En revanche, le lien entre l’exposition aux écrans et un retard de développement moteur est plus ténu. Si les enfants fortement exposés aux écrans semblent plus à risque de présenter un tel retard à 2 ans, cette majoration du risque ne se maintient plus à l’âge de 4 ans. De même, aucun lien clair n’a pu être établi entre une exposition aux écrans et un retard dans le domaine des compétences sociales.
« Des associations ont été systématiquement observées dans les domaines de la communication et de la résolution de problèmes pour les enfants âgés de 2 et 4 ans et non dans le domaine des compétences personnelles et sociales à l'âge de 4 ans » résument les auteurs de l’étude. Selon eux, cela pourrait signifier que les effets de l’exposition des très jeunes enfants peuvent également dépendre du contenu auxquels les enfants sont exposés.
« Bien que le temps passé devant un écran ait été associé à un retard de développement, il peut avoir un aspect éducatif selon les programmes regardés sur les appareils électroniques » concluent les auteurs. Si les parents doivent donc en général ne pas trop exposer leurs très jeunes enfants à des écrans, ils doivent également faire attention au contenu regardé par leurs petites têtes blondes.
Quentin Haroche
JIM.fr
Et pour les adultes, une seule direction : l'application le guide IADE. La plus pertinente et complète application pour les IADE et les étudiants. En page d'accueil du site de la SOFIA version android ou Apple.
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2506
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Publié le 24/08/2023
Près de la moitié des infirmières quittent l’hôpital après dix ans
Selon une étude de la Drees, seulement 54 % des infirmières exercent encore à l’hôpital dix ans après le début de leur carrière.
Le manque d’infirmières est sans doute le point central de la crise que traverse l’hôpital public depuis plusieurs années. Ce manque de personnel provoque des fermetures de lits, une surcharge de travail et une dégradation des conditions d’exercice pour les infirmières restantes, ce qui les pousse également à la démission dans un cercle vicieux bien connu. Si la résolution de ce problème passe par une augmentation du nombre d’infirmières formées, il est également primordial de tout faire pour retenir celles déjà formées à l’hôpital. Or, elles sont de plus en plus nombreuses à quitter le navire.
11 % des infirmières sont sans emploi dix ans après le début de carrière
En effet, une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) publiée ce mercredi a suivi le parcours professionnel des infirmières ayant débuté leur carrière à l’hôpital entre 1989 et 2019. Selon cette enquête, plus les années avancent, plus les infirmières quittent le salariat et l’hôpital.
Ainsi, cinq ans après leur entrée à l’hôpital, seulement 87 % des infirmières sont encore salariées, dont 67 % qui sont infirmières hospitalières, les autres étant soit infirmières salariées hors hôpital (9 %), soit sont salariées mais n’exercent plus comme infirmière (11 %). Dix ans après le début de la carrière, la proportion d’infirmières qui exerce toujours à l’hôpital n’est plus que de 54 % et on compte 11 % d’infirmières salariées hors hôpital (en Ehpad par exemple) et 14 % de salariées qui ne sont plus infirmières.
En parallèle, le nombre d’infirmières qui se tournent vers l’exercice libéral augmente logiquement avec les années, même s’il tend à stagner douze ans après le début de la carrière (à noter que l’exercice libéral est conditionné à une expérience minimale de deux ans comme infirmière salariée). Cinq ans après l’entrée dans la carrière, 9,4 % des infirmières exercent en libéral, dont 5 % en libéral exclusif et 4,4 % en exercice mixte. Après dix ans d’exercice, on compte 12,6 % d’infirmières libérales (10,5 % en exclusif et 2,1 % en exercice mixte). A noter que dix ans après l’arrivée à l’hôpital, on compte 11,4 % d’infirmières sans emploi.
Par ailleurs, l’étude montre que le désamour pour l’exercice hospitalier est plus fort chez les jeunes générations. Ainsi, 60 % des infirmières hospitalières qui ont commencé leur carrière au début des années 1990 l’étaient encore dix ans après, alors que ce taux n’est que de 50 % chez les infirmières ayant débuté leur carrière à la fin des années 2000.
Le SNPI demande un « plan Marshall » pour les infirmières
La Drees ne se penche pas sur les causes de cette grande démission et sur les raisons qui poussent les infirmières à fuir l’exercice hospitalier. Tout juste évacue-t-elle une hypothèse : ce n’est pas le fait d’être mère qui pousse les infirmières à changer leur mode de carrière. Ainsi, si le premier enfant survient généralement dans les dix premières années de carrière (26 % des infirmières sont mères en début de carrière, 79 % dix ans plus tard), cela n’a pas d’incidence sur leur mode d’exercice. En revanche, la naissance du premier enfant conduit à une baisse du nombre d’heures travaillées, lié à un passage en travail à temps partiel.
Le Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI) a immédiatement réagi à cette étude. « Comment s’étonner que des infirmières sous-payées, en sous-effectif, agressées par des patients et leurs familles et souvent victimes institutionnelles ne restent pas à l’hôpital ? » s’insurge le syndicat. Pour mettre fin à l’hémorragie et rendre à nouveau l’exercice hospitalier attractif, le SNPI demande la mise en place d’un « plan Marshall en trois points ».
Le syndicat demande ainsi aux autorités d’augmenter les salaires, d’instaurer un ratio de six à huit patients par infirmière et de travailler à l’amélioration des conditions de travail. « Alors qu’il y a déjà 60 000 postes infirmiers vacants et que 10 % des soignants sont en arrêt maladie, épuisement, dépression, burnout, il y a urgence à agir » tonne le syndicat.
Quentin Haroche
jim.fr
Depuis le temps que l'on méprise le "petit personnel", les sans grades se vengent. Les années passées où les mandarins considéraient les IDE comme des moins que rien, différence de classe sociale oblige, les infirmières prennent leur revanche. Elles quittent le navire. Et le navire qui ne voyait que le capitaine, s'aperçoit qu'il ne peut pas aller très loin sans le second. C'est très bien géré une fois de plus. On a tellement augmenté les médecins et si peu les IDE au cours des 30 dernières années, qu'à un moment le petit personnel est saturé. la crise covid en a été un révélateur.
Près de la moitié des infirmières quittent l’hôpital après dix ans
Selon une étude de la Drees, seulement 54 % des infirmières exercent encore à l’hôpital dix ans après le début de leur carrière.
Le manque d’infirmières est sans doute le point central de la crise que traverse l’hôpital public depuis plusieurs années. Ce manque de personnel provoque des fermetures de lits, une surcharge de travail et une dégradation des conditions d’exercice pour les infirmières restantes, ce qui les pousse également à la démission dans un cercle vicieux bien connu. Si la résolution de ce problème passe par une augmentation du nombre d’infirmières formées, il est également primordial de tout faire pour retenir celles déjà formées à l’hôpital. Or, elles sont de plus en plus nombreuses à quitter le navire.
11 % des infirmières sont sans emploi dix ans après le début de carrière
En effet, une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) publiée ce mercredi a suivi le parcours professionnel des infirmières ayant débuté leur carrière à l’hôpital entre 1989 et 2019. Selon cette enquête, plus les années avancent, plus les infirmières quittent le salariat et l’hôpital.
Ainsi, cinq ans après leur entrée à l’hôpital, seulement 87 % des infirmières sont encore salariées, dont 67 % qui sont infirmières hospitalières, les autres étant soit infirmières salariées hors hôpital (9 %), soit sont salariées mais n’exercent plus comme infirmière (11 %). Dix ans après le début de la carrière, la proportion d’infirmières qui exerce toujours à l’hôpital n’est plus que de 54 % et on compte 11 % d’infirmières salariées hors hôpital (en Ehpad par exemple) et 14 % de salariées qui ne sont plus infirmières.
En parallèle, le nombre d’infirmières qui se tournent vers l’exercice libéral augmente logiquement avec les années, même s’il tend à stagner douze ans après le début de la carrière (à noter que l’exercice libéral est conditionné à une expérience minimale de deux ans comme infirmière salariée). Cinq ans après l’entrée dans la carrière, 9,4 % des infirmières exercent en libéral, dont 5 % en libéral exclusif et 4,4 % en exercice mixte. Après dix ans d’exercice, on compte 12,6 % d’infirmières libérales (10,5 % en exclusif et 2,1 % en exercice mixte). A noter que dix ans après l’arrivée à l’hôpital, on compte 11,4 % d’infirmières sans emploi.
Par ailleurs, l’étude montre que le désamour pour l’exercice hospitalier est plus fort chez les jeunes générations. Ainsi, 60 % des infirmières hospitalières qui ont commencé leur carrière au début des années 1990 l’étaient encore dix ans après, alors que ce taux n’est que de 50 % chez les infirmières ayant débuté leur carrière à la fin des années 2000.
Le SNPI demande un « plan Marshall » pour les infirmières
La Drees ne se penche pas sur les causes de cette grande démission et sur les raisons qui poussent les infirmières à fuir l’exercice hospitalier. Tout juste évacue-t-elle une hypothèse : ce n’est pas le fait d’être mère qui pousse les infirmières à changer leur mode de carrière. Ainsi, si le premier enfant survient généralement dans les dix premières années de carrière (26 % des infirmières sont mères en début de carrière, 79 % dix ans plus tard), cela n’a pas d’incidence sur leur mode d’exercice. En revanche, la naissance du premier enfant conduit à une baisse du nombre d’heures travaillées, lié à un passage en travail à temps partiel.
Le Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI) a immédiatement réagi à cette étude. « Comment s’étonner que des infirmières sous-payées, en sous-effectif, agressées par des patients et leurs familles et souvent victimes institutionnelles ne restent pas à l’hôpital ? » s’insurge le syndicat. Pour mettre fin à l’hémorragie et rendre à nouveau l’exercice hospitalier attractif, le SNPI demande la mise en place d’un « plan Marshall en trois points ».
Le syndicat demande ainsi aux autorités d’augmenter les salaires, d’instaurer un ratio de six à huit patients par infirmière et de travailler à l’amélioration des conditions de travail. « Alors qu’il y a déjà 60 000 postes infirmiers vacants et que 10 % des soignants sont en arrêt maladie, épuisement, dépression, burnout, il y a urgence à agir » tonne le syndicat.
Quentin Haroche
jim.fr
Depuis le temps que l'on méprise le "petit personnel", les sans grades se vengent. Les années passées où les mandarins considéraient les IDE comme des moins que rien, différence de classe sociale oblige, les infirmières prennent leur revanche. Elles quittent le navire. Et le navire qui ne voyait que le capitaine, s'aperçoit qu'il ne peut pas aller très loin sans le second. C'est très bien géré une fois de plus. On a tellement augmenté les médecins et si peu les IDE au cours des 30 dernières années, qu'à un moment le petit personnel est saturé. la crise covid en a été un révélateur.
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2506
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Peste noire : l'origine de la pandémie se situerait en Asie centrale
Dr Thomas Kron
1er juillet 2022
Source medscape.com
La peste noire, qui a engendré la plus grande pandémie de l'histoire de l'humanité, trouverait son origine en Asie centrale, d’après les analyses d'anciens génomes de Yersinia pestis effectuées par une équipe de scientifiques, dont des chercheurs de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire de Leipzig, de l'université de Tübingen et de l'université de Stirling (Royaume-Uni) [1].
20 à 25 millions de morts
En 1347, la peste est arrivée pour la première fois dans le bassin méditerranéen par le biais de navires marchands en provenance de la mer Noire et de zones de peuplement de la Horde d'or (un ancien empire turco-mongol). La bactérie s'est rapidement propagée à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.
Selon les estimations des historiens, environ 20 à 25 millions de personnes (environ un tiers de la population européenne de l'époque) ont perdu la vie au cours d'une seule grande épidémie, connue également sous le nom de « mort noire ». Pour l’historien norvégien Ole Benedictow, elle aurait même frappé environ 60 % de la population européenne, soit 50 millions d'habitants sur 80.
Les analyses actuelles montrent cependant que toutes les régions d'Europe n'en ont pas souffert de la même manière [2]. Ainsi, l'historien de la médecine Manfred Vasold estime à environ 10% de la population le nombre de décès dus à l'épidémie en Allemagne [3].
L'écrivain italien Giovanni Boccaccio, témoin de la pandémie entre 1347 et 1353, a décrit de manière impressionnante ce qu'il a vécu dans son recueil de nouvelles Decamerone : « Ainsi, quiconque se serait promené en ville – surtout le matin – aurait pu voir d'innombrables cadavres. On faisait alors venir des civières ou, à défaut, on déposait les morts sur une simple planche. Il arrivait aussi que sur une civière on en emporte deux ou trois, et on aurait pu compter non pas une fois mais de nombreuses fois où la même civière portait les corps du mari et de la femme, ou de deux ou trois frères, ou du père et de son enfant. »
Cette première vague a conduit à une deuxième pandémie qui a duré 500 ans, se poursuivant jusqu'au début du 19ème siècle. Les origines de cette deuxième pandémie font depuis longtemps l'objet de débats chez les spécialistes. D’après l'une des théories les plus populaires, elle pourrait avoir pris naissance en Asie de l'Est, et plus particulièrement en Chine.
Cette théorie est cependant contredite par des découvertes archéologiques d'Asie centrale, provenant d'une région proche du lac Issyk Kul, dans l'actuel Kirghizstan, sur les contreforts des monts Tian Shan. Elles témoignent d'une épidémie de peste au sein d'une communauté commerciale locale en 1338 et 1339. Des fouilles menées il y a près de 140 ans ont permis de découvrir des pierres tombales dont les inscriptions indiquent que ces personnes ont été victimes d'une épidémie ou d'une « peste » inconnue. Depuis leur découverte, les pierres tombales inscrites en syriaque-araméen ont suscité la controverse dans les milieux spécialisés quant à leur signification pour la mort noire en Europe.
Une équipe de recherche internationale a analysé l'ADN ancien des restes humains et évalué les données historiques et archéologiques de deux sites où des témoins de la « peste » ont été découverts. Les premiers résultats étaient déjà encourageants : les chercheurs ont ainsi réussi à mettre en évidence de l'ADN de Yersinia pestis chez des personnes dont l'inscription sur la pierre tombale indique qu'elles sont mortes en 1338.
« Nous avons enfin pu prouver que l'épidémie mentionnée sur les pierres tombales était bien causée par la peste », affirme Phil Slavin, l'un des principaux auteurs de l'étude et historien à l'université de Sterling.
La souche d'origine de la mort noire identifiée
Jusqu'à présent, l'apparition de la mort noire a été associée à une diversification massive des souches de peste, ce que l'on appelle un « big bang de la diversité de la peste ». La date de cet événement n'a toutefois pas pu être déterminée avec précision – on la situait jusqu'à présent entre le 10ème et le 14ème siècle. Les chercheurs ont assemblé d'anciens génomes complets de la peste provenant des sites trouvés au Kirghizstan, examinant ensuite comment ils pourraient être liés à ce « big bang ».
« Nous avons découvert que les anciennes tribus du Kirghizistan se trouvaient exactement au point nodal de cet événement de diversification massive. Nous avons donc effectivement réussi à déterminer la souche d'origine de la mort noire et la date exacte de son apparition, qui était l'année 1338 », explique Maria Spyrou, première auteure de l’article publié par Nature et chercheuse à l'université de Tübingen [1].
Mais d'où vient cette souche ? S'est-elle développée localement ou a-t-elle été introduite dans la région avant de se propager ? La peste n'est pas une maladie d'origine humaine : Yersinia pestis survit dans les populations de rongeurs sauvages du monde entier, qui en constituent donc les réservoirs. L'ancienne souche d'Asie centrale à l'origine de l'épidémie 1338-1339 au lac Issyk Kul doit donc provenir d'un tel réservoir.
« Nous trouvons aujourd'hui des souches modernes, les plus proches de l'ancienne souche, dans des réservoirs de peste autour des montagnes Tian Shan, donc tout près de l'endroit où l’ancienne souche a été découverte. L'ancêtre de la mort noire semble donc être apparu en Asie centrale », conclut Johannes Krause, auteur principal de l'étude et directeur de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire.
Cet article a été publié initialement sur Univadis.de et intitulé Der Schwarze Tod: Der Ursprung der Pest-Pandemie liegt offenbar in Zentralasien . Traduction/adaptation du Dr Claude Leroy.
_________________
Quelles querelles d’égo derrière la découverte de l’insuline ?
Becky McCall
10 février 2022
La découverte de l’insuline il y a un siècle a révolutionné la vie de millions de patients et valu un prix Nobel à ses deux découvreurs, Banting et MacLeod. Pourtant, comme pour chaque découverte importante, l’histoire officielle ne retient que les principaux noms et oublie au passage des personnes-clés et les guerres d’égos qu’elles se sont livrées. La petite histoire dans la grande, que nous relate notre consœur Becky McCall.
Prêt à tout pour sauver son enfant d'une mort certaine due au diabète, le père de Leonard Thompson emmène son fils de 14 ans à l'hôpital général de Toronto le 11 janvier 1922 pour recevoir ce qui fut sans doute la première dose d'insuline administrée à un être humain. Alors qu’on lui prédisait une espérance de vie augmentée de quelques semaines – voire quelques mois au mieux –, de façon surprenante, le jeune Thompson a vécu 13 années supplémentaires, pour finalement mourir d'une pneumonie sans lien avec son diabète.
Cette histoire refait surface à l’occasion de la célébration du centenaire d'une découverte remarquable. L'insuline a, en effet, changé ce qui était autrefois une condamnation à mort en une espérance de vie presque normale pour les millions de personnes atteintes de diabète de type 1 au cours des 100 dernières années.
Mais derrière le succès bouleversant de cette découverte – et du prix Nobel qui l'a accompagné – se cache une autre histoire entachée par les affirmations contestées, les vérités biaisées et les probables injustices, alors que chacun se disputait une place d'honneur dans l'histoire de la médecine.
Kersten Hall, PhD, chercheur honoraire en histoire des sciences et des religions à l'Université de Leeds (Royaume-Uni) a parcouru les archives et les dossiers de patients stockés à l'Université de Toronto, Ontario, Canada, pour découvrir la petite histoire derrière la découverte de l'insuline.
Revenant sur les querelles des scientifiques, il affirme : « Il y a une distinction entre la science et les scientifiques. Les scientifiques sont des êtres humains merveilleusement imparfaits et complexes avec toutes leurs vertus et leurs vices, comme nous tous. Il n'est pas surprenant qu'ils puissent être avides, jaloux ou manquant d’assurance ».
Les scientifiques sont des êtres humains merveilleusement imparfaits et complexes avec toutes leurs vertus et leurs vices, comme nous tous. Kersten Hall
Des années 1920 à aujourd’hui
Avant la découverte de l'insuline en 1921, être diagnostiqué avec un diabète de type 1 plaçait quelqu'un au seuil de la mort, avec la famine comme seule option pour tenter de survivre. Sachant qu’à cette époque, la plupart des cas de diabète étaient probablement du diabète de type 1 car, avec des régimes moins obésogènes et une durée de vie plus courte, les gens étaient beaucoup moins susceptibles de développer un diabète de type 2.
De nos jours, il est largement reconnu que la prévalence du diabète de type 2 est sur une courbe ascendante abrupte, mais il en va de même pour le diabète de type 1. Si l’on s’en tient uniquement aux États-Unis, 1,5 million de personnes ont reçu un diagnostic de diabète de type 1, un nombre qui devrait atteindre environ 5 millions d'ici 2050, selon la Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF), une association d’aide aux diabétiques de type 1.
Fait intéressant, 100 ans après le premier patient traité, l'insuline à vie reste la seule véritable thérapie efficace pour les patients atteints de diabète de type 1. Une fois que les cellules bêta pancréatiques ont cessé de fonctionner et que la production d'insuline s'est arrêtée, le remplacement de l'insuline est le seul moyen de maintenir la glycémie dans la plage recommandée (A1c ≤ 48 mmol/mol [6,5 %]), selon National Institute for Health and Care Excellence (NICE) britannique et de nombreuses autres société savantes du diabète, dont l'American Diabetes Association (ADA).
Des essais cliniques préliminaires s’intéressent à la greffe de cellules souches, qualifiée prématurément de « remède » contre le diabète de type 1, comme alternative à l'insulinothérapie. La procédure consiste à transplanter des cellules dérivées de cellules souches, qui deviennent des cellules bêta fonctionnelles lorsqu'elles sont transplantées chez l'homme, mais nécessitent une immunosuppression (un frein à son développement).
Aujourd'hui, l'espérance de vie des personnes atteintes de diabète de type 1 traitées à l'insuline est proche de celle des non-diabétiques, bien que cela dépende du degré de contrôle de la glycémie. Certaines études montrent que l'espérance de vie des personnes atteintes de diabète de type 1 est inférieure d'environ 8 à 12 ans à celle de la population générale, mais varie selon l'endroit où vit la personne.
Dans certains pays à faible revenu, de nombreuses personnes atteintes de diabète de type 1 meurent encore prématurément, soit parce qu'elles ne sont pas diagnostiquées, soit parce qu'elles n'ont pas accès à l'insuline. Le coût élevé de l'insuline aux États-Unis est bien connu, et nombreux sont les patients qui meurent faute de moyens pour acheter de l'insuline.
Sans insuline, le jeune Leonard Thompson n’aurait pas eu la chance d'atteindre son 15e anniversaire.
« Ces patients étaient cachectiques et maigres, ils auraient pesé environ 40 à 50 livres (18 à 23 kg), ce qui est très peu pour un jeune adolescent. La survie était courte, de l’ordre de semaines ou de mois », remarque le Dr Elizabeth Stephens, endocrinologue à Portland dans l’Oregon.
« La découverte de l'insuline a vraiment été un miracle car sans elle, les patients diabétiques risquaient une mort certaine. Même de nos jours, si les gens ne reçoivent pas leur insuline parce qu'ils n'en ont pas les moyens ou pour une raison quelconque, le risque de décès reste important », souligne le Dr Stephens.
De la découverte des îlots pancréatiques à l’extrait purifié
C’est en 1869 que le Dr Paul Langerhans découvre les cellules des îlots pancréatiques, ou îlots de Langerhans, alors qu'il est étudiant en médecine. Les chercheurs essayent alors de produire des extraits qui abaissaient la glycémie, mais ceux-ci sont trop toxiques pour être utilisés par les patients.
Dans son livre récent, Insulin - the Crooked Timber, l’auteur Kersten Hall, ex-chercheur en biologie moléculaire, fait également référence au fait qu'un chercheur allemand appelé le Dr Georg Zuelzer a démontré chez six patients, en 1908, que les extraits pancréatiques pouvaient réduire les taux urinaires de glucose et de cétones, et que dans un cas, le traitement avait pu sortir un patient du coma. Le Dr Zuelzer avait purifié l'extrait avec de l'alcool mais les patients souffraient toujours de convulsions et de coma car ils subissaient, en fait, un choc hypoglycémique, que le Dr Zuelzer n'avait pas identifié comme tel.
« Il pensait que sa préparation contenait des impuretés – et c'est là toute l'ironie de l’histoire, car il avait entre les mains une préparation d'insuline si propre et si puissante qu'elle envoyait les animaux de test en état de choc hypoglycémique », souligne Kersten Hall.
C’est en 1921 que deux jeunes chercheurs, le Dr Frederick Banting, médecin praticien à Toronto, et un étudiant de dernière année en physiologie à l'Université de Toronto et Charles Best, MD, DSc, collaborent aux travaux de John Macleod, MBChB, professeur de physiologie à l'Université de Toronto, et supérieur de Charles Best, pour fabriquer des extraits pancréatiques, d'abord à partir de chiens, puis de bovins.
Au cours des mois précédents le traitement du jeune Thompson, Banting et Best travaillent tous deux au laboratoire à la préparation de l'extrait pancréatique de bovins et le testent sur des chiens atteints de diabète.
C’est donc, dans ce qui équivaudrait aujourd’hui à un essai de phase 1, avec un "n = 1", que Leonard Thompson, frêle et proche de la mort, reçoit 15 ml d'extrait pancréatique au Toronto General Hospital en janvier 1922. Son taux de glycémie chute alors de 25 %, mais malheureusement, son corps continue à produire des corps cétoniques, indiquant que l'effet antidiabétique est limité. Il présente également une réaction indésirable au point d'injection avec une accumulation d'abcès.
Ainsi, malgré l'isolement réussi de l'extrait et son administration au jeune Thompson, le produit reste contaminé par des impuretés.
À ce stade, un collègue, le Dr James Collip, PhD, vient à la rescousse. Grâce à ses compétences de biochimiste, il purifie suffisamment l'extrait pancréatique pour en éliminer les impuretés.
Lorsque Léonard Thompson est traité 2 semaines plus tard avec l'extrait purifié, le résultat est beaucoup plus positif. Finie la réaction au site d'injection, finis les niveaux élevés de glucose dans le sang, et Léonard Thompson, lui-même « est devenu plus vif, plus actif, a meilleure mine et dit qu'il se sent plus fort », dans une publication décrivant le traitement.
Le Dr Collip détermine alors également qu’avec une purification poussée à l’excès du produit, les animaux sur lesquels il expérimente peuvent réagir de manière excessive et avoir des convulsions, tomber dans le coma, voire mourir pour cause d’hypoglycémie due à une trop grande quantité d'insuline.
Combat d’égos
S’appuyant un extrait du journal de Frederick Banting, Kersten Hall affirme que celui-ci était d’un tempérament lunatique. En témoigne sa perte de patience quand James Collip refuse de partager sa formule de purification. Son journal relate les faits suivants : « Je l'ai attrapé d'une main par le pardessus... et je l'ai presque soulevé, je l'ai assis durement sur la chaise... Je me souviens lui avoir dit que c'était un bon travail. Il était si petit – sinon je « lui aurait collé mon poing dans la figure ».
Selon Kersten Hall, lorsque Banting et Macleod reçoivent conjointement le prix Nobel de médecine, en 1923, Best supporte mal d’être exclu. Et même si Banting partage avec lui la moitié du montant de son prix, l'animosité subsiste.
Au point qu’avant de partir en avion pour une mission de guerre au Royaume-Uni, Banting affirme que s'il ne revient pas vivant, « et qu’ils donnent ma chaire [de professeur] à ce fils de pute Best [sic], je ne reposerai jamais en paix dans ma tombe. » Par un cruel coup du destin, l'avion de Banting s’écrase et tous les passagers meurent.
A l’époque, la course au prix Nobel est également une source de rivalité entre Banting et son patron, Macleod. À la fin de 1921, alors qu'il présente les résultats de modèles animaux à la conférence de l'American Physiological Society, les nerfs de Banting lâchent. Quand Macleod prend le relais sur l’estrade pour terminer l'exposé, Banting considère que son patron lui vole la vedette.
Quelques mois plus tard seulement, lors de la conférence annuelle de l'Association of American Physicians, lorsque Macleod fait la première annonce officielle de la découverte de l’insuline à la communauté scientifique, l’absence de Banting est remarquée.
Dr Charles Best (à droite) avec son assistant (à gauche) dans le laboratoire en 1960.
Prix Nobel ou un cadeau empoisonné ?
Décernés chaque année pour la physique, la chimie, la médecine/physiologie, la littérature, la paix et l'économie, les prix Nobel sont généralement considérés comme le Saint Graal de la réussite. Chaque prix équivaut à environ 40 000 $ à l'époque (environ 1 000 000 $ en valeur actuelle) – l’argent remis ayant été légué par testament par Alfred Nobel en 1895.
En 2001, s’exprimant dans la revue Diabetes Voice, le professeur Sir George Alberti, DPhil, BM BCh, ancien président du Royal College of Physicians du Royaume-Uni, résume le fardeau qui accompagne le prix Nobel ainsi : « Je crois personnellement que de tels prix et récompenses font plus de mal que de bien et devraient être abolis. Beaucoup de scientifiques sont morts en se sentant profondément lésés parce qu'ils n'ont pas reçu de prix Nobel ».
Beaucoup de scientifiques sont morts en se sentant profondément lésés parce qu'ils n'ont pas reçu de prix Nobel. Sir George Alberti
Des enjeux si élevés entourent le prestigieux prix que, dans le cas de l'insuline, la poursuite ardente de la gloire a balayé la vérité et la plus élémentaire courtoisie de l’histoire de la découverte de l’insuline. Après la mort de Macleod en 1935 et celle de Banting en 1941, Best en profite pour essayer de réviser l'histoire en minimisant la contribution de Collip et en ne gardant que le moment clé de la première dose d'insuline administrée, bien que la récupération complète du patient sans effets secondaires n'ait été obtenue que plus tard avec l'aide de Collip.
Malgré son exclusion du prix Nobel, Best a néanmoins été reconnu comme un élément crucial de la découverte de l'insuline, explique Kersten Hall. Au point que lorsque Best s’exprime sur la découverte de l'insuline lors de la réunion de la New York Diabetes Association en 1946, il a été présenté comme un conférencier dont la réputation est déjà si grande qu'il « n'a pas besoin d’être présenté ».
« Et lorsqu'un nouvel institut de recherche est ouvert à Toronto en 1953, il porte le nom de Best, en son honneur. Le discours d'ouverture, par Sir Henry Dale du UK Medical Research Council, le porte aux nues, au grand mécontentement de son ancien collègue, James Collip, qui est assis dans le public », souligne Hall.
« La découverte de l'insuline a été un miracle, elle a permis aux gens de survivre », explique le Dr Stephens. « Peu de médicaments peuvent annuler une condamnation à mort comme l'insuline peut le faire. Il est facile d'oublier comment c'était quand l'insuline n'était pas là – et ce n’est pourtant pas si loin. »
Kersten Hall fait remarquer que le progrès scientifique et les découvertes sont souvent décrits comme étant le résultat de génies imposants s’appuyant les uns sur les autres.
« Mais je pense que lorsque le philosophe allemand Emmanuel Kant dit que « d’un bois si tordu dont sont faits les hommes, jamais l’on ne tirera rien de bien droit », il nous offre une image beaucoup plus précise de la façon dont la science fonctionne. Et je pense qu'il n'y a peut-être pas d’exemple plus probant que l'histoire de l'insuline », considère-t-il.
Kersten Hall qu’Elizabeth Stephens sont diabétiques de type 1 et ont tous deux ont bénéficié des efforts de Banting, Best, Collip, Zuelzer et Macleod.
L’article a été publié initialement sur Medscape.com sous le titre Inside Insulin : The Feuds and Vitriol Behind the Discovery of This Life-Saving Therapy. Traduit par Stéphanie Lavaud.
Dr Thomas Kron
1er juillet 2022
Source medscape.com
La peste noire, qui a engendré la plus grande pandémie de l'histoire de l'humanité, trouverait son origine en Asie centrale, d’après les analyses d'anciens génomes de Yersinia pestis effectuées par une équipe de scientifiques, dont des chercheurs de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire de Leipzig, de l'université de Tübingen et de l'université de Stirling (Royaume-Uni) [1].
20 à 25 millions de morts
En 1347, la peste est arrivée pour la première fois dans le bassin méditerranéen par le biais de navires marchands en provenance de la mer Noire et de zones de peuplement de la Horde d'or (un ancien empire turco-mongol). La bactérie s'est rapidement propagée à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.
Selon les estimations des historiens, environ 20 à 25 millions de personnes (environ un tiers de la population européenne de l'époque) ont perdu la vie au cours d'une seule grande épidémie, connue également sous le nom de « mort noire ». Pour l’historien norvégien Ole Benedictow, elle aurait même frappé environ 60 % de la population européenne, soit 50 millions d'habitants sur 80.
Les analyses actuelles montrent cependant que toutes les régions d'Europe n'en ont pas souffert de la même manière [2]. Ainsi, l'historien de la médecine Manfred Vasold estime à environ 10% de la population le nombre de décès dus à l'épidémie en Allemagne [3].
L'écrivain italien Giovanni Boccaccio, témoin de la pandémie entre 1347 et 1353, a décrit de manière impressionnante ce qu'il a vécu dans son recueil de nouvelles Decamerone : « Ainsi, quiconque se serait promené en ville – surtout le matin – aurait pu voir d'innombrables cadavres. On faisait alors venir des civières ou, à défaut, on déposait les morts sur une simple planche. Il arrivait aussi que sur une civière on en emporte deux ou trois, et on aurait pu compter non pas une fois mais de nombreuses fois où la même civière portait les corps du mari et de la femme, ou de deux ou trois frères, ou du père et de son enfant. »
Cette première vague a conduit à une deuxième pandémie qui a duré 500 ans, se poursuivant jusqu'au début du 19ème siècle. Les origines de cette deuxième pandémie font depuis longtemps l'objet de débats chez les spécialistes. D’après l'une des théories les plus populaires, elle pourrait avoir pris naissance en Asie de l'Est, et plus particulièrement en Chine.
Cette théorie est cependant contredite par des découvertes archéologiques d'Asie centrale, provenant d'une région proche du lac Issyk Kul, dans l'actuel Kirghizstan, sur les contreforts des monts Tian Shan. Elles témoignent d'une épidémie de peste au sein d'une communauté commerciale locale en 1338 et 1339. Des fouilles menées il y a près de 140 ans ont permis de découvrir des pierres tombales dont les inscriptions indiquent que ces personnes ont été victimes d'une épidémie ou d'une « peste » inconnue. Depuis leur découverte, les pierres tombales inscrites en syriaque-araméen ont suscité la controverse dans les milieux spécialisés quant à leur signification pour la mort noire en Europe.
Une équipe de recherche internationale a analysé l'ADN ancien des restes humains et évalué les données historiques et archéologiques de deux sites où des témoins de la « peste » ont été découverts. Les premiers résultats étaient déjà encourageants : les chercheurs ont ainsi réussi à mettre en évidence de l'ADN de Yersinia pestis chez des personnes dont l'inscription sur la pierre tombale indique qu'elles sont mortes en 1338.
« Nous avons enfin pu prouver que l'épidémie mentionnée sur les pierres tombales était bien causée par la peste », affirme Phil Slavin, l'un des principaux auteurs de l'étude et historien à l'université de Sterling.
La souche d'origine de la mort noire identifiée
Jusqu'à présent, l'apparition de la mort noire a été associée à une diversification massive des souches de peste, ce que l'on appelle un « big bang de la diversité de la peste ». La date de cet événement n'a toutefois pas pu être déterminée avec précision – on la situait jusqu'à présent entre le 10ème et le 14ème siècle. Les chercheurs ont assemblé d'anciens génomes complets de la peste provenant des sites trouvés au Kirghizstan, examinant ensuite comment ils pourraient être liés à ce « big bang ».
« Nous avons découvert que les anciennes tribus du Kirghizistan se trouvaient exactement au point nodal de cet événement de diversification massive. Nous avons donc effectivement réussi à déterminer la souche d'origine de la mort noire et la date exacte de son apparition, qui était l'année 1338 », explique Maria Spyrou, première auteure de l’article publié par Nature et chercheuse à l'université de Tübingen [1].
Mais d'où vient cette souche ? S'est-elle développée localement ou a-t-elle été introduite dans la région avant de se propager ? La peste n'est pas une maladie d'origine humaine : Yersinia pestis survit dans les populations de rongeurs sauvages du monde entier, qui en constituent donc les réservoirs. L'ancienne souche d'Asie centrale à l'origine de l'épidémie 1338-1339 au lac Issyk Kul doit donc provenir d'un tel réservoir.
« Nous trouvons aujourd'hui des souches modernes, les plus proches de l'ancienne souche, dans des réservoirs de peste autour des montagnes Tian Shan, donc tout près de l'endroit où l’ancienne souche a été découverte. L'ancêtre de la mort noire semble donc être apparu en Asie centrale », conclut Johannes Krause, auteur principal de l'étude et directeur de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire.
Cet article a été publié initialement sur Univadis.de et intitulé Der Schwarze Tod: Der Ursprung der Pest-Pandemie liegt offenbar in Zentralasien . Traduction/adaptation du Dr Claude Leroy.
_________________
Quelles querelles d’égo derrière la découverte de l’insuline ?
Becky McCall
10 février 2022
La découverte de l’insuline il y a un siècle a révolutionné la vie de millions de patients et valu un prix Nobel à ses deux découvreurs, Banting et MacLeod. Pourtant, comme pour chaque découverte importante, l’histoire officielle ne retient que les principaux noms et oublie au passage des personnes-clés et les guerres d’égos qu’elles se sont livrées. La petite histoire dans la grande, que nous relate notre consœur Becky McCall.
Prêt à tout pour sauver son enfant d'une mort certaine due au diabète, le père de Leonard Thompson emmène son fils de 14 ans à l'hôpital général de Toronto le 11 janvier 1922 pour recevoir ce qui fut sans doute la première dose d'insuline administrée à un être humain. Alors qu’on lui prédisait une espérance de vie augmentée de quelques semaines – voire quelques mois au mieux –, de façon surprenante, le jeune Thompson a vécu 13 années supplémentaires, pour finalement mourir d'une pneumonie sans lien avec son diabète.
Cette histoire refait surface à l’occasion de la célébration du centenaire d'une découverte remarquable. L'insuline a, en effet, changé ce qui était autrefois une condamnation à mort en une espérance de vie presque normale pour les millions de personnes atteintes de diabète de type 1 au cours des 100 dernières années.
Mais derrière le succès bouleversant de cette découverte – et du prix Nobel qui l'a accompagné – se cache une autre histoire entachée par les affirmations contestées, les vérités biaisées et les probables injustices, alors que chacun se disputait une place d'honneur dans l'histoire de la médecine.
Kersten Hall, PhD, chercheur honoraire en histoire des sciences et des religions à l'Université de Leeds (Royaume-Uni) a parcouru les archives et les dossiers de patients stockés à l'Université de Toronto, Ontario, Canada, pour découvrir la petite histoire derrière la découverte de l'insuline.
Revenant sur les querelles des scientifiques, il affirme : « Il y a une distinction entre la science et les scientifiques. Les scientifiques sont des êtres humains merveilleusement imparfaits et complexes avec toutes leurs vertus et leurs vices, comme nous tous. Il n'est pas surprenant qu'ils puissent être avides, jaloux ou manquant d’assurance ».
Les scientifiques sont des êtres humains merveilleusement imparfaits et complexes avec toutes leurs vertus et leurs vices, comme nous tous. Kersten Hall
Des années 1920 à aujourd’hui
Avant la découverte de l'insuline en 1921, être diagnostiqué avec un diabète de type 1 plaçait quelqu'un au seuil de la mort, avec la famine comme seule option pour tenter de survivre. Sachant qu’à cette époque, la plupart des cas de diabète étaient probablement du diabète de type 1 car, avec des régimes moins obésogènes et une durée de vie plus courte, les gens étaient beaucoup moins susceptibles de développer un diabète de type 2.
De nos jours, il est largement reconnu que la prévalence du diabète de type 2 est sur une courbe ascendante abrupte, mais il en va de même pour le diabète de type 1. Si l’on s’en tient uniquement aux États-Unis, 1,5 million de personnes ont reçu un diagnostic de diabète de type 1, un nombre qui devrait atteindre environ 5 millions d'ici 2050, selon la Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF), une association d’aide aux diabétiques de type 1.
Fait intéressant, 100 ans après le premier patient traité, l'insuline à vie reste la seule véritable thérapie efficace pour les patients atteints de diabète de type 1. Une fois que les cellules bêta pancréatiques ont cessé de fonctionner et que la production d'insuline s'est arrêtée, le remplacement de l'insuline est le seul moyen de maintenir la glycémie dans la plage recommandée (A1c ≤ 48 mmol/mol [6,5 %]), selon National Institute for Health and Care Excellence (NICE) britannique et de nombreuses autres société savantes du diabète, dont l'American Diabetes Association (ADA).
Des essais cliniques préliminaires s’intéressent à la greffe de cellules souches, qualifiée prématurément de « remède » contre le diabète de type 1, comme alternative à l'insulinothérapie. La procédure consiste à transplanter des cellules dérivées de cellules souches, qui deviennent des cellules bêta fonctionnelles lorsqu'elles sont transplantées chez l'homme, mais nécessitent une immunosuppression (un frein à son développement).
Aujourd'hui, l'espérance de vie des personnes atteintes de diabète de type 1 traitées à l'insuline est proche de celle des non-diabétiques, bien que cela dépende du degré de contrôle de la glycémie. Certaines études montrent que l'espérance de vie des personnes atteintes de diabète de type 1 est inférieure d'environ 8 à 12 ans à celle de la population générale, mais varie selon l'endroit où vit la personne.
Dans certains pays à faible revenu, de nombreuses personnes atteintes de diabète de type 1 meurent encore prématurément, soit parce qu'elles ne sont pas diagnostiquées, soit parce qu'elles n'ont pas accès à l'insuline. Le coût élevé de l'insuline aux États-Unis est bien connu, et nombreux sont les patients qui meurent faute de moyens pour acheter de l'insuline.
Sans insuline, le jeune Leonard Thompson n’aurait pas eu la chance d'atteindre son 15e anniversaire.
« Ces patients étaient cachectiques et maigres, ils auraient pesé environ 40 à 50 livres (18 à 23 kg), ce qui est très peu pour un jeune adolescent. La survie était courte, de l’ordre de semaines ou de mois », remarque le Dr Elizabeth Stephens, endocrinologue à Portland dans l’Oregon.
« La découverte de l'insuline a vraiment été un miracle car sans elle, les patients diabétiques risquaient une mort certaine. Même de nos jours, si les gens ne reçoivent pas leur insuline parce qu'ils n'en ont pas les moyens ou pour une raison quelconque, le risque de décès reste important », souligne le Dr Stephens.
De la découverte des îlots pancréatiques à l’extrait purifié
C’est en 1869 que le Dr Paul Langerhans découvre les cellules des îlots pancréatiques, ou îlots de Langerhans, alors qu'il est étudiant en médecine. Les chercheurs essayent alors de produire des extraits qui abaissaient la glycémie, mais ceux-ci sont trop toxiques pour être utilisés par les patients.
Dans son livre récent, Insulin - the Crooked Timber, l’auteur Kersten Hall, ex-chercheur en biologie moléculaire, fait également référence au fait qu'un chercheur allemand appelé le Dr Georg Zuelzer a démontré chez six patients, en 1908, que les extraits pancréatiques pouvaient réduire les taux urinaires de glucose et de cétones, et que dans un cas, le traitement avait pu sortir un patient du coma. Le Dr Zuelzer avait purifié l'extrait avec de l'alcool mais les patients souffraient toujours de convulsions et de coma car ils subissaient, en fait, un choc hypoglycémique, que le Dr Zuelzer n'avait pas identifié comme tel.
« Il pensait que sa préparation contenait des impuretés – et c'est là toute l'ironie de l’histoire, car il avait entre les mains une préparation d'insuline si propre et si puissante qu'elle envoyait les animaux de test en état de choc hypoglycémique », souligne Kersten Hall.
C’est en 1921 que deux jeunes chercheurs, le Dr Frederick Banting, médecin praticien à Toronto, et un étudiant de dernière année en physiologie à l'Université de Toronto et Charles Best, MD, DSc, collaborent aux travaux de John Macleod, MBChB, professeur de physiologie à l'Université de Toronto, et supérieur de Charles Best, pour fabriquer des extraits pancréatiques, d'abord à partir de chiens, puis de bovins.
Au cours des mois précédents le traitement du jeune Thompson, Banting et Best travaillent tous deux au laboratoire à la préparation de l'extrait pancréatique de bovins et le testent sur des chiens atteints de diabète.
C’est donc, dans ce qui équivaudrait aujourd’hui à un essai de phase 1, avec un "n = 1", que Leonard Thompson, frêle et proche de la mort, reçoit 15 ml d'extrait pancréatique au Toronto General Hospital en janvier 1922. Son taux de glycémie chute alors de 25 %, mais malheureusement, son corps continue à produire des corps cétoniques, indiquant que l'effet antidiabétique est limité. Il présente également une réaction indésirable au point d'injection avec une accumulation d'abcès.
Ainsi, malgré l'isolement réussi de l'extrait et son administration au jeune Thompson, le produit reste contaminé par des impuretés.
À ce stade, un collègue, le Dr James Collip, PhD, vient à la rescousse. Grâce à ses compétences de biochimiste, il purifie suffisamment l'extrait pancréatique pour en éliminer les impuretés.
Lorsque Léonard Thompson est traité 2 semaines plus tard avec l'extrait purifié, le résultat est beaucoup plus positif. Finie la réaction au site d'injection, finis les niveaux élevés de glucose dans le sang, et Léonard Thompson, lui-même « est devenu plus vif, plus actif, a meilleure mine et dit qu'il se sent plus fort », dans une publication décrivant le traitement.
Le Dr Collip détermine alors également qu’avec une purification poussée à l’excès du produit, les animaux sur lesquels il expérimente peuvent réagir de manière excessive et avoir des convulsions, tomber dans le coma, voire mourir pour cause d’hypoglycémie due à une trop grande quantité d'insuline.
Combat d’égos
S’appuyant un extrait du journal de Frederick Banting, Kersten Hall affirme que celui-ci était d’un tempérament lunatique. En témoigne sa perte de patience quand James Collip refuse de partager sa formule de purification. Son journal relate les faits suivants : « Je l'ai attrapé d'une main par le pardessus... et je l'ai presque soulevé, je l'ai assis durement sur la chaise... Je me souviens lui avoir dit que c'était un bon travail. Il était si petit – sinon je « lui aurait collé mon poing dans la figure ».
Selon Kersten Hall, lorsque Banting et Macleod reçoivent conjointement le prix Nobel de médecine, en 1923, Best supporte mal d’être exclu. Et même si Banting partage avec lui la moitié du montant de son prix, l'animosité subsiste.
Au point qu’avant de partir en avion pour une mission de guerre au Royaume-Uni, Banting affirme que s'il ne revient pas vivant, « et qu’ils donnent ma chaire [de professeur] à ce fils de pute Best [sic], je ne reposerai jamais en paix dans ma tombe. » Par un cruel coup du destin, l'avion de Banting s’écrase et tous les passagers meurent.
A l’époque, la course au prix Nobel est également une source de rivalité entre Banting et son patron, Macleod. À la fin de 1921, alors qu'il présente les résultats de modèles animaux à la conférence de l'American Physiological Society, les nerfs de Banting lâchent. Quand Macleod prend le relais sur l’estrade pour terminer l'exposé, Banting considère que son patron lui vole la vedette.
Quelques mois plus tard seulement, lors de la conférence annuelle de l'Association of American Physicians, lorsque Macleod fait la première annonce officielle de la découverte de l’insuline à la communauté scientifique, l’absence de Banting est remarquée.
Dr Charles Best (à droite) avec son assistant (à gauche) dans le laboratoire en 1960.
Prix Nobel ou un cadeau empoisonné ?
Décernés chaque année pour la physique, la chimie, la médecine/physiologie, la littérature, la paix et l'économie, les prix Nobel sont généralement considérés comme le Saint Graal de la réussite. Chaque prix équivaut à environ 40 000 $ à l'époque (environ 1 000 000 $ en valeur actuelle) – l’argent remis ayant été légué par testament par Alfred Nobel en 1895.
En 2001, s’exprimant dans la revue Diabetes Voice, le professeur Sir George Alberti, DPhil, BM BCh, ancien président du Royal College of Physicians du Royaume-Uni, résume le fardeau qui accompagne le prix Nobel ainsi : « Je crois personnellement que de tels prix et récompenses font plus de mal que de bien et devraient être abolis. Beaucoup de scientifiques sont morts en se sentant profondément lésés parce qu'ils n'ont pas reçu de prix Nobel ».
Beaucoup de scientifiques sont morts en se sentant profondément lésés parce qu'ils n'ont pas reçu de prix Nobel. Sir George Alberti
Des enjeux si élevés entourent le prestigieux prix que, dans le cas de l'insuline, la poursuite ardente de la gloire a balayé la vérité et la plus élémentaire courtoisie de l’histoire de la découverte de l’insuline. Après la mort de Macleod en 1935 et celle de Banting en 1941, Best en profite pour essayer de réviser l'histoire en minimisant la contribution de Collip et en ne gardant que le moment clé de la première dose d'insuline administrée, bien que la récupération complète du patient sans effets secondaires n'ait été obtenue que plus tard avec l'aide de Collip.
Malgré son exclusion du prix Nobel, Best a néanmoins été reconnu comme un élément crucial de la découverte de l'insuline, explique Kersten Hall. Au point que lorsque Best s’exprime sur la découverte de l'insuline lors de la réunion de la New York Diabetes Association en 1946, il a été présenté comme un conférencier dont la réputation est déjà si grande qu'il « n'a pas besoin d’être présenté ».
« Et lorsqu'un nouvel institut de recherche est ouvert à Toronto en 1953, il porte le nom de Best, en son honneur. Le discours d'ouverture, par Sir Henry Dale du UK Medical Research Council, le porte aux nues, au grand mécontentement de son ancien collègue, James Collip, qui est assis dans le public », souligne Hall.
« La découverte de l'insuline a été un miracle, elle a permis aux gens de survivre », explique le Dr Stephens. « Peu de médicaments peuvent annuler une condamnation à mort comme l'insuline peut le faire. Il est facile d'oublier comment c'était quand l'insuline n'était pas là – et ce n’est pourtant pas si loin. »
Kersten Hall fait remarquer que le progrès scientifique et les découvertes sont souvent décrits comme étant le résultat de génies imposants s’appuyant les uns sur les autres.
« Mais je pense que lorsque le philosophe allemand Emmanuel Kant dit que « d’un bois si tordu dont sont faits les hommes, jamais l’on ne tirera rien de bien droit », il nous offre une image beaucoup plus précise de la façon dont la science fonctionne. Et je pense qu'il n'y a peut-être pas d’exemple plus probant que l'histoire de l'insuline », considère-t-il.
Kersten Hall qu’Elizabeth Stephens sont diabétiques de type 1 et ont tous deux ont bénéficié des efforts de Banting, Best, Collip, Zuelzer et Macleod.
L’article a été publié initialement sur Medscape.com sous le titre Inside Insulin : The Feuds and Vitriol Behind the Discovery of This Life-Saving Therapy. Traduit par Stéphanie Lavaud.
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2506
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Infirmiers référents d'urgence : les syndicats de médecins urgentistes s’y opposent
Jacques Cofard
21 août 2023
Medscape.com
Un projet d'arrêté devrait conférer la possibilité pour des infirmier d'intervenir en premier lieu sur des situations d'urgence. L'Amuf et le SNPHARE y sont opposés.
Alors que la situation dans les services d'urgences, aux dires des principaux concernés, n'a jamais été pire que cette année, un projet d’arrêté suscite une polémique entre infirmiers et médecins urgentistes. Ce projet d’arrêté, rendu public par Hospimedia, prévoit la création d'un statut d'infirmier correspondant de Samu. Il a été présenté ces jours derniers devant le Haut conseil des professions paramédicales, et est issu des réflexions de l'ancien ministre de la Santé, François Braun, sur la réforme des services d'urgences, annoncé lors du dernier congrès Santexpo, en mai dernier.
Un IDE formé aux soins de médecine d'urgence
Ce nouveau dispositif copie peu ou prou celui des médecins correspondants de Samu. « Le Médecin Correspondant du SAMU est un médecin de premier recours volontaire, formé et équipé pour répondre à l’urgence, qui participe à la mission de service public de l’Aide Médicale Urgente (AMU) », tel que le définit la société française de médecine d'urgence (SFMU). Selon Hospimedia, « l'infirmier diplômé d'État formé aux soins de médecine d'urgence interviendra à la demande de la régulation du Samu-Centre 15 afin de prendre en charge des patients en situation d'urgence médicale dans une zone préalablement identifiée par l'ARS. La formation sera dispensée sous l'autorité du service hospitalo-universitaire de référence, en liaison avec le Samu, le centre d'enseignement des soins d'urgence ainsi que les structures des urgences et les Smur ».
« Une logique d’adaptation pragmatique »
De fait, la notion d'infirmier référent de Samu n'est pas nouvelle : elle avait déjà été édictée dans le cadre de la mission flash menée par François Braun, alors qu’il n'était pas encore ministre de la Santé, en juin 2022. En effet, la mesure 22 de ce plan prévoyait la création d'une équipe paramédicale d'urgence (EPMU). « En absence de médecin urgentiste sur un territoire Smur, il peut être temporairement acceptable que l’équipe d’intervention hospitalière ne soit composée que d’un ambulancier et d’un IDE dans une logique d’adaptation pragmatique », définissaient les rapporteurs de la mission flash urgences. Qui poursuivait : « en cas d’indisponibilité du SMUR pour une situation identifiée d’urgence vitale, l’envoi sur zone par le Samu d’un vecteur embarquant une équipe paramédicale de médecine d’urgence formée et supervisée à distance par le médecin régulateur peut permettre une première intervention pour sauvegarder les chances du patient, le temps qu’un SMUR plus lointain n’arrive. » Il était aussi indiqué que cette mesure avait vocation à rester "dérogatoire et temporaire". Il était aussi prévu, comme le mentionne la mesure 16 dudit plan, le recours aux infirmiers libéraux, sollicités par le Samu, afin de se rendre au domicile des patients en demande de soins urgents, pour évaluer la situation et déclencher éventuellement une téléconsultation.
SNPHARE ET Amuf furieux
Si l'intervention directe d'infirmiers dans le dispositif des soins d'urgences avait donc été dévoilée dès l'été 2022, et expérimenté par le SAMU 72/EPMU Château-du-Loir, il n'en reste pas moins que l'annonce de la rédaction d'un arrêté sur la question a suscité la réprobation de syndicats de médecins hospitaliers. Ainsi, les syndicats SNPHARE (syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes réanimateurs élargi) et l'amuf (association des médecins urgentistes de France) ont signé un communiqué commun pour dire « Non aux infirmiers correspondants de Samu ». Pour les deux syndicats, « cet arrêté fait écho négativement et à contre-courant de l’évolution de la médecine d’urgence depuis le début des années 90 ! » Depuis 2015, la médecine d'urgence est devenue une spécialité à part entière grâce à la création du diplôme d'études spécialisées (DES), rappelle les deux syndicats. « Le DES a permis d’adapter la formation des urgentistes aux exigences de la médecine d’urgence moderne, en particulier dans l’étendue de son exercice (adulte et pédiatrique, médical et chirurgical, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’hôpital (Samu, Smur). Avec ce projet, nous sommes aux antipodes du Pacte de Refondation des urgences de 2019 qui devait « Renforcer et reconnaître les compétences des professionnels des urgences », arguent les deux syndicats. Qui ajoutent : cet arrêté « témoigne de l’incapacité de nos tutelles à garantir une couverture sanitaire à la hauteur des besoins de la population. C’est un triste aveu d’impuissance. Les solutions proposées sont inadaptées et potentiellement dangereuses. Plus qu’un glissement de tâche, c’est placer le corps infirmier dans la difficulté en situation d’urgence, ignorer les spécificités respectives des métiers de médecin et d’infirmier, et, in fine, exposer les patients à une perte de chance ».
« Retirer immédiatement son projet d'arrêté »
L'Amuf et le SNPHARE demandent donc au tout nouveau ministre de la santé, Aurélien Rousseau, de « retirer immédiatement son projet d'arrêté », « de maintenir et renforcer les structures d'urgence existantes », de « restaurer le maillage en équipe SMUR sur l'ensemble du territoire », de « respecter les formations des professionnels de l'urgence », de donner des moyens pour les prises en charge de patients, et de restaurer l'attractivité des carrières hospitalières. Reste à savoir si le nouveau ministère de la santé assumera l'héritage de François Braun, et poursuivra la politique menée par son prédécesseur, notamment en ce qui concerne les services d'urgence.
Quand le SNPHAR-e est sur tous les fronts, même ceux qu'il a abandonné. Si l'on reprend les propos tenus lors de la 4e réunion IGAS sur la pratique avancée (dont je faisais partie), voici ce qui est dit par un des protagonistes ex président de la SFAR, donc pur produit anesthésique : Retranscription du 11 mai 2022 page 21 M. Claude (Ecoffey) :
Non, mais, ce point-là, il faut arrêter d’en discuter ! Le CNP médecine d’urgence, quand, en 2017, vous vous souvenez, ils avaient, c’est eux qui avaient limité aux transports inter-hospitaliers ; donc le pré-hospitalier, ils ne voulaient pas en entendre ! Donc je pense que là, autour, les médecins qui sont en tout cas autour de cette table, on n’est pas compétents, on n’est pas compétents pour discuter de ce sujet-là ! Donc je pense que ce sujet-là…on doit sortir...
Le syndrome de la girouette a encore frappé. Ils sont compétents pour dénoncer un truc pour lequel ils se sont prononcés comme incompétents, renvoyant la patate chaude aux urgentistes qui eux nous déclarent moins compétents que les IDE alors que les IADE ont 2 années supplémentaires et sont issus de la formation IDE considérée comme compétente par les urgentistes qui viennent apprendre à intuber au bloc, encadrés souvent par les IADE qui restent incompétents en matière d'urgence mais qu'ils sont bien contents de trouver quand même, notamment lors des transports inter-régionaux de la covid. Constance de la pensée et du raisonnement quand tu nous tiens...
On ne compte plus le nombre de fois où le terme "perte de chance" a été utilisé au fil des 3 dernières années notamment. Comme si tous les MAR étaient compétents, et tous les IADE ne l'étaient pas ou moins. Quand on sait comment les semestres des internes un peu "légers" (qui ne font pas l'affaire en clair), sont validés pour s'en débarrasser vers le service d'un autre collègue d'un autre établissement qui lui-même fera de même au bout de 6 mois... jusqu’à l'obtention haut la main de la thèse et d'un poste de CCA récompensant ces années de hautes volées, alors qu'un EIA qui ne fait pas l'affaire sera signalé à l'école des IADE, qu'il aura plusieurs entretiens, et qu'au bout du compte il pourrait être définitivement écarté de la formation pour insuffisance professionnelle, on comprend mieux l’homogénéité territoriale des IADE vs l'hétérogénéité des MAR sur ce même territoire.
Quant au représentant de l'AMUF, on ne note plus le nombre de communiqués où il se montre hostile au monde infirmier, bon à obéir et surtout à fermer sa gueule quand le docteur a parlé. Le drôle n'amuse plus son public, celui-ci se lasse de ses prestations datées et quitte le chapiteau pour aller voir un spectacle plus récent et moderne.
NDLR (edit) Pour en finir sur la facilité médicale vs la difficulté d'être IADE (quoi qu'on en dise) et de la perte de chance qui invariablement serait de notre côté mais jamais du côté du médical qui est telllllllleeeeeemmmmmmmment bien encadré, performant et présent au bloc...
Jacques Cofard
21 août 2023
Medscape.com
Un projet d'arrêté devrait conférer la possibilité pour des infirmier d'intervenir en premier lieu sur des situations d'urgence. L'Amuf et le SNPHARE y sont opposés.
Alors que la situation dans les services d'urgences, aux dires des principaux concernés, n'a jamais été pire que cette année, un projet d’arrêté suscite une polémique entre infirmiers et médecins urgentistes. Ce projet d’arrêté, rendu public par Hospimedia, prévoit la création d'un statut d'infirmier correspondant de Samu. Il a été présenté ces jours derniers devant le Haut conseil des professions paramédicales, et est issu des réflexions de l'ancien ministre de la Santé, François Braun, sur la réforme des services d'urgences, annoncé lors du dernier congrès Santexpo, en mai dernier.
Un IDE formé aux soins de médecine d'urgence
Ce nouveau dispositif copie peu ou prou celui des médecins correspondants de Samu. « Le Médecin Correspondant du SAMU est un médecin de premier recours volontaire, formé et équipé pour répondre à l’urgence, qui participe à la mission de service public de l’Aide Médicale Urgente (AMU) », tel que le définit la société française de médecine d'urgence (SFMU). Selon Hospimedia, « l'infirmier diplômé d'État formé aux soins de médecine d'urgence interviendra à la demande de la régulation du Samu-Centre 15 afin de prendre en charge des patients en situation d'urgence médicale dans une zone préalablement identifiée par l'ARS. La formation sera dispensée sous l'autorité du service hospitalo-universitaire de référence, en liaison avec le Samu, le centre d'enseignement des soins d'urgence ainsi que les structures des urgences et les Smur ».
« Une logique d’adaptation pragmatique »
De fait, la notion d'infirmier référent de Samu n'est pas nouvelle : elle avait déjà été édictée dans le cadre de la mission flash menée par François Braun, alors qu’il n'était pas encore ministre de la Santé, en juin 2022. En effet, la mesure 22 de ce plan prévoyait la création d'une équipe paramédicale d'urgence (EPMU). « En absence de médecin urgentiste sur un territoire Smur, il peut être temporairement acceptable que l’équipe d’intervention hospitalière ne soit composée que d’un ambulancier et d’un IDE dans une logique d’adaptation pragmatique », définissaient les rapporteurs de la mission flash urgences. Qui poursuivait : « en cas d’indisponibilité du SMUR pour une situation identifiée d’urgence vitale, l’envoi sur zone par le Samu d’un vecteur embarquant une équipe paramédicale de médecine d’urgence formée et supervisée à distance par le médecin régulateur peut permettre une première intervention pour sauvegarder les chances du patient, le temps qu’un SMUR plus lointain n’arrive. » Il était aussi indiqué que cette mesure avait vocation à rester "dérogatoire et temporaire". Il était aussi prévu, comme le mentionne la mesure 16 dudit plan, le recours aux infirmiers libéraux, sollicités par le Samu, afin de se rendre au domicile des patients en demande de soins urgents, pour évaluer la situation et déclencher éventuellement une téléconsultation.
SNPHARE ET Amuf furieux
Si l'intervention directe d'infirmiers dans le dispositif des soins d'urgences avait donc été dévoilée dès l'été 2022, et expérimenté par le SAMU 72/EPMU Château-du-Loir, il n'en reste pas moins que l'annonce de la rédaction d'un arrêté sur la question a suscité la réprobation de syndicats de médecins hospitaliers. Ainsi, les syndicats SNPHARE (syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes réanimateurs élargi) et l'amuf (association des médecins urgentistes de France) ont signé un communiqué commun pour dire « Non aux infirmiers correspondants de Samu ». Pour les deux syndicats, « cet arrêté fait écho négativement et à contre-courant de l’évolution de la médecine d’urgence depuis le début des années 90 ! » Depuis 2015, la médecine d'urgence est devenue une spécialité à part entière grâce à la création du diplôme d'études spécialisées (DES), rappelle les deux syndicats. « Le DES a permis d’adapter la formation des urgentistes aux exigences de la médecine d’urgence moderne, en particulier dans l’étendue de son exercice (adulte et pédiatrique, médical et chirurgical, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’hôpital (Samu, Smur). Avec ce projet, nous sommes aux antipodes du Pacte de Refondation des urgences de 2019 qui devait « Renforcer et reconnaître les compétences des professionnels des urgences », arguent les deux syndicats. Qui ajoutent : cet arrêté « témoigne de l’incapacité de nos tutelles à garantir une couverture sanitaire à la hauteur des besoins de la population. C’est un triste aveu d’impuissance. Les solutions proposées sont inadaptées et potentiellement dangereuses. Plus qu’un glissement de tâche, c’est placer le corps infirmier dans la difficulté en situation d’urgence, ignorer les spécificités respectives des métiers de médecin et d’infirmier, et, in fine, exposer les patients à une perte de chance ».
« Retirer immédiatement son projet d'arrêté »
L'Amuf et le SNPHARE demandent donc au tout nouveau ministre de la santé, Aurélien Rousseau, de « retirer immédiatement son projet d'arrêté », « de maintenir et renforcer les structures d'urgence existantes », de « restaurer le maillage en équipe SMUR sur l'ensemble du territoire », de « respecter les formations des professionnels de l'urgence », de donner des moyens pour les prises en charge de patients, et de restaurer l'attractivité des carrières hospitalières. Reste à savoir si le nouveau ministère de la santé assumera l'héritage de François Braun, et poursuivra la politique menée par son prédécesseur, notamment en ce qui concerne les services d'urgence.
Quand le SNPHAR-e est sur tous les fronts, même ceux qu'il a abandonné. Si l'on reprend les propos tenus lors de la 4e réunion IGAS sur la pratique avancée (dont je faisais partie), voici ce qui est dit par un des protagonistes ex président de la SFAR, donc pur produit anesthésique : Retranscription du 11 mai 2022 page 21 M. Claude (Ecoffey) :
Non, mais, ce point-là, il faut arrêter d’en discuter ! Le CNP médecine d’urgence, quand, en 2017, vous vous souvenez, ils avaient, c’est eux qui avaient limité aux transports inter-hospitaliers ; donc le pré-hospitalier, ils ne voulaient pas en entendre ! Donc je pense que là, autour, les médecins qui sont en tout cas autour de cette table, on n’est pas compétents, on n’est pas compétents pour discuter de ce sujet-là ! Donc je pense que ce sujet-là…on doit sortir...
Le syndrome de la girouette a encore frappé. Ils sont compétents pour dénoncer un truc pour lequel ils se sont prononcés comme incompétents, renvoyant la patate chaude aux urgentistes qui eux nous déclarent moins compétents que les IDE alors que les IADE ont 2 années supplémentaires et sont issus de la formation IDE considérée comme compétente par les urgentistes qui viennent apprendre à intuber au bloc, encadrés souvent par les IADE qui restent incompétents en matière d'urgence mais qu'ils sont bien contents de trouver quand même, notamment lors des transports inter-régionaux de la covid. Constance de la pensée et du raisonnement quand tu nous tiens...
On ne compte plus le nombre de fois où le terme "perte de chance" a été utilisé au fil des 3 dernières années notamment. Comme si tous les MAR étaient compétents, et tous les IADE ne l'étaient pas ou moins. Quand on sait comment les semestres des internes un peu "légers" (qui ne font pas l'affaire en clair), sont validés pour s'en débarrasser vers le service d'un autre collègue d'un autre établissement qui lui-même fera de même au bout de 6 mois... jusqu’à l'obtention haut la main de la thèse et d'un poste de CCA récompensant ces années de hautes volées, alors qu'un EIA qui ne fait pas l'affaire sera signalé à l'école des IADE, qu'il aura plusieurs entretiens, et qu'au bout du compte il pourrait être définitivement écarté de la formation pour insuffisance professionnelle, on comprend mieux l’homogénéité territoriale des IADE vs l'hétérogénéité des MAR sur ce même territoire.
Quant au représentant de l'AMUF, on ne note plus le nombre de communiqués où il se montre hostile au monde infirmier, bon à obéir et surtout à fermer sa gueule quand le docteur a parlé. Le drôle n'amuse plus son public, celui-ci se lasse de ses prestations datées et quitte le chapiteau pour aller voir un spectacle plus récent et moderne.
NDLR (edit) Pour en finir sur la facilité médicale vs la difficulté d'être IADE (quoi qu'on en dise) et de la perte de chance qui invariablement serait de notre côté mais jamais du côté du médical qui est telllllllleeeeeemmmmmmmment bien encadré, performant et présent au bloc...
Par La rédac'
19 février 2016 - 13:00, mise à jour le 13 décembre 2022 - 16:31
« Le concours de PH, on peut y aller les mains dans les poches »
Tous les ans, de janvier à mars, se tiennent les oraux du concours de praticien hospitalier. Une réputation s’est forgée autour de l’épreuve… celle de n’être qu’une « formalité ». Alors, légende ou vérité ? What’s up doc s’est rendu sur les lieux du concours pour tirer tout ça au clair, et recueillir les témoignages de ces futurs PH.
Les épreuves orales du concours de PH se déroulent de janvier à mars. Chaque semaine, des spécialités différentes sont évaluées. En ce froid jeudi de février, c’est au tour de la psychiatrie. Quels sont donc les enjeux pour ces jeunes médecins qui ont fait le déplacement ?
La préparation
La préparation du concours semble avoir été fastidieuse pour la plupart des jeunes médecins interrogés. En tout cas, en ce qui concerne le dossier de candidature. Alexandre, psy à Grenoble et PH contractuel témoigne : « Le dossier, c’est pénible, mais ce n’est pas du travail. Il faut demander aux administrations les papiers de ses formations, des gardes qu’on a faites pour montrer qu’on en a fait beaucoup, etc ». Sachant qu’il faut rendre le dossier fin juin, mieux vaut s’y mettre avant le 15 du mois.
Et la préparation de l’oral ? La présentation devant le jury consiste à exposer en 10 minutes chrono « sa vie, son œuvre », selon Julie, qui vient passer le concours : « son parcours, son internat, le sujet de sa thèse, de son mémoire, éventuellement les formations complémentaires, et ses domaines d’intérêt ». Peu d’enjeux sur ce point-là semble-t-il. Paul témoigne : « j’ai préparé quelques notes hier pour un petit discours spontané ».
L’enjeu semble plus important pour ceux qui passent l’épreuve de type 2, pour laquelle après l’entretien oral de 30 minutes, les candidats ont « une mise en situation pratique de 30 minutes », explique Philippe Touzy, chef du Département concours-autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel du CNG (Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers, et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui organise le concours de PH). « Nous avons relu nos cours, même si finalement c’est ce qu’on fait au quotidien », expliquent Faustine et Jeanne-Marie qui s’apprêtent à passer l’épreuve type 2. « Mais c’est quand même différent de se trouver face à une feuille à commenter plutôt que face à un patient ».
L’épreuve
Mais là encore, tout va mieux une fois dans la salle. « Il n’y a pas du tout de question piège, c’était plutôt sympa comme ambiance, plutôt détendu », raconte Gaëlle, PH contractuelle à Brest, qui semblait stressée avant d’entrer dans la salle. Alexandre confirme : « le jury a été très très bienveillant ».
Les candidats doivent attendre le 11 mars prochain pour connaître leurs résultats. La plupart semblent confiants. « Je me base sur l’expérience de mes collègues qui l’ont passé et qui me disent que ça se passait bien en général », explique Yann.
Beaucoup d’inscrits, beaucoup d’élus
Alors est-il possible de se faire recaler à l’épreuve ? « Le taux de réussite global l’année dernière était de 88,5%, avec à près de 95% sur le type 1 ; et 77,5% sur le type 2 », explique Philippe Touzy. Le Pr Daniel Sechter, président du jury en psychiatrie insiste pourtant : « nous faisons en sorte de sélectionner les candidats de qualité ». Mais il concède : « La plupart sont bien préparé, avec à la fois un dossier administratif, des compétences cliniques et des connaissances de qualité ». Une façon de justifier le fait que la plupart des candidats obtiennent le titre ?
Alexandre conclut en donnant son sentiment sur le caractère de « formalité » souvent attribué à cette épreuve : « la formalité est due au fait qu’il manque beaucoup de postes à l’heure actuelle, donc on se doute bien qu’ils ont besoin de nous ».
Par La rédac'
Source: https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article ... s-poches-0
Cécile Lienhard
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2506
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Publié le 31/08/2023
Crise des urgences : les SMUR également touchés
Outre une offre dégradée dans les services d’urgence, le manque de médecins urgentistes a provoqué, cet été, la fermeture de plusieurs SMUR à travers le pays.
Des heures d’attente pour voir un médecin ou être transféré, des services fermés la nuit et le week-end, la régulation obligatoire par le 15… : cet été, comme l’an dernier, de nombreux services d’urgence à travers la France ont été confrontés à un manque de personnel médical et infirmier et n’ont pas pu faire face sereinement à l’afflux de patients. Si cette situation devient malheureusement monnaie courante, cet été a été marqué par une situation plus inédite et a priori bien plus inquiétante : par manque de médecins, certains CHU ont du fermer les SMUR (services mobiles d’urgence et de réanimation), ces ambulances comprenant un médecin, un infirmier et un ambulancier qui sont envoyés par le SAMU pour répondre aux urgences vitales.
Dans l’Eure en Normandie, le week-end dernier, deux équipes de SMUR sur six étaient hors service ; en Vendée, trois SMUR sur six étaient indisponibles à plusieurs reprises cet été, alors mêmes que les urgences de plusieurs hôpitaux du département étaient fermées la nuit ; l’Oise, le Finistère, la Manche, la Gironde et le Vaucluse ont également dû se passer de SMUR momentanément. « Nous n’avons jamais eu autant d’alertes » souligne le Dr Agnès Ricard-Hibon, porte-parole de la Société française de médecine d’urgence. « C’est nouveau, personne n’en parle, alors qu’on touche à la détresse vitale ». « On est en pleine dégringolade » réagit à son tour le Dr Patrick Pelloux, président de l’association des médecins urgentistes de France (AMUF).
Des SMUR paramédicalisés faute de médecins
Officiellement, la fermeture de SMUR dans certains départements durant l’été n’a conduit à aucun décès évitable ou plutôt à aucun « évènement indésirable grave » selon l’euphémisme administratif en vigueur. Mais tous les responsables du SAMU confient avoir connu un été « très inconfortable » au cours duquel il a fallu souvent faire avec les moyens du bord. Lorsque les ambulances manquent, l’envoi d’un SMUR doit être décidé avec parcimonie, uniquement quand la situation le requiert impérativement. « On n’envoie pas de SMUR si ce n’est pas vital, s’il n’y a pas de perte de chance à proprement parler » précise le Dr François Brau, responsable SAMU-SMUR au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon.
Dans plusieurs départements, les hôpitaux ont mis en place des SMUR paramédicalisés, comprenez des SMUR sans médecin un infirmier et un ambulancier, qui sont envoyés pour les urgences de moindre importante. Les textes réglementaires encadrant ces SMUR paramédicalisés sont toujours dans les tuyaux du ministère et n’ont pas encore été publiés.
De nouvelles annonces en faveur des soignants attendus ce jeudi
En principe, « les moyens dédiés à l’intervention doivent être conditionnés par le niveau de médicalisation dont le patient a besoin et non par les moyens disponibles » explique-t-on du coté du ministère de la Santé. Mais en pratique, c’est le plus souvent par manque de médecins qu’un infirmier est envoyé seul le terrain. « Nous envoyons l’infirmier, faute de médecin, en attendant que le SMUR de Libourne arrive » explique le Dr Catherine Pradeau, responsable du SAMU de Bordeaux.
« Il n’y a pas eu de difficultés majeures, mais c’est vraiment un palliatif ». « On voit des dispositifs montés du jour au lendemain, ce n’est pas sérieux, cela nécessite un cahier des charges précis, des formations en amont, un accompagnement » peste de son côté le Dr Joel Pannetier, qui a lui aussi du mettre en place un SMUR paramédicalisé cet été dans la Sarthe.
Dans ce contexte de dégradation continue des conditions de travail aux urgences, la communication du gouvernement exaspère de plus en plus les médecins. Le nouveau ministre de la Santé Aurélien Rousseau a répété tout au long du mois d’août à qui voulait l’entendre que le système hospitalier « tenait » et que la situation était meilleure que l’été dernier grâce aux mesures prises par l’exécutif. « Il faut arrêter la désinformation, il y a une mise en danger de la population » répond le Dr Marc Noizet, président du syndicat SAMU-Urgences de France. « Quand on voit des départements qui doivent fonctionner parfois avec la moitié de leurs SMUR en moins, ça ne peut pas se passer bien ».
La Première Ministre Elisabeth Borne est attendu ce jeudi au CHU de Rouen avec le ministre de la Santé, où elle doit faire des annonces en faveur des soignants, notamment concernant l’attractivité et la prise en compte de la pénibilité.
Les urgentistes attendent des mesures fortes pour apaiser leur colère et mettre fin à une crise qui, quoi qu’on en dise, s’aggrave.
Quentin Haroche
jim.fr
Crise des urgences : les SMUR également touchés
Outre une offre dégradée dans les services d’urgence, le manque de médecins urgentistes a provoqué, cet été, la fermeture de plusieurs SMUR à travers le pays.
Des heures d’attente pour voir un médecin ou être transféré, des services fermés la nuit et le week-end, la régulation obligatoire par le 15… : cet été, comme l’an dernier, de nombreux services d’urgence à travers la France ont été confrontés à un manque de personnel médical et infirmier et n’ont pas pu faire face sereinement à l’afflux de patients. Si cette situation devient malheureusement monnaie courante, cet été a été marqué par une situation plus inédite et a priori bien plus inquiétante : par manque de médecins, certains CHU ont du fermer les SMUR (services mobiles d’urgence et de réanimation), ces ambulances comprenant un médecin, un infirmier et un ambulancier qui sont envoyés par le SAMU pour répondre aux urgences vitales.
Dans l’Eure en Normandie, le week-end dernier, deux équipes de SMUR sur six étaient hors service ; en Vendée, trois SMUR sur six étaient indisponibles à plusieurs reprises cet été, alors mêmes que les urgences de plusieurs hôpitaux du département étaient fermées la nuit ; l’Oise, le Finistère, la Manche, la Gironde et le Vaucluse ont également dû se passer de SMUR momentanément. « Nous n’avons jamais eu autant d’alertes » souligne le Dr Agnès Ricard-Hibon, porte-parole de la Société française de médecine d’urgence. « C’est nouveau, personne n’en parle, alors qu’on touche à la détresse vitale ». « On est en pleine dégringolade » réagit à son tour le Dr Patrick Pelloux, président de l’association des médecins urgentistes de France (AMUF).
Des SMUR paramédicalisés faute de médecins
Officiellement, la fermeture de SMUR dans certains départements durant l’été n’a conduit à aucun décès évitable ou plutôt à aucun « évènement indésirable grave » selon l’euphémisme administratif en vigueur. Mais tous les responsables du SAMU confient avoir connu un été « très inconfortable » au cours duquel il a fallu souvent faire avec les moyens du bord. Lorsque les ambulances manquent, l’envoi d’un SMUR doit être décidé avec parcimonie, uniquement quand la situation le requiert impérativement. « On n’envoie pas de SMUR si ce n’est pas vital, s’il n’y a pas de perte de chance à proprement parler » précise le Dr François Brau, responsable SAMU-SMUR au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon.
Dans plusieurs départements, les hôpitaux ont mis en place des SMUR paramédicalisés, comprenez des SMUR sans médecin un infirmier et un ambulancier, qui sont envoyés pour les urgences de moindre importante. Les textes réglementaires encadrant ces SMUR paramédicalisés sont toujours dans les tuyaux du ministère et n’ont pas encore été publiés.
De nouvelles annonces en faveur des soignants attendus ce jeudi
En principe, « les moyens dédiés à l’intervention doivent être conditionnés par le niveau de médicalisation dont le patient a besoin et non par les moyens disponibles » explique-t-on du coté du ministère de la Santé. Mais en pratique, c’est le plus souvent par manque de médecins qu’un infirmier est envoyé seul le terrain. « Nous envoyons l’infirmier, faute de médecin, en attendant que le SMUR de Libourne arrive » explique le Dr Catherine Pradeau, responsable du SAMU de Bordeaux.
« Il n’y a pas eu de difficultés majeures, mais c’est vraiment un palliatif ». « On voit des dispositifs montés du jour au lendemain, ce n’est pas sérieux, cela nécessite un cahier des charges précis, des formations en amont, un accompagnement » peste de son côté le Dr Joel Pannetier, qui a lui aussi du mettre en place un SMUR paramédicalisé cet été dans la Sarthe.
Dans ce contexte de dégradation continue des conditions de travail aux urgences, la communication du gouvernement exaspère de plus en plus les médecins. Le nouveau ministre de la Santé Aurélien Rousseau a répété tout au long du mois d’août à qui voulait l’entendre que le système hospitalier « tenait » et que la situation était meilleure que l’été dernier grâce aux mesures prises par l’exécutif. « Il faut arrêter la désinformation, il y a une mise en danger de la population » répond le Dr Marc Noizet, président du syndicat SAMU-Urgences de France. « Quand on voit des départements qui doivent fonctionner parfois avec la moitié de leurs SMUR en moins, ça ne peut pas se passer bien ».
La Première Ministre Elisabeth Borne est attendu ce jeudi au CHU de Rouen avec le ministre de la Santé, où elle doit faire des annonces en faveur des soignants, notamment concernant l’attractivité et la prise en compte de la pénibilité.
Les urgentistes attendent des mesures fortes pour apaiser leur colère et mettre fin à une crise qui, quoi qu’on en dise, s’aggrave.
Quentin Haroche
jim.fr
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2506
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Publié le 01/09/2023
Hôpital : 1,1 milliard d’euros de revalorisations salariales
La Première Ministre Elisabeth Borne a annoncé la pérennisation de diverses mesures de revalorisation salariales pour les soignants, notamment ceux travaillant la nuit.
Ce vendredi 31 août devait marquer la fin de l’application des revalorisations de la « mission flash », des mesures salariales mises en place l’été dernier par l’ancien ministre de la Santé François Braun, en principe temporaires, mais régulièrement renouvelées depuis. En déplacement ce vendredi au CHU de Rouen, la Première Ministre Elisabeth Borne a non seulement annoncé le maintien de ces mesures provisoires jusqu’à la fin de l’année mais surtout leur pérennisation. La cheffe du gouvernement a ainsi annoncé que 1,1 milliard d’euros allait être débloqués dans le prochain budget de la Sécurité Sociale afin d’augmenter de manière pérenne le salaire des soignants travaillant de nuit à l’hôpital et ce dès le 1er janvier 2024.
Dans le détail, Elisabeth Borne a annoncé que les personnels non-médicaux, essentiellement les infirmières et les aides-soignants, verront la rémunération de leur travail de nuit réhaussée de 25 % par rapport à leurs heures de jour, tandis que le forfait qui leur est versé pour le travail le dimanche et les jours fériés sera augmenté de 20 %. Une mesure plus avantageuse que celle en place depuis l’été 2022, consistant en une majoration d’un euro par heure travaillée, qui ne permettait pas de prendre en compte l’ancienneté du professionnel.
La revalorisation de 50 % des gardes de nuit pour les médecins est pérennisée
Selon Matignon, cette revalorisation correspond à une hausse de 300 euros brut par mois pour une infirmière en milieu de carrière travaillant douze nuits par mois et de 496 euros en fin de carrière. « Nous assumons une priorité sur les personnels non médicaux aux rémunérations plus faibles » défend le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, qui accompagnait Elisabeth Borne en Normandie ce vendredi.
Les médecins n’ont pourtant pas été oubliés dans les annonces d’Elisabeth Borne ce vendredi. Comme Aurélien Rousseau l’avait déjà annoncé le 19 août dernier, la Première Ministre a annoncé que la revalorisation de 50 % des gardes de nuit pour les médecins, en vigueur depuis l’été dernier, sera pérennisée dans le prochain budget de la Sécurité Sociale et appliquée « à tous les médecins quelques soit le statut, à l’hôpital, en clinique ou en hôpital privé non lucratif ». Cela représente une hausse de rémunération de 560 euros brut par mois en moyenne pour un praticien en milieu de carrière effectuant quatre gardes par mois estime Matignon. Par ailleurs, les médecins exerçant dans le public vont voir la rémunération de leurs astreintes alignée sur celle du public.
Avec ces mesures de revalorisation, le gouvernement espère améliorer l’attractivité de l’exercice hospitalier et ainsi enclencher un cercle vertueux pour sortir l’hôpital de l’ornière. « Si nous parvenons ainsi à multiplier les recrutements et à mieux fidéliser des infirmiers, nous pourrons rouvrir des lits » espère Aurélien Rousseau.
Pour les syndicats, il faut aussi améliorer les conditions de travail
Signe que la crise de l’hôpital public est profonde et qu’un grand nombre de soignants sont à bout de forces, les réactions des syndicats de soignants hospitaliers face à ces annonces ont été assez froides. En somme, les organisations représentatives disent toutes la même chose : ces revalorisations sont les bienvenus mais sont « insuffisantes au regard de la crise actuelle » estime le Dr Christophe Prudhomme, délégué CGT-Santé. Les syndicats insistent notamment sur le fait que la question n’est pas uniquement financière et qu’il est urgent d’améliorer les conditions de travail à l’hôpital si on veut lui rendre son attractivité. « Le vrai problème ce sont les conditions infernales dans lesquelles on travaille » explique ainsi Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI) qui demande par ailleurs une hausse généralisée du salaire des infirmières et la mise en place d’un ratio de patients par infirmière.
« Cette augmentation est importante mais ce n’est pas suffisant, l’hôpital a aussi besoin d’évoluer sur ses méthodes managériales, sur ses méthodes de recrutement et sur la qualité de vie des professionnels de santé au travail » abonde dans le même sens le Dr Marc Noizet, président du syndicat Samu-Urgences de France. Des critiques entendues par Aurélien Rousseau, qui promet qu’il va « continuer à avancer sur les autres chantiers pour redonner du sens au métier de soignant ».
En espérant que, sur la question des conditions de travail, le gouvernement ne mettra pas plus d’un an à prendre des mesures pérennes.
Quentin Haroche
jim.fr
Les heures de nuit rehaussées de 25 % par rapport au tarif de jour, et le forfait versé pour le travail le dimanche et les jours fériés augmenté de 20 %, il ne faut pas rêver, cela reste peu. Le tarif en heure de nuit va passer de 1.07 euros à 1.33. De quoi faire des folies à la caisse des supermarchés. Le tarif de la garde de nuit des médecins augmenté de 50 %, ça commence à faire plus : Son montant actuel pour les PH et les CCA pour une nuit, un dimanche ou un jour férié : 277,19 € si on ajoute 50%, ça fait 415,78 euros. Comme souvent, comme toujours, les soignants sont moins revalorisés que le corps médical. Comme un goût de déjà vu...
_________________
Publié le 01/09/2023
Covid : un variant qui inquiète
Détecté en France pour la première fois, le variant BA.2.86 présenterait une grande capacité d’échappement immunitaire.
Ce n’était qu’une question de jours avant qu’il soit détecté en France, c’est désormais chose faite. Le variant d’Omicron BA.2.86, qui avait déjà été identifié dans une quinzaine de pays dans le monde, a été détectée pour la première fois en France a indiqué ce jeudi Santé Publique France (SPF). Le prélèvement a été effectué le 21 août dernier et concerne un patient vivant dans l’Aube.
Ce nouveau sous-variant d’Omicron, appelé « Pirola » sur les réseaux sociaux, fait parler de lui depuis une quinzaine de jours. Le 17 août dernier, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le Centre de contrôle des épidémies (CDC) aux Etats-Unis ont en effet tous les deux annoncés qu’ils surveillaient activement ce nouveau variant du SARS-Cov-2 en raison du nombre importants de mutations (plus d’une trentaine) qu’il présente sur la protéine Spike, celle qui permet au virus de pénétrer les cellules de l’hôte. En théorie, ces nombreuses mutations pourraient conférer à ce nouveau variant une grande capacité d’échappement immunitaire, mais cela reste à prouver en pratique. En revanche, ce nouveau variant ne semble, à ce stade, ni plus contagieux, ni plus pathogène que les autres variants d’Omicron circulant actuellement.
Le Royaume-Uni avance sa campagne de vaccination
Pour le moment, les scientifiques se montrent plutôt rassurant quant aux risques liés à ce nouveau variant, alors que la France connait depuis quelques semaines une faible remontée des cas de Covid-19. « Les cas avérés de BA.2.86 ne présentent pas de symptômes atypiques et la population mondiale a acquis en grande majorité une forme d’immunité contre les formes graves » estime Etienne Simon-Lorière, virologue à l’Institut Pasteur. « En grande partie, la protéine Spike reste la même et est reconnue, surtout par la réponse cellulaire qui est activée chez les personnes qui ont été vaccinées ou en contact avec le virus ».
Interrogé sur ce nouveau variant ce vendredi matin sur France info, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a estimé que ce mutant « n’appelait pas de réponse sanitaire particulière ». Nos voisins britanniques ne sont visiblement pas de cet avis : le gouvernement britannique a en effet annoncé ce mercredi que la prochaine campagne de vaccination de rappel contre la Covid-19, initialement prévue pour début octobre, allait être avancée au 11 septembre. Londres justifie cette décision par l’arrivée de ce nouveau variant, tout en reconnaissant que les informations sur ce mutant sont encore très limitées.
Une course perdue d’avance ?
Les mutations permanentes du SARS-Cov-2 posent le problème de l’efficacité de la vaccination. Les vaccins à ARNm actuellement disponibles ont été développé pour cibler le variant BA5, majoritaire l’été dernier en France mais qui ne circule quasiment plus dans nos contrées. Les laboratoires américains Pfizer et Moderna ont donc développé des vaccins adaptés au variant XBB 1.5 et qui seraient, si l’on en croit les premières données disponibles sur le sujet, également efficaces contre le variant EG.5.1 ou « Eris », le mutant responsable de la hausse des contaminations en France cet été.
Reste à savoir quand ces nouveaux vaccins seront disponibles. La nouvelle version du vaccin de Pfizer a été autorisée par la Commission Européenne ce vendredi et le géant de l’industrie pharmaceutique assure qu’il pourra livrer les premières doses en Europe dès le mois d’octobre. Mais d’ici là, le variant BA.2.86 aura peut-être pris le dessus sur les autres variants et les nouveaux vaccins déjà pourraient se trouver, à peine mis sur le marché, déjà dépassés.
Comme depuis près de trois ans, il semble donc que le SARS-Cov-2 ait toujours une longueur d’avance sur le génie humain.
Quentin Haroche
jim.fr
Hôpital : 1,1 milliard d’euros de revalorisations salariales
La Première Ministre Elisabeth Borne a annoncé la pérennisation de diverses mesures de revalorisation salariales pour les soignants, notamment ceux travaillant la nuit.
Ce vendredi 31 août devait marquer la fin de l’application des revalorisations de la « mission flash », des mesures salariales mises en place l’été dernier par l’ancien ministre de la Santé François Braun, en principe temporaires, mais régulièrement renouvelées depuis. En déplacement ce vendredi au CHU de Rouen, la Première Ministre Elisabeth Borne a non seulement annoncé le maintien de ces mesures provisoires jusqu’à la fin de l’année mais surtout leur pérennisation. La cheffe du gouvernement a ainsi annoncé que 1,1 milliard d’euros allait être débloqués dans le prochain budget de la Sécurité Sociale afin d’augmenter de manière pérenne le salaire des soignants travaillant de nuit à l’hôpital et ce dès le 1er janvier 2024.
Dans le détail, Elisabeth Borne a annoncé que les personnels non-médicaux, essentiellement les infirmières et les aides-soignants, verront la rémunération de leur travail de nuit réhaussée de 25 % par rapport à leurs heures de jour, tandis que le forfait qui leur est versé pour le travail le dimanche et les jours fériés sera augmenté de 20 %. Une mesure plus avantageuse que celle en place depuis l’été 2022, consistant en une majoration d’un euro par heure travaillée, qui ne permettait pas de prendre en compte l’ancienneté du professionnel.
La revalorisation de 50 % des gardes de nuit pour les médecins est pérennisée
Selon Matignon, cette revalorisation correspond à une hausse de 300 euros brut par mois pour une infirmière en milieu de carrière travaillant douze nuits par mois et de 496 euros en fin de carrière. « Nous assumons une priorité sur les personnels non médicaux aux rémunérations plus faibles » défend le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, qui accompagnait Elisabeth Borne en Normandie ce vendredi.
Les médecins n’ont pourtant pas été oubliés dans les annonces d’Elisabeth Borne ce vendredi. Comme Aurélien Rousseau l’avait déjà annoncé le 19 août dernier, la Première Ministre a annoncé que la revalorisation de 50 % des gardes de nuit pour les médecins, en vigueur depuis l’été dernier, sera pérennisée dans le prochain budget de la Sécurité Sociale et appliquée « à tous les médecins quelques soit le statut, à l’hôpital, en clinique ou en hôpital privé non lucratif ». Cela représente une hausse de rémunération de 560 euros brut par mois en moyenne pour un praticien en milieu de carrière effectuant quatre gardes par mois estime Matignon. Par ailleurs, les médecins exerçant dans le public vont voir la rémunération de leurs astreintes alignée sur celle du public.
Avec ces mesures de revalorisation, le gouvernement espère améliorer l’attractivité de l’exercice hospitalier et ainsi enclencher un cercle vertueux pour sortir l’hôpital de l’ornière. « Si nous parvenons ainsi à multiplier les recrutements et à mieux fidéliser des infirmiers, nous pourrons rouvrir des lits » espère Aurélien Rousseau.
Pour les syndicats, il faut aussi améliorer les conditions de travail
Signe que la crise de l’hôpital public est profonde et qu’un grand nombre de soignants sont à bout de forces, les réactions des syndicats de soignants hospitaliers face à ces annonces ont été assez froides. En somme, les organisations représentatives disent toutes la même chose : ces revalorisations sont les bienvenus mais sont « insuffisantes au regard de la crise actuelle » estime le Dr Christophe Prudhomme, délégué CGT-Santé. Les syndicats insistent notamment sur le fait que la question n’est pas uniquement financière et qu’il est urgent d’améliorer les conditions de travail à l’hôpital si on veut lui rendre son attractivité. « Le vrai problème ce sont les conditions infernales dans lesquelles on travaille » explique ainsi Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI) qui demande par ailleurs une hausse généralisée du salaire des infirmières et la mise en place d’un ratio de patients par infirmière.
« Cette augmentation est importante mais ce n’est pas suffisant, l’hôpital a aussi besoin d’évoluer sur ses méthodes managériales, sur ses méthodes de recrutement et sur la qualité de vie des professionnels de santé au travail » abonde dans le même sens le Dr Marc Noizet, président du syndicat Samu-Urgences de France. Des critiques entendues par Aurélien Rousseau, qui promet qu’il va « continuer à avancer sur les autres chantiers pour redonner du sens au métier de soignant ».
En espérant que, sur la question des conditions de travail, le gouvernement ne mettra pas plus d’un an à prendre des mesures pérennes.
Quentin Haroche
jim.fr
Les heures de nuit rehaussées de 25 % par rapport au tarif de jour, et le forfait versé pour le travail le dimanche et les jours fériés augmenté de 20 %, il ne faut pas rêver, cela reste peu. Le tarif en heure de nuit va passer de 1.07 euros à 1.33. De quoi faire des folies à la caisse des supermarchés. Le tarif de la garde de nuit des médecins augmenté de 50 %, ça commence à faire plus : Son montant actuel pour les PH et les CCA pour une nuit, un dimanche ou un jour férié : 277,19 € si on ajoute 50%, ça fait 415,78 euros. Comme souvent, comme toujours, les soignants sont moins revalorisés que le corps médical. Comme un goût de déjà vu...
_________________
Publié le 01/09/2023
Covid : un variant qui inquiète
Détecté en France pour la première fois, le variant BA.2.86 présenterait une grande capacité d’échappement immunitaire.
Ce n’était qu’une question de jours avant qu’il soit détecté en France, c’est désormais chose faite. Le variant d’Omicron BA.2.86, qui avait déjà été identifié dans une quinzaine de pays dans le monde, a été détectée pour la première fois en France a indiqué ce jeudi Santé Publique France (SPF). Le prélèvement a été effectué le 21 août dernier et concerne un patient vivant dans l’Aube.
Ce nouveau sous-variant d’Omicron, appelé « Pirola » sur les réseaux sociaux, fait parler de lui depuis une quinzaine de jours. Le 17 août dernier, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le Centre de contrôle des épidémies (CDC) aux Etats-Unis ont en effet tous les deux annoncés qu’ils surveillaient activement ce nouveau variant du SARS-Cov-2 en raison du nombre importants de mutations (plus d’une trentaine) qu’il présente sur la protéine Spike, celle qui permet au virus de pénétrer les cellules de l’hôte. En théorie, ces nombreuses mutations pourraient conférer à ce nouveau variant une grande capacité d’échappement immunitaire, mais cela reste à prouver en pratique. En revanche, ce nouveau variant ne semble, à ce stade, ni plus contagieux, ni plus pathogène que les autres variants d’Omicron circulant actuellement.
Le Royaume-Uni avance sa campagne de vaccination
Pour le moment, les scientifiques se montrent plutôt rassurant quant aux risques liés à ce nouveau variant, alors que la France connait depuis quelques semaines une faible remontée des cas de Covid-19. « Les cas avérés de BA.2.86 ne présentent pas de symptômes atypiques et la population mondiale a acquis en grande majorité une forme d’immunité contre les formes graves » estime Etienne Simon-Lorière, virologue à l’Institut Pasteur. « En grande partie, la protéine Spike reste la même et est reconnue, surtout par la réponse cellulaire qui est activée chez les personnes qui ont été vaccinées ou en contact avec le virus ».
Interrogé sur ce nouveau variant ce vendredi matin sur France info, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a estimé que ce mutant « n’appelait pas de réponse sanitaire particulière ». Nos voisins britanniques ne sont visiblement pas de cet avis : le gouvernement britannique a en effet annoncé ce mercredi que la prochaine campagne de vaccination de rappel contre la Covid-19, initialement prévue pour début octobre, allait être avancée au 11 septembre. Londres justifie cette décision par l’arrivée de ce nouveau variant, tout en reconnaissant que les informations sur ce mutant sont encore très limitées.
Une course perdue d’avance ?
Les mutations permanentes du SARS-Cov-2 posent le problème de l’efficacité de la vaccination. Les vaccins à ARNm actuellement disponibles ont été développé pour cibler le variant BA5, majoritaire l’été dernier en France mais qui ne circule quasiment plus dans nos contrées. Les laboratoires américains Pfizer et Moderna ont donc développé des vaccins adaptés au variant XBB 1.5 et qui seraient, si l’on en croit les premières données disponibles sur le sujet, également efficaces contre le variant EG.5.1 ou « Eris », le mutant responsable de la hausse des contaminations en France cet été.
Reste à savoir quand ces nouveaux vaccins seront disponibles. La nouvelle version du vaccin de Pfizer a été autorisée par la Commission Européenne ce vendredi et le géant de l’industrie pharmaceutique assure qu’il pourra livrer les premières doses en Europe dès le mois d’octobre. Mais d’ici là, le variant BA.2.86 aura peut-être pris le dessus sur les autres variants et les nouveaux vaccins déjà pourraient se trouver, à peine mis sur le marché, déjà dépassés.
Comme depuis près de trois ans, il semble donc que le SARS-Cov-2 ait toujours une longueur d’avance sur le génie humain.
Quentin Haroche
jim.fr
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2506
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Publié le 04/09/2023
Transmission sexuelle du VIH avec une charge virale « presque » indétectable, un risque zéro ?
Au cours de l’infection par le VIH, la charge virale est le gold standard pour l’estimation de la réponse au traitement antirétroviral, l’objectif étant d’aboutir à une virémie quasiment nulle le plus longtemps possible. C’est la condition qui garantit un état de santé optimal, une longévité au diapason et une diminution de la transmission sexuelle du virus. Les données épidémiologiques les plus récentes indiquent que chez une minorité de patients, la charge virale reste détectable (par exemple <1 000 copies par mL), ce qui est certes significatif, mais pas au point de conclure systématiquement à un échec thérapeutique.
La signification clinique et l’attitude à adopter face à ces virémies faibles sont l’objet d’un débat sans fin. Le risque de transmission sexuelle du virus est notamment incertain, au point d’affecter les messages destinés au public. Aux Etats-Unis comme dans d’autres pays à haut revenu, le message undetectable=untransmittable (U=U) définissant le risque zéro correspond à une charge virale < 200 copies/ mL. Qu’en est-il pour des valeurs comprises entre 200 et 999 copies/ mL ? La réponse à cette question est plus controversée.
Une revue systématique et exhaustive de la littérature internationale permet de faire le point sur ce sujet débattu : elle est basée sur les données enregistrées entre le 1er janvier 2010 et le 17 novembre 2022 sur PubMed, MEDLINE, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Embase, Conference Proceedings Citation Index-Science et WHO Global Index Medicus. N’ont été sélectionnées que les études traitant de la transmission sexuelle du virus au sein de couples sérologiquement discordants, la charge virale étant connue avec précision. Les articles portant sur le message U-U et l’impact public des virémies faibles ont également retenu l’attention. Ont été exclus les lettres à l’éditeur, les commentaires et les éditoriaux.
Plus de 7 700 couples sérodiscordants
Sur les 244 études identifiées, huit ont été finalement incluses dans l’analyse, regroupant 7 762 couples « sérodiscordants » résidant dans 35 pays. Le niveau de certitude au terme de l’analyse est considéré comme faible, celui de biais apparaissant peu important.
Trois études ont conclu à l’absence de transmission du VIH en cas de charge virale < 200 copies/Ml chez le partenaire séropositif. Dans les autres études de cohorte prospectives, ont été dénombrés 323 cas de transmission virale, aucun n’impliquant des patients chez lesquels la charge virale était constamment indétectable sous traitement antirétroviral.
En cas de charge virale < 1 000 copies/ml et dans l’ensemble des études, deux cas de transmission potentielle ont été mis en évidence. Leur interprétation reste cependant difficile, du fait de la longueur de l’intervalle (respectivement 50 et 53 jours) entre la date supposée de la transmission et la charge virale la plus récente.
Cette revue de la littérature internationale suggère fortement que le risque de transmission sexuelle du VIH est proche de zéro quand la charge virale est <1 000 copies/ mL. Une information qui pourrait mettre un terme au débat actuel, tout en incitant les patients séropositifs à une observance thérapeutique optimale et en réduisant leur stigmatisation. La surveillance régulière de la virémie est un élément essentiel de cette stratégie.
Dr Philippe Tellier
jim.fr
RÉFÉRENCE
Broyles LN et coll. : The risk of sexual transmission of HIV in individuals with low-level HIV viraemia: a systematic review. Lancet 2023; 402: 464–µdoi.org/10.1016/ S0140-6736(23)00877-2.
_____________
Publié le 04/09/2023
Santé du rugbyman à la retraite, il est temps de transformer l’essai !
Dans quelques jours, la France accueillera des joueurs venant de toute la planète à l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby.
Les exigences physiques et psychologiques du rugby en font l’une des disciplines où le taux de blessures est le plus élevé. Ainsi, comparés à des pratiquants de sports sans contact, les joueurs de haut niveau sont plus exposés aux commotions cérébrales et aux lésions graves nécessitant une intervention chirurgicale. De plus, ils sont volontiers confrontés à des symptômes d’anxiété, voire de dépression.
À ce jour, la recherche épidémiologique sur la santé des joueurs de rugby qui ont arrêté leur carrière sportive est peu développée. Pourtant, des travaux ont mis en évidence, chez les anciens joueurs de sexe masculin, des soucis musculosquelettiques, cardiovasculaires et neurocognitifs. Dans ce dernier cas, il s’agit en particulier des conséquences à long terme des traumatismes crâniens répétés dont ils peuvent être victimes et qui, à juste titre, font l’objet d’une attention croissante.
Dès lors, il conviendrait de disposer de données plus fines sur la prévalence des problèmes de santé tant chez les joueurs que chez les joueuses, une fois à la retraite.
Des données insuffisantes pour les hommes et aucune pour les femmes
Des chercheurs d’Amsterdam aux Pays-Bas, dont l’équipe nationale est 26e au classement de l’International Rugby Board (IRB), se sont saisis de la question en conduisant une étude de la portée (ou scoping review). Cette méthode, qui se fonde sur la pertinence des résultats plus que sur la qualité de la recherche, permet d’obtenir rapidement des données sur un thème peu connu.
Ils ont exploré les bases habituelles (Medline, SportDiscus, Embase, PsycINFO) en s’intéressant aux pratiquants professionnels ou de haut niveau. Sur les 573 articles identifiés, seuls 16 correspondaient aux critères d’inclusion et ont été analysés.
Premier constat : aucune étude ne portait sur les conditions de santé des anciennes joueuses de rugby, qui ont pourtant eu une première coupe du monde en 1991 (mais pas reconnue par l’IRB).
Second constat, par rapport aux groupes témoins (autres sportifs), les taux de prévalence d’arthrose, de douleurs articulaires et du dos, d’affections neurocognitives et de dépression autodéclarée étaient plus élevés chez les rugbymen retraités. De même pour leur taux de consommation à risque d’alcool. Les répercussions cardiovasculaires n’ont pas pu être évaluées par manque de témoins.
Les auteurs concluent à la nécessité de recherches supplémentaires pour mieux comprendre les conditions de santé des joueurs et les joueuses de rugby d’élite à la retraite.
Dr Patrick Laure
jim.fr
RÉFÉRENCE
Le Roux J, Anema F et coll. : Health conditions among retired elite rugby players: a scoping review. BMJ Open Sport & Exercise Medicine 2023;9: e001573. doi:10.1136/bmjsem-2023-001573
Les anciens du rugby font du sport extrême après : tricot, coloriage ou canevas.
___________
Publié le 04/09/2023
Infirmiers et aides-soignants : les services de 12 heures nuisent (gravement ?) à la santé
Travailler 10 à 12 heures : c’est le quotidien de nombreux infirmiers et infirmières français. Une nouvelle étude semble prouver que d’aussi longues plages horaires sont associées à des troubles psychologiques, davantage de stress et des comportements nocifs.
Le troisième volet de l’étude AMADEUS (« AMéliorer l’ADaptation à l’Emploi pour limiter la soUffrance des Soignants »), menée par le Dr Guillaume Fond (médecin psychiatre à l’AP-HM) et Guillaume Lucas (docteur en santé publique), s’est attaché à comprendre les effets des services de 12 heures sur la santé mentale et physique des infirmiers et des aides-soignants.
Plus de risque de développer des troubles psychologiques
Les infirmiers et aides-soignants ont le choix entre travailler 7 heures 5 jours par semaine ou travailler 10 à 12 heures, 3 jours par semaine. Si la durée hebdomadaire est in fine similaire, l’étude tend à montrer que l’impact sur la santé est bien différent. Les chercheurs ont ainsi interrogé 3133 infirmiers et infirmières pour en savoir plus, notamment, sur leur état psychologique et leur santé mentale en fonction des plages horaires travaillées. 42,2 % d’entre eux avaient adopté pour des horaires de travail longs.
Selon les résultats de l’enquête, ces derniers étaient ainsi beaucoup plus susceptibles de faire état d’une « grande demande psychologique, d’un épuisement professionnel plus fréquent, d’un plus grand nombre de cigarettes fumées quotidiennement et d’une plus grande consommation de café », expliquent les chercheurs. Ainsi, même si ces infirmiers disposent de plus de jours de congés, ils subissent aussi et surtout une plus grande charge de travail concentrée sur une période plus courte.
Des mécanismes d’adaptation qui entraînent des comportements nocifs
Les infirmiers et aides-soignants en question seraient ainsi susceptibles, selon les chercheurs, d’adopter « des comportements plus nocifs pour la santé en tant que mécanisme d’adaptation ». Parmi ces mécanismes en question, les auteurs y incluent la consommation accrue de café et de tabac « pour faire face à l’épuisement professionnel et à une demande psychologique élevée ».
De plus, travailler sur de longues plages horaires amène les personnels à prendre plus de pauses, ce qui augmente davantage leur consommation de café et de cigarettes (pour les fumeurs) « afin d’accroître leur vigilance et leur concentration et de réduire le stress ».
Les auteurs de l’étude estiment donc nécessaire la création de programmes de prévention donnant des informations sur les « risques à long terme de ces comportements », notamment en ce qui concerne la santé mentale. Ils proposent aussi de mettre en avant la sieste au travail ainsi que la méditation pendant les pauses pour « aider les infirmiers à gérer le stress lié au travail sans avoir recours à la consommation de café ou de tabac ».
Des résultats confirmés des études internationales
Le Dr Guillaume Fond et Guillaume Lucas font remarquer que les résultats de leur étude sont confirmés par de nombreuses études internationales portant sur le même sujet.
Ainsi, qu’ils s’agissent d’infirmiers et aides-soignants chinois, malaisiens, nigérians, singapouriens ou néerlandais, de nombreux travaux récents tendent à montrer que travailler sur de longues plages horaires augmente le stress et le risque d’épuisement professionnel, et peut éventuellement mener à une plus grande détresse psychologique. Des données qui fournissent des résultats essentiels « pour orienter les politiques de santé et de prévention », expliquent les chercheurs.
Raphaël Lichten
jim.fr
Éternel débat, ceux qui sont contre diront qu'il faut plutôt embaucher. Oui mais qui ? Le personnel fuit et ce n'est pas en colmatant avec un soignant le départ de 10 autres, que l'on va y arriver. Les 12h sont certes fatigantes, mais pour le personnel, souvent résidant à plusieurs dizaines de Km de son travail, venir 5 fois dans la semaine est bien plus contraignant que 3 fois :
en terme de distance, la fatigue est tout autant, voire plus,
en terme de coût de carburant c'est plus,
en terme d'usure mécanique c'est plus. (on fait plus de km par définition)
en terme de jours à soi, c'est moins (pour les enfants, les activités personnelles, le repos...)
Traditionnellement les syndicats sont contre, mais encore une fois, les embauches à l'hôpital sont difficiles. De plus, ce ne sont pas aux syndicats de nous dire comment nous devons organiser notre quotidien. Si certains et certaines y trouvent leur intérêt à être en 12h, qu'ils et elles le soient.
Transmission sexuelle du VIH avec une charge virale « presque » indétectable, un risque zéro ?
Au cours de l’infection par le VIH, la charge virale est le gold standard pour l’estimation de la réponse au traitement antirétroviral, l’objectif étant d’aboutir à une virémie quasiment nulle le plus longtemps possible. C’est la condition qui garantit un état de santé optimal, une longévité au diapason et une diminution de la transmission sexuelle du virus. Les données épidémiologiques les plus récentes indiquent que chez une minorité de patients, la charge virale reste détectable (par exemple <1 000 copies par mL), ce qui est certes significatif, mais pas au point de conclure systématiquement à un échec thérapeutique.
La signification clinique et l’attitude à adopter face à ces virémies faibles sont l’objet d’un débat sans fin. Le risque de transmission sexuelle du virus est notamment incertain, au point d’affecter les messages destinés au public. Aux Etats-Unis comme dans d’autres pays à haut revenu, le message undetectable=untransmittable (U=U) définissant le risque zéro correspond à une charge virale < 200 copies/ mL. Qu’en est-il pour des valeurs comprises entre 200 et 999 copies/ mL ? La réponse à cette question est plus controversée.
Une revue systématique et exhaustive de la littérature internationale permet de faire le point sur ce sujet débattu : elle est basée sur les données enregistrées entre le 1er janvier 2010 et le 17 novembre 2022 sur PubMed, MEDLINE, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Embase, Conference Proceedings Citation Index-Science et WHO Global Index Medicus. N’ont été sélectionnées que les études traitant de la transmission sexuelle du virus au sein de couples sérologiquement discordants, la charge virale étant connue avec précision. Les articles portant sur le message U-U et l’impact public des virémies faibles ont également retenu l’attention. Ont été exclus les lettres à l’éditeur, les commentaires et les éditoriaux.
Plus de 7 700 couples sérodiscordants
Sur les 244 études identifiées, huit ont été finalement incluses dans l’analyse, regroupant 7 762 couples « sérodiscordants » résidant dans 35 pays. Le niveau de certitude au terme de l’analyse est considéré comme faible, celui de biais apparaissant peu important.
Trois études ont conclu à l’absence de transmission du VIH en cas de charge virale < 200 copies/Ml chez le partenaire séropositif. Dans les autres études de cohorte prospectives, ont été dénombrés 323 cas de transmission virale, aucun n’impliquant des patients chez lesquels la charge virale était constamment indétectable sous traitement antirétroviral.
En cas de charge virale < 1 000 copies/ml et dans l’ensemble des études, deux cas de transmission potentielle ont été mis en évidence. Leur interprétation reste cependant difficile, du fait de la longueur de l’intervalle (respectivement 50 et 53 jours) entre la date supposée de la transmission et la charge virale la plus récente.
Cette revue de la littérature internationale suggère fortement que le risque de transmission sexuelle du VIH est proche de zéro quand la charge virale est <1 000 copies/ mL. Une information qui pourrait mettre un terme au débat actuel, tout en incitant les patients séropositifs à une observance thérapeutique optimale et en réduisant leur stigmatisation. La surveillance régulière de la virémie est un élément essentiel de cette stratégie.
Dr Philippe Tellier
jim.fr
RÉFÉRENCE
Broyles LN et coll. : The risk of sexual transmission of HIV in individuals with low-level HIV viraemia: a systematic review. Lancet 2023; 402: 464–µdoi.org/10.1016/ S0140-6736(23)00877-2.
_____________
Publié le 04/09/2023
Santé du rugbyman à la retraite, il est temps de transformer l’essai !
Dans quelques jours, la France accueillera des joueurs venant de toute la planète à l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby.
Les exigences physiques et psychologiques du rugby en font l’une des disciplines où le taux de blessures est le plus élevé. Ainsi, comparés à des pratiquants de sports sans contact, les joueurs de haut niveau sont plus exposés aux commotions cérébrales et aux lésions graves nécessitant une intervention chirurgicale. De plus, ils sont volontiers confrontés à des symptômes d’anxiété, voire de dépression.
À ce jour, la recherche épidémiologique sur la santé des joueurs de rugby qui ont arrêté leur carrière sportive est peu développée. Pourtant, des travaux ont mis en évidence, chez les anciens joueurs de sexe masculin, des soucis musculosquelettiques, cardiovasculaires et neurocognitifs. Dans ce dernier cas, il s’agit en particulier des conséquences à long terme des traumatismes crâniens répétés dont ils peuvent être victimes et qui, à juste titre, font l’objet d’une attention croissante.
Dès lors, il conviendrait de disposer de données plus fines sur la prévalence des problèmes de santé tant chez les joueurs que chez les joueuses, une fois à la retraite.
Des données insuffisantes pour les hommes et aucune pour les femmes
Des chercheurs d’Amsterdam aux Pays-Bas, dont l’équipe nationale est 26e au classement de l’International Rugby Board (IRB), se sont saisis de la question en conduisant une étude de la portée (ou scoping review). Cette méthode, qui se fonde sur la pertinence des résultats plus que sur la qualité de la recherche, permet d’obtenir rapidement des données sur un thème peu connu.
Ils ont exploré les bases habituelles (Medline, SportDiscus, Embase, PsycINFO) en s’intéressant aux pratiquants professionnels ou de haut niveau. Sur les 573 articles identifiés, seuls 16 correspondaient aux critères d’inclusion et ont été analysés.
Premier constat : aucune étude ne portait sur les conditions de santé des anciennes joueuses de rugby, qui ont pourtant eu une première coupe du monde en 1991 (mais pas reconnue par l’IRB).
Second constat, par rapport aux groupes témoins (autres sportifs), les taux de prévalence d’arthrose, de douleurs articulaires et du dos, d’affections neurocognitives et de dépression autodéclarée étaient plus élevés chez les rugbymen retraités. De même pour leur taux de consommation à risque d’alcool. Les répercussions cardiovasculaires n’ont pas pu être évaluées par manque de témoins.
Les auteurs concluent à la nécessité de recherches supplémentaires pour mieux comprendre les conditions de santé des joueurs et les joueuses de rugby d’élite à la retraite.
Dr Patrick Laure
jim.fr
RÉFÉRENCE
Le Roux J, Anema F et coll. : Health conditions among retired elite rugby players: a scoping review. BMJ Open Sport & Exercise Medicine 2023;9: e001573. doi:10.1136/bmjsem-2023-001573
Les anciens du rugby font du sport extrême après : tricot, coloriage ou canevas.
___________
Publié le 04/09/2023
Infirmiers et aides-soignants : les services de 12 heures nuisent (gravement ?) à la santé
Travailler 10 à 12 heures : c’est le quotidien de nombreux infirmiers et infirmières français. Une nouvelle étude semble prouver que d’aussi longues plages horaires sont associées à des troubles psychologiques, davantage de stress et des comportements nocifs.
Le troisième volet de l’étude AMADEUS (« AMéliorer l’ADaptation à l’Emploi pour limiter la soUffrance des Soignants »), menée par le Dr Guillaume Fond (médecin psychiatre à l’AP-HM) et Guillaume Lucas (docteur en santé publique), s’est attaché à comprendre les effets des services de 12 heures sur la santé mentale et physique des infirmiers et des aides-soignants.
Plus de risque de développer des troubles psychologiques
Les infirmiers et aides-soignants ont le choix entre travailler 7 heures 5 jours par semaine ou travailler 10 à 12 heures, 3 jours par semaine. Si la durée hebdomadaire est in fine similaire, l’étude tend à montrer que l’impact sur la santé est bien différent. Les chercheurs ont ainsi interrogé 3133 infirmiers et infirmières pour en savoir plus, notamment, sur leur état psychologique et leur santé mentale en fonction des plages horaires travaillées. 42,2 % d’entre eux avaient adopté pour des horaires de travail longs.
Selon les résultats de l’enquête, ces derniers étaient ainsi beaucoup plus susceptibles de faire état d’une « grande demande psychologique, d’un épuisement professionnel plus fréquent, d’un plus grand nombre de cigarettes fumées quotidiennement et d’une plus grande consommation de café », expliquent les chercheurs. Ainsi, même si ces infirmiers disposent de plus de jours de congés, ils subissent aussi et surtout une plus grande charge de travail concentrée sur une période plus courte.
Des mécanismes d’adaptation qui entraînent des comportements nocifs
Les infirmiers et aides-soignants en question seraient ainsi susceptibles, selon les chercheurs, d’adopter « des comportements plus nocifs pour la santé en tant que mécanisme d’adaptation ». Parmi ces mécanismes en question, les auteurs y incluent la consommation accrue de café et de tabac « pour faire face à l’épuisement professionnel et à une demande psychologique élevée ».
De plus, travailler sur de longues plages horaires amène les personnels à prendre plus de pauses, ce qui augmente davantage leur consommation de café et de cigarettes (pour les fumeurs) « afin d’accroître leur vigilance et leur concentration et de réduire le stress ».
Les auteurs de l’étude estiment donc nécessaire la création de programmes de prévention donnant des informations sur les « risques à long terme de ces comportements », notamment en ce qui concerne la santé mentale. Ils proposent aussi de mettre en avant la sieste au travail ainsi que la méditation pendant les pauses pour « aider les infirmiers à gérer le stress lié au travail sans avoir recours à la consommation de café ou de tabac ».
Des résultats confirmés des études internationales
Le Dr Guillaume Fond et Guillaume Lucas font remarquer que les résultats de leur étude sont confirmés par de nombreuses études internationales portant sur le même sujet.
Ainsi, qu’ils s’agissent d’infirmiers et aides-soignants chinois, malaisiens, nigérians, singapouriens ou néerlandais, de nombreux travaux récents tendent à montrer que travailler sur de longues plages horaires augmente le stress et le risque d’épuisement professionnel, et peut éventuellement mener à une plus grande détresse psychologique. Des données qui fournissent des résultats essentiels « pour orienter les politiques de santé et de prévention », expliquent les chercheurs.
Raphaël Lichten
jim.fr
Éternel débat, ceux qui sont contre diront qu'il faut plutôt embaucher. Oui mais qui ? Le personnel fuit et ce n'est pas en colmatant avec un soignant le départ de 10 autres, que l'on va y arriver. Les 12h sont certes fatigantes, mais pour le personnel, souvent résidant à plusieurs dizaines de Km de son travail, venir 5 fois dans la semaine est bien plus contraignant que 3 fois :
en terme de distance, la fatigue est tout autant, voire plus,
en terme de coût de carburant c'est plus,
en terme d'usure mécanique c'est plus. (on fait plus de km par définition)
en terme de jours à soi, c'est moins (pour les enfants, les activités personnelles, le repos...)
Traditionnellement les syndicats sont contre, mais encore une fois, les embauches à l'hôpital sont difficiles. De plus, ce ne sont pas aux syndicats de nous dire comment nous devons organiser notre quotidien. Si certains et certaines y trouvent leur intérêt à être en 12h, qu'ils et elles le soient.
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2506
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Vaccins Pfizer et Moderna : le point sur les effets indésirables
Aude Lecrubier
31 août 2023
medscape.com
France — Quel est bilan des effets indésirables (EI) liés aux vaccins ARN contre le Covid depuis le début de la vaccination ? Dans une actualisation publiée le 28 août, l’ANSM et le RF-CRPV indiquent qu’aucun nouveau signal n’a été rapporté depuis plusieurs mois mais ils font le point sur les déclarations, les événements à surveiller, les signaux potentiels et les EI confirmés depuis fin 2020 .
Les deux organismes rappellent que près de 157 millions (156 788 000) injections de vaccins contre le Covid-19 ont été réalisées en France depuis le début de la vaccination dont plus de 123 millions d’injections avec le Comirnaty de BioNTech-Pfizer et plus de 24 millions avec le Spikevax de Moderna (données du 8 juin 2023). Sur l’ensemble de ces injections, 193 934 déclarations de possibles effets indésirables ont été faites.
L’analyse indique qu’aucun signal spécifique n’a été identifié chez les personnes ayant eu une dose de rappel, que ce soit avec le vaccin monovalent ou le vaccin bivalent ainsi qu’après l’administration d’un schéma hétérologue.
Comirnaty : la surveillance se poursuit pour une vingtaine de pathologies
Concernant le vaccin Comirnaty, 126 802 déclarations ont été réalisées depuis le début de la vaccination pour plus de 123 573 800 injections.
Les effets indésirables avérés liés au Comirnaty sont l’hypertension artérielle (rapport 4), la myocardite / péricardite (focus 1) et les saignements menstruels importants (communication PRAC).
Parmi les signaux potentiels déjà sous surveillance, l’évaluation européenne n’a pas identifié de lien entre la survenue des événements listés ci-dessous et le vaccin mais la surveillance au niveau national se poursuit pour :
-Zona et réactivation virale ;
-Troubles du rythme cardiaque ;
-Néphropathie glomérulaire ;
-Pancréatite ;
-Troubles menstruels (hors saignements menstruels importants).
D’autres signaux sont encore en cours d’évaluation comme la survenue d’une polyarthite rhumatoïde, d’une hémophilie acquise, le syndrome de Parsonage Turner, la pseudo-polyarthrite rhizomélique, l’hépatite auto-immune et la surdité.
Concernant les événements déjà sous surveillance, qui sont les cas qui montrent une gravité, une fréquence et/ou un caractère inattendus, sans que les informations soient suffisamment étayées pour conclure sur un rôle du vaccin, l’ANSM rapporte les pathologies suivantes :
-Thrombose veineuse cérébrale ;
-Thrombopénie / thrombopénie immunologique / hématomes spontanés
-Déséquilibre diabétique dans des contextes de réactogénicité
-Syndrome d’activation macrophagique
-Méningoencéphalite zostérienne
-Aplasie médullaire
-Syndrome de Guillain-Barré (SGB)
-Rejet de greffe de la cornée
Chez l’enfant :
-Syndrome inflammatoire multisystémique chez l’enfant (PIMS).
Spikevax : des signaux et des EI proches de ceux du Comirnaty
Pour le vaccin ARN Spikevax de Moderna, 33 794 déclarations d’EI potentiel ont été transmises depuis le début de la vaccination pour plus de 24 212 300 injections.
Parmi les effets indésirables établis figurent les troubles vasculaires de type d’hypertension artérielle, les réactions retardées (réaction locale douloureuse, érythémateuse, prurigineuse au site d’injection), les myocardites / péricardites, l’érythème polymorphe et les saignements menstruels importants.
Concernant, les signaux potentiels déjà sous surveillance, ils sont similaires à ceux du vaccin Comirnaty, si ce n’est que n’y figurent pas la pancréatite et la pseudo-polyarthrite rhizomélique. En revanche, la perte de connaissance, plus ou moins associée à des chutes, l’anémie-hémolytique auto-immune et des vascularites pourraient être associées au Spikevax alors qu’il n’y a pas eu de signaux rapportés avec le Comirnaty.
Enfin, la liste des événements déjà sous surveillance est la suivante :
-Réactogénicité D2 ;
-Evénement thromboembolique, dont thrombose veineuse cérébrale ;
-Déséquilibre / récidive de pathologie chronique ;
-Ictus amnésique ;
-Acouphènes ;
-Vascularite systémique à ANCA ;
-Troubles musculo-squelettiques ;
-Thyroïdite ;
-Uvéite.
Chez les femmes enceintes ou allaitantes, depuis le début de la vaccination, « les fausses couches spontanées représentent la majorité des effets indésirables rapportés mais les données actuelles ne permettent pas de conclure que ces événements sont liés au vaccin, d’autant que des
facteurs de risques étaient associés dans plusieurs cas et qu’il s’agit d’un évènement relativement fréquent en population générale (de 12 à 20 % des grossesses selon les études). Par ailleurs, 3 études récentes (Zauche &
al., Kharbanda & al. et Magnus & al.) n’ont pas retrouvé de lien entre les fausses couches spontanées et les vaccins à ARNm contre le Covid-19. Ainsi, le lien avec le vaccin ne peut pas être établi », indique l’analyse.
Concernant les événements déjà sous surveillance, des événements thromboemboliques, des morts in utéro, des HELLP Syndrome, des métrorragies, des contractions utérines et des mastites ont été rapportés avec le Comirnaty. En parallèle, des morts in utéro, des métrorragies, et des contractions utérines ont aussi été signalées avec le vaccin de Moderna.
Aude Lecrubier
31 août 2023
medscape.com
France — Quel est bilan des effets indésirables (EI) liés aux vaccins ARN contre le Covid depuis le début de la vaccination ? Dans une actualisation publiée le 28 août, l’ANSM et le RF-CRPV indiquent qu’aucun nouveau signal n’a été rapporté depuis plusieurs mois mais ils font le point sur les déclarations, les événements à surveiller, les signaux potentiels et les EI confirmés depuis fin 2020 .
Les deux organismes rappellent que près de 157 millions (156 788 000) injections de vaccins contre le Covid-19 ont été réalisées en France depuis le début de la vaccination dont plus de 123 millions d’injections avec le Comirnaty de BioNTech-Pfizer et plus de 24 millions avec le Spikevax de Moderna (données du 8 juin 2023). Sur l’ensemble de ces injections, 193 934 déclarations de possibles effets indésirables ont été faites.
L’analyse indique qu’aucun signal spécifique n’a été identifié chez les personnes ayant eu une dose de rappel, que ce soit avec le vaccin monovalent ou le vaccin bivalent ainsi qu’après l’administration d’un schéma hétérologue.
Comirnaty : la surveillance se poursuit pour une vingtaine de pathologies
Concernant le vaccin Comirnaty, 126 802 déclarations ont été réalisées depuis le début de la vaccination pour plus de 123 573 800 injections.
Les effets indésirables avérés liés au Comirnaty sont l’hypertension artérielle (rapport 4), la myocardite / péricardite (focus 1) et les saignements menstruels importants (communication PRAC).
Parmi les signaux potentiels déjà sous surveillance, l’évaluation européenne n’a pas identifié de lien entre la survenue des événements listés ci-dessous et le vaccin mais la surveillance au niveau national se poursuit pour :
-Zona et réactivation virale ;
-Troubles du rythme cardiaque ;
-Néphropathie glomérulaire ;
-Pancréatite ;
-Troubles menstruels (hors saignements menstruels importants).
D’autres signaux sont encore en cours d’évaluation comme la survenue d’une polyarthite rhumatoïde, d’une hémophilie acquise, le syndrome de Parsonage Turner, la pseudo-polyarthrite rhizomélique, l’hépatite auto-immune et la surdité.
Concernant les événements déjà sous surveillance, qui sont les cas qui montrent une gravité, une fréquence et/ou un caractère inattendus, sans que les informations soient suffisamment étayées pour conclure sur un rôle du vaccin, l’ANSM rapporte les pathologies suivantes :
-Thrombose veineuse cérébrale ;
-Thrombopénie / thrombopénie immunologique / hématomes spontanés
-Déséquilibre diabétique dans des contextes de réactogénicité
-Syndrome d’activation macrophagique
-Méningoencéphalite zostérienne
-Aplasie médullaire
-Syndrome de Guillain-Barré (SGB)
-Rejet de greffe de la cornée
Chez l’enfant :
-Syndrome inflammatoire multisystémique chez l’enfant (PIMS).
Spikevax : des signaux et des EI proches de ceux du Comirnaty
Pour le vaccin ARN Spikevax de Moderna, 33 794 déclarations d’EI potentiel ont été transmises depuis le début de la vaccination pour plus de 24 212 300 injections.
Parmi les effets indésirables établis figurent les troubles vasculaires de type d’hypertension artérielle, les réactions retardées (réaction locale douloureuse, érythémateuse, prurigineuse au site d’injection), les myocardites / péricardites, l’érythème polymorphe et les saignements menstruels importants.
Concernant, les signaux potentiels déjà sous surveillance, ils sont similaires à ceux du vaccin Comirnaty, si ce n’est que n’y figurent pas la pancréatite et la pseudo-polyarthrite rhizomélique. En revanche, la perte de connaissance, plus ou moins associée à des chutes, l’anémie-hémolytique auto-immune et des vascularites pourraient être associées au Spikevax alors qu’il n’y a pas eu de signaux rapportés avec le Comirnaty.
Enfin, la liste des événements déjà sous surveillance est la suivante :
-Réactogénicité D2 ;
-Evénement thromboembolique, dont thrombose veineuse cérébrale ;
-Déséquilibre / récidive de pathologie chronique ;
-Ictus amnésique ;
-Acouphènes ;
-Vascularite systémique à ANCA ;
-Troubles musculo-squelettiques ;
-Thyroïdite ;
-Uvéite.
Chez les femmes enceintes ou allaitantes, depuis le début de la vaccination, « les fausses couches spontanées représentent la majorité des effets indésirables rapportés mais les données actuelles ne permettent pas de conclure que ces événements sont liés au vaccin, d’autant que des
facteurs de risques étaient associés dans plusieurs cas et qu’il s’agit d’un évènement relativement fréquent en population générale (de 12 à 20 % des grossesses selon les études). Par ailleurs, 3 études récentes (Zauche &
al., Kharbanda & al. et Magnus & al.) n’ont pas retrouvé de lien entre les fausses couches spontanées et les vaccins à ARNm contre le Covid-19. Ainsi, le lien avec le vaccin ne peut pas être établi », indique l’analyse.
Concernant les événements déjà sous surveillance, des événements thromboemboliques, des morts in utéro, des HELLP Syndrome, des métrorragies, des contractions utérines et des mastites ont été rapportés avec le Comirnaty. En parallèle, des morts in utéro, des métrorragies, et des contractions utérines ont aussi été signalées avec le vaccin de Moderna.
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2506
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Pratiques non-médicales pour les demandes d'examens d'imagerie aux USA
mardi 01 août 2023
Les praticiens non-médecins sont de plus en plus nombreux à réaliser des demandes d’examens d’imagerie aux USA. Une étude publiée dans la Revue Current problems in Diagnostic Imaging cherche à identifier les conditions qui favorisent cette tendance ainsi que les régions où ces professionnels sont les plus nombreux à interpréter les radiographies.
À mesure que la demande de services de santé augmente par rapport à l'offre de médecins, le nombre de praticiens non-médecins (PNM), notamment les infirmières praticiennes, augmente aux États-Unis (USA).
Les demandes d’examens d’imagerie non médicales augmentent aux USA
La montée en compétences de ces PNM a été associée à une amélioration de la prévention, de la qualité des soins, une réduction des passages aux urgences et à la baisse des coûts et de l'augmentation de la santé mentale autodéclarée. Cependant, les PNM ont été associés à des taux de demandes d’examens d'imagerie plus élevés tant dans les structures de soins primaires que dans les services d'urgence, ainsi qu'à un taux plus élevé de demandes de scanners de contraste par rapport aux pratiques des médecins.
Des praticiens non-médecins habitués à interpréter les radiographies
D’autre part, les PNM interprètent une part faible mais croissante des examens d'imagerie, ce qui interpelle la communauté médicale quant à la pertinence de leur formation et de l'exactitude de ces interprétations, d’autant que la plupart ne reçoit pas de formation rigoureuse en matière de radiologie clinique. Cette tendance est favorisée par la pénurie de services médicaux en milieu rural, qui crée des opportunités pour les PNM de combler les lacunes en matière de soins à mesure que l'autonomie de leur pratique s'étend, avec des variations réglementaires d’un État à l’autre.
Une étude publiée dans la Revue Current problems in Diagnostic Radiology cherche à comprendre les raisons de cette évolution afin de mieux évaluer les écarts dans l'accès et la qualité des soins radiologiques des PNM par rapport aux médecins. Ils ont, dans un premier temps, analysé l'association entre le type d'établissement et l'augmentation de l'interprétation de l'imagerie diagnostique par les PNM, et ont cherché à identifier les États où cette tendance est la plus significative.
Une étude évalue les conditions qui favorisent cette tendance
L'étude a évalué plus de 110 millions de demandes d’examens d'imagerie non invasive de 2016 à 2020, dont plus de 3 millions (3 %) pourraient être attribuées aux PNM. Bien que les taux globaux les plus élevés aient été observés dans les zones rurales et les petites villes, la croissance la plus importante des taux d’examens d'imagerie interprétée par les PNM au cours de la période d'étude a été observée à la fois dans les régions métropolitaines (+ 31 %) et les agglomérations de moins de 50 000 habitants (+ 19 %).
« Dans des études antérieures, nous avons montré que les PNM sont associés à une utilisation accrue de l'imagerie dans les établissements de soins primaires et des services d'urgence, ce qui signifie que les PNM prescrivent plus d'imagerie que les médecins, explique le Pr Eric Christensen, directeur du Harvey L. Neiman Health Policy Institute à Reston (virginie, USA). Cette étude analyse directement les PNM pratiquant la radiologie et a exploré où, géographiquement, ils contribuent davantage à l'interprétation des images. »
Des interprétations non-médicales plus fréquentes dans les régions aux réglementations plus souples
Les chercheurs ont également ciblé les catégories de PNM par rapport aux réglementations sur le champ d'exercice (Scope-of-Practice - SOP) dans chaque État. Et comme ils s’y attendaient, dans certains États qui accordent aux PNM une plus grande autonomie, la plus forte croissance de demandes d'imagerie par les PNM y est la plus forte. Néanmoins, bien que la croissance de l'imagerie facturée par les PNM n'a été observée que dans les zones métropolitaines des États dotés d'une législation SOP moins restrictive, cette croissance n'a pas été répercutée dans les petites villes ou les zones rurales de ces mêmes États.
Bruno Benque
Medscape.com
mardi 01 août 2023
Les praticiens non-médecins sont de plus en plus nombreux à réaliser des demandes d’examens d’imagerie aux USA. Une étude publiée dans la Revue Current problems in Diagnostic Imaging cherche à identifier les conditions qui favorisent cette tendance ainsi que les régions où ces professionnels sont les plus nombreux à interpréter les radiographies.
À mesure que la demande de services de santé augmente par rapport à l'offre de médecins, le nombre de praticiens non-médecins (PNM), notamment les infirmières praticiennes, augmente aux États-Unis (USA).
Les demandes d’examens d’imagerie non médicales augmentent aux USA
La montée en compétences de ces PNM a été associée à une amélioration de la prévention, de la qualité des soins, une réduction des passages aux urgences et à la baisse des coûts et de l'augmentation de la santé mentale autodéclarée. Cependant, les PNM ont été associés à des taux de demandes d’examens d'imagerie plus élevés tant dans les structures de soins primaires que dans les services d'urgence, ainsi qu'à un taux plus élevé de demandes de scanners de contraste par rapport aux pratiques des médecins.
Des praticiens non-médecins habitués à interpréter les radiographies
D’autre part, les PNM interprètent une part faible mais croissante des examens d'imagerie, ce qui interpelle la communauté médicale quant à la pertinence de leur formation et de l'exactitude de ces interprétations, d’autant que la plupart ne reçoit pas de formation rigoureuse en matière de radiologie clinique. Cette tendance est favorisée par la pénurie de services médicaux en milieu rural, qui crée des opportunités pour les PNM de combler les lacunes en matière de soins à mesure que l'autonomie de leur pratique s'étend, avec des variations réglementaires d’un État à l’autre.
Une étude publiée dans la Revue Current problems in Diagnostic Radiology cherche à comprendre les raisons de cette évolution afin de mieux évaluer les écarts dans l'accès et la qualité des soins radiologiques des PNM par rapport aux médecins. Ils ont, dans un premier temps, analysé l'association entre le type d'établissement et l'augmentation de l'interprétation de l'imagerie diagnostique par les PNM, et ont cherché à identifier les États où cette tendance est la plus significative.
Une étude évalue les conditions qui favorisent cette tendance
L'étude a évalué plus de 110 millions de demandes d’examens d'imagerie non invasive de 2016 à 2020, dont plus de 3 millions (3 %) pourraient être attribuées aux PNM. Bien que les taux globaux les plus élevés aient été observés dans les zones rurales et les petites villes, la croissance la plus importante des taux d’examens d'imagerie interprétée par les PNM au cours de la période d'étude a été observée à la fois dans les régions métropolitaines (+ 31 %) et les agglomérations de moins de 50 000 habitants (+ 19 %).
« Dans des études antérieures, nous avons montré que les PNM sont associés à une utilisation accrue de l'imagerie dans les établissements de soins primaires et des services d'urgence, ce qui signifie que les PNM prescrivent plus d'imagerie que les médecins, explique le Pr Eric Christensen, directeur du Harvey L. Neiman Health Policy Institute à Reston (virginie, USA). Cette étude analyse directement les PNM pratiquant la radiologie et a exploré où, géographiquement, ils contribuent davantage à l'interprétation des images. »
Des interprétations non-médicales plus fréquentes dans les régions aux réglementations plus souples
Les chercheurs ont également ciblé les catégories de PNM par rapport aux réglementations sur le champ d'exercice (Scope-of-Practice - SOP) dans chaque État. Et comme ils s’y attendaient, dans certains États qui accordent aux PNM une plus grande autonomie, la plus forte croissance de demandes d'imagerie par les PNM y est la plus forte. Néanmoins, bien que la croissance de l'imagerie facturée par les PNM n'a été observée que dans les zones métropolitaines des États dotés d'une législation SOP moins restrictive, cette croissance n'a pas été répercutée dans les petites villes ou les zones rurales de ces mêmes États.
Bruno Benque
Medscape.com
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2506
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Publié le 11/09/2023
Trop de patients pour pas assez d’infirmières, l’éternel problème
Les syndicats estiment que diminuer le nombre de patients que chaque infirmière doit prendre en charge est une priorité. L’instauration d’un ratio légal est de nouveau en débat.
L’annonce le 31 août dernier par la Première Ministre Elisabeth Borne d’une augmentation substantielle de la rémunération des soignants, notamment ceux travaillant la nuit et le dimanche, a suscité des réponses peu enthousiastes de la part des syndicats. Parmi les réactions les plus sceptiques, on relève notamment celle du Syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI), dont le porte-parole Thierry Amouroux rappelait que la problématique centrale de l’hôpital n’était pas tant celle de la rémunération, mais plutôt celle des conditions de travail et de la perte de sens pour les soignants.
L’infirmier soulignait notamment que « la charge de travail normale, dans le respect des normes internationales, c’est six à huit patients par infirmière alors qu’en France, on est au double » et que cette surcharge de travail poussait les infirmières au burn-out et à la démission, entretenant ainsi un cercle vicieux de départs de soignants en série.
Un nombre trop élevé de patients par soignant nuit à une bonne prise en charge
La question du nombre de patients par soignant et notamment par infirmier et de la nécessité d’instaurer des ratios est un vieux débat. Le sujet est d’autant plus complexe que l’on ignore le nombre de patients par infirmière en moyenne en pratique dans notre pays. Dans un rapport sur la question élaboré en février dernier, le Sénat notait « qu’il n’existe pas de données nationales fines permettant de connaitre le nombre de soignants effectivement présent au lit du patient ».
L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé (ANAP) notait quant à elle que le ratio varie énormément selon les services et les situations, relevant que « le nombre observé de soignants présents peut être de 1 pour 6, 8 ou 10, voire 12 ou même 14 le jour et 1 pour 16, 20 ou 30 la nuit ». Seule la conférence des directeurs de CHU s’avance à donner un chiffre, celui de 9,4 patients par infirmière en médecine et 9,8 en chirurgie en 2022, un ratio qui se serait légèrement amélioré depuis la crise sanitaire.
Il n’existe d’ailleurs pas non plus de « normes internationales » quant au nombre de patients par soignants, contrairement aux allégations de Thierry Amouroux. Cependant, comme l’affirme le porte-parole du SNPI, le fait qu’une infirmière ait à sa charge un nombre trop important de patients conduit effectivement à une perte de chance d’être correctement soigné pour ces derniers et à une hausse de la mortalité.
Selon une étude menée dans les hôpitaux israéliens, le taux de mortalité des patients augmente de 7 % lorsque chaque infirmière doit s’occuper de six patients au lieu de quatre et de 14 % lorsqu’elle a huit patients à sa charge et non plus six. En l’absence de normes internationales, le retard de la France peut aussi s’évaluer par rapport au nombre d’infirmières en activité : notre pays en compte 12 pour 1 000 habitants, contre 14 en Allemagne, 15 aux Etats-Unis et 18 en Suisse ou en Norvège.
Instaurer un ratio obligatoire patients/soignant, une fausse bonne idée ?
Pour de nombreux syndicats de soignants, la solution à cet épineux problème est tout trouvé : il faut généraliser les ratios obligatoires de patients par soignants, qui sont déjà en place dans certaines spécialités jugées critiques (réanimation, néonatalogie…). Pour les partisans de cette réforme, la mise en place de ces ratios permettrait d’enclencher un cercle vertueux, en renforçant l’attractivité de l’hôpital pour les infirmières qui auraient enfin l’assurance de pouvoir y exercer leur métier dans de bonnes conditions. La mesure pourrait même in fine devenir économiquement rentable en améliorant la prise en charge des patients et en réduisant le risque de réadmission. Les syndicats prennent notamment l’exemple de l’Australie, de la Californie et de l’Irlande, où de tels ratios ont été mis en place, avec d’excellents résultats selon eux.
Le Dr Bernard Jomier, généraliste sénateur socialiste de Paris, a fait de la mise en place de ces ratios son cheval de bataille. Le 1er février dernier, sa proposition de loi visant à confier à la Haute Autorité de Santé (HAS) le soin de fixer un ratio obligatoire de patients par soignants a été largement adoptée par le Sénat. Mais cette réforme est jugée « contre-productive » par le gouvernement qui estime, par la voix de la ministre des Professionnels de santé Agnès Firmin Le Bodo, que « la rigidité intrinsèque des ratios conduira inévitablement à des réorganisations de l’offre de soins avec des effets collatéraux nécessitant des rappels de personnel et des fermetures de lit ». Sept mois après le vote du Sénat, la proposition de loi du Dr Jomier n’a toujours pas été mise à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale.
Quentin Haroche
jim.fr
Quand Agnès Firmin Le Bodo, dit que « la rigidité intrinsèque des ratios conduira inévitablement à des réorganisations de l’offre de soins avec des effets collatéraux nécessitant des rappels de personnel et des fermetures de lit », c'est se foutre ouvertement de la gueule des gens. Au total, fin 2022, plus de 21 000 lits ont été supprimés sur la période fin 2016-fin 2021 correspondant en majeure partie au premier quinquennat d’Emmanuel Macron. Soit deux fois plus que sous son prédécesseur François Hollande (-10 000) mais nettement moins que durant le mandat de Nicolas Sarkozy (-37 000). Au Ségur de la santé, en juillet 2020, Olivier Véran a annoncé que "c’en était fini" du dogme de la fermeture de lits, “avec 30 ans d’incurie”. Et le ministre de la Santé, a promis le déblocage immédiat d’une enveloppe de 50 millions d’euros pour rouvrir 4.000 lits à la demande. En 2020, la première année du Covid, on a plus fermé de lits que jamais. 5.700 exactement contre 3.400 en 2019. Sauf que cette fois, ce n’était plus un choix politique comme les années précédentes. Cette fois, les fermetures ont essentiellement été dues au manque de personnel. Aux infirmières et infirmiers qui craquent et qui démissionnent. Aux milliers d'élèves infirmiers qui ont quitté l’école avant la fin de leurs études. Les hôpitaux ont de plus en plus de mal à recruter, le taux d'absentéisme a augmenté, bref les lits ferment non plus pour faire des économies mais parce que l’on manque de bras. Donc évidemment que Firmin le Bodo dit que c'est contre productif les ratio. Elle n'a plus personne pour venir bosser. Donc les ratios Patient/IDE vont augmenter, augmentant la fatigue, fatigue conduisant à un ras-le-bol, ras-le-bol conduisant à un burn out, burn out conduisant à la démission, démission conduisant à l'augmentation des ratios. CQFD
Trop de patients pour pas assez d’infirmières, l’éternel problème
Les syndicats estiment que diminuer le nombre de patients que chaque infirmière doit prendre en charge est une priorité. L’instauration d’un ratio légal est de nouveau en débat.
L’annonce le 31 août dernier par la Première Ministre Elisabeth Borne d’une augmentation substantielle de la rémunération des soignants, notamment ceux travaillant la nuit et le dimanche, a suscité des réponses peu enthousiastes de la part des syndicats. Parmi les réactions les plus sceptiques, on relève notamment celle du Syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI), dont le porte-parole Thierry Amouroux rappelait que la problématique centrale de l’hôpital n’était pas tant celle de la rémunération, mais plutôt celle des conditions de travail et de la perte de sens pour les soignants.
L’infirmier soulignait notamment que « la charge de travail normale, dans le respect des normes internationales, c’est six à huit patients par infirmière alors qu’en France, on est au double » et que cette surcharge de travail poussait les infirmières au burn-out et à la démission, entretenant ainsi un cercle vicieux de départs de soignants en série.
Un nombre trop élevé de patients par soignant nuit à une bonne prise en charge
La question du nombre de patients par soignant et notamment par infirmier et de la nécessité d’instaurer des ratios est un vieux débat. Le sujet est d’autant plus complexe que l’on ignore le nombre de patients par infirmière en moyenne en pratique dans notre pays. Dans un rapport sur la question élaboré en février dernier, le Sénat notait « qu’il n’existe pas de données nationales fines permettant de connaitre le nombre de soignants effectivement présent au lit du patient ».
L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé (ANAP) notait quant à elle que le ratio varie énormément selon les services et les situations, relevant que « le nombre observé de soignants présents peut être de 1 pour 6, 8 ou 10, voire 12 ou même 14 le jour et 1 pour 16, 20 ou 30 la nuit ». Seule la conférence des directeurs de CHU s’avance à donner un chiffre, celui de 9,4 patients par infirmière en médecine et 9,8 en chirurgie en 2022, un ratio qui se serait légèrement amélioré depuis la crise sanitaire.
Il n’existe d’ailleurs pas non plus de « normes internationales » quant au nombre de patients par soignants, contrairement aux allégations de Thierry Amouroux. Cependant, comme l’affirme le porte-parole du SNPI, le fait qu’une infirmière ait à sa charge un nombre trop important de patients conduit effectivement à une perte de chance d’être correctement soigné pour ces derniers et à une hausse de la mortalité.
Selon une étude menée dans les hôpitaux israéliens, le taux de mortalité des patients augmente de 7 % lorsque chaque infirmière doit s’occuper de six patients au lieu de quatre et de 14 % lorsqu’elle a huit patients à sa charge et non plus six. En l’absence de normes internationales, le retard de la France peut aussi s’évaluer par rapport au nombre d’infirmières en activité : notre pays en compte 12 pour 1 000 habitants, contre 14 en Allemagne, 15 aux Etats-Unis et 18 en Suisse ou en Norvège.
Instaurer un ratio obligatoire patients/soignant, une fausse bonne idée ?
Pour de nombreux syndicats de soignants, la solution à cet épineux problème est tout trouvé : il faut généraliser les ratios obligatoires de patients par soignants, qui sont déjà en place dans certaines spécialités jugées critiques (réanimation, néonatalogie…). Pour les partisans de cette réforme, la mise en place de ces ratios permettrait d’enclencher un cercle vertueux, en renforçant l’attractivité de l’hôpital pour les infirmières qui auraient enfin l’assurance de pouvoir y exercer leur métier dans de bonnes conditions. La mesure pourrait même in fine devenir économiquement rentable en améliorant la prise en charge des patients et en réduisant le risque de réadmission. Les syndicats prennent notamment l’exemple de l’Australie, de la Californie et de l’Irlande, où de tels ratios ont été mis en place, avec d’excellents résultats selon eux.
Le Dr Bernard Jomier, généraliste sénateur socialiste de Paris, a fait de la mise en place de ces ratios son cheval de bataille. Le 1er février dernier, sa proposition de loi visant à confier à la Haute Autorité de Santé (HAS) le soin de fixer un ratio obligatoire de patients par soignants a été largement adoptée par le Sénat. Mais cette réforme est jugée « contre-productive » par le gouvernement qui estime, par la voix de la ministre des Professionnels de santé Agnès Firmin Le Bodo, que « la rigidité intrinsèque des ratios conduira inévitablement à des réorganisations de l’offre de soins avec des effets collatéraux nécessitant des rappels de personnel et des fermetures de lit ». Sept mois après le vote du Sénat, la proposition de loi du Dr Jomier n’a toujours pas été mise à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale.
Quentin Haroche
jim.fr
Quand Agnès Firmin Le Bodo, dit que « la rigidité intrinsèque des ratios conduira inévitablement à des réorganisations de l’offre de soins avec des effets collatéraux nécessitant des rappels de personnel et des fermetures de lit », c'est se foutre ouvertement de la gueule des gens. Au total, fin 2022, plus de 21 000 lits ont été supprimés sur la période fin 2016-fin 2021 correspondant en majeure partie au premier quinquennat d’Emmanuel Macron. Soit deux fois plus que sous son prédécesseur François Hollande (-10 000) mais nettement moins que durant le mandat de Nicolas Sarkozy (-37 000). Au Ségur de la santé, en juillet 2020, Olivier Véran a annoncé que "c’en était fini" du dogme de la fermeture de lits, “avec 30 ans d’incurie”. Et le ministre de la Santé, a promis le déblocage immédiat d’une enveloppe de 50 millions d’euros pour rouvrir 4.000 lits à la demande. En 2020, la première année du Covid, on a plus fermé de lits que jamais. 5.700 exactement contre 3.400 en 2019. Sauf que cette fois, ce n’était plus un choix politique comme les années précédentes. Cette fois, les fermetures ont essentiellement été dues au manque de personnel. Aux infirmières et infirmiers qui craquent et qui démissionnent. Aux milliers d'élèves infirmiers qui ont quitté l’école avant la fin de leurs études. Les hôpitaux ont de plus en plus de mal à recruter, le taux d'absentéisme a augmenté, bref les lits ferment non plus pour faire des économies mais parce que l’on manque de bras. Donc évidemment que Firmin le Bodo dit que c'est contre productif les ratio. Elle n'a plus personne pour venir bosser. Donc les ratios Patient/IDE vont augmenter, augmentant la fatigue, fatigue conduisant à un ras-le-bol, ras-le-bol conduisant à un burn out, burn out conduisant à la démission, démission conduisant à l'augmentation des ratios. CQFD
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2506
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Publié le 04/09/2023
Révolution dans le choc cardiogénique post-IDM : l’ECMO ne fait pas mieux que le traitement médical seul
Jusqu’à 10 % des patients hospitalisés pour un infarctus du myocarde (IDM) développent un choc cardiogénique dont le traitement se limite à la revascularisation immédiate de la lésion coupable. Cependant, la mortalité reste élevée, de 40 à 50 % dans les 30 jours. Dans une tentative d’améliorer ces résultats, le recours à l'oxygénation par membrane extra-corporelle veino-artérielle (ECMO VA ou ECLS -extracorporeal life support- qui permet une assistance circulatoire et respiratoire complète) s’est accru, sa fréquence a été multipliée par plus de 10 au cours des 10 dernières années.
Cependant, les preuves de l’efficacité de l'ECLS dans cette indication se limitent à des études d'observation et à trois petits essais randomisés. Ses avantages potentiels sont contrebalancés par un risque de complications locales et systémiques : hémorragies, accidents vasculaires cérébraux (AVC), ischémie des membres, hémolyse.
Un essai randomisé sur plus de 400 malades
D’où l’intérêt de l'essai ouvert multicentrique (44 centres en Allemagne et en Slovénie) ECLS-SHOCK dont l'objectif principal était de déterminer si les patients présentant un IDM compliqué par un choc cardiogénique avec une revascularisation planifiée précoce, pourraient bénéficier d'une ECLS précoce en plus du traitement médical habituel, par rapport au traitement médical seul.
Le choc cardiogénique (de stade C, D ou E des critères de la Society for Cardiovascular Angiography and Interventions) a été défini comme une pression artérielle systolique (PAS) < à 90 mmHg pendant plus de 30 minutes ou par le recours aux catécholamines pour maintenir une PAS > à 90 mmHg, une lactatémie artérielle > à 3 mmol/litre et des signes d'altération de la perfusion des organes avec au moins un des critères suivants : altération de l'état mental, peau et membres froids ou moites, ou débit urinaire inférieur à 30 ml par heure.
Les patients ont été assignés au hasard à recevoir une ECLS précoce plus un traitement médical habituel (groupe ECLS) ou un traitement médical habituel seul (groupe contrôle). Le résultat principal était le décès à J 30, quelle qu'en soit la cause. Les principaux résultats secondaires étaient le temps écoulé avant la stabilisation hémodynamique, la durée du séjour en unité de soins intensifs, l'insuffisance rénale aiguë justifiant une thérapie de remplacement, la récidive d’IDM et la ré-hospitalisation pour insuffisance cardiaque congestive.
Les autres résultats secondaires comprenaient l'instauration et la durée du traitement par catécholamines, l'utilisation et la durée de la ventilation mécanique, ainsi qu'un mauvais résultat neurologique (score de catégorie de performance cérébrale de 3 ou 4) à 30 jours. Enfin, les critères de sécurité comprenaient les hémorragies, les AVC et les complications vasculaires périphériques justifiant un traitement interventionnel ou chirurgical.
Au total, 417 ont été inclus dans les analyses finales (âge médian : 63 ans [IQ, 56 à 70], hommes 81,3 %). Deux tiers des patients présentaient un IDM avec sus-décalage du segment ST. Environ deux tiers des patients souffraient d'une maladie coronarienne pluri tronculaire et 77,7 % d’entre eux avaient subi une réanimation cardiopulmonaire avant la randomisation. Le taux médian de lactate avant la revascularisation était de 6,9 mmol par litre (IQ, 4,6 à 9,9).
Pas d’avantage à l’ECLS
À J 30, 100 des 209 patients (47,8 %) du groupe ECLS et 102 des 208 patients (49,0 %) du groupe témoin étaient décédés (risque relatif RR, 0,98 ; IC à 95 % : 0,80 à 1,19 ; p = 0,81), sans différence significative. La durée médiane de la ventilation mécanique a été plus longue sous ECLS : 7 jours (IQ, 4 à 12) versus 5 jours (IQ, 3 à 9) dans le groupe témoin (différence médiane : 1 jour ; IC à 95 % : 0 à 2).
En termes de sécurité, une hémorragie modérée ou grave est plus souvent survenue sous ECLS : 23,4 % versus 9,6 % du groupe de contrôle (RR, 2,44 ; IC à 95 % : 1,50 à 3,95) ; et des complications vasculaires périphériques justifiant une intervention sont survenues dans 11,0 % et 3,8 % des cas, respectivement (RR, 2,86 ; IC à 95 % : 1,31 à 6,25).
Cet essai présente certaines limites dont son caractère ouvert qui peut avoir influencé les décisions thérapeutiques des médecins. De plus, 39 malades sont passés du groupe auquel ils avaient été assignés à l'autre groupe, dont 7 après un arrêt cardiaque réfractaire dans le groupe de contrôle pour lequel l'ECLS était la seule technique disponible pour rétablir la circulation.
La présentation clinique et l’évolution des patients souffrant de choc cardiogénique post IDM sont généralement hétérogènes. Dans cet essai, ont été inclus uniquement des patients présentant un choc cardiogénique sévère, ce qui explique probablement les forts taux de mortalité dans les deux groupes de l'essai par rapport aux essais antérieurs portant sur une population similaire. L'ECLS pourrait avoir été bénéfique dans certains sous-groupes, même s'il n'y avait pas de signal de ce type dans les analyses de sous-groupes pré-spécifiées et post hoc.
Une révolution en perspective dans le monde de la réanimation cardiaque ?
Dr Bernard-Alex Gaüzère
jim.fr
Référence
Thiele H, Zeymer U, Akin I, et al. ECLS-SHOCK Investigators. Extracorporeal Life Support in Infarct-Related Cardiogenic Shock. N Engl J Med. 2023 Aug 26. doi: 10.1056/NEJMoa2307227.
_____________
Publié le 29/08/2023
La stratégie de l’IRM cardiaque pour une douleur thoracique aiguë sans élévation marquée de la troponine
Face à une douleur thoracique associée à des concentrations sériques détectables ou légèrement élevées de la troponine cardiaque, la stratégie diagnostique optimale reste à établir. Cette situation clinique est loin d’être exceptionnelle, et les résultats d’un essai randomisé multicentrique étatsunien mené à ce sujet méritent d’être rapportés.
Il s’agit de l'essai CMR-IMPACT (Cardiac Magnetic Resonance Imaging Strategy for the Management of Patients with Acute Chest Pain and Detectable to Elevated Troponin) mené dans quatre établissements hospitaliers tertiaires entre septembre 2013 et juillet 2018. Ont été inclus 312 patients (âge moyen, 60,6 ± 41,3 ans ; 125 femmes : 59,9 %) présentant tous un tableau de douleur thoracique aiguë, alors que les concentrations sériques de troponine dosées en urgence étaient soient tout juste détectables ou < 1,0 ng/mL.
Deux groupes ont été constitués par tirage au sort selon les modalités de la prise en charge initiale : (1) invasive incluant la coronarographie (n = 156) ; (2) non invasive reposant sur l’IRM cardiaque avec injection de produit de contraste paramagnétique. Le passage du groupe 2 au groupe 1 était autorisé en fonction de l’évolution clinique à court terme. Le critère de jugement principal combinait les évènements suivants : décès, infarctus du myocarde, réadmissions en milieu hospitalier ou encore consultations en urgence en raison d’un problème supposé être cardiaque. Le suivi médian a été 2,6 années (intervalle de confiance à 95 % IC 95 %, 2,4-2,9).
Une approche moins invasive qui ne compromet pas le pronostic
La stratégie diagnostique prévue a été appliquée chez 102 patients du groupe IRM (65,3 %), et à 110 dans l’autre groupe (70,5 %). Le critère de jugement principal a été atteint dans 59 % des cas dans le groupe IRM, versus 52 % dans l’autre groupe, ce qui conduit à un hazard ratio (HR) de 1,17 [IC 95 %, 0,86-1,57]. Un syndrome coronarien aigu survenu après la sortie de l’hôpital a été diagnostiqué chez 23 % des patients du groupe IRM, versus 22 % dans l’autre groupe, soit un HR de 1,07 [IC 95 %, 0,67-1,71].
La coronarographie, pour sa part, a été utilisée à tout moment au cours du suivi chez un patient sur deux (52 %) dans le groupe IRM, versus près de trois sur quatre dans l’autre groupe, soit un HR de 0,66 [IC 95 %, 0,49-0,87]. Une IRM totalement normale (55/95 ; 58 %) a été associée à un pronostic favorable et, dans ce cas, aucune exploration invasive n’a été réalisée dans les 90 jours qui ont suivi, et de ce fait, aucune revascularisation myocardique n’a été envisagée. Le rendement thérapeutique de la coronarographie s’est avéré plus élevé dans le groupe IRM avec 52 revascularisations pour 81 angiographies [64,2 %] versus 46 interventions pour 115 coronarographies [40,0 %] dans l’autre groupe (p=0,001).
Cet essai randomisé qui porte sur un effectif restreint plaide en faveur d’une stratégie diagnostique non invasive face à une douleur thoracique aiguë, accompagnée d’une augmentation tout au plus légère des concentrations sériques de troponine cardiaque. Quand elle est réalisable en urgence, l’IRM cardiaque permettrait de réduire significativement le recours à la coronarographie sans compromettre le pronostic à court ou long terme. Les indications de la coronarographie seraient plus judicieuses en débouchant plus souvent sur des indications de revascularisation. Autant d’avantages potentiels qui méritent d’être confirmés par d’autres études contrôlées.
Dr Philippe Tellier
jim.fr
Référence
Miller CD et coll. : Cardiac Magnetic Resonance Imaging Versus Invasive-Based Strategies in Patients With Chest Pain and Detectable to Mildly Elevated Serum Troponin: A Randomized Clinical Trial. Circ Cardiovasc Imaging. 2023;16(6):e015063. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.122.015063.
Révolution dans le choc cardiogénique post-IDM : l’ECMO ne fait pas mieux que le traitement médical seul
Jusqu’à 10 % des patients hospitalisés pour un infarctus du myocarde (IDM) développent un choc cardiogénique dont le traitement se limite à la revascularisation immédiate de la lésion coupable. Cependant, la mortalité reste élevée, de 40 à 50 % dans les 30 jours. Dans une tentative d’améliorer ces résultats, le recours à l'oxygénation par membrane extra-corporelle veino-artérielle (ECMO VA ou ECLS -extracorporeal life support- qui permet une assistance circulatoire et respiratoire complète) s’est accru, sa fréquence a été multipliée par plus de 10 au cours des 10 dernières années.
Cependant, les preuves de l’efficacité de l'ECLS dans cette indication se limitent à des études d'observation et à trois petits essais randomisés. Ses avantages potentiels sont contrebalancés par un risque de complications locales et systémiques : hémorragies, accidents vasculaires cérébraux (AVC), ischémie des membres, hémolyse.
Un essai randomisé sur plus de 400 malades
D’où l’intérêt de l'essai ouvert multicentrique (44 centres en Allemagne et en Slovénie) ECLS-SHOCK dont l'objectif principal était de déterminer si les patients présentant un IDM compliqué par un choc cardiogénique avec une revascularisation planifiée précoce, pourraient bénéficier d'une ECLS précoce en plus du traitement médical habituel, par rapport au traitement médical seul.
Le choc cardiogénique (de stade C, D ou E des critères de la Society for Cardiovascular Angiography and Interventions) a été défini comme une pression artérielle systolique (PAS) < à 90 mmHg pendant plus de 30 minutes ou par le recours aux catécholamines pour maintenir une PAS > à 90 mmHg, une lactatémie artérielle > à 3 mmol/litre et des signes d'altération de la perfusion des organes avec au moins un des critères suivants : altération de l'état mental, peau et membres froids ou moites, ou débit urinaire inférieur à 30 ml par heure.
Les patients ont été assignés au hasard à recevoir une ECLS précoce plus un traitement médical habituel (groupe ECLS) ou un traitement médical habituel seul (groupe contrôle). Le résultat principal était le décès à J 30, quelle qu'en soit la cause. Les principaux résultats secondaires étaient le temps écoulé avant la stabilisation hémodynamique, la durée du séjour en unité de soins intensifs, l'insuffisance rénale aiguë justifiant une thérapie de remplacement, la récidive d’IDM et la ré-hospitalisation pour insuffisance cardiaque congestive.
Les autres résultats secondaires comprenaient l'instauration et la durée du traitement par catécholamines, l'utilisation et la durée de la ventilation mécanique, ainsi qu'un mauvais résultat neurologique (score de catégorie de performance cérébrale de 3 ou 4) à 30 jours. Enfin, les critères de sécurité comprenaient les hémorragies, les AVC et les complications vasculaires périphériques justifiant un traitement interventionnel ou chirurgical.
Au total, 417 ont été inclus dans les analyses finales (âge médian : 63 ans [IQ, 56 à 70], hommes 81,3 %). Deux tiers des patients présentaient un IDM avec sus-décalage du segment ST. Environ deux tiers des patients souffraient d'une maladie coronarienne pluri tronculaire et 77,7 % d’entre eux avaient subi une réanimation cardiopulmonaire avant la randomisation. Le taux médian de lactate avant la revascularisation était de 6,9 mmol par litre (IQ, 4,6 à 9,9).
Pas d’avantage à l’ECLS
À J 30, 100 des 209 patients (47,8 %) du groupe ECLS et 102 des 208 patients (49,0 %) du groupe témoin étaient décédés (risque relatif RR, 0,98 ; IC à 95 % : 0,80 à 1,19 ; p = 0,81), sans différence significative. La durée médiane de la ventilation mécanique a été plus longue sous ECLS : 7 jours (IQ, 4 à 12) versus 5 jours (IQ, 3 à 9) dans le groupe témoin (différence médiane : 1 jour ; IC à 95 % : 0 à 2).
En termes de sécurité, une hémorragie modérée ou grave est plus souvent survenue sous ECLS : 23,4 % versus 9,6 % du groupe de contrôle (RR, 2,44 ; IC à 95 % : 1,50 à 3,95) ; et des complications vasculaires périphériques justifiant une intervention sont survenues dans 11,0 % et 3,8 % des cas, respectivement (RR, 2,86 ; IC à 95 % : 1,31 à 6,25).
Cet essai présente certaines limites dont son caractère ouvert qui peut avoir influencé les décisions thérapeutiques des médecins. De plus, 39 malades sont passés du groupe auquel ils avaient été assignés à l'autre groupe, dont 7 après un arrêt cardiaque réfractaire dans le groupe de contrôle pour lequel l'ECLS était la seule technique disponible pour rétablir la circulation.
La présentation clinique et l’évolution des patients souffrant de choc cardiogénique post IDM sont généralement hétérogènes. Dans cet essai, ont été inclus uniquement des patients présentant un choc cardiogénique sévère, ce qui explique probablement les forts taux de mortalité dans les deux groupes de l'essai par rapport aux essais antérieurs portant sur une population similaire. L'ECLS pourrait avoir été bénéfique dans certains sous-groupes, même s'il n'y avait pas de signal de ce type dans les analyses de sous-groupes pré-spécifiées et post hoc.
Une révolution en perspective dans le monde de la réanimation cardiaque ?
Dr Bernard-Alex Gaüzère
jim.fr
Référence
Thiele H, Zeymer U, Akin I, et al. ECLS-SHOCK Investigators. Extracorporeal Life Support in Infarct-Related Cardiogenic Shock. N Engl J Med. 2023 Aug 26. doi: 10.1056/NEJMoa2307227.
_____________
Publié le 29/08/2023
La stratégie de l’IRM cardiaque pour une douleur thoracique aiguë sans élévation marquée de la troponine
Face à une douleur thoracique associée à des concentrations sériques détectables ou légèrement élevées de la troponine cardiaque, la stratégie diagnostique optimale reste à établir. Cette situation clinique est loin d’être exceptionnelle, et les résultats d’un essai randomisé multicentrique étatsunien mené à ce sujet méritent d’être rapportés.
Il s’agit de l'essai CMR-IMPACT (Cardiac Magnetic Resonance Imaging Strategy for the Management of Patients with Acute Chest Pain and Detectable to Elevated Troponin) mené dans quatre établissements hospitaliers tertiaires entre septembre 2013 et juillet 2018. Ont été inclus 312 patients (âge moyen, 60,6 ± 41,3 ans ; 125 femmes : 59,9 %) présentant tous un tableau de douleur thoracique aiguë, alors que les concentrations sériques de troponine dosées en urgence étaient soient tout juste détectables ou < 1,0 ng/mL.
Deux groupes ont été constitués par tirage au sort selon les modalités de la prise en charge initiale : (1) invasive incluant la coronarographie (n = 156) ; (2) non invasive reposant sur l’IRM cardiaque avec injection de produit de contraste paramagnétique. Le passage du groupe 2 au groupe 1 était autorisé en fonction de l’évolution clinique à court terme. Le critère de jugement principal combinait les évènements suivants : décès, infarctus du myocarde, réadmissions en milieu hospitalier ou encore consultations en urgence en raison d’un problème supposé être cardiaque. Le suivi médian a été 2,6 années (intervalle de confiance à 95 % IC 95 %, 2,4-2,9).
Une approche moins invasive qui ne compromet pas le pronostic
La stratégie diagnostique prévue a été appliquée chez 102 patients du groupe IRM (65,3 %), et à 110 dans l’autre groupe (70,5 %). Le critère de jugement principal a été atteint dans 59 % des cas dans le groupe IRM, versus 52 % dans l’autre groupe, ce qui conduit à un hazard ratio (HR) de 1,17 [IC 95 %, 0,86-1,57]. Un syndrome coronarien aigu survenu après la sortie de l’hôpital a été diagnostiqué chez 23 % des patients du groupe IRM, versus 22 % dans l’autre groupe, soit un HR de 1,07 [IC 95 %, 0,67-1,71].
La coronarographie, pour sa part, a été utilisée à tout moment au cours du suivi chez un patient sur deux (52 %) dans le groupe IRM, versus près de trois sur quatre dans l’autre groupe, soit un HR de 0,66 [IC 95 %, 0,49-0,87]. Une IRM totalement normale (55/95 ; 58 %) a été associée à un pronostic favorable et, dans ce cas, aucune exploration invasive n’a été réalisée dans les 90 jours qui ont suivi, et de ce fait, aucune revascularisation myocardique n’a été envisagée. Le rendement thérapeutique de la coronarographie s’est avéré plus élevé dans le groupe IRM avec 52 revascularisations pour 81 angiographies [64,2 %] versus 46 interventions pour 115 coronarographies [40,0 %] dans l’autre groupe (p=0,001).
Cet essai randomisé qui porte sur un effectif restreint plaide en faveur d’une stratégie diagnostique non invasive face à une douleur thoracique aiguë, accompagnée d’une augmentation tout au plus légère des concentrations sériques de troponine cardiaque. Quand elle est réalisable en urgence, l’IRM cardiaque permettrait de réduire significativement le recours à la coronarographie sans compromettre le pronostic à court ou long terme. Les indications de la coronarographie seraient plus judicieuses en débouchant plus souvent sur des indications de revascularisation. Autant d’avantages potentiels qui méritent d’être confirmés par d’autres études contrôlées.
Dr Philippe Tellier
jim.fr
Référence
Miller CD et coll. : Cardiac Magnetic Resonance Imaging Versus Invasive-Based Strategies in Patients With Chest Pain and Detectable to Mildly Elevated Serum Troponin: A Randomized Clinical Trial. Circ Cardiovasc Imaging. 2023;16(6):e015063. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.122.015063.
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2506
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
CHU de Brest : les anesthésistes boycottent les temps de travail additionnels
Jacques Cofard
Medscape.com
Auteurs et déclarations
20 septembre 2023
Brest, France — De nombreuses déprogrammations chirurgicales ont été annoncées par le CHU de Brest (29) par manque d'anesthésistes. Les médecins ont décidé de ne plus faire d'heures supplémentaires pour cause d'épuisement, a annoncé la direction le 4 septembre dans un communiqué.
Le recours au temps de travail additionnel (TTA) était l'un des remèdes de cheval préconisé par François Braun, alors ministre de la Santé, pour faire passer la pilule de la loi Rist, laquelle loi avait vocation à plafonner le salaire des médecins intérimaires.
Comme pour pallier la pénurie de médecins intérimaires, rebutés par des rémunérations revues à la baisse dans les hôpitaux, le ministre de la Santé de l'époque avait pensé multiplier le temps de travail additionnel des médecins titulaires, soit les heures supplémentaires, mieux payées, en facilitant son usage.
Déjà, dès le mois de juin 2022, François Braun avait doublé, pour l'été, la rémunération du temps de travail additionnel. Il semble que le CHU de Brest en ait usé et abusé.
Refus massif des TTA
Depuis la semaine 36, soit dès le lundi 4 septembre, les médecins anesthésistes réanimateurs ont dédié de refuser collectivement de faire des TTA.
« Ils avaient déjà alerté la direction avant l'été mais comme la direction n'a apporté aucune réponse ils ont décidé d'arrêter de faire des heures supplémentaires », nous indique Thomas Bourhis, secrétaire général de la CGT du CHU de Brest, qui précise par ailleurs que son syndicat n'est pas partie prenante de ce mouvement social des anesthésistes réanimateurs.
Ils avaient déjà alerté la direction avant l'été mais comme la direction n'a apporté aucune réponse ils ont décidé d'arrêter de faire des heures supplémentaires. Thomas Bourhis
« On ne les accompagne pas, d'ailleurs, ils n'ont pas fait appel à nous ni à d'autres syndicats, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de préavis de grève déposé, pas de porte-parole, et les revendications ne sont pas vraiment bien définies. Officiellement, ce n'est pas un mouvement social, ce sont des médecins anesthésistes victimes d'un épuisement professionnel, car ils font énormément d'heures supplémentaires puisqu'ils manquent énormément de postes d'anesthésistes », ajoute-t-il.
Joint par Medscape édition française, Anne Wernet-Geoffroy, présidente du syndicat SNPHARE, confirme les dires du représentant de la CGT : « Les anesthésistes du CHU de Brest ne souhaitent pas communiquer sur leur mouvement et n'ont pas non plus de porte-parole. »
142 opérations déprogrammées
Quoi qu'il en soit, les conséquences de ce mouvement restent impressionnantes. « Les médecins anesthésistes s’impliquent massivement dans ce mouvement car 80% des opérations sont déprogrammées. La semaine dernière (semaine 36), 142 opérations étaient déprogrammées sur les 206 opérations de prévues. Pour la semaine 37 les déprogrammations sont du même ordre mais nous n'avons pas encore les chiffres. »
Ces déprogrammations impliquent des conséquences en cascade pour les autres personnels : « Les autres personnels comprennent leurs revendications, mais il n'y a pas de soutien massif en leur faveur. En revanche, les personnels paramédicaux sont impactés, puisque l'activité du bloc opératoire est diminuée de 80% : la direction essaie de leur imposer des récupérations ou des repos. Nous avons demandé que les repos imposés soient appliqués uniquement aux agents qui ont beaucoup d’heures en stock : nous avons été entendus et il n'y a que les agents qui ont un contingent de plus de 50 heures qui se voient imposer des congés. »
Les médecins anesthésistes s’impliquent massivement dans ce mouvement car 80% des opérations sont déprogrammées.
Chef de service suspendu
Si l'application de la loi Rist a provoqué la multiplication des temps de travail additionnels, d'autres facteurs ont aussi pesé sur la dégradation des conditions de travail des anesthésistes réanimateurs.« L'application de la loi Rist est l'un des facteurs qui a fait en en sorte que la situation dégénère : auparavant, le manque de personnels était plus ou moins compensé par les intérimaires. Maintenant, cela devient compliqué. Mais on rencontre aussi des difficultés de recrutement à Brest et dans les hôpitaux publics. Qui plus est dans notre CHU, nous avions un troisième facteur aggravant, qui était la présence d'un chef de service en anesthésie réanimation aux pratiques déviantes : il a été suspendu de ses fonctions il y a trois ou quatre mois. Cela a pénalisé la politique de recrutement puisque les internes ne restaient pas au CHU de Brest à cause de ce chef de service. Il y actuellement une dizaine de postes vacants sur 49 postes au total », analyse Thomas Bourhis.
Qui plus est dans notre CHU, nous avions un troisième facteur aggravant, qui était la présence d'un chef de service en anesthésie réanimation aux pratiques déviantes : il a été suspendu de ses fonctions, depuis trois ou quatre mois.
Revalorisations pour les contractuels
Si les anesthésistes réanimateurs ne communiquent pas sur leurs revendications, il semblerait qu'au-delà d'une demande de recrutement de praticiens, ils demandent aussi des revalorisations salariales, selon le représentant de la CGT à Brest : « On sait qu'il y a des discussions autour des rémunérations, notamment celles des contractuels pour rendre plus attractifs les postes au CHU. »
Si le mouvement des anesthésistes accapare l'attention de la direction, la pénurie de médecins urgentistes à Carhaix, rattaché au CHU de Brest, génère également un conflit entre les personnels et la direction.
« La direction avait promis de rouvrir des urgences à Carhaix (29) 24 heures sur 24 et en fait elle n'a pas tenu sa promesse. Ce qui veut dire qu'à partir de 18 heures nous sommes sur un système de réorientation vers Morlaix (29) ou Quimper (29)... Nous avons bloqué les directions de l'ARS et celle du CHU, donc c'est un peu tendu. Là encore, nous sommes sur un problème de recrutement de médecins urgentistes, surtout en centre Bretagne, qui n'est pas forcément attractif », ajoute Thomas Bourhis.
Sollicitée par Medscape édition française, la direction du CHU de Brest n’a pas donné suite.
Les solutions du SNPHARE
Sensibilité par la situation des anesthésistes réanimateurs du CHU de Brest, le syndicat national des praticiens anesthésistes réanimateurs élargi (SNPHARE) a formulé une série de propositions pour résoudre ce problème de fond :
« - Sanctuarisation d’un nombre maximum de médecin anesthésiste-réanimateur par salle (entre 1 et 2 selon le type de patient et d’intervention), et de la relation en binôme entre médecin anesthésiste-réanimateur et infirmier anesthésiste (IADE) : respect du décret de sécurité de l’anesthésie de 1994 et du décret de compétence des IADE de 2017 ;
- Passage en temps continu systématique pour l’ensemble des services d’anesthésie-réanimation du territoire national, avec une réduction des obligations de service à 39 heures ;
- Adaptation du nombre d’internes formés en anesthésie-réanimation aux projections en besoin de santé en anesthésie, soins critiques et médecine périopératoire ;
- Ouverture du chantier de la permanence des soins qui doit prendre en compte sa pénibilité, sa rémunération, mais aussi la durée de la garde et les conditions de dispense de la permanence des soins nocturne ;
- Restauration, comme pour l’ensemble des praticiens hospitaliers nommés avant le 1er octobre 2020, des 4 ans d’ancienneté qui ont été octroyés uniquement aux plus jeunes, et valorisation de la fidélité des praticiens hospitaliers dans l’hôpital public. »
Les solutions du SNPHARE on les connait. Surtout pour les IADE; pas de pratique avancée, pas de dépassement de la ligne jaune qui ferait que les MAR perdraient du poids qui les fait peser dans la balance administrative, conserver le côté sécuritaire de l'anesthésie en gardant un mar responsable de l'acte d'anesthésie, (même si le mar est expert en anesthésie en WI-FI depuis le fin fond de son bureau ou le moelleux du canapé de la salle de repos où il exerce chaque jour le module blabla et discussion diverse avec ses collègues). A se demander à quoi sert l'IADE en terme de sécurité, qui dès la fin de l'injection des 3 seringues ultra sécurisée, que seul un mar est capable de balancer dans la tubulure en toute sécurité, se retrouve seul à gérer le patient jusqu'à la sortie en SSPI, et ne revoit son sauveur médical que pour la prochaine induction, une fois que le patient est scopé, perfusé et que le plateau d'induction soit prêt. Il ne faut pas exagérer non plus, le dieu de l'Olympe ne descend de son nuage que le temps d'une poussette de seringue et vérifier être bien noté sur la feuille et le compte-rendu chirurgical, où sa présence a irradié la salle. Le reste...
Jacques Cofard
Medscape.com
Auteurs et déclarations
20 septembre 2023
Brest, France — De nombreuses déprogrammations chirurgicales ont été annoncées par le CHU de Brest (29) par manque d'anesthésistes. Les médecins ont décidé de ne plus faire d'heures supplémentaires pour cause d'épuisement, a annoncé la direction le 4 septembre dans un communiqué.
Le recours au temps de travail additionnel (TTA) était l'un des remèdes de cheval préconisé par François Braun, alors ministre de la Santé, pour faire passer la pilule de la loi Rist, laquelle loi avait vocation à plafonner le salaire des médecins intérimaires.
Comme pour pallier la pénurie de médecins intérimaires, rebutés par des rémunérations revues à la baisse dans les hôpitaux, le ministre de la Santé de l'époque avait pensé multiplier le temps de travail additionnel des médecins titulaires, soit les heures supplémentaires, mieux payées, en facilitant son usage.
Déjà, dès le mois de juin 2022, François Braun avait doublé, pour l'été, la rémunération du temps de travail additionnel. Il semble que le CHU de Brest en ait usé et abusé.
Refus massif des TTA
Depuis la semaine 36, soit dès le lundi 4 septembre, les médecins anesthésistes réanimateurs ont dédié de refuser collectivement de faire des TTA.
« Ils avaient déjà alerté la direction avant l'été mais comme la direction n'a apporté aucune réponse ils ont décidé d'arrêter de faire des heures supplémentaires », nous indique Thomas Bourhis, secrétaire général de la CGT du CHU de Brest, qui précise par ailleurs que son syndicat n'est pas partie prenante de ce mouvement social des anesthésistes réanimateurs.
Ils avaient déjà alerté la direction avant l'été mais comme la direction n'a apporté aucune réponse ils ont décidé d'arrêter de faire des heures supplémentaires. Thomas Bourhis
« On ne les accompagne pas, d'ailleurs, ils n'ont pas fait appel à nous ni à d'autres syndicats, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de préavis de grève déposé, pas de porte-parole, et les revendications ne sont pas vraiment bien définies. Officiellement, ce n'est pas un mouvement social, ce sont des médecins anesthésistes victimes d'un épuisement professionnel, car ils font énormément d'heures supplémentaires puisqu'ils manquent énormément de postes d'anesthésistes », ajoute-t-il.
Joint par Medscape édition française, Anne Wernet-Geoffroy, présidente du syndicat SNPHARE, confirme les dires du représentant de la CGT : « Les anesthésistes du CHU de Brest ne souhaitent pas communiquer sur leur mouvement et n'ont pas non plus de porte-parole. »
142 opérations déprogrammées
Quoi qu'il en soit, les conséquences de ce mouvement restent impressionnantes. « Les médecins anesthésistes s’impliquent massivement dans ce mouvement car 80% des opérations sont déprogrammées. La semaine dernière (semaine 36), 142 opérations étaient déprogrammées sur les 206 opérations de prévues. Pour la semaine 37 les déprogrammations sont du même ordre mais nous n'avons pas encore les chiffres. »
Ces déprogrammations impliquent des conséquences en cascade pour les autres personnels : « Les autres personnels comprennent leurs revendications, mais il n'y a pas de soutien massif en leur faveur. En revanche, les personnels paramédicaux sont impactés, puisque l'activité du bloc opératoire est diminuée de 80% : la direction essaie de leur imposer des récupérations ou des repos. Nous avons demandé que les repos imposés soient appliqués uniquement aux agents qui ont beaucoup d’heures en stock : nous avons été entendus et il n'y a que les agents qui ont un contingent de plus de 50 heures qui se voient imposer des congés. »
Les médecins anesthésistes s’impliquent massivement dans ce mouvement car 80% des opérations sont déprogrammées.
Chef de service suspendu
Si l'application de la loi Rist a provoqué la multiplication des temps de travail additionnels, d'autres facteurs ont aussi pesé sur la dégradation des conditions de travail des anesthésistes réanimateurs.« L'application de la loi Rist est l'un des facteurs qui a fait en en sorte que la situation dégénère : auparavant, le manque de personnels était plus ou moins compensé par les intérimaires. Maintenant, cela devient compliqué. Mais on rencontre aussi des difficultés de recrutement à Brest et dans les hôpitaux publics. Qui plus est dans notre CHU, nous avions un troisième facteur aggravant, qui était la présence d'un chef de service en anesthésie réanimation aux pratiques déviantes : il a été suspendu de ses fonctions il y a trois ou quatre mois. Cela a pénalisé la politique de recrutement puisque les internes ne restaient pas au CHU de Brest à cause de ce chef de service. Il y actuellement une dizaine de postes vacants sur 49 postes au total », analyse Thomas Bourhis.
Qui plus est dans notre CHU, nous avions un troisième facteur aggravant, qui était la présence d'un chef de service en anesthésie réanimation aux pratiques déviantes : il a été suspendu de ses fonctions, depuis trois ou quatre mois.
Revalorisations pour les contractuels
Si les anesthésistes réanimateurs ne communiquent pas sur leurs revendications, il semblerait qu'au-delà d'une demande de recrutement de praticiens, ils demandent aussi des revalorisations salariales, selon le représentant de la CGT à Brest : « On sait qu'il y a des discussions autour des rémunérations, notamment celles des contractuels pour rendre plus attractifs les postes au CHU. »
Si le mouvement des anesthésistes accapare l'attention de la direction, la pénurie de médecins urgentistes à Carhaix, rattaché au CHU de Brest, génère également un conflit entre les personnels et la direction.
« La direction avait promis de rouvrir des urgences à Carhaix (29) 24 heures sur 24 et en fait elle n'a pas tenu sa promesse. Ce qui veut dire qu'à partir de 18 heures nous sommes sur un système de réorientation vers Morlaix (29) ou Quimper (29)... Nous avons bloqué les directions de l'ARS et celle du CHU, donc c'est un peu tendu. Là encore, nous sommes sur un problème de recrutement de médecins urgentistes, surtout en centre Bretagne, qui n'est pas forcément attractif », ajoute Thomas Bourhis.
Sollicitée par Medscape édition française, la direction du CHU de Brest n’a pas donné suite.
Les solutions du SNPHARE
Sensibilité par la situation des anesthésistes réanimateurs du CHU de Brest, le syndicat national des praticiens anesthésistes réanimateurs élargi (SNPHARE) a formulé une série de propositions pour résoudre ce problème de fond :
« - Sanctuarisation d’un nombre maximum de médecin anesthésiste-réanimateur par salle (entre 1 et 2 selon le type de patient et d’intervention), et de la relation en binôme entre médecin anesthésiste-réanimateur et infirmier anesthésiste (IADE) : respect du décret de sécurité de l’anesthésie de 1994 et du décret de compétence des IADE de 2017 ;
- Passage en temps continu systématique pour l’ensemble des services d’anesthésie-réanimation du territoire national, avec une réduction des obligations de service à 39 heures ;
- Adaptation du nombre d’internes formés en anesthésie-réanimation aux projections en besoin de santé en anesthésie, soins critiques et médecine périopératoire ;
- Ouverture du chantier de la permanence des soins qui doit prendre en compte sa pénibilité, sa rémunération, mais aussi la durée de la garde et les conditions de dispense de la permanence des soins nocturne ;
- Restauration, comme pour l’ensemble des praticiens hospitaliers nommés avant le 1er octobre 2020, des 4 ans d’ancienneté qui ont été octroyés uniquement aux plus jeunes, et valorisation de la fidélité des praticiens hospitaliers dans l’hôpital public. »
Les solutions du SNPHARE on les connait. Surtout pour les IADE; pas de pratique avancée, pas de dépassement de la ligne jaune qui ferait que les MAR perdraient du poids qui les fait peser dans la balance administrative, conserver le côté sécuritaire de l'anesthésie en gardant un mar responsable de l'acte d'anesthésie, (même si le mar est expert en anesthésie en WI-FI depuis le fin fond de son bureau ou le moelleux du canapé de la salle de repos où il exerce chaque jour le module blabla et discussion diverse avec ses collègues). A se demander à quoi sert l'IADE en terme de sécurité, qui dès la fin de l'injection des 3 seringues ultra sécurisée, que seul un mar est capable de balancer dans la tubulure en toute sécurité, se retrouve seul à gérer le patient jusqu'à la sortie en SSPI, et ne revoit son sauveur médical que pour la prochaine induction, une fois que le patient est scopé, perfusé et que le plateau d'induction soit prêt. Il ne faut pas exagérer non plus, le dieu de l'Olympe ne descend de son nuage que le temps d'une poussette de seringue et vérifier être bien noté sur la feuille et le compte-rendu chirurgical, où sa présence a irradié la salle. Le reste...
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2506
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Publié le 20/09/2023
Puberté et microbiote, révolution à tous les étages !
Le microbiote serait genré, même avant la puberté au cours de laquelle sa composition évolue en fonction du type d’hormones sécrétées (testostérone ou estrogènes), de telle sorte que les différences entre sexes s’accroissent durant cette période. La puberté participerait ainsi à dessiner les contours du microbiote intestinal de l’adulte, mais de manière légèrement différente selon les sexes : la composition du microbiote intestinal des filles se rapproche progressivement de celle du microbiote de l’adulte au fur et à mesure de l’avancée de la puberté, alors que chez le garçon, cette corrélation est moins évidente, ce qui laisse penser que les estrogènes joueraient un rôle, notamment par leur influence sur certains lactobacilles.
Des interactions bidirectionnelles
Si la composition du microbiote intestinal change sous l’influence des hormones sexuelles, on sait aussi que ces modifications sont bidirectionnelles car le microbiote agit, par le biais de la sécrétion d’acides gras à chaîne courte butyrate et de propionate, sur le métabolisme des estrogènes via (i) une action directe sur les récepteurs cérébraux qui régulent la production de FSH et de LH, et (ii) de manière indirecte sur les récepteurs régulant l’appétit avec impact sur l’adiposité et l’équilibre hormonal.
C’est le cas notamment de l’« estrobolome », nom donnée à l’ensemble des bactéries du microbiote (famille des Clostridia) qui ont la capacité de déconjuguer les estrogènes et de les relarguer dans la circulation générale. Il pourrait ainsi avoir un rôle dans le déclenchement de la puberté et dans les pubertés précoces comme le laisse supposer une étude montrant que la composition du microbiote intestinal est similaire chez les filles atteintes de puberté précoce idiopathique à celui des femmes obèses.
Microbiote et troubles psychologiques de l’adolescente
La puberté est marquée par un remodelage du cerveau avec neurogenèse, synaptogenèse et croissance dendritique, des phénomènes qui participent au développement des capacités sociales et cognitives et de la réceptivité au stress notamment. La dysbiose intestinale pourrait avoir un impact délétère sur cette période de maturation neuropsychologique par le biais de phénomènes inflammatoires tandis qu’à l’inverse, le stress environnemental altère la composition du microbiote intestinal avec augmentation du risque d’inflammation systémique et modifications immunologiques.
Microbiote vaginal et vulvaire : des questions sans réponse et une hypothèse
Le microbiote génital est dominé chez la femme adulte par les lactobacilles, avec 4 souches dominantes parmi la vingtaine d’espèces identifiées : L. crispatus, L. gasseri, L. jensenii et L. iners. Il est par ailleurs acquis que la transition entre le microbiote vaginal de l’enfant et celui de l’adulte s’étend sur plusieurs mois voire années et débute bien avant la ménarche, dès le stade 2 de Tanner.
Quant au microbiote vulvaire, il montre des modifications dans sa composition, parallèles aux modifications vaginales, avec néanmoins une plus grande variété d’espèces bactériennes. Ces modifications progressent avec le stade de Tanner avec, en particulier, une proportion croissante de bactéries productrices d’acide lactique.
On ignore encore pourquoi parmi les plus de 200 lactobacilles connus, seule une vingtaine d’espèces, dont 4 dominantes, sont présentes dans le vagin, ni pourquoi certains microbiotes sont dominés par l’une de ces espèces et d’autres par d’autres. Enfin, il existe une faible similitude entre le microbiote des filles prépubères et pubères, et celui de leur mère.
Quoi qu’il en soit, on sait que la muqueuse cervicovaginale est tapissée par un mucus qui contient de l’eau, des protéines et des lipides ainsi que des mucines, glycoprotéines composant majeur de ce mucus dont la fonction est de protéger le tractus génital physiquement, chimiquement et bactériologiquement. Or certaines souches de lactobacilles -mais pas toutes- possèdent des gènes qui leur permettent d’adhérer aux glycanes par des adhésines et des mucin-binding proteins et donc de coloniser le mucus vaginal.
Ceci pourrait expliquer pourquoi seules certaines souches s’implantent dans le vagin. « Il est par ailleurs probable que chaque femme possède un catalogue de mucines spécifiques, ce qui expliquerait la dominance de telle ou telle souche et l’incapacité de certains probiotiques de s’implanter », conclut à ce propos Jean-Marc Bohbot (Infectiologie, Institut Fournier).
Les modifications du microbiote intestinal ne sont probablement que la partie émergée de l’iceberg. La vraie révolution se passe au nouveau intestinal et débute bien avant la puberté, une période avant laquelle le microbiote intestinal est genré. Il existe par ailleurs une influence bidirectionnelle entre microbiote intestinal et hormones sexuelles, ce qui pourrait expliquer que la dysbiose intestinale aurait un rapport avec les pubertés précoces.
Dr Dominique-Jean Bouilliez
jim.fr
RÉFÉRENCE
Bohbot JM. Conduite à tenir : La puberté : la révolution du microbiote. GENESIS 2023, 14 et 15 septembre, Paris.
___________
Publié le 20/09/2023
Euthanasie et fin de vie aux Pays-Bas, l'exemple de la SLA
La pratique de l'euthanasie constitue une question éthique, sociale et légale importante et fait l'objet de discussions croissantes dans de nombreux pays. La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie neurodégénérative évolutive et mortelle qui est à l'avant-garde des débats sur la réglementation de l'aide médicale à mourir.
Depuis 2002, lorsque l'euthanasie était légalement réglementée aux Pays-Bas, la fréquence de cette pratique de fin de vie a considérablement augmenté, passant de 1,7 % de tous les décès en 1990 et 2005 à 4,5 % des décès. en 2015. Une étude néerlandaise a cherché à évaluer l'impact de la législation sur les pratiques de fin de vie et sur la qualité de vie pour les patients atteints de SLA aux Pays-Bas.
Une pratique en augmentation
Il s'agit d'une étude de cohorte basée sur la population de cliniciens, de soignants, et d'aidants de patients atteints de SLA à partir des registres de santé néerlandais et des rapports des comités d'examen de l'euthanasie. Ont été inclus les personnes ayant reçu un diagnostic de SLA selon les critères révisés d'El-Escorial. La fréquence de la pratique de l'euthanasie a été calculée à partir des rapports soumis aux comités d'examen des demandes d'euthanasie.
Les pratiques de fin de vie sont des décisions de fin de vie prises par un clinicien lorsque l'accélération de la mort est considérée comme un effet potentiel, probable ou certain, comprenant l'euthanasie, le suicide médicalement assisté, la fin de vie sans demande explicite, le renoncement à un traitement de prolongation de la vie et l'intensification du soulagement des symptômes.
Entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2020, 4 130 décès dus à la SLA ont été signalés, dont 1 014 par euthanasie ou de suicide assisté par un médecin (fréquence moyenne de 25 % par an). Selon les cliniciens identifiés qui ont accepté de participer à l'étude, les pratiques de fin de vie ont fait l'objet d'un choix par 280/356 (79 %) des malades décédés. La fréquence de l'euthanasie chez les patients atteints de SLA en 2014-2016 (141/356 [40 %] décès) était plus élevée qu'en 1994-1998 (35/203 [17 %]) et 2000-2005 (33 /209 [16 %]).
La survie médiane des patients atteints de SLA depuis le diagnostic était de 15,9 mois (IC à 95 % 12,6-17,6) pour ceux qui avaient choisi l'euthanasie et de 16,1 mois (IC à 95 % 13 ,4-19,1) pour ceux qui ne l'avaient pas choisi (RR 1,07, IC à 95 % 0,85-1,34 ; p = 0,58). Selon les soignants / aidants, par rapport à d'autres pratiques de fin de vie, les raisons évoquées de souffrir la mort pour les patients atteints de SLA susceptibles de l'euthanasie étaient : l'absence de chance d'amélioration (53 [56 % ] des 94 patients ayant choisi l'euthanasie vs 28 [39 %] sur 72 patients ayant choisi d'autres pratiques de fin de vie), la perte de dignité (47 [50 %] vs 15 [21 %]), la dépendance (34 [36 %] vs 5 [7 %] ), et la fatigue ou la faiblesse extrême (41 [44 %] vs 14 [20 %]). Par ailleurs,
Ainsi, dans cette étude, le choix de l'euthanasie ne semble pas être associé à la maladie ou aux caractéristiques du patient (même si les personnes susceptibles de l'euthanasie étaient sensiblement plus jeunes et plus instruites), ni à la dépression ou au désespoir , ni aux soins. L'appréciation de la qualité et de la disponibilité des soins de fin de vie, qui sont complexes et multidisciplinaires dans la SLA, semble avoir été similaire chez les malades ayant choisi l'euthanasie et chez ceux ne l'ayant pas choisi. Par conséquent, le choix de l'euthanasie apparaît comme une décision individuelle et existentielle associée à des sentiments de perte d'autonomie et de dignité, et non liée à une déficience de prise en charge. Dernier point,
Anne-Céline Rigaud
jim.fr
RÉFÉRENCE
Van Eenennaam RM, Kruithof W, Beelen A et al. Fréquence de l'euthanasie, facteurs associés aux pratiques de fin de vie et qualité des soins de fin de vie chez les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique aux Pays-Bas : une étude de cohorte basée sur la population. Lancette Neurol. juillet 2023;22(7):591-601. est ce que je: 10.1016/S1474-4422(23)00155-2. PMID : 37353279.
Puberté et microbiote, révolution à tous les étages !
Le microbiote serait genré, même avant la puberté au cours de laquelle sa composition évolue en fonction du type d’hormones sécrétées (testostérone ou estrogènes), de telle sorte que les différences entre sexes s’accroissent durant cette période. La puberté participerait ainsi à dessiner les contours du microbiote intestinal de l’adulte, mais de manière légèrement différente selon les sexes : la composition du microbiote intestinal des filles se rapproche progressivement de celle du microbiote de l’adulte au fur et à mesure de l’avancée de la puberté, alors que chez le garçon, cette corrélation est moins évidente, ce qui laisse penser que les estrogènes joueraient un rôle, notamment par leur influence sur certains lactobacilles.
Des interactions bidirectionnelles
Si la composition du microbiote intestinal change sous l’influence des hormones sexuelles, on sait aussi que ces modifications sont bidirectionnelles car le microbiote agit, par le biais de la sécrétion d’acides gras à chaîne courte butyrate et de propionate, sur le métabolisme des estrogènes via (i) une action directe sur les récepteurs cérébraux qui régulent la production de FSH et de LH, et (ii) de manière indirecte sur les récepteurs régulant l’appétit avec impact sur l’adiposité et l’équilibre hormonal.
C’est le cas notamment de l’« estrobolome », nom donnée à l’ensemble des bactéries du microbiote (famille des Clostridia) qui ont la capacité de déconjuguer les estrogènes et de les relarguer dans la circulation générale. Il pourrait ainsi avoir un rôle dans le déclenchement de la puberté et dans les pubertés précoces comme le laisse supposer une étude montrant que la composition du microbiote intestinal est similaire chez les filles atteintes de puberté précoce idiopathique à celui des femmes obèses.
Microbiote et troubles psychologiques de l’adolescente
La puberté est marquée par un remodelage du cerveau avec neurogenèse, synaptogenèse et croissance dendritique, des phénomènes qui participent au développement des capacités sociales et cognitives et de la réceptivité au stress notamment. La dysbiose intestinale pourrait avoir un impact délétère sur cette période de maturation neuropsychologique par le biais de phénomènes inflammatoires tandis qu’à l’inverse, le stress environnemental altère la composition du microbiote intestinal avec augmentation du risque d’inflammation systémique et modifications immunologiques.
Microbiote vaginal et vulvaire : des questions sans réponse et une hypothèse
Le microbiote génital est dominé chez la femme adulte par les lactobacilles, avec 4 souches dominantes parmi la vingtaine d’espèces identifiées : L. crispatus, L. gasseri, L. jensenii et L. iners. Il est par ailleurs acquis que la transition entre le microbiote vaginal de l’enfant et celui de l’adulte s’étend sur plusieurs mois voire années et débute bien avant la ménarche, dès le stade 2 de Tanner.
Quant au microbiote vulvaire, il montre des modifications dans sa composition, parallèles aux modifications vaginales, avec néanmoins une plus grande variété d’espèces bactériennes. Ces modifications progressent avec le stade de Tanner avec, en particulier, une proportion croissante de bactéries productrices d’acide lactique.
On ignore encore pourquoi parmi les plus de 200 lactobacilles connus, seule une vingtaine d’espèces, dont 4 dominantes, sont présentes dans le vagin, ni pourquoi certains microbiotes sont dominés par l’une de ces espèces et d’autres par d’autres. Enfin, il existe une faible similitude entre le microbiote des filles prépubères et pubères, et celui de leur mère.
Quoi qu’il en soit, on sait que la muqueuse cervicovaginale est tapissée par un mucus qui contient de l’eau, des protéines et des lipides ainsi que des mucines, glycoprotéines composant majeur de ce mucus dont la fonction est de protéger le tractus génital physiquement, chimiquement et bactériologiquement. Or certaines souches de lactobacilles -mais pas toutes- possèdent des gènes qui leur permettent d’adhérer aux glycanes par des adhésines et des mucin-binding proteins et donc de coloniser le mucus vaginal.
Ceci pourrait expliquer pourquoi seules certaines souches s’implantent dans le vagin. « Il est par ailleurs probable que chaque femme possède un catalogue de mucines spécifiques, ce qui expliquerait la dominance de telle ou telle souche et l’incapacité de certains probiotiques de s’implanter », conclut à ce propos Jean-Marc Bohbot (Infectiologie, Institut Fournier).
Les modifications du microbiote intestinal ne sont probablement que la partie émergée de l’iceberg. La vraie révolution se passe au nouveau intestinal et débute bien avant la puberté, une période avant laquelle le microbiote intestinal est genré. Il existe par ailleurs une influence bidirectionnelle entre microbiote intestinal et hormones sexuelles, ce qui pourrait expliquer que la dysbiose intestinale aurait un rapport avec les pubertés précoces.
Dr Dominique-Jean Bouilliez
jim.fr
RÉFÉRENCE
Bohbot JM. Conduite à tenir : La puberté : la révolution du microbiote. GENESIS 2023, 14 et 15 septembre, Paris.
___________
Publié le 20/09/2023
Euthanasie et fin de vie aux Pays-Bas, l'exemple de la SLA
La pratique de l'euthanasie constitue une question éthique, sociale et légale importante et fait l'objet de discussions croissantes dans de nombreux pays. La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie neurodégénérative évolutive et mortelle qui est à l'avant-garde des débats sur la réglementation de l'aide médicale à mourir.
Depuis 2002, lorsque l'euthanasie était légalement réglementée aux Pays-Bas, la fréquence de cette pratique de fin de vie a considérablement augmenté, passant de 1,7 % de tous les décès en 1990 et 2005 à 4,5 % des décès. en 2015. Une étude néerlandaise a cherché à évaluer l'impact de la législation sur les pratiques de fin de vie et sur la qualité de vie pour les patients atteints de SLA aux Pays-Bas.
Une pratique en augmentation
Il s'agit d'une étude de cohorte basée sur la population de cliniciens, de soignants, et d'aidants de patients atteints de SLA à partir des registres de santé néerlandais et des rapports des comités d'examen de l'euthanasie. Ont été inclus les personnes ayant reçu un diagnostic de SLA selon les critères révisés d'El-Escorial. La fréquence de la pratique de l'euthanasie a été calculée à partir des rapports soumis aux comités d'examen des demandes d'euthanasie.
Les pratiques de fin de vie sont des décisions de fin de vie prises par un clinicien lorsque l'accélération de la mort est considérée comme un effet potentiel, probable ou certain, comprenant l'euthanasie, le suicide médicalement assisté, la fin de vie sans demande explicite, le renoncement à un traitement de prolongation de la vie et l'intensification du soulagement des symptômes.
Entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2020, 4 130 décès dus à la SLA ont été signalés, dont 1 014 par euthanasie ou de suicide assisté par un médecin (fréquence moyenne de 25 % par an). Selon les cliniciens identifiés qui ont accepté de participer à l'étude, les pratiques de fin de vie ont fait l'objet d'un choix par 280/356 (79 %) des malades décédés. La fréquence de l'euthanasie chez les patients atteints de SLA en 2014-2016 (141/356 [40 %] décès) était plus élevée qu'en 1994-1998 (35/203 [17 %]) et 2000-2005 (33 /209 [16 %]).
La survie médiane des patients atteints de SLA depuis le diagnostic était de 15,9 mois (IC à 95 % 12,6-17,6) pour ceux qui avaient choisi l'euthanasie et de 16,1 mois (IC à 95 % 13 ,4-19,1) pour ceux qui ne l'avaient pas choisi (RR 1,07, IC à 95 % 0,85-1,34 ; p = 0,58). Selon les soignants / aidants, par rapport à d'autres pratiques de fin de vie, les raisons évoquées de souffrir la mort pour les patients atteints de SLA susceptibles de l'euthanasie étaient : l'absence de chance d'amélioration (53 [56 % ] des 94 patients ayant choisi l'euthanasie vs 28 [39 %] sur 72 patients ayant choisi d'autres pratiques de fin de vie), la perte de dignité (47 [50 %] vs 15 [21 %]), la dépendance (34 [36 %] vs 5 [7 %] ), et la fatigue ou la faiblesse extrême (41 [44 %] vs 14 [20 %]). Par ailleurs,
Ainsi, dans cette étude, le choix de l'euthanasie ne semble pas être associé à la maladie ou aux caractéristiques du patient (même si les personnes susceptibles de l'euthanasie étaient sensiblement plus jeunes et plus instruites), ni à la dépression ou au désespoir , ni aux soins. L'appréciation de la qualité et de la disponibilité des soins de fin de vie, qui sont complexes et multidisciplinaires dans la SLA, semble avoir été similaire chez les malades ayant choisi l'euthanasie et chez ceux ne l'ayant pas choisi. Par conséquent, le choix de l'euthanasie apparaît comme une décision individuelle et existentielle associée à des sentiments de perte d'autonomie et de dignité, et non liée à une déficience de prise en charge. Dernier point,
Anne-Céline Rigaud
jim.fr
RÉFÉRENCE
Van Eenennaam RM, Kruithof W, Beelen A et al. Fréquence de l'euthanasie, facteurs associés aux pratiques de fin de vie et qualité des soins de fin de vie chez les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique aux Pays-Bas : une étude de cohorte basée sur la population. Lancette Neurol. juillet 2023;22(7):591-601. est ce que je: 10.1016/S1474-4422(23)00155-2. PMID : 37353279.
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2506
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Publié le 23/09/2023
Et les patients dans tout ça ?
La novlangue démagogique ne manque jamais une occasion de « mettre le patient au centre ». Au centre de quoi ? Des « besoins », des « structures », des « solutions » et autres terminologies floues et nécessairement plurielles, permettant d’avoir l’air de tout dire sans en dire plus.
Pourtant, le patient est-il vraiment au « centre » aujourd’hui ? Attente interminable pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste en ville ou à l’hôpital, nécessité de rivaliser d’ingéniosité et de prudence pour appliquer sans dommage les recommandations d’utilisation des médicaments (en raison des pénuries frappant des galéniques mieux adaptées), acceptation du risque (fréquent) qu’une intervention soit déprogrammée inopinément : être patient en France aujourd’hui, c’est être au centre d’un jeu dont les règles semblent fréquemment être écrites à ses dépens.
Tout va bien… ou presque
Bien sûr, on rappellera à ces patients qu’ils bénéficient d’une santé quasiment gratuite (si l’on oublie les cotisations très élevées dont tous les salariés s’acquittent directement ou indirectement). Surtout, même s’ils ne sont plus si nombreux ceux qui se risquent encore à pavoiser sur le meilleur système de santé du monde, on n’hésite pas à répéter aux patients que la qualité des soins reste dans notre pays « exceptionnelle ». A moins qu’il faille entendre l’adjectif sous son autre acception, non plus d’extraordinaire mais de rare.
Dans une tribune publiée dans The Conversation au début de l’été, Valery Ridde, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement et Christian Dagenais, professeur de psychologie à l’Université de Montréal remarquaient : « En France, l’espérance de vie sans incapacité à la naissance continue à évoluer de façon positive : elle était estimée en 2021 à 67 ans chez les femmes et 65,6 ans chez les hommes. Ce chiffre, qui se situe juste au niveau de la moyenne des pays européens, ne doit cependant pas être utilisé pour éviter de s’interroger sur la fragilité de notre système de santé. En effet, certains indicateurs de l’état de santé sont préoccupants : taux de mortalité infantile en hausse, évolution préoccupante du surpoids et de l’obésité (notamment en fonction des conditions sociales), taux de vaccination contre le papillomavirus faible, signant un déficit en prévention médicale, (…) toutes ces données accentuées par de fortes inégalités sociales ». Valery Ridde et Christian Dagenais ne disent par ailleurs rien de l’accès aux médicaments innovants souvent freiné dans notre pays par des considérations ayant trait à la fixation des prix et qui atteignent dans l’hexagone des niveaux de complexité inégalés.
Quand je me compare…
Si l’on va au-delà de ces données épidémiologiques et économiques très globales, le détail n’est pas toujours plus flatteur pour la France. Dans le numéro de juin du magazine du Cercle de recherche et d’analyse sur la protection sociale (CRAPS), le professeur Alain Bernard, président de l’IRAPS (Instance régionale de l’amélioration de la pertinence des soins) Bourgogne Franche-Comté, comparait (ce qui est toujours douloureux) : concernant « la perception de vivre en bonne santé des populations des pays de l’OCDE (…) la France ne fait pas partie des pays où les personnes ont la perception la plus élevée de vivre en bonne santé. Dans les pays comme la Belgique, le Danemark, la Norvège, la Suède et la Suisse, le pourcentage des personnes déclarant une perception de vivre en bonne santé est plus important que celui de la France. Cet indicateur consiste à interroger les personnes pour répondre à la question suivante : « Êtes-vous limité(e), depuis au moins six mois, en raison d’un problème de santé, dans vos activités habituelles ? ». Cet indicateur peut paraître subjectif dans l’interprétation de la limitation globale de l’activité, cependant des travaux ont montré qu’il reflétait de manière satisfaisante d’autres mesures de la santé et de l’incapacité ». Se penchant non plus seulement sur ces questions de perception, le Pr Bernard s’intéresse également à la qualité des soins : « Un travail a comparé les résultats de la chirurgie du cancer du poumon en France aux autres pays européens. Ce travail a été pris comme exemple pour la comparaison de la mesure de la qualité en France aux autres pays européens, car il a fait l’objet d’une publication mais nous aurions pu parfaitement utiliser d’autres types d’interventions chirurgicales ou technologies de santé. La mortalité postopératoire fait partie des différents indicateurs de résultats de la chirurgie du cancer du poumon. (…) Les pays comme la Grande-Bretagne et l’Espagne ont un taux de mortalité inférieur à la moyenne européenne. À l’opposé, deux pays comme l’Allemagne et la France ont un taux de mortalité respectivement de 2,9 % et 2,94 % alors que la moyenne européenne est de 2,1 %. Pour ces deux pays, la probabilité que leur taux de décès soit [réellement] supérieur à la moyenne européenne est de 98 % ».
Des indicateurs de résultats boudés en France
Bien sûr, l’exemple sera sans doute l’objet de quelques critiques (comme peut-être le fait que des patients en plus mauvais état général soient opérés en France) et on trouvera facilement (on l’espère) d’autres domaines où la France surpasse la Grande-Bretagne et l’Espagne. Néanmoins, derrière ces différences, sont isolées certaines spécificités françaises que l’on pourrait interroger et qui dénotent comment le souci du patient paraît parfois être relégué au second plan. Le professeur Bernard en énumère plusieurs. « Les indicateurs de résultats (…) sont peu évalués en France à l’opposé d’autres pays européens qui publient régulièrement les résultats des différentes techniques chirurgicales comme la chirurgie des coronaires, de la prothèse de hanche ou de la chirurgie de l’obésité ».
Il poursuit en remarquant la dispersion « de la pratique chirurgicale en France » qui a « comme corollaire la faible activité de certaines équipes » et qu’on constate moins en Grande-Bretagne ou dans d’autres pays. Or, régulièrement, des responsables politiques tentent de s’attaquer à cette question, mais se heurtent souvent à l’hostilité des représentants médicaux… doit-on y voir une préoccupation liée d’abord à la qualité des soins apportée aux patients ? Le professeur Bernard poursuit : « D’autres raisons pourraient être évoquées, certains pays européens sont impliqués dans des programmes de suivi des indicateurs de résultats, comme la mortalité postopératoire. Les équipes chirurgicales qui participent à ce type de programme sont informées de manière régulière sur leur niveau de performance et peuvent ainsi mettre en place des mesures d’amélioration de leurs résultats. En France, ce type de programme n’existe pas pour le moment, les établissements sont soumis à l’obligation de certification délivrée par la Haute Autorité de santé. Ce programme s’intéresse principalement aux indicateurs des structures et de processus. D’autres actions sont proposées aux praticiens pour améliorer leur pratique au quotidien, nous citerons l’accréditation pour les spécialités chirurgicales. Pour valider leur accréditation, le praticien devra déclarer des événements porteurs de risque pour le patient et montrer les actions qu’il a mises en place pour les prévenir. Cette démarche est louable, mais elle ne concerne que des actions ponctuelles et à aucun moment une évaluation globale de sa pratique. Une autre mesure est le développement professionnel continu qui est une obligation pour les praticiens. Cette obligation demande aux praticiens de suivre des formations continues et d’évaluer leur pratique. Le développement professionnel continu est géré par une structure administrative qui a complexifié le fonctionnement. Le patient a totalement disparu de cet univers où les praticiens s’inscrivent pour satisfaire à cette obligation réglementaire comme ils le feraient pour leur déclaration d’impôt » conclut-il.
Inversement des valeurs
Bien sûr, ici, les professionnels de santé pourraient être tout autant considérés comme les victimes d’un système aveugle et managérial que les patients. De fait, les syndicats ont beaucoup dénoncé le fait que les logiques qui ont été appliquées ces dernières années, notamment à l’hôpital, méconnaissent complètement le bien être des professionnels. Pour autant, les « hôpitaux » eux-mêmes (et en leur sein ceux qui y travaillent) peuvent parfois être les bénéficiaires de cette « disparition » des patients. Dans une tribune publiée ce printemps dans le Monde, le professeur de santé publique, Thierry Lang observe : « Depuis 2020, un curieux sophisme s’est installé dans le paysage médiatique qui, par sa répétition, semble avoir perdu toute capacité d’étonner. Confinements, comportements de prévention, masques, vaccination ne semblent avoir qu’un but : préserver l’hôpital. Cet objectif s’accompagne de bulletins de santé réguliers pour un hôpital qu’il s’agit de « soulager » et dont on se demande s’il va « tenir ». Le temps n’est pas si loin où le raisonnement était inverse. Au lieu de développer prévention et soins pour ménager le système de santé, la question était de mesurer les besoins de santé de la population pour définir les budgets nécessaires, la répartition et le dimensionnement des structures sanitaires. En d’autres termes, l’objectif recherché n’était pas d’adapter l’état de santé des citoyens au système, mais leur meilleure santé possible. Cette nouvelle façon de penser, inversant les valeurs, s’est installée progressivement. Depuis 2020, elle est devenue le nouveau paradigme. Les préoccupations financières (…) façonnent le système de santé. Malgré les appels répétés de nombreux professionnels de santé, le navire poursuit sa route, imperturbable, et les citoyens sont tenus de veiller à préserver un système malade. Il y a peu, la presse ne titrait pas sur les morts ou les handicaps que risquait de générer une nouvelle « vague » de Covid-19, ni sur la recrudescence prévisible de trois infections Covid-19, grippe et bronchiolite, encore moins sur les reports de soins. La question angoissante était : l’hôpital, les professionnels vont-ils tenir ? Pourtant, ce n’est pas aux malades de soulager le système de santé, c’est l’inverse » constatait-il.
Premier rôle
Comment les professionnels pourraient-ils inverser la tendance ? Peut-être en acceptant de ne plus se penser au centre. Pour le Dr Gaétan Casanova, ancien président de l’Intersyndicale nationale des Internes et membre de l’Observatoire Santé et Innovation de l’Institut Sapiens, c’est la voie montrée par les récentes évolutions législatives qui modifient les compétences des pharmaciens ou des infirmiers de pratique avancée. Il écrivait dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche : « On développe la spécialisation des infirmiers avec les Infirmiers en Pratiques Avancées (IPA), on reconnait le grade universitaire de master aux kinésithérapeutes et tout récemment les sage-femmes se sont vu ajouter une sixième année d’étude qui leur confèrera le statut de docteur en maïeutique. (…) Toutes ces réformes ont le mérite d’exprimer clairement une réalité : le médecin est un maillon essentiel du système de santé, il n’en est plus le centre. C’est bien ici un progrès car le seul centre légitime du système de santé est le patient. La crise existentielle est à son paroxysme. (…) L’orgueil médical est blessé : le médecin devra faire jeu égal avec les autres professionnels. La revendication d’une consultation à 50 euros est le cri légitime et dissimulé d’une profession en pleine crise existentielle qui à travers la rémunération recherche la reconnaissance qu’elle pense avoir perdu. Face à cette crise, deux voies sont possibles. La première consiste à refuser la coopération et à sacraliser injustement la place du médecin au-dessus des autres professionnels de la santé. Ce combat n’est ni souhaitable ni gagnable. La seconde voie consiste à porter avec enthousiasme un projet pour la santé des Français avec l’ensemble des autres professionnels. Cette deuxième voie est une voie d’humilité et de bienveillance, qualités essentielles pour un médecin. Nous devons tout à la fois souhaiter à nos médecins généralistes qu’ils reçoivent la reconnaissance qu’ils méritent et qu’ils empruntent cette dernière voie ».
Il y en aura bien sûr beaucoup pour rétorquer que les combats des médecins sont justement insufflés par le souci du patient. Mais celui-ci n’est-il pas en réalité devenu un prétexte facile, un artefact sans valeur oublié peu à peu tant des politiques, des décideurs et maintenant des médecins et professionnels. Trompés par la novlangue et autres hypocrisies, tous ont considéré comme acquis la primauté du patient. Mais n’est-il pas temps de ramener la balle au centre ?
On relira :
Valery Ridde et Christian Dagenais : https://theconversation.com/partout-dan ... les-207198
Pr Alain Bernard : https://www.thinktankcraps.fr/qualite-s ... europeens/
Pr Thierry Lang : https://www.lemonde.fr/idees/article/20 ... _3232.html
Gaetan Casanova : https://www.lejdd.fr/societe/tribune-le ... tre-132500
Aurélie Haroche
jim.fr
Et les patients dans tout ça ?
La novlangue démagogique ne manque jamais une occasion de « mettre le patient au centre ». Au centre de quoi ? Des « besoins », des « structures », des « solutions » et autres terminologies floues et nécessairement plurielles, permettant d’avoir l’air de tout dire sans en dire plus.
Pourtant, le patient est-il vraiment au « centre » aujourd’hui ? Attente interminable pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste en ville ou à l’hôpital, nécessité de rivaliser d’ingéniosité et de prudence pour appliquer sans dommage les recommandations d’utilisation des médicaments (en raison des pénuries frappant des galéniques mieux adaptées), acceptation du risque (fréquent) qu’une intervention soit déprogrammée inopinément : être patient en France aujourd’hui, c’est être au centre d’un jeu dont les règles semblent fréquemment être écrites à ses dépens.
Tout va bien… ou presque
Bien sûr, on rappellera à ces patients qu’ils bénéficient d’une santé quasiment gratuite (si l’on oublie les cotisations très élevées dont tous les salariés s’acquittent directement ou indirectement). Surtout, même s’ils ne sont plus si nombreux ceux qui se risquent encore à pavoiser sur le meilleur système de santé du monde, on n’hésite pas à répéter aux patients que la qualité des soins reste dans notre pays « exceptionnelle ». A moins qu’il faille entendre l’adjectif sous son autre acception, non plus d’extraordinaire mais de rare.
Dans une tribune publiée dans The Conversation au début de l’été, Valery Ridde, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement et Christian Dagenais, professeur de psychologie à l’Université de Montréal remarquaient : « En France, l’espérance de vie sans incapacité à la naissance continue à évoluer de façon positive : elle était estimée en 2021 à 67 ans chez les femmes et 65,6 ans chez les hommes. Ce chiffre, qui se situe juste au niveau de la moyenne des pays européens, ne doit cependant pas être utilisé pour éviter de s’interroger sur la fragilité de notre système de santé. En effet, certains indicateurs de l’état de santé sont préoccupants : taux de mortalité infantile en hausse, évolution préoccupante du surpoids et de l’obésité (notamment en fonction des conditions sociales), taux de vaccination contre le papillomavirus faible, signant un déficit en prévention médicale, (…) toutes ces données accentuées par de fortes inégalités sociales ». Valery Ridde et Christian Dagenais ne disent par ailleurs rien de l’accès aux médicaments innovants souvent freiné dans notre pays par des considérations ayant trait à la fixation des prix et qui atteignent dans l’hexagone des niveaux de complexité inégalés.
Quand je me compare…
Si l’on va au-delà de ces données épidémiologiques et économiques très globales, le détail n’est pas toujours plus flatteur pour la France. Dans le numéro de juin du magazine du Cercle de recherche et d’analyse sur la protection sociale (CRAPS), le professeur Alain Bernard, président de l’IRAPS (Instance régionale de l’amélioration de la pertinence des soins) Bourgogne Franche-Comté, comparait (ce qui est toujours douloureux) : concernant « la perception de vivre en bonne santé des populations des pays de l’OCDE (…) la France ne fait pas partie des pays où les personnes ont la perception la plus élevée de vivre en bonne santé. Dans les pays comme la Belgique, le Danemark, la Norvège, la Suède et la Suisse, le pourcentage des personnes déclarant une perception de vivre en bonne santé est plus important que celui de la France. Cet indicateur consiste à interroger les personnes pour répondre à la question suivante : « Êtes-vous limité(e), depuis au moins six mois, en raison d’un problème de santé, dans vos activités habituelles ? ». Cet indicateur peut paraître subjectif dans l’interprétation de la limitation globale de l’activité, cependant des travaux ont montré qu’il reflétait de manière satisfaisante d’autres mesures de la santé et de l’incapacité ». Se penchant non plus seulement sur ces questions de perception, le Pr Bernard s’intéresse également à la qualité des soins : « Un travail a comparé les résultats de la chirurgie du cancer du poumon en France aux autres pays européens. Ce travail a été pris comme exemple pour la comparaison de la mesure de la qualité en France aux autres pays européens, car il a fait l’objet d’une publication mais nous aurions pu parfaitement utiliser d’autres types d’interventions chirurgicales ou technologies de santé. La mortalité postopératoire fait partie des différents indicateurs de résultats de la chirurgie du cancer du poumon. (…) Les pays comme la Grande-Bretagne et l’Espagne ont un taux de mortalité inférieur à la moyenne européenne. À l’opposé, deux pays comme l’Allemagne et la France ont un taux de mortalité respectivement de 2,9 % et 2,94 % alors que la moyenne européenne est de 2,1 %. Pour ces deux pays, la probabilité que leur taux de décès soit [réellement] supérieur à la moyenne européenne est de 98 % ».
Des indicateurs de résultats boudés en France
Bien sûr, l’exemple sera sans doute l’objet de quelques critiques (comme peut-être le fait que des patients en plus mauvais état général soient opérés en France) et on trouvera facilement (on l’espère) d’autres domaines où la France surpasse la Grande-Bretagne et l’Espagne. Néanmoins, derrière ces différences, sont isolées certaines spécificités françaises que l’on pourrait interroger et qui dénotent comment le souci du patient paraît parfois être relégué au second plan. Le professeur Bernard en énumère plusieurs. « Les indicateurs de résultats (…) sont peu évalués en France à l’opposé d’autres pays européens qui publient régulièrement les résultats des différentes techniques chirurgicales comme la chirurgie des coronaires, de la prothèse de hanche ou de la chirurgie de l’obésité ».
Il poursuit en remarquant la dispersion « de la pratique chirurgicale en France » qui a « comme corollaire la faible activité de certaines équipes » et qu’on constate moins en Grande-Bretagne ou dans d’autres pays. Or, régulièrement, des responsables politiques tentent de s’attaquer à cette question, mais se heurtent souvent à l’hostilité des représentants médicaux… doit-on y voir une préoccupation liée d’abord à la qualité des soins apportée aux patients ? Le professeur Bernard poursuit : « D’autres raisons pourraient être évoquées, certains pays européens sont impliqués dans des programmes de suivi des indicateurs de résultats, comme la mortalité postopératoire. Les équipes chirurgicales qui participent à ce type de programme sont informées de manière régulière sur leur niveau de performance et peuvent ainsi mettre en place des mesures d’amélioration de leurs résultats. En France, ce type de programme n’existe pas pour le moment, les établissements sont soumis à l’obligation de certification délivrée par la Haute Autorité de santé. Ce programme s’intéresse principalement aux indicateurs des structures et de processus. D’autres actions sont proposées aux praticiens pour améliorer leur pratique au quotidien, nous citerons l’accréditation pour les spécialités chirurgicales. Pour valider leur accréditation, le praticien devra déclarer des événements porteurs de risque pour le patient et montrer les actions qu’il a mises en place pour les prévenir. Cette démarche est louable, mais elle ne concerne que des actions ponctuelles et à aucun moment une évaluation globale de sa pratique. Une autre mesure est le développement professionnel continu qui est une obligation pour les praticiens. Cette obligation demande aux praticiens de suivre des formations continues et d’évaluer leur pratique. Le développement professionnel continu est géré par une structure administrative qui a complexifié le fonctionnement. Le patient a totalement disparu de cet univers où les praticiens s’inscrivent pour satisfaire à cette obligation réglementaire comme ils le feraient pour leur déclaration d’impôt » conclut-il.
Inversement des valeurs
Bien sûr, ici, les professionnels de santé pourraient être tout autant considérés comme les victimes d’un système aveugle et managérial que les patients. De fait, les syndicats ont beaucoup dénoncé le fait que les logiques qui ont été appliquées ces dernières années, notamment à l’hôpital, méconnaissent complètement le bien être des professionnels. Pour autant, les « hôpitaux » eux-mêmes (et en leur sein ceux qui y travaillent) peuvent parfois être les bénéficiaires de cette « disparition » des patients. Dans une tribune publiée ce printemps dans le Monde, le professeur de santé publique, Thierry Lang observe : « Depuis 2020, un curieux sophisme s’est installé dans le paysage médiatique qui, par sa répétition, semble avoir perdu toute capacité d’étonner. Confinements, comportements de prévention, masques, vaccination ne semblent avoir qu’un but : préserver l’hôpital. Cet objectif s’accompagne de bulletins de santé réguliers pour un hôpital qu’il s’agit de « soulager » et dont on se demande s’il va « tenir ». Le temps n’est pas si loin où le raisonnement était inverse. Au lieu de développer prévention et soins pour ménager le système de santé, la question était de mesurer les besoins de santé de la population pour définir les budgets nécessaires, la répartition et le dimensionnement des structures sanitaires. En d’autres termes, l’objectif recherché n’était pas d’adapter l’état de santé des citoyens au système, mais leur meilleure santé possible. Cette nouvelle façon de penser, inversant les valeurs, s’est installée progressivement. Depuis 2020, elle est devenue le nouveau paradigme. Les préoccupations financières (…) façonnent le système de santé. Malgré les appels répétés de nombreux professionnels de santé, le navire poursuit sa route, imperturbable, et les citoyens sont tenus de veiller à préserver un système malade. Il y a peu, la presse ne titrait pas sur les morts ou les handicaps que risquait de générer une nouvelle « vague » de Covid-19, ni sur la recrudescence prévisible de trois infections Covid-19, grippe et bronchiolite, encore moins sur les reports de soins. La question angoissante était : l’hôpital, les professionnels vont-ils tenir ? Pourtant, ce n’est pas aux malades de soulager le système de santé, c’est l’inverse » constatait-il.
Premier rôle
Comment les professionnels pourraient-ils inverser la tendance ? Peut-être en acceptant de ne plus se penser au centre. Pour le Dr Gaétan Casanova, ancien président de l’Intersyndicale nationale des Internes et membre de l’Observatoire Santé et Innovation de l’Institut Sapiens, c’est la voie montrée par les récentes évolutions législatives qui modifient les compétences des pharmaciens ou des infirmiers de pratique avancée. Il écrivait dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche : « On développe la spécialisation des infirmiers avec les Infirmiers en Pratiques Avancées (IPA), on reconnait le grade universitaire de master aux kinésithérapeutes et tout récemment les sage-femmes se sont vu ajouter une sixième année d’étude qui leur confèrera le statut de docteur en maïeutique. (…) Toutes ces réformes ont le mérite d’exprimer clairement une réalité : le médecin est un maillon essentiel du système de santé, il n’en est plus le centre. C’est bien ici un progrès car le seul centre légitime du système de santé est le patient. La crise existentielle est à son paroxysme. (…) L’orgueil médical est blessé : le médecin devra faire jeu égal avec les autres professionnels. La revendication d’une consultation à 50 euros est le cri légitime et dissimulé d’une profession en pleine crise existentielle qui à travers la rémunération recherche la reconnaissance qu’elle pense avoir perdu. Face à cette crise, deux voies sont possibles. La première consiste à refuser la coopération et à sacraliser injustement la place du médecin au-dessus des autres professionnels de la santé. Ce combat n’est ni souhaitable ni gagnable. La seconde voie consiste à porter avec enthousiasme un projet pour la santé des Français avec l’ensemble des autres professionnels. Cette deuxième voie est une voie d’humilité et de bienveillance, qualités essentielles pour un médecin. Nous devons tout à la fois souhaiter à nos médecins généralistes qu’ils reçoivent la reconnaissance qu’ils méritent et qu’ils empruntent cette dernière voie ».
Il y en aura bien sûr beaucoup pour rétorquer que les combats des médecins sont justement insufflés par le souci du patient. Mais celui-ci n’est-il pas en réalité devenu un prétexte facile, un artefact sans valeur oublié peu à peu tant des politiques, des décideurs et maintenant des médecins et professionnels. Trompés par la novlangue et autres hypocrisies, tous ont considéré comme acquis la primauté du patient. Mais n’est-il pas temps de ramener la balle au centre ?
On relira :
Valery Ridde et Christian Dagenais : https://theconversation.com/partout-dan ... les-207198
Pr Alain Bernard : https://www.thinktankcraps.fr/qualite-s ... europeens/
Pr Thierry Lang : https://www.lemonde.fr/idees/article/20 ... _3232.html
Gaetan Casanova : https://www.lejdd.fr/societe/tribune-le ... tre-132500
Aurélie Haroche
jim.fr
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade