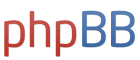Articles sur la santé
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2511
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Publié le 19/02/2022
Bas les masques : la politique comme depuis toujours avant la science ?
Paris, le samedi 19 février 2022 – Tout en observant une grande prudence, en raison des incertitudes constantes concernant l’évolution de l’épidémie de SARS-CoV-2, tant le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal que le ministre de la Santé, Olivier Véran ont évoqué la possibilité que l’obligation du port du masque dans les lieux clos puisse être levée vers la mi-mars. Cette suspension pourrait concerner jusqu’aux transports en commun et les écoles. L’annonce suscite un mélange de circonspection, d’espoirs et de critiques.
Déjà ?
Ces premiers signes d’un possible relâchement ont par exemple donné lieu au lancement sur Twitter d’un hashtag proclamant #Ouiaumasque. Il s’agissait de rappeler l’importance de ne pas abandonner trop rapidement cette protection à la fois individuelle et collective. Les promoteurs d’une prolongation du port du masque mettent en avant l’impact limité de cette mesure sur les libertés individuelles et son rôle pour protéger les plus fragiles (notamment les personnes immunodéprimées chez lesquelles la vaccination est peu efficace). Parallèlement, certaines chaines de télévision ont recueilli le témoignage de ces Français qui assurent que la fin de l’obligation n’entraînera pas de changement de leurs habitudes. La perspective d’une disparition du masque dans quelques semaines est de fait surprenante : il y a encore une dizaine de jours, une telle option ne semblait en effet guère envisageable avant l’été, notamment à l’école. Elle est d’autant plus surprenante que certains avaient parfois pu dessiner un monde où le masque demeurerait un outil du quotidien, notamment dans les transports en commun. L’étonnement suscité par les déclarations des responsables politiques témoigne en outre de la crainte que peut inspirer chez certains le retour à la vie d’avant que nous évoquions la semaine dernière dans ces colonnes.
L’objet incontournable
Le masque a revêtu une charge symbolique si forte depuis deux ans que sa fin programmée est nécessairement appréhendée comme une étape majeure. Qu’il s’agisse de se comparer avec les pays étrangers, de juger l’attitude du gouvernement, de s’interroger sur ce qui fonde la science ou encore de parler de liberté, le masque a toujours été au cœur du débat. On se souvient ainsi comment a été beaucoup répété que dans les pays Asiatiques la compliance au masque était infiniment meilleure que celle observée dans nos contrées… oubliant souvent que dans les pays cités le masque est utilisé par les personnes infectées ou pour se protéger de la pollution et non comme un dispositif généralisé.
Apprentissage (raté) du doute
Bien sûr, le masque a d’abord surtout été l’objet du scandale quand a été découverte la pauvreté du stock français. Très vite le gouvernement a été suspecté d’avoir minimisé l’efficacité du dispositif pour masquer ses insuffisances. Cependant, les théories développées ont été parfois remises en question. Ainsi, pendant l’été 2020, sur le site Agora Vox, l’essayiste Sylvain Rakotoarison remarquait : « Beaucoup de personnes, j’ai été tenté d’en faire partie, imaginaient que le gouvernement avait adapté la "doctrine" au champ du possible, et à cause de la pénurie de masques, le gouvernement aurait donc dit que ce n’était pas nécessaire. C’est Claude Weill, éditorialiste de "Nice-Matin" qui m’a convaincu qu’il fallait voir le problème à l’envers. Il pense que c’est parce que c’est au contraire la doxa française qui voulait que le masque était inutile pour le grand public qui a entraîné cette pénurie de masques, parce que l’État n’a pris en compte que les personnels soignants et les malades et pas toute la population dans ses stockages, commandes, etc. On laissera les commissions d’enquête parlementaires conclure à ce sujet qui est aussi délicat qu’épineux, mais cette hypothèse paraît la plus vraisemblable. L’un des signes de cette doxa française, c’est que pendant plusieurs semaines, elle n’a pas été défendue seulement par le gouvernement, mais aussi, indépendamment, par de nombreux médecins chefs de service qui sont rarement des personnes qui cèdent facilement aux influences de l’État (au même titre que les mandarins d’autres corps de métier, journalistes, enseignants, etc.), l’indépendance intellectuelle de cette profession n’est pas discutable. Et si elle a été ainsi défendue par eux, c’est parce qu’ils n’ont jamais appris que cela. En d’autres termes, en mars, le gouvernement ne leur a pas dit : "dites que cela ne sert à rien car sinon, il n’y en aurait pas assez" (avec le nombre de médecins, on l’aurait su), mais c’est plutôt eux qui auraient dit au gouvernement cette doxa car ils l’avaient toujours appris comme cela ». C’est ainsi que dès les premières questions sur les masques, non pas seulement la controverse scientifique, mais plus encore le doute scientifique et la difficulté d’apporter certaines preuves solides dans des contextes aussi complexes s’imposait sur le devant de la scène. Un doute qui justifiait la nuance et la prudence mais qui n’a pas toujours su guider de façon pertinente les discours.
Anti masques et antivax : mêmes combats
Concernant les masques, le doute n’a subitement plus été audible. Ainsi, très vite, tenir un discours s’interrogant sur les limites de l’efficacité du masque (qui plus est dans les conditions non optimales où il est parfois porté) a été assimilé à la défense de positions complotistes. D’ailleurs, sur le site The Conversation, Mélissa Fox-Muraton (Professeur de Philosophie, Groupe ESC Clermont) rappelait également en 2020 : « Une récente étude française a montré que les individus qui rejettent le masque adhèrent plus fortement aux thèses conspirationnistes que l’ensemble de la population française. 90 % des anti-masques (contre 43 % sur l’ensemble de la population française) pensent par exemple que le ministère de la Santé s’est allié aux compagnies pharmaceutiques pour cacher la nocivité des vaccins. Les anti-masques sont très actifs sur les réseaux sociaux où un grand nombre de fake news sur le port du masque ont été activement relayées. D’après eux, le masque serait inutile, voire même carrément dangereux pour la santé. Inutile car le maillage ne serait pas adapté et laisserait passer le virus. Dangereux car il diminuerait l’apport d’oxygène dans le sang, augmenterait l’inhalation de toxines, détériorerait le système immunitaire ou activerait des rétrovirus dormants déjà présents dans l’organisme. C’est évidemment faux comme l’explique en détail cet article de l’AFP. D’autres vont encore plus loin. Le port du masque serait « un rituel des pédo-satanistes » comme le prétend par exemple Eve Engerer, récemment radiée de l’Ordre des médecins, ou le groupe QAnon ». Difficile, il est vrai, face à de telles inepties de risquer d’être rangé du côté des anti-masques. Certains pourtant osent. Ainsi, le Dr Jean-Claude Grange (auteur du blog docteur du 16) n’a pas hésité, à l’instar de l’hématologue américain Vinay Prasad à signaler les biais importants d’une récente étude présentée par les CDC et censée confirmer les bénéfices indiscutables du masque. De son côté, le Dr Gérard Kierzeck dans le Figaro, cette semaine, relève : « Le variant Omicron est sans commune mesure avec les souches précédentes, le pic épidémique est derrière nous et, encore une fois, nous faisons face à un virus respiratoire qu'il est illusoire de vouloir stopper avec des masques ».
Paternalisme à circulation virale variable
Au-delà de ces questions scientifiques (qui restent majeures), d’un point de vue « politique », il sera difficile de déterminer si c’est l’ancienne doctrine médicale qui a conduit le gouvernement à négliger notre stock de masques ou si c’est parce qu’il l’avait négligé qu’il a mis en avant cette position. Une chose est sûre, le masque a symbolisé le paternalisme du gouvernement. Car sans remords, ni explications, celui que l’on avait quasiment interdit aux Français est devenu en quelques semaines une obligation, tandis que toute rébellion était assimilée à une position antiscience et irresponsable. Ce paternalisme certain du gouvernement est aujourd’hui à mettre en lumière avec la petite phrase cette semaine du professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, qui considère qu’il est temps que les Français puissent « gérer eux-mêmes leur vie en fonction du niveau de l’épidémie ». Difficile de comprendre pourquoi en d’autres périodes où le « niveau de l’épidémie » était pourtant bien inférieur à celui d’aujourd’hui, une telle approche n’a-t-elle pas pu être prônée.
La liberté a-t-elle été masquée ?
C’est sans doute parce que au plus haut sommet de l’Etat et pour un très grand nombre d’observateurs, il n’a jamais été considéré que le masque puisse réellement être considéré comme une entrave à la liberté (à la différence du confinement). D’ailleurs, sur cette question de philosophie politique, les débats ont été nombreux et houleux. Mélissa Fox-Muraton a tenté de le trancher en notant : « A quelle liberté l’obligation du port du masque porterait-elle atteinte ? Certainement pas à celle d’aller et venir, puisqu’il est tout à fait évident que la libre circulation des personnes est possible (et même renforcée tant que la mesure permet d’éviter un nouveau confinement) par cette mesure de prophylaxie. Certaines des voix qui s’élèvent contre le port du masque suggèrent que cette obligation porterait atteinte à leur liberté d’expression, de conscience ou de vie privée. (…) À l’heure actuelle, toute question de choix est immédiatement appropriée dans un discours sur la liberté individuelle. Ce faisant, cependant, l’on oublie souvent que la liberté n’est pas l’absence de toute contrainte ou l’autodétermination absolue, mais que nos libertés existent dans une sphère sociale et politique, et sont de ce fait limitées par celles des autres. (…) Selon d’aucuns, cette obligation constitue une ingérence de la part des pouvoirs publics sur leurs choix personnels, une forme de paternalisme qu’ils estiment inacceptable. C’est à chacun, ils disent, de décider s’il veut se mettre en danger, prendre le risque de tomber malade. Ce n’est pas le rôle de l’État d’intervenir dans les choix et les préférences. Si un tel argument est recevable, ce type de raisonnement n’est valable que dans les cas où les choix et préférences ne comportent aucun tort commis à l’égard d’autrui, et n’entraînent aucune restriction de ses droits ou libertés fondamentales. Dans le cas du port du masque, pourtant, il ne s’agit pas d’une obligation de se protéger, mais d’une mesure visant la protection des autres, et surtout les plus vulnérables au sein de notre société » expose-t-elle avant de marteler : « La liberté absolue, c’est la responsabilité absolue (…). Rappelons, (…) que même les penseurs qui ont défendu une conception beaucoup plus radicale de la liberté humaine, comme Jean Paul Sartre qui affirmait que la liberté était la possibilité de se choisir indépendamment des contextes politiques ou des normes, n’ont jamais soutenu que l’exercice de la liberté était sans contrainte. Pour Sartre, notamment, la liberté absolue va de pair avec la responsabilité absolue. C’est parce que l’homme est libre qu’il est responsable, et Sartre précise que cela ne veut « pas dire que l’homme est responsable de sa stricte individualité, mais qu’il est responsable de tous les hommes. » Aucune norme, aucune loi, aucune institution ne peut nous dire ce que nous devons faire, ce qui est juste. Cependant, nos actions et nos choix impactent les autres qui nous entourent, et c’est précisément parce que ces actions sont libres que nous devons répondre de leurs conséquences. Autrement dit, une conception radicale de la liberté implique une conscience accrue du fait que nous tenons la vie (et la liberté) de toute autre personne entre nos mains. Quelle que soit notre conception de la liberté, aucun argument juridique ni moral ne permet de soutenir l’idée que l’obligation du port du masque serait contraire à cette liberté ».
L’égoïsme des uns et des autres
Epousant cette argumentation philosophique, beaucoup ont ainsi insisté sur la « responsabilité » que représente le port du masque, allant jusqu’à le comparer au préservatif (même si l’efficacité du préservatif pour éviter les maladies sexuellement transmissibles est bien plus robustement établie). Poursuivant cette logique, « l’égoïsme » des réfractaires au masque a été fustigé. Pourtant, pour certains, s’agissant du masque imposé aux enfants, l’égoïsme concernerait peut-être plus certainement ceux qui imposent sans sourciller le port de cette protection. C’est par exemple le point de vue défendu par l’essayiste Samuel Fitoussi dans plusieurs textes concernant le masque pour les plus jeunes. Dans une tribune publiée par le Figaro fin 2021, il s’interroge : « À partir de combien de vies sauvées par an devient-il acceptable de faire porter à 13 millions d'enfants un masque toute la journée ? » après avoir fait remarquer : « Rappelons que tout n'est pas bon pour sauver des vies. Plusieurs milliers de Français meurent sur la route chaque année, chiffre que nous pourrions considérablement réduire en divisant par deux toutes les limites de vitesse. Mesure que personne ne propose, puisque nous jugeons que ses bénéfices seraient inférieurs à ses coûts sociaux » et avant de conclure : « Cela fait donc deux ans que nous imposons aux enfants de se sacrifier pour un virus contre lequel ils ne sont pas à risque. Aujourd'hui, pouvons-nous continuer à leur infliger des contraintes pour réduire le risque d'adultes qui choisissent de ne pas se vacciner ou qui souhaitent pour eux le risque zéro ? Et tant que le risque de saturation des hôpitaux n'est qu'hypothétique, la réduction de l'affluence hospitalière peut-elle être un objectif collectif légitime ? Les hôpitaux doivent être au service des Français et non les Français (et encore moins les enfants) au service des hôpitaux. Après deux ans de pandémie, l'égoïste n'est peut-être plus l'adolescent qui enlève son masque mais l'adulte qui veut continuer à le lui imposer ».
Quand les orthophonistes ne s’entendent pas
Un tel raisonnement est évacué par ceux qui d’une part martèlent que le risque n’est pas anodin pour les enfants et au-delà affirment que le masque n’a aucune conséquence sur les plus jeunes, même si ce sujet aussi (l’impact du masque sur les apprentissages notamment) les controverses ont été infinies et perdurent encore. Ainsi, la Fédération nationale des orthophonistes (FNO) vient-elle de publier un communiqué pour rappeler que l’affirmation selon laquelle le masque serait délétère pour l’apprentissage de la lecture ou l’acquisition du langage défendue récemment par le Collège national des orthophonistes ne reflète nullement la position majoritaire de ces spécialistes…
Après la peur mauvaise conseillère, la lassitude ?
Avec cette énième controverse scientifique, il apparaît une fois encore combien le masque est d’abord un instrument politique, comme l’affirme Samuel Fitoussi en ce qui concerne les enfants. D’ailleurs, les perspectives ouvertes cette semaine par Gabriel Attal et Olivier Véran ont ainsi été commentées par l’épidémiologiste Dominique Costagliola et par d’autres : « Ce serait une décision politique et non scientifique » compte tenu du contexte électoral. Cependant, même si l’influence de ce dernier ne doit certainement pas être méconnue, le fait que dans tous les pays du monde, un mouvement similaire s’observe témoigne qu’il en est probablement du masque comme de l’épidémie en général : la lassitude pourrait avoir fini par vaincre la peur. L’histoire nous dira laquelle de ces deux émotions est la plus mauvaise conseillère.
Aurélie Haroche
jim.fr
Bas les masques : la politique comme depuis toujours avant la science ?
Paris, le samedi 19 février 2022 – Tout en observant une grande prudence, en raison des incertitudes constantes concernant l’évolution de l’épidémie de SARS-CoV-2, tant le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal que le ministre de la Santé, Olivier Véran ont évoqué la possibilité que l’obligation du port du masque dans les lieux clos puisse être levée vers la mi-mars. Cette suspension pourrait concerner jusqu’aux transports en commun et les écoles. L’annonce suscite un mélange de circonspection, d’espoirs et de critiques.
Déjà ?
Ces premiers signes d’un possible relâchement ont par exemple donné lieu au lancement sur Twitter d’un hashtag proclamant #Ouiaumasque. Il s’agissait de rappeler l’importance de ne pas abandonner trop rapidement cette protection à la fois individuelle et collective. Les promoteurs d’une prolongation du port du masque mettent en avant l’impact limité de cette mesure sur les libertés individuelles et son rôle pour protéger les plus fragiles (notamment les personnes immunodéprimées chez lesquelles la vaccination est peu efficace). Parallèlement, certaines chaines de télévision ont recueilli le témoignage de ces Français qui assurent que la fin de l’obligation n’entraînera pas de changement de leurs habitudes. La perspective d’une disparition du masque dans quelques semaines est de fait surprenante : il y a encore une dizaine de jours, une telle option ne semblait en effet guère envisageable avant l’été, notamment à l’école. Elle est d’autant plus surprenante que certains avaient parfois pu dessiner un monde où le masque demeurerait un outil du quotidien, notamment dans les transports en commun. L’étonnement suscité par les déclarations des responsables politiques témoigne en outre de la crainte que peut inspirer chez certains le retour à la vie d’avant que nous évoquions la semaine dernière dans ces colonnes.
L’objet incontournable
Le masque a revêtu une charge symbolique si forte depuis deux ans que sa fin programmée est nécessairement appréhendée comme une étape majeure. Qu’il s’agisse de se comparer avec les pays étrangers, de juger l’attitude du gouvernement, de s’interroger sur ce qui fonde la science ou encore de parler de liberté, le masque a toujours été au cœur du débat. On se souvient ainsi comment a été beaucoup répété que dans les pays Asiatiques la compliance au masque était infiniment meilleure que celle observée dans nos contrées… oubliant souvent que dans les pays cités le masque est utilisé par les personnes infectées ou pour se protéger de la pollution et non comme un dispositif généralisé.
Apprentissage (raté) du doute
Bien sûr, le masque a d’abord surtout été l’objet du scandale quand a été découverte la pauvreté du stock français. Très vite le gouvernement a été suspecté d’avoir minimisé l’efficacité du dispositif pour masquer ses insuffisances. Cependant, les théories développées ont été parfois remises en question. Ainsi, pendant l’été 2020, sur le site Agora Vox, l’essayiste Sylvain Rakotoarison remarquait : « Beaucoup de personnes, j’ai été tenté d’en faire partie, imaginaient que le gouvernement avait adapté la "doctrine" au champ du possible, et à cause de la pénurie de masques, le gouvernement aurait donc dit que ce n’était pas nécessaire. C’est Claude Weill, éditorialiste de "Nice-Matin" qui m’a convaincu qu’il fallait voir le problème à l’envers. Il pense que c’est parce que c’est au contraire la doxa française qui voulait que le masque était inutile pour le grand public qui a entraîné cette pénurie de masques, parce que l’État n’a pris en compte que les personnels soignants et les malades et pas toute la population dans ses stockages, commandes, etc. On laissera les commissions d’enquête parlementaires conclure à ce sujet qui est aussi délicat qu’épineux, mais cette hypothèse paraît la plus vraisemblable. L’un des signes de cette doxa française, c’est que pendant plusieurs semaines, elle n’a pas été défendue seulement par le gouvernement, mais aussi, indépendamment, par de nombreux médecins chefs de service qui sont rarement des personnes qui cèdent facilement aux influences de l’État (au même titre que les mandarins d’autres corps de métier, journalistes, enseignants, etc.), l’indépendance intellectuelle de cette profession n’est pas discutable. Et si elle a été ainsi défendue par eux, c’est parce qu’ils n’ont jamais appris que cela. En d’autres termes, en mars, le gouvernement ne leur a pas dit : "dites que cela ne sert à rien car sinon, il n’y en aurait pas assez" (avec le nombre de médecins, on l’aurait su), mais c’est plutôt eux qui auraient dit au gouvernement cette doxa car ils l’avaient toujours appris comme cela ». C’est ainsi que dès les premières questions sur les masques, non pas seulement la controverse scientifique, mais plus encore le doute scientifique et la difficulté d’apporter certaines preuves solides dans des contextes aussi complexes s’imposait sur le devant de la scène. Un doute qui justifiait la nuance et la prudence mais qui n’a pas toujours su guider de façon pertinente les discours.
Anti masques et antivax : mêmes combats
Concernant les masques, le doute n’a subitement plus été audible. Ainsi, très vite, tenir un discours s’interrogant sur les limites de l’efficacité du masque (qui plus est dans les conditions non optimales où il est parfois porté) a été assimilé à la défense de positions complotistes. D’ailleurs, sur le site The Conversation, Mélissa Fox-Muraton (Professeur de Philosophie, Groupe ESC Clermont) rappelait également en 2020 : « Une récente étude française a montré que les individus qui rejettent le masque adhèrent plus fortement aux thèses conspirationnistes que l’ensemble de la population française. 90 % des anti-masques (contre 43 % sur l’ensemble de la population française) pensent par exemple que le ministère de la Santé s’est allié aux compagnies pharmaceutiques pour cacher la nocivité des vaccins. Les anti-masques sont très actifs sur les réseaux sociaux où un grand nombre de fake news sur le port du masque ont été activement relayées. D’après eux, le masque serait inutile, voire même carrément dangereux pour la santé. Inutile car le maillage ne serait pas adapté et laisserait passer le virus. Dangereux car il diminuerait l’apport d’oxygène dans le sang, augmenterait l’inhalation de toxines, détériorerait le système immunitaire ou activerait des rétrovirus dormants déjà présents dans l’organisme. C’est évidemment faux comme l’explique en détail cet article de l’AFP. D’autres vont encore plus loin. Le port du masque serait « un rituel des pédo-satanistes » comme le prétend par exemple Eve Engerer, récemment radiée de l’Ordre des médecins, ou le groupe QAnon ». Difficile, il est vrai, face à de telles inepties de risquer d’être rangé du côté des anti-masques. Certains pourtant osent. Ainsi, le Dr Jean-Claude Grange (auteur du blog docteur du 16) n’a pas hésité, à l’instar de l’hématologue américain Vinay Prasad à signaler les biais importants d’une récente étude présentée par les CDC et censée confirmer les bénéfices indiscutables du masque. De son côté, le Dr Gérard Kierzeck dans le Figaro, cette semaine, relève : « Le variant Omicron est sans commune mesure avec les souches précédentes, le pic épidémique est derrière nous et, encore une fois, nous faisons face à un virus respiratoire qu'il est illusoire de vouloir stopper avec des masques ».
Paternalisme à circulation virale variable
Au-delà de ces questions scientifiques (qui restent majeures), d’un point de vue « politique », il sera difficile de déterminer si c’est l’ancienne doctrine médicale qui a conduit le gouvernement à négliger notre stock de masques ou si c’est parce qu’il l’avait négligé qu’il a mis en avant cette position. Une chose est sûre, le masque a symbolisé le paternalisme du gouvernement. Car sans remords, ni explications, celui que l’on avait quasiment interdit aux Français est devenu en quelques semaines une obligation, tandis que toute rébellion était assimilée à une position antiscience et irresponsable. Ce paternalisme certain du gouvernement est aujourd’hui à mettre en lumière avec la petite phrase cette semaine du professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, qui considère qu’il est temps que les Français puissent « gérer eux-mêmes leur vie en fonction du niveau de l’épidémie ». Difficile de comprendre pourquoi en d’autres périodes où le « niveau de l’épidémie » était pourtant bien inférieur à celui d’aujourd’hui, une telle approche n’a-t-elle pas pu être prônée.
La liberté a-t-elle été masquée ?
C’est sans doute parce que au plus haut sommet de l’Etat et pour un très grand nombre d’observateurs, il n’a jamais été considéré que le masque puisse réellement être considéré comme une entrave à la liberté (à la différence du confinement). D’ailleurs, sur cette question de philosophie politique, les débats ont été nombreux et houleux. Mélissa Fox-Muraton a tenté de le trancher en notant : « A quelle liberté l’obligation du port du masque porterait-elle atteinte ? Certainement pas à celle d’aller et venir, puisqu’il est tout à fait évident que la libre circulation des personnes est possible (et même renforcée tant que la mesure permet d’éviter un nouveau confinement) par cette mesure de prophylaxie. Certaines des voix qui s’élèvent contre le port du masque suggèrent que cette obligation porterait atteinte à leur liberté d’expression, de conscience ou de vie privée. (…) À l’heure actuelle, toute question de choix est immédiatement appropriée dans un discours sur la liberté individuelle. Ce faisant, cependant, l’on oublie souvent que la liberté n’est pas l’absence de toute contrainte ou l’autodétermination absolue, mais que nos libertés existent dans une sphère sociale et politique, et sont de ce fait limitées par celles des autres. (…) Selon d’aucuns, cette obligation constitue une ingérence de la part des pouvoirs publics sur leurs choix personnels, une forme de paternalisme qu’ils estiment inacceptable. C’est à chacun, ils disent, de décider s’il veut se mettre en danger, prendre le risque de tomber malade. Ce n’est pas le rôle de l’État d’intervenir dans les choix et les préférences. Si un tel argument est recevable, ce type de raisonnement n’est valable que dans les cas où les choix et préférences ne comportent aucun tort commis à l’égard d’autrui, et n’entraînent aucune restriction de ses droits ou libertés fondamentales. Dans le cas du port du masque, pourtant, il ne s’agit pas d’une obligation de se protéger, mais d’une mesure visant la protection des autres, et surtout les plus vulnérables au sein de notre société » expose-t-elle avant de marteler : « La liberté absolue, c’est la responsabilité absolue (…). Rappelons, (…) que même les penseurs qui ont défendu une conception beaucoup plus radicale de la liberté humaine, comme Jean Paul Sartre qui affirmait que la liberté était la possibilité de se choisir indépendamment des contextes politiques ou des normes, n’ont jamais soutenu que l’exercice de la liberté était sans contrainte. Pour Sartre, notamment, la liberté absolue va de pair avec la responsabilité absolue. C’est parce que l’homme est libre qu’il est responsable, et Sartre précise que cela ne veut « pas dire que l’homme est responsable de sa stricte individualité, mais qu’il est responsable de tous les hommes. » Aucune norme, aucune loi, aucune institution ne peut nous dire ce que nous devons faire, ce qui est juste. Cependant, nos actions et nos choix impactent les autres qui nous entourent, et c’est précisément parce que ces actions sont libres que nous devons répondre de leurs conséquences. Autrement dit, une conception radicale de la liberté implique une conscience accrue du fait que nous tenons la vie (et la liberté) de toute autre personne entre nos mains. Quelle que soit notre conception de la liberté, aucun argument juridique ni moral ne permet de soutenir l’idée que l’obligation du port du masque serait contraire à cette liberté ».
L’égoïsme des uns et des autres
Epousant cette argumentation philosophique, beaucoup ont ainsi insisté sur la « responsabilité » que représente le port du masque, allant jusqu’à le comparer au préservatif (même si l’efficacité du préservatif pour éviter les maladies sexuellement transmissibles est bien plus robustement établie). Poursuivant cette logique, « l’égoïsme » des réfractaires au masque a été fustigé. Pourtant, pour certains, s’agissant du masque imposé aux enfants, l’égoïsme concernerait peut-être plus certainement ceux qui imposent sans sourciller le port de cette protection. C’est par exemple le point de vue défendu par l’essayiste Samuel Fitoussi dans plusieurs textes concernant le masque pour les plus jeunes. Dans une tribune publiée par le Figaro fin 2021, il s’interroge : « À partir de combien de vies sauvées par an devient-il acceptable de faire porter à 13 millions d'enfants un masque toute la journée ? » après avoir fait remarquer : « Rappelons que tout n'est pas bon pour sauver des vies. Plusieurs milliers de Français meurent sur la route chaque année, chiffre que nous pourrions considérablement réduire en divisant par deux toutes les limites de vitesse. Mesure que personne ne propose, puisque nous jugeons que ses bénéfices seraient inférieurs à ses coûts sociaux » et avant de conclure : « Cela fait donc deux ans que nous imposons aux enfants de se sacrifier pour un virus contre lequel ils ne sont pas à risque. Aujourd'hui, pouvons-nous continuer à leur infliger des contraintes pour réduire le risque d'adultes qui choisissent de ne pas se vacciner ou qui souhaitent pour eux le risque zéro ? Et tant que le risque de saturation des hôpitaux n'est qu'hypothétique, la réduction de l'affluence hospitalière peut-elle être un objectif collectif légitime ? Les hôpitaux doivent être au service des Français et non les Français (et encore moins les enfants) au service des hôpitaux. Après deux ans de pandémie, l'égoïste n'est peut-être plus l'adolescent qui enlève son masque mais l'adulte qui veut continuer à le lui imposer ».
Quand les orthophonistes ne s’entendent pas
Un tel raisonnement est évacué par ceux qui d’une part martèlent que le risque n’est pas anodin pour les enfants et au-delà affirment que le masque n’a aucune conséquence sur les plus jeunes, même si ce sujet aussi (l’impact du masque sur les apprentissages notamment) les controverses ont été infinies et perdurent encore. Ainsi, la Fédération nationale des orthophonistes (FNO) vient-elle de publier un communiqué pour rappeler que l’affirmation selon laquelle le masque serait délétère pour l’apprentissage de la lecture ou l’acquisition du langage défendue récemment par le Collège national des orthophonistes ne reflète nullement la position majoritaire de ces spécialistes…
Après la peur mauvaise conseillère, la lassitude ?
Avec cette énième controverse scientifique, il apparaît une fois encore combien le masque est d’abord un instrument politique, comme l’affirme Samuel Fitoussi en ce qui concerne les enfants. D’ailleurs, les perspectives ouvertes cette semaine par Gabriel Attal et Olivier Véran ont ainsi été commentées par l’épidémiologiste Dominique Costagliola et par d’autres : « Ce serait une décision politique et non scientifique » compte tenu du contexte électoral. Cependant, même si l’influence de ce dernier ne doit certainement pas être méconnue, le fait que dans tous les pays du monde, un mouvement similaire s’observe témoigne qu’il en est probablement du masque comme de l’épidémie en général : la lassitude pourrait avoir fini par vaincre la peur. L’histoire nous dira laquelle de ces deux émotions est la plus mauvaise conseillère.
Aurélie Haroche
jim.fr
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2511
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Un médicament vieux de 70 ans protège les poumons de la Covid-19
Julie Kern
Rédactrice scientifique
Publié le 13/02/2022
Le disulfirame est prescrit pour traiter l'alcoolisme, mais des chercheurs du Weil Medical College, aux États-Unis, ont aussi observé qu'il réduisait dans les poumons de hamsters les dégâts causés par le coronavirus.
L'action thérapeutique du disulfirame est connue depuis près de 70 ans. Utilisé d'abord comme antiparasitaire, il est aujourd'hui prescrit dans le cadre d'une dépendance à l'alcool. En effet, le disulfirame inhibe l'action d'une enzyme impliquée dans l'élimination de l'alcool dans l'organisme. La molécule amplifie donc les symptômes de la « gueule de bois », un moyen de dissuader les alcooliques de consommer à nouveau de l'alcool.
Souvent, un médicament autorisé pour une maladie donnée fait l'objet de nouveaux tests pour estimer son effet dans une autre. C'est ce qu'il s'est passé pour le disulfirame. En 2020, des chercheurs ont observé que la molécule limite la formation de NETs (pour neutrophil extracellular traps, en anglais), une structure extracellulaire que les globules blancs neutrophiles déploient comme une toile d'araignée pour attraper les pathogènes. Or, ces NETs peuvent aussi agresser les tissus et les vaisseaux pulmonaires. Ils sont présents dans les poumons de certains patients atteints de la Covid-19.
« Les NETs peuvent endommager les tissus, mais comme le disulfirame interfère avec la gasdermine D, une molécule requise pour produire les NETs, il ne s'en forme aucun après un traitement au disulfirame », explique Mikala Egelbad, première autrice de l'étude parue dans JCI insight.
Des essais pré-cliniques positifs
Après des tests in vitro qui ont montré que le disulfirame empêche les neutrophiles de déployer leurs NETs, les chercheurs ont réalisé des essais pré-cliniques sur des hamsters dorés atteints de Covid-19. Une prise de disulfirame un jour avant et un jour après l'infection par le SARS-CoV-2 réduit la formation de NETs et en conséquence les dommages tissulaires dans les poumons (fibroses), et éteint aussi l'inflammation néfaste.
Les NETs sont impliqués dans d'autres maladies pulmonaires, agir sur leur formation pourrait être intéressant au-delà de la Covid-19. Les chercheurs ont testé le disulfirame sur des souris atteintes du syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel (TRALI), qui est une détresse respiratoire aiguë après une transfusion sanguine. Un traitement au disulfirame a augmenté significativement la survie du groupe de souris, comparativement à celles non traitées. Un petit essai clinique mené sur 60 patients Covid est en cours à l'Université de Californie à San Francisco pour confirmer les effets positifs du disulfirame.
_____________
Vaccinés et pourtant hospitalisés à cause de la Covid-19 : quels sont leurs profils ?
Stéphanie Le Guillou
Journaliste Santé
futura science.com
Publié le 12/02/2022
« La vaccination prévient les formes graves de la maladie à Covid-19. » Oui, pourtant certains sont vaccinés et font tout de même une forme grave. Quel est le profil de ces patients-là ? Parmi les vaccinés, quels sont les facteurs de risque d'être hospitalisé voire de décéder d'une infection au SARS-CoV-2 ?
Les facteurs de risque de faire une forme grave de la maladie à Covid-19 chez les personnes non vaccinées sont clairement identifiés. Il s'agit de l'âge, de l'obésité, du diabète, de la trisomie 21, du retard mental, d'une greffe rénale ou pulmonaire, de l'insuffisance rénale chronique terminale, ou du cancer du poumon. La vaccination est efficace pour prévenir les formes sévères, même face au variant Omicron. Néanmoins, certains patients ayant un schéma vaccinal complet se retrouvent intubés en réanimation. Quel est le profil de ces patients ? Les facteurs de risque sont-ils identiques chez les vaccinés et chez les non-vaccinés ? Une étude EPI-Phare portant sur 28 millions de personnes s'est penchée sur la question.
Une étude portant sur 28 millions de vaccinés
EPI-Phare est un groupement d'intérêt scientifique créé en 2018. Il réalise de manière indépendante des études de pharmaco-épidémiologie afin d'éclairer le gouvernement dans sa politique sanitaire. EPI-Phare utilise le Système national des données de santé (SNDS). Il s'agit d'une base de données anonymes contenant tous les actes, consultations, et prescriptions de médicaments remboursés de l'ensemble des Français depuis 2006.
L'étude porte sur l'ensemble des personnes ayant un schéma vaccinal complet en France au 31 juillet 2021, soit 28 millions d'individus. Le suivi des participants a démarré deux semaines après la seconde injection (ou la première pour ceux ayant été préalablement contaminées) et s'est terminé au 31 août 2021. Les personnes ont été suivies en moyenne pendant 80 jours.
Facteurs de risque chez les vaccinés
Les auteurs ont pu relever 5.345 hospitalisations pour Covid-19 et 996 décès liés également à la Covid-19. Quelles étaient les caractéristiques de ces personnes totalement vaccinées ayant fait une forme grave de la maladie ?
Être âgé : les personnes de 85-89 ans avaient quatre fois plus de risques d'être hospitalisées et 38 fois plus de risques de décéder de l'infection au SARS-CoV-2 que les personnes de 45-54 ans.
Être un homme : les risques d'hospitalisation et de décès étaient respectivement 1,6 et 2 fois plus élevés chez les hommes que chez les femmes.
Être issu d'une commune défavorisée : les risques d'hospitalisation et de décès étaient respectivement 1,3 et 1,5 fois plus élevés chez ceux issus d'une commune défavorisée que chez ceux issus d'une commune favorisée.
Être atteint d'une affection chronique : l'affection chronique représentant le plus fort facteur de risque était la transplantation rénale, suivi de la transplantation du poumon.
Avoir un traitement au long cours par immunosuppresseurs ou par corticoïdes oraux, ce qui est le cas des personnes greffées.
Parmi les personnes totalement vaccinées et hospitalisées, seulement 10 % n'avaient aucune comorbidité. Parmi celles totalement vaccinées et décédées, seulement 2 % n'avaient aucune comorbidité.
En conclusion, les facteurs de risque chez les personnes vaccinées sont sensiblement les mêmes que chez les personnes non vaccinées. En revanche, on retrouve beaucoup moins de personnes sans comorbidité et hospitalisées ou décédées de la Covid-19 chez les vaccinés que chez les non-vaccinés.
____________
Publié le 02/02/2022
Transfusion supermassive en pédiatrie, une zone de combat
Aux États-Unis, les traumatismes constituent la principale cause de mortalité pédiatrique, avec un taux de mortalité de près de 50 % chez les enfants nécessitant une transfusion massive (MT). Des études systématiques soulignent la nécessité d’une définition commune de la MT chez les enfants traumatisés, ainsi qu’un critère standardisé pour l’initier. Les études récentes, de 2015 à 2020, suggèrent de définir la MT pédiatrique comme étant une transfusion de plus de 40 ml/kg de tout type de produits sanguins, en 24 h. Des revues systématiques concernant des blessés pédiatriques civils ont abouti à des conclusions similaires ; considérer comme étant massive une transfusion de plus de 37 mL/kg dans les quatre heures optimise la sensibilité et la spécificité, en tant que facteur prédictif de la mortalité précoce et de la nécessité d'une intervention de contrôle des hémorragies.
Par ailleurs, on trouve très peu de publications décrivant la transfusion supermassive (SMT), en particulier aux alentours du volume sanguin pédiatrique complet (75-80 ml/kg). De plus, les modèles de blessures, les interventions pré-hospitalières et les résultats cliniques prédictifs de la nécessité d'une transfusion SMT chez les enfants traumatisés n'ont pas encore été rapportés dans la littérature.
Cet article décrit les types de blessures, les interventions pré-hospitalières et les caractéristiques cliniques d'un sous-ensemble de patients pédiatriques victimes de traumatismes et ayant eu besoin de transfusions « supermassives ».
Les données pédiatriques du Department of defense trauma registry de janvier 2007 à 2016, ont été analysées rétrospectivement. Ce registre est un référentiel sur les blessures liées aux traumatismes qui documente les données démographiques, les incidents à l'origine des blessures, les diagnostics, les traitements et les résultats des blessures subies par le personnel militaire américain et non-américain, et le personnel civil américain et non-américain dans le cadre de missions de combat et de maintien de la paix (y compris les missions humanitaires), depuis le moment de la blessure jusqu'à son traitement.
Les patients ont été stratifiés en deux cohortes en fonction des produits sanguins reçus au cours des 24 premières heures après la blessure : 1) Ceux qui ont reçu 40-80 ml/kg (MT) ou 2) Ceux qui ont reçu > 80 ml/kg (SMT).
Un taux de survie significativement plus faible dans le groupe transfusion supermassive
Cet ensemble de données original concernait entre autres 3 439 blessés pédiatriques (âgés de moins de 17 ans) dont 536 qui répondaient aux paramètres d'inclusion (transfusion ≥ 40 ml/kg de produits sanguins [sang total, concentré de globules rouges, plasma frais congelé, plaquettes ou cryoprécipité]). La cohorte MT comprenait 271 patients (50,6 %) et la cohorte SMT 265 patients (49,4 %). Le taux de survie jusqu'à la sortie de l’hôpital a été significativement plus faible (78 % dans le groupe SMT, 86 % dans le groupe MT ; p < 0,011).
L’analyse multivariée des types de blessures a révélé que les blessures graves (Abbreviated Injury Scale 3-6) des extrémités (Odds Ratio OR 2,13, intervalle de confiance à 95 % IC 95 % 1,45 - 3,12) et à l'abdomen (OR 1,65, 1,08 - 2,53) étaient associées aux SMT. Des pansements (41 % vs 29 % ; p = 0,003), des garrots (23 % vs 12 % ; p = 0,001) et un accès intra-osseux (17 % vs 10 % ; p = 0,013) étaient plus fréquemment mis en place dans le groupe SMT. Il y avait significativement davantage d’hypotension ajustée à l'âge dans le groupe SMT (41 %, n = 100 vs 23 %, n = 59 ; p < 0,001) sans qu'aucune différence statistique n’ait été détectée pour la tachycardie (87 %, n = 223 vs 87 %, n = 228 ; p = 0,932).
Le point fort de cette étude est la taille de la cohorte étudiée. Toutefois, l'application des données des zones de conflit aux traumatismes civils limite l'étude, car 63,9 % des cas étaient dus à des explosions. Or, les blessures par explosion ne sont pas une cause courante de décès traumatique pédiatrique aux États-Unis, où le mécanisme de blessure typique est un accident de voiture (47 % des traumatismes pédiatriques en 2004). En outre, cette étude n'a pas tenu compte du temps de transport pré-hospitalier dans les zones de conflit et de la multitude de façons dont un blessé civil peut être évacué vers un centre de soins militaires par rapport à un système militaire d'évacuation des blessés parfaitement codifié. Ainsi, les délais d’évacuation des civils signifient que certains patients présentant des blessures graves pouvant conduire à une SMT, auraient pu mourir en route et n’ont donc pas été pris en compte dans cette étude. Enfin, le suivi à long terme lors de l'évaluation de la survie n’a pas été abordé.
Dr Bernard-Alex Gaüzère
Référence
Hesling JD et coll. : Characterizing pediatric supermassive transfusion and the contributing injury patterns in the combat environment. Am J Emerg Med., 2022, 51 : 139-143.
jim.fr
Julie Kern
Rédactrice scientifique
Publié le 13/02/2022
Le disulfirame est prescrit pour traiter l'alcoolisme, mais des chercheurs du Weil Medical College, aux États-Unis, ont aussi observé qu'il réduisait dans les poumons de hamsters les dégâts causés par le coronavirus.
L'action thérapeutique du disulfirame est connue depuis près de 70 ans. Utilisé d'abord comme antiparasitaire, il est aujourd'hui prescrit dans le cadre d'une dépendance à l'alcool. En effet, le disulfirame inhibe l'action d'une enzyme impliquée dans l'élimination de l'alcool dans l'organisme. La molécule amplifie donc les symptômes de la « gueule de bois », un moyen de dissuader les alcooliques de consommer à nouveau de l'alcool.
Souvent, un médicament autorisé pour une maladie donnée fait l'objet de nouveaux tests pour estimer son effet dans une autre. C'est ce qu'il s'est passé pour le disulfirame. En 2020, des chercheurs ont observé que la molécule limite la formation de NETs (pour neutrophil extracellular traps, en anglais), une structure extracellulaire que les globules blancs neutrophiles déploient comme une toile d'araignée pour attraper les pathogènes. Or, ces NETs peuvent aussi agresser les tissus et les vaisseaux pulmonaires. Ils sont présents dans les poumons de certains patients atteints de la Covid-19.
« Les NETs peuvent endommager les tissus, mais comme le disulfirame interfère avec la gasdermine D, une molécule requise pour produire les NETs, il ne s'en forme aucun après un traitement au disulfirame », explique Mikala Egelbad, première autrice de l'étude parue dans JCI insight.
Des essais pré-cliniques positifs
Après des tests in vitro qui ont montré que le disulfirame empêche les neutrophiles de déployer leurs NETs, les chercheurs ont réalisé des essais pré-cliniques sur des hamsters dorés atteints de Covid-19. Une prise de disulfirame un jour avant et un jour après l'infection par le SARS-CoV-2 réduit la formation de NETs et en conséquence les dommages tissulaires dans les poumons (fibroses), et éteint aussi l'inflammation néfaste.
Les NETs sont impliqués dans d'autres maladies pulmonaires, agir sur leur formation pourrait être intéressant au-delà de la Covid-19. Les chercheurs ont testé le disulfirame sur des souris atteintes du syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel (TRALI), qui est une détresse respiratoire aiguë après une transfusion sanguine. Un traitement au disulfirame a augmenté significativement la survie du groupe de souris, comparativement à celles non traitées. Un petit essai clinique mené sur 60 patients Covid est en cours à l'Université de Californie à San Francisco pour confirmer les effets positifs du disulfirame.
_____________
Vaccinés et pourtant hospitalisés à cause de la Covid-19 : quels sont leurs profils ?
Stéphanie Le Guillou
Journaliste Santé
futura science.com
Publié le 12/02/2022
« La vaccination prévient les formes graves de la maladie à Covid-19. » Oui, pourtant certains sont vaccinés et font tout de même une forme grave. Quel est le profil de ces patients-là ? Parmi les vaccinés, quels sont les facteurs de risque d'être hospitalisé voire de décéder d'une infection au SARS-CoV-2 ?
Les facteurs de risque de faire une forme grave de la maladie à Covid-19 chez les personnes non vaccinées sont clairement identifiés. Il s'agit de l'âge, de l'obésité, du diabète, de la trisomie 21, du retard mental, d'une greffe rénale ou pulmonaire, de l'insuffisance rénale chronique terminale, ou du cancer du poumon. La vaccination est efficace pour prévenir les formes sévères, même face au variant Omicron. Néanmoins, certains patients ayant un schéma vaccinal complet se retrouvent intubés en réanimation. Quel est le profil de ces patients ? Les facteurs de risque sont-ils identiques chez les vaccinés et chez les non-vaccinés ? Une étude EPI-Phare portant sur 28 millions de personnes s'est penchée sur la question.
Une étude portant sur 28 millions de vaccinés
EPI-Phare est un groupement d'intérêt scientifique créé en 2018. Il réalise de manière indépendante des études de pharmaco-épidémiologie afin d'éclairer le gouvernement dans sa politique sanitaire. EPI-Phare utilise le Système national des données de santé (SNDS). Il s'agit d'une base de données anonymes contenant tous les actes, consultations, et prescriptions de médicaments remboursés de l'ensemble des Français depuis 2006.
L'étude porte sur l'ensemble des personnes ayant un schéma vaccinal complet en France au 31 juillet 2021, soit 28 millions d'individus. Le suivi des participants a démarré deux semaines après la seconde injection (ou la première pour ceux ayant été préalablement contaminées) et s'est terminé au 31 août 2021. Les personnes ont été suivies en moyenne pendant 80 jours.
Facteurs de risque chez les vaccinés
Les auteurs ont pu relever 5.345 hospitalisations pour Covid-19 et 996 décès liés également à la Covid-19. Quelles étaient les caractéristiques de ces personnes totalement vaccinées ayant fait une forme grave de la maladie ?
Être âgé : les personnes de 85-89 ans avaient quatre fois plus de risques d'être hospitalisées et 38 fois plus de risques de décéder de l'infection au SARS-CoV-2 que les personnes de 45-54 ans.
Être un homme : les risques d'hospitalisation et de décès étaient respectivement 1,6 et 2 fois plus élevés chez les hommes que chez les femmes.
Être issu d'une commune défavorisée : les risques d'hospitalisation et de décès étaient respectivement 1,3 et 1,5 fois plus élevés chez ceux issus d'une commune défavorisée que chez ceux issus d'une commune favorisée.
Être atteint d'une affection chronique : l'affection chronique représentant le plus fort facteur de risque était la transplantation rénale, suivi de la transplantation du poumon.
Avoir un traitement au long cours par immunosuppresseurs ou par corticoïdes oraux, ce qui est le cas des personnes greffées.
Parmi les personnes totalement vaccinées et hospitalisées, seulement 10 % n'avaient aucune comorbidité. Parmi celles totalement vaccinées et décédées, seulement 2 % n'avaient aucune comorbidité.
En conclusion, les facteurs de risque chez les personnes vaccinées sont sensiblement les mêmes que chez les personnes non vaccinées. En revanche, on retrouve beaucoup moins de personnes sans comorbidité et hospitalisées ou décédées de la Covid-19 chez les vaccinés que chez les non-vaccinés.
____________
Publié le 02/02/2022
Transfusion supermassive en pédiatrie, une zone de combat
Aux États-Unis, les traumatismes constituent la principale cause de mortalité pédiatrique, avec un taux de mortalité de près de 50 % chez les enfants nécessitant une transfusion massive (MT). Des études systématiques soulignent la nécessité d’une définition commune de la MT chez les enfants traumatisés, ainsi qu’un critère standardisé pour l’initier. Les études récentes, de 2015 à 2020, suggèrent de définir la MT pédiatrique comme étant une transfusion de plus de 40 ml/kg de tout type de produits sanguins, en 24 h. Des revues systématiques concernant des blessés pédiatriques civils ont abouti à des conclusions similaires ; considérer comme étant massive une transfusion de plus de 37 mL/kg dans les quatre heures optimise la sensibilité et la spécificité, en tant que facteur prédictif de la mortalité précoce et de la nécessité d'une intervention de contrôle des hémorragies.
Par ailleurs, on trouve très peu de publications décrivant la transfusion supermassive (SMT), en particulier aux alentours du volume sanguin pédiatrique complet (75-80 ml/kg). De plus, les modèles de blessures, les interventions pré-hospitalières et les résultats cliniques prédictifs de la nécessité d'une transfusion SMT chez les enfants traumatisés n'ont pas encore été rapportés dans la littérature.
Cet article décrit les types de blessures, les interventions pré-hospitalières et les caractéristiques cliniques d'un sous-ensemble de patients pédiatriques victimes de traumatismes et ayant eu besoin de transfusions « supermassives ».
Les données pédiatriques du Department of defense trauma registry de janvier 2007 à 2016, ont été analysées rétrospectivement. Ce registre est un référentiel sur les blessures liées aux traumatismes qui documente les données démographiques, les incidents à l'origine des blessures, les diagnostics, les traitements et les résultats des blessures subies par le personnel militaire américain et non-américain, et le personnel civil américain et non-américain dans le cadre de missions de combat et de maintien de la paix (y compris les missions humanitaires), depuis le moment de la blessure jusqu'à son traitement.
Les patients ont été stratifiés en deux cohortes en fonction des produits sanguins reçus au cours des 24 premières heures après la blessure : 1) Ceux qui ont reçu 40-80 ml/kg (MT) ou 2) Ceux qui ont reçu > 80 ml/kg (SMT).
Un taux de survie significativement plus faible dans le groupe transfusion supermassive
Cet ensemble de données original concernait entre autres 3 439 blessés pédiatriques (âgés de moins de 17 ans) dont 536 qui répondaient aux paramètres d'inclusion (transfusion ≥ 40 ml/kg de produits sanguins [sang total, concentré de globules rouges, plasma frais congelé, plaquettes ou cryoprécipité]). La cohorte MT comprenait 271 patients (50,6 %) et la cohorte SMT 265 patients (49,4 %). Le taux de survie jusqu'à la sortie de l’hôpital a été significativement plus faible (78 % dans le groupe SMT, 86 % dans le groupe MT ; p < 0,011).
L’analyse multivariée des types de blessures a révélé que les blessures graves (Abbreviated Injury Scale 3-6) des extrémités (Odds Ratio OR 2,13, intervalle de confiance à 95 % IC 95 % 1,45 - 3,12) et à l'abdomen (OR 1,65, 1,08 - 2,53) étaient associées aux SMT. Des pansements (41 % vs 29 % ; p = 0,003), des garrots (23 % vs 12 % ; p = 0,001) et un accès intra-osseux (17 % vs 10 % ; p = 0,013) étaient plus fréquemment mis en place dans le groupe SMT. Il y avait significativement davantage d’hypotension ajustée à l'âge dans le groupe SMT (41 %, n = 100 vs 23 %, n = 59 ; p < 0,001) sans qu'aucune différence statistique n’ait été détectée pour la tachycardie (87 %, n = 223 vs 87 %, n = 228 ; p = 0,932).
Le point fort de cette étude est la taille de la cohorte étudiée. Toutefois, l'application des données des zones de conflit aux traumatismes civils limite l'étude, car 63,9 % des cas étaient dus à des explosions. Or, les blessures par explosion ne sont pas une cause courante de décès traumatique pédiatrique aux États-Unis, où le mécanisme de blessure typique est un accident de voiture (47 % des traumatismes pédiatriques en 2004). En outre, cette étude n'a pas tenu compte du temps de transport pré-hospitalier dans les zones de conflit et de la multitude de façons dont un blessé civil peut être évacué vers un centre de soins militaires par rapport à un système militaire d'évacuation des blessés parfaitement codifié. Ainsi, les délais d’évacuation des civils signifient que certains patients présentant des blessures graves pouvant conduire à une SMT, auraient pu mourir en route et n’ont donc pas été pris en compte dans cette étude. Enfin, le suivi à long terme lors de l'évaluation de la survie n’a pas été abordé.
Dr Bernard-Alex Gaüzère
Référence
Hesling JD et coll. : Characterizing pediatric supermassive transfusion and the contributing injury patterns in the combat environment. Am J Emerg Med., 2022, 51 : 139-143.
jim.fr
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2511
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
En France, les infirmières se heurtent au patriarcat médical
8 mars 2022
Caroline Coq-Chodorge (Source : médiapart)
Dans de très nombreux pays, les infirmières sont montées en compétences, accédant à la « pratique avancée », un métier intermédiaire, plus autonome vis-à-vis des médecins. En France, ce mouvement est empêché par le corps médical, qui refuse de partager son monopole sur la prescription ou la consultation.
Les infirmières manquent partout, et singulièrement dans les grandes villes, où la vie est la plus chère.
Des lits ferment, l’activité des hôpitaux baisse, c’est-à-dire leur budget, le nerf de la guerre. Les augmentations de salaire consenties pendant le Ségur de la santé ne disent rien de la valeur des infirmières.
L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a fait les comptes en janvier, dans ses 39 hôpitaux d’Île-de-France : il en manque 1 400, 7,5 % des postes sont vacants. Pour parvenir à les recruter, la plus grande institution hospitalière sort le chéquier : 7 500 euros pour les étudiantes infirmières qui s’engageront à travailler 18 mois dans les hôpitaux franciliens, ou encore une prime d’installation en Île-de-France de 2 055 euros brut.
L’agence régionale de santé d’Île-de-France a fait monter les enchères : jusqu’au 28 février, elle leur a proposé des CDD au salaire mensuel de 3 085 euros brut, assorti d’une prime de 4 000 euros pour un CDD de six mois et de 7 000 euros pour un CDD de neuf mois. Résultat : 63 contrats ont été signés. Après deux années de crise Covid, le « quoi qu’il en coûte » ne fonctionne plus.
« À l’hôpital, la fuite des infirmières est manifeste, l’infirmière expérimentée n’existe quasiment plus », constate Sophie Chrétien, infirmière depuis 25 ans, une perle rare avec sa solide expérience en soins palliatifs. « Le métier s’est extrêmement réduit à la tâche, avec des cadences qui se sont accélérées », poursuit-elle.
« La richesse du métier, c’est la rencontre du patient, s’asseoir au bord de son lit, prendre le temps de l’écoute, de la réflexion. Tout cela s’est considérablement appauvri. Les cadres de santé, notre management, ne nous soutiennent plus, car ils sont à la tête d’équipes de plus en plus grandes, pris dans la gestion des plannings, complète l’infirmière Ludivine Videloup. Notre métier doit évoluer, les professionnels ont besoin de retrouver du sens. »
Se joue une lutte des pouvoirs dans un système de santé extrêmement hiérarchisé, travaillé par les questions de genre. Les infirmières sont très largement des femmes. Et que les médecins soient un peu moins fréquemment des hommes « ne change finalement rien au positionnement de chacun », dit encore l’infirmière Sophie Chrétien. « Des médecins voient toujours l’infirmière comme une tâcheronne, comme quelqu’un qui n’est pas capable de raisonner. C’est extrêmement frustrant. »
Avant les infirmières, les religieuses
« L’histoire des infirmières françaises est lourde », rappelle Sophie Chrétien. Au XIXe siècle, des religieuses travaillaient comme petites mains aux côtés des médecins dans les hôpitaux. Puis, au XXe siècle, « les médecins ont voulu éduquer le petit personnel, qui est resté sous leur coupe ».
En parallèle, ce patriarcat médical a assis son rôle surplombant, en inscrivant dans le code de la santé publique le « monopole médical », en particulier sur « le diagnostic et le traitement de maladies », rappelle l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) dans un récent rapport sur les nouveaux partages de compétences entre professionnel·les de santé.
Dans d’autres pays, comme la Grande-Bretagne, les infirmières ont une relation bien plus égalitaire aux médecins : le Royal College of Nursing, qui tient à la fois de l’Ordre et du syndicat, revendique 435 000 membres (infirmières, mais aussi sages-femmes) et se présente comme le « plus grand syndicat au monde ». Florence Nightingale, pionnière britannique des infirmières à qui Arte consacre un beau documentaire, est une icône féministe dans son pays. Dans les années 1850, pendant la guerre de Crimée, elle a posé les bases des soins infirmiers modernes, en introduisant les premières notions d’hygiène dans les hôpitaux militaires. Elle a créé les premières écoles d’infirmières et offert aux femmes leur premier métier qualifié.
Une autre révolution infirmière court, depuis les années 1960, aux quatre coins du monde, en commençant par les États-Unis. Les premières infirmières de « pratique avancée » y sont apparues dans l’État rural du Colorado, en voie de désertification médicale. Des infirmières, avec le soutien de médecins, ont décidé de monter en compétences pour mieux répondre aux besoins de santé, en particulier des populations les plus précaires. La pratique avancée a ensuite gagné le Canada, puis le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Irlande, l’Allemagne, les Pays-Bas, etc.
Ailleurs, des infirmières ont des doctorats, enseignent, consultent
Dans ces pays, les infirmières de pratique avancée évoluent aujourd’hui dans l’encadrement, la recherche, l’enseignement, et dans tous les secteurs du soin, en ville comme à l’hôpital, ou dans le secteur médicosocial. Aux États-Unis, 10 % des infirmières sont des « nurses practitioners ». Elles ont au moins un master, certaines ont des doctorats en soins infirmiers, conduisent des recherches et ont apporté la preuve de l’efficacité de leur prise en charge. Une méta-analyse américaine, publiée en 2011, a montré que l’état de santé de la population suivie par des infirmières de pratique avancée « est aussi bon, voire meilleur ». En prime, elles permettent de « réduire la durée et le coût des soins des patients hospitalisés ».
En France, l’idée a fait très lentement son chemin, engluée dans l’appareil technocratique. Le premier rapport qui évoque la montée en compétences des infirmières date de 2002. Ce n’est qu’en 2016, avec la loi Santé de Marisol Touraine, que la pratique avancée infirmière entre enfin dans la loi. Mais il a fallu attendre, encore, la parution en juillet 2018 de décrets et d’arrêtés qui définissent enfin ce nouveau métier, diplômé au niveau master. Il peut s'exercer en établissement de santé, public ou privé, ainsi qu'en libéral. Au départ sont créées trois spécialités : les pathologies chroniques stabilisées, l’oncologie et la maladie rénale chronique. En 2019, s’est ajoutée une spécialité en psychiatrie et en 2021 une autre aux urgences.
Il y a aujourd’hui un peu moins de mille infirmières de pratique avancée formées en France, un chiffre qui n’est pas « à la hauteur des objectifs fixés » car elles ont été confrontées, « dès l’origine, à de fortes oppositions », constate l’Igas dans son rapport sur les nouveaux partages de compétences entre professionnel·les de santé, largement consacré aux infirmières de pratique avancée (IPA).
Ludivine Videloup et Sophie Chrétien sont parmi les premières IPA diplômées en France. La première est spécialisée dans la maladie rénale, la seconde dans les pathologies chroniques associées. Elles sont l’actuelle et l’ancienne présidente de l’Association nationale française des infirmières de pratique avancée (Anfipa).
« Je pense qu’on veut nous empêcher de travailler », dit encore Marie-Astrid Meyer, infirmière de pratique avancée en santé mentale, également membre de cette association.
Pour le Conseil international des infirmières, l’IPA a « la base de connaissance d’un expert, la capacité à prendre des décisions complexes et à démontrer des compétences adéquates ». Au minimum diplômées d’un master 2, à bac +5, elles consultent, posent des diagnostics, prescrivent, toujours dans les limites de leurs compétences. Ce qui les différencie des médecins est d’agir du côté de la prévention, auprès de la population en bonne santé – les personnes âgées, les enfants ou les femmes enceintes – ou auprès des malades, pour les aider à vivre avec leur maladie et leur éviter des complications.
Mais, en France, les représentants des médecins ont bataillé pied à pied, leur contestant la prescription de médicaments, ou encore l’usage du terme de « consultation ». Elles ne peuvent que renouveler ou adapter des traitements, et conduisent des « entretiens infirmiers ». L’Ordre des médecins est encore intervenu, au moment de l’écriture des décrets, pour leur interdire, à la dernière minute, l’accès direct aux patient·es : elles ne peuvent les voir que lorsqu’ils et elles leur sont confié·es par un médecin.
« C’est le médecin […] qui décide des patients auxquels, avec leur accord, un suivi sera proposé par un infirmier exerçant en pratique avancée », s’est positionné l’Ordre en 2017, qui disait souhaiter voir se développer ce nouveau métier « lentement mais sûrement ». En réalité beaucoup plus lentement que sûrement.
Les chausse-trapes posées par les médecins ont fonctionné : les IPA sont nombreuses à ne pas pouvoir exercer, puisqu’elles dépendent de la bonne volonté de médecins disposés à leur confier des patients.
Des infirmières plus qualifiées et moins payées
L’administration leur a mis d’autres bâtons dans les roues, en les payant au rabais. À l’hôpital, elles viennent tout juste d’obtenir une prime de 180 euros brut… mais se retrouvent souvent moins bien payées qu’une infirmière, malgré leurs deux années d’études supplémentaires, car elles perdent les nombreuses primes qui agrémentent le salaire de leurs collègues.
Et en libéral, le mode de paiement qui leur a été accordé – un forfait de 177 euros par patient·e, qu’elles doivent voir environ quatre fois par an – n’est tout simplement pas viable. « Le modèle économique ne fonctionne pas. Même avec une file active de 300 patients, on gagne moins qu’une infirmière libérale », explique Tatiana Henriot, présidente du syndicat Unipa. Elle-même, l’une des premières diplômées IPA en libéral en France, doit continuer d’exercer en libéral pour pouvoir vivre.
Elle donne quelques exemples de la pratique avancée en libéral : « Avec un patient diabétique, nous ne sommes pas là pour initier un traitement, c’est le rôle du médecin. Mais nous pouvons mettre en place de l’éducation thérapeutique : éduquer au traitement, discuter de l’hygiène de vie, de la nutrition. Nous pouvons rendre visite au patient pour évaluer ses conditions de vie. Nous pouvons renouveler et adapter le traitement, en lien avec le médecin traitant. » En pratique, l’IPA consacre au patient le temps dont ne dispose pas le médecin, et lui permet d’espacer certaines de ses consultations.
Tatiana Henriot donne un autre exemple encore, celui d’un « patient âgé atteint d’un cancer, qui sort de l’hôpital avec toute une liste de médicaments et d’examens auxquels il ne comprend rien, jeté dans la nature. L’IPA est là pour coordonner le parcours des patients, lui expliquer les traitements, les examens, mobiliser ses savoirs pour agir. Le médecin traitant ne peut pas faire tout cela pendant une consultation de 15 minutes ».
Certains médecins ne voient pas à quoi on va servir, ne comprennent pas qu’on puisse utiliser un stéthoscope.
Dans tous les pays où elles se sont implantées, les infirmières de pratique avancée sont utiles dans les zones désertées par les médecins. Il y a urgence en France : 10 % de la population n’a pas de médecin traitant, dont nombre de malades chroniques. Mais le corps médical a interdit aux IPA de s’occuper de ces patients sans médecins.
« Quand on rappelle aux médecins qu’ils ne sont pas assez nombreux, qu’ils sont surchargés, que les gens ont besoin d’être soignés, ils en conviennent. Mais quand ils sont dans leur vision syndicaliste, ils sont contre nous », tance Tatiana Henriot.
À l’hôpital, où les médecins ont l’expérience du travail en équipe, la place de l’IPA est plus évidente. Julie Devictor, qui est aussi la présidente du Conseil national professionnel des IPA, exerce la pratique avancée en oncohépatologie à l’hôpital Beaujon à Clichy (Hauts-de-Seine). Elle a été encouragée par son encadrement à se former, et elle a trouvé sa place dans son service. « J’évalue globalement la situation des malades du cancer du foie, explique-t-elle. Ils sont souvent atteints d’autres maladies, alors je m’assure qu’ils sont aussi suivis pour leur insuffisance rénale ou leur diabète et je me mets en lien avec les différents médecins qui les prennent en charge. J’évalue ce qu’ils savent de leur pathologie, s’ils sont entourés, s’ils ont un aidant. Le médecin n’a pas le temps de faire tout ce que je fais, chaque patient me prend un temps fou. J’en vois seulement cinq par jour. »
« Dans mon hôpital, les infirmières de pratique avancée sont attendues, assure-t-elle. Même si je ne suis toujours pas nommée officiellement, et que je n’ai toujours pas vu la tête de ma première fiche de paie… »
Anne-Sophie Swyndauw sera en juin l’une des trois premières IPA aux urgences. Elle est là pour éviter « que le patient reste pendant des heures et des heures sans voir personne ». Son service d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) l’attend dans ses nouvelles fonctions. Son chef l’a « positionnée sur les pathologies les plus fréquentes aux urgences : les douleurs abdominales, thoraciques, les traumatismes crâniens, les lombalgies » : « Je commencerai la prise en charge de ces patients suivant un protocole, en réalisant un premier examen médical, en prescrivant un bilan biologique, une radio, un scanner. On a le droit de prescrire ces examens, mais c’est au médecin de les lire et de poser un diagnostic. »
Le décret d’acte des IPA aux urgences n’est pas encore paru mais devrait intégrer « les sutures, les plâtres ». « Nous sommes des techniciennes, avec une grande expérience des urgences. Quand on voit comment les internes et les externes sont livrés à eux-mêmes dans la nature pour faire ces gestes… » L’infirmière voit deux types de réactions médicales : « Certains ne voient pas à quoi on va servir, ne comprennent pas qu’on ait un stéthoscope, que l’on puisse ausculter les gens. »
C’est le cas de Patrick Pelloux, président de l’Association des médecins urgences de France, qui dénonce un « démantèlement » et même une « ubérisation » de la médecine.
« Mais d’autres médecins nous soutiennent, parce qu’on a l’ancienneté, la technicité, la connaissance du service et des patients, nuance Anne-Sophie Swyndauw. Tous ceux qui ont travaillé aux États-Unis, qui ont croisé une nurse practitioner, sont convaincus. »
Au fond, « c’est gagné », estime Tatiana Henriot. « Aujourd’hui, toutes les spécialités médicales voudraient leur IPA. Mais tous ces médecins voudraient définir notre périmètre d’exercice, si possible sans nous. Ils n’ont toujours pas compris que notre vocation est d’être transversales, et non hyperspécialisées, à leur image. En France, il est grand temps qu’on interroge les expertes. »
8 mars 2022
Caroline Coq-Chodorge (Source : médiapart)
Dans de très nombreux pays, les infirmières sont montées en compétences, accédant à la « pratique avancée », un métier intermédiaire, plus autonome vis-à-vis des médecins. En France, ce mouvement est empêché par le corps médical, qui refuse de partager son monopole sur la prescription ou la consultation.
Les infirmières manquent partout, et singulièrement dans les grandes villes, où la vie est la plus chère.
Des lits ferment, l’activité des hôpitaux baisse, c’est-à-dire leur budget, le nerf de la guerre. Les augmentations de salaire consenties pendant le Ségur de la santé ne disent rien de la valeur des infirmières.
L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a fait les comptes en janvier, dans ses 39 hôpitaux d’Île-de-France : il en manque 1 400, 7,5 % des postes sont vacants. Pour parvenir à les recruter, la plus grande institution hospitalière sort le chéquier : 7 500 euros pour les étudiantes infirmières qui s’engageront à travailler 18 mois dans les hôpitaux franciliens, ou encore une prime d’installation en Île-de-France de 2 055 euros brut.
L’agence régionale de santé d’Île-de-France a fait monter les enchères : jusqu’au 28 février, elle leur a proposé des CDD au salaire mensuel de 3 085 euros brut, assorti d’une prime de 4 000 euros pour un CDD de six mois et de 7 000 euros pour un CDD de neuf mois. Résultat : 63 contrats ont été signés. Après deux années de crise Covid, le « quoi qu’il en coûte » ne fonctionne plus.
« À l’hôpital, la fuite des infirmières est manifeste, l’infirmière expérimentée n’existe quasiment plus », constate Sophie Chrétien, infirmière depuis 25 ans, une perle rare avec sa solide expérience en soins palliatifs. « Le métier s’est extrêmement réduit à la tâche, avec des cadences qui se sont accélérées », poursuit-elle.
« La richesse du métier, c’est la rencontre du patient, s’asseoir au bord de son lit, prendre le temps de l’écoute, de la réflexion. Tout cela s’est considérablement appauvri. Les cadres de santé, notre management, ne nous soutiennent plus, car ils sont à la tête d’équipes de plus en plus grandes, pris dans la gestion des plannings, complète l’infirmière Ludivine Videloup. Notre métier doit évoluer, les professionnels ont besoin de retrouver du sens. »
Se joue une lutte des pouvoirs dans un système de santé extrêmement hiérarchisé, travaillé par les questions de genre. Les infirmières sont très largement des femmes. Et que les médecins soient un peu moins fréquemment des hommes « ne change finalement rien au positionnement de chacun », dit encore l’infirmière Sophie Chrétien. « Des médecins voient toujours l’infirmière comme une tâcheronne, comme quelqu’un qui n’est pas capable de raisonner. C’est extrêmement frustrant. »
Avant les infirmières, les religieuses
« L’histoire des infirmières françaises est lourde », rappelle Sophie Chrétien. Au XIXe siècle, des religieuses travaillaient comme petites mains aux côtés des médecins dans les hôpitaux. Puis, au XXe siècle, « les médecins ont voulu éduquer le petit personnel, qui est resté sous leur coupe ».
En parallèle, ce patriarcat médical a assis son rôle surplombant, en inscrivant dans le code de la santé publique le « monopole médical », en particulier sur « le diagnostic et le traitement de maladies », rappelle l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) dans un récent rapport sur les nouveaux partages de compétences entre professionnel·les de santé.
Dans d’autres pays, comme la Grande-Bretagne, les infirmières ont une relation bien plus égalitaire aux médecins : le Royal College of Nursing, qui tient à la fois de l’Ordre et du syndicat, revendique 435 000 membres (infirmières, mais aussi sages-femmes) et se présente comme le « plus grand syndicat au monde ». Florence Nightingale, pionnière britannique des infirmières à qui Arte consacre un beau documentaire, est une icône féministe dans son pays. Dans les années 1850, pendant la guerre de Crimée, elle a posé les bases des soins infirmiers modernes, en introduisant les premières notions d’hygiène dans les hôpitaux militaires. Elle a créé les premières écoles d’infirmières et offert aux femmes leur premier métier qualifié.
Une autre révolution infirmière court, depuis les années 1960, aux quatre coins du monde, en commençant par les États-Unis. Les premières infirmières de « pratique avancée » y sont apparues dans l’État rural du Colorado, en voie de désertification médicale. Des infirmières, avec le soutien de médecins, ont décidé de monter en compétences pour mieux répondre aux besoins de santé, en particulier des populations les plus précaires. La pratique avancée a ensuite gagné le Canada, puis le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Irlande, l’Allemagne, les Pays-Bas, etc.
Ailleurs, des infirmières ont des doctorats, enseignent, consultent
Dans ces pays, les infirmières de pratique avancée évoluent aujourd’hui dans l’encadrement, la recherche, l’enseignement, et dans tous les secteurs du soin, en ville comme à l’hôpital, ou dans le secteur médicosocial. Aux États-Unis, 10 % des infirmières sont des « nurses practitioners ». Elles ont au moins un master, certaines ont des doctorats en soins infirmiers, conduisent des recherches et ont apporté la preuve de l’efficacité de leur prise en charge. Une méta-analyse américaine, publiée en 2011, a montré que l’état de santé de la population suivie par des infirmières de pratique avancée « est aussi bon, voire meilleur ». En prime, elles permettent de « réduire la durée et le coût des soins des patients hospitalisés ».
En France, l’idée a fait très lentement son chemin, engluée dans l’appareil technocratique. Le premier rapport qui évoque la montée en compétences des infirmières date de 2002. Ce n’est qu’en 2016, avec la loi Santé de Marisol Touraine, que la pratique avancée infirmière entre enfin dans la loi. Mais il a fallu attendre, encore, la parution en juillet 2018 de décrets et d’arrêtés qui définissent enfin ce nouveau métier, diplômé au niveau master. Il peut s'exercer en établissement de santé, public ou privé, ainsi qu'en libéral. Au départ sont créées trois spécialités : les pathologies chroniques stabilisées, l’oncologie et la maladie rénale chronique. En 2019, s’est ajoutée une spécialité en psychiatrie et en 2021 une autre aux urgences.
Il y a aujourd’hui un peu moins de mille infirmières de pratique avancée formées en France, un chiffre qui n’est pas « à la hauteur des objectifs fixés » car elles ont été confrontées, « dès l’origine, à de fortes oppositions », constate l’Igas dans son rapport sur les nouveaux partages de compétences entre professionnel·les de santé, largement consacré aux infirmières de pratique avancée (IPA).
Ludivine Videloup et Sophie Chrétien sont parmi les premières IPA diplômées en France. La première est spécialisée dans la maladie rénale, la seconde dans les pathologies chroniques associées. Elles sont l’actuelle et l’ancienne présidente de l’Association nationale française des infirmières de pratique avancée (Anfipa).
« Je pense qu’on veut nous empêcher de travailler », dit encore Marie-Astrid Meyer, infirmière de pratique avancée en santé mentale, également membre de cette association.
Pour le Conseil international des infirmières, l’IPA a « la base de connaissance d’un expert, la capacité à prendre des décisions complexes et à démontrer des compétences adéquates ». Au minimum diplômées d’un master 2, à bac +5, elles consultent, posent des diagnostics, prescrivent, toujours dans les limites de leurs compétences. Ce qui les différencie des médecins est d’agir du côté de la prévention, auprès de la population en bonne santé – les personnes âgées, les enfants ou les femmes enceintes – ou auprès des malades, pour les aider à vivre avec leur maladie et leur éviter des complications.
Mais, en France, les représentants des médecins ont bataillé pied à pied, leur contestant la prescription de médicaments, ou encore l’usage du terme de « consultation ». Elles ne peuvent que renouveler ou adapter des traitements, et conduisent des « entretiens infirmiers ». L’Ordre des médecins est encore intervenu, au moment de l’écriture des décrets, pour leur interdire, à la dernière minute, l’accès direct aux patient·es : elles ne peuvent les voir que lorsqu’ils et elles leur sont confié·es par un médecin.
« C’est le médecin […] qui décide des patients auxquels, avec leur accord, un suivi sera proposé par un infirmier exerçant en pratique avancée », s’est positionné l’Ordre en 2017, qui disait souhaiter voir se développer ce nouveau métier « lentement mais sûrement ». En réalité beaucoup plus lentement que sûrement.
Les chausse-trapes posées par les médecins ont fonctionné : les IPA sont nombreuses à ne pas pouvoir exercer, puisqu’elles dépendent de la bonne volonté de médecins disposés à leur confier des patients.
Des infirmières plus qualifiées et moins payées
L’administration leur a mis d’autres bâtons dans les roues, en les payant au rabais. À l’hôpital, elles viennent tout juste d’obtenir une prime de 180 euros brut… mais se retrouvent souvent moins bien payées qu’une infirmière, malgré leurs deux années d’études supplémentaires, car elles perdent les nombreuses primes qui agrémentent le salaire de leurs collègues.
Et en libéral, le mode de paiement qui leur a été accordé – un forfait de 177 euros par patient·e, qu’elles doivent voir environ quatre fois par an – n’est tout simplement pas viable. « Le modèle économique ne fonctionne pas. Même avec une file active de 300 patients, on gagne moins qu’une infirmière libérale », explique Tatiana Henriot, présidente du syndicat Unipa. Elle-même, l’une des premières diplômées IPA en libéral en France, doit continuer d’exercer en libéral pour pouvoir vivre.
Elle donne quelques exemples de la pratique avancée en libéral : « Avec un patient diabétique, nous ne sommes pas là pour initier un traitement, c’est le rôle du médecin. Mais nous pouvons mettre en place de l’éducation thérapeutique : éduquer au traitement, discuter de l’hygiène de vie, de la nutrition. Nous pouvons rendre visite au patient pour évaluer ses conditions de vie. Nous pouvons renouveler et adapter le traitement, en lien avec le médecin traitant. » En pratique, l’IPA consacre au patient le temps dont ne dispose pas le médecin, et lui permet d’espacer certaines de ses consultations.
Tatiana Henriot donne un autre exemple encore, celui d’un « patient âgé atteint d’un cancer, qui sort de l’hôpital avec toute une liste de médicaments et d’examens auxquels il ne comprend rien, jeté dans la nature. L’IPA est là pour coordonner le parcours des patients, lui expliquer les traitements, les examens, mobiliser ses savoirs pour agir. Le médecin traitant ne peut pas faire tout cela pendant une consultation de 15 minutes ».
Certains médecins ne voient pas à quoi on va servir, ne comprennent pas qu’on puisse utiliser un stéthoscope.
Dans tous les pays où elles se sont implantées, les infirmières de pratique avancée sont utiles dans les zones désertées par les médecins. Il y a urgence en France : 10 % de la population n’a pas de médecin traitant, dont nombre de malades chroniques. Mais le corps médical a interdit aux IPA de s’occuper de ces patients sans médecins.
« Quand on rappelle aux médecins qu’ils ne sont pas assez nombreux, qu’ils sont surchargés, que les gens ont besoin d’être soignés, ils en conviennent. Mais quand ils sont dans leur vision syndicaliste, ils sont contre nous », tance Tatiana Henriot.
À l’hôpital, où les médecins ont l’expérience du travail en équipe, la place de l’IPA est plus évidente. Julie Devictor, qui est aussi la présidente du Conseil national professionnel des IPA, exerce la pratique avancée en oncohépatologie à l’hôpital Beaujon à Clichy (Hauts-de-Seine). Elle a été encouragée par son encadrement à se former, et elle a trouvé sa place dans son service. « J’évalue globalement la situation des malades du cancer du foie, explique-t-elle. Ils sont souvent atteints d’autres maladies, alors je m’assure qu’ils sont aussi suivis pour leur insuffisance rénale ou leur diabète et je me mets en lien avec les différents médecins qui les prennent en charge. J’évalue ce qu’ils savent de leur pathologie, s’ils sont entourés, s’ils ont un aidant. Le médecin n’a pas le temps de faire tout ce que je fais, chaque patient me prend un temps fou. J’en vois seulement cinq par jour. »
« Dans mon hôpital, les infirmières de pratique avancée sont attendues, assure-t-elle. Même si je ne suis toujours pas nommée officiellement, et que je n’ai toujours pas vu la tête de ma première fiche de paie… »
Anne-Sophie Swyndauw sera en juin l’une des trois premières IPA aux urgences. Elle est là pour éviter « que le patient reste pendant des heures et des heures sans voir personne ». Son service d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) l’attend dans ses nouvelles fonctions. Son chef l’a « positionnée sur les pathologies les plus fréquentes aux urgences : les douleurs abdominales, thoraciques, les traumatismes crâniens, les lombalgies » : « Je commencerai la prise en charge de ces patients suivant un protocole, en réalisant un premier examen médical, en prescrivant un bilan biologique, une radio, un scanner. On a le droit de prescrire ces examens, mais c’est au médecin de les lire et de poser un diagnostic. »
Le décret d’acte des IPA aux urgences n’est pas encore paru mais devrait intégrer « les sutures, les plâtres ». « Nous sommes des techniciennes, avec une grande expérience des urgences. Quand on voit comment les internes et les externes sont livrés à eux-mêmes dans la nature pour faire ces gestes… » L’infirmière voit deux types de réactions médicales : « Certains ne voient pas à quoi on va servir, ne comprennent pas qu’on ait un stéthoscope, que l’on puisse ausculter les gens. »
C’est le cas de Patrick Pelloux, président de l’Association des médecins urgences de France, qui dénonce un « démantèlement » et même une « ubérisation » de la médecine.
« Mais d’autres médecins nous soutiennent, parce qu’on a l’ancienneté, la technicité, la connaissance du service et des patients, nuance Anne-Sophie Swyndauw. Tous ceux qui ont travaillé aux États-Unis, qui ont croisé une nurse practitioner, sont convaincus. »
Au fond, « c’est gagné », estime Tatiana Henriot. « Aujourd’hui, toutes les spécialités médicales voudraient leur IPA. Mais tous ces médecins voudraient définir notre périmètre d’exercice, si possible sans nous. Ils n’ont toujours pas compris que notre vocation est d’être transversales, et non hyperspécialisées, à leur image. En France, il est grand temps qu’on interroge les expertes. »
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2511
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
D’autres coronavirus de chauve-souris pour infecter les humains ?
Publié le 07/03/2022
Plus de deux ans après l’émergence du SARS-CoV-2 et le début de la pandémie, l’origine du virus reste inconnue. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer son apparition chez l’Homme, principalement une transmission depuis un réservoir animal. Différentes espèces ont été étudiées, et notamment de nombreuses chauves-souris du genre Rhinolophus. Plusieurs virus proches du SARS-CoV-2 ont été identifiés en Asie ces dernières années. Le virus RaTG13 isolé chez la chauve-souris Rhinolophus affinis en Chine en 2013 reste le plus proche du SARS-CoV-2, avec lequel il partage plus de 96 % de son génome.
La compréhension de la diversité des coronavirus retrouvés chez l’animal, et en particulier chez la chauve-souris, est cruciale pour identifier l’origine du SARS-CoV-2. La recherche de séquences communes au SARS-CoV-2 et aux coronavirus animaux est un premier pas vers cette identification, notamment sur la séquence de la protéine spike. Cette séquence apparaît essentielle à l’interaction entre le virus et l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ACE2), et donc à la liaison virus-cellule, et détermine les espèces susceptibles d’être infectées. Le domaine de liaison au récepteur cellulaire du virus RaTG13 de R.affinis est très différent de celui du SARS-CoV-2, avec seulement 11 acides aminés en contact avec l’ACE2 communs sur 17, et a donc une affinité très limitée pour l’ACE2 humaine. De manière similaire, le SARS-CoV-2 n’infecte que très mal les cellules de chauve-souris.
Si vous rencontrez une chauve-souris au Nord du Laos…passez votre chemin !
Les travaux d’une équipe de l’Institut Pasteur, publiés dans la revue Nature, identifient un nouveau chaînon essentiel pour déterminer l’origine du SARS-CoV-2. Ils décrivent plusieurs coronavirus de chauves-souris du Nord du Laos dont la séquence du domaine de liaison au récepteur est extrêmement proche de celle du SARS-CoV-2. Ces virus se lient avec une forte affinité à l’ACE2 humaine, et sont capables d’infecter et de se répliquer dans des cellules humaines plus efficacement que la souche d’origine de SARS-CoV-2 identifiée à Wuhan. Ces nouveaux virus, du genre Sarbecovirus, sont les ancêtres les plus proches génétiquement du SARS-CoV-2 décrits à ce jour. Les résultats soutiennent l’hypothèse d’une recombinaison de séquences préexistantes chez les chauves-souris du genre Rhinolophus d'Asie du Sud-Est et du Sud de la Chine comme à l’origine du SARS-CoV-2. Ils montrent également qu’une sélection naturelle chez l’Homme ou un hôte intermédiaire comme le pangolin n'a pas été nécessaire pour favoriser l’interaction du virus avec l’ACE2 humaine. Les personnes en contact avec les chauves-souris Rhinolophus, les populations locales et les touristes visitant les grottes, sont particulièrement à risque d’être exposées. Si les Sarbecovirus décrits pourraient avoir contribué à l’apparition du SARS-CoV-2, le lien épidémiologique entre eux et les premiers cas humains de contamination recensés reste à démontrer. Une surveillance est toutefois nécessaire pour prévenir un futur risque de transmission à l’Homme.
Dr Remi Samain
Référence
S. Temmam et coll. : Bat coronaviruses related to SARS-CoV-2 and infectious for human cells. Nature, 2022; publication avancée en ligne le 16 février. doi: 10.1038/s41586-022-04532-4.
jim.fr
_________________
Ne pas lésiner sur l’huile d’olive pour réduire la mortalité !
Publié le 07/03/2022
Il a été montré que la consommation régulière d’huile d’olive diminuait le risque cardiovasculaire (CV) ; cependant, l’influence d’un tel régime sur la mortalité de toute cause et la mortalité liée à une cause spécifique demeurait incertaine. C’est ce qui qui a poussé Guasch-Ferré et coll. à tenter de déterminer, à partir des données de 2 cohortes prospectives suivies aux États-Unis comportant des hommes et des femmes, si la consommation d’huile d’olive était ou non associée à une réduction de la mortalité totale et spécifique.
L’étude a été menée auprès des 60 582 infirmières ayant participé à la Nurses’ Health Study, (1990-2018) et des 31 801 médecins inclus dans la Health Professionals Follow-up Study (1990-2018) ; tous les participants à ces 2 études étaient indemnes de maladie CV et de cancer à l’état basal.
Le régime alimentaire suivi était apprécié, tous les 4 ans, au moyen d’un questionnaire semi-quantitatif. Les modèles de régression multivariée des risques proportionnels de Cox ont été utilisés pour estimer le hazard ratio (HR) de la mortalité totale et de la mortalité spécifique.
Lors du suivi de 28 ans, 36 856 décès sont survenus.
Remplacer la margarine, le beurre et la mayonnaise !
Comparé au HR des sujets dont la consommation d’huile d’olive était nulle ou rare, le HR des sujets qui consommaient le plus d’huile d’olive (à savoir, > 0,5 cuillérée à soupe ou > 7 g/jour) était de 0,81 (intervalle de confiance [IC] 95 % : 0,78 à 0,84).
Une consommation plus élevée d’huile d’olive s’est trouvée associée à une diminution : de 19 % du risque de décès CV (HR 0,81; IC 95 % : 0,75 à 0,87) ; de 17 % du risque de décès par cancer (HR 0,83 ; IC 95 % : 0,78 à 0,89) ; de 29 % du risque de décès par maladie neurodégénérative (HR 0,71 ; IC 95 % : 0,64 à 0,78) ; de 18 % du risque de décès par affection respiratoire (HR 0,82 ; IC 95 % : 0,72 à 0,93).
De plus, le fait de remplacer 10 g/jour de margarine, beurre, mayonnaise et produits laitiers gras par une quantité équivalente d’huile d’olive était associé à une diminution de 8 % à 34 % de la mortalité totale et spécifique.
Il n’a pas été trouvé d’associations significatives, quand l’huile d’olive était comparée à une combinaison d’autres huiles végétales.
Ainsi, si on savait que la consommation régulière d’huile d’olive diminuait le risque CV cette étude a le mérite de montrer que l’ingestion d’huile d’olive réduit aussi significativement la mortalité totale et la mortalité liée à une cause spécifique. La substitution de la margarine, du beurre, de la mayonnaise et des produits laitiers gras par de l’huile d’olive s’est trouvée associée à un risque plus faible de décès.
Dr Robert Haïat
Référence
Guasch-Ferré M et coll. : Consumption of Olive Oil and Risk of Total and Cause-Specific Mortality Among U.S. Adults. J Am Coll Cardiol., 2022 ; 79 : 101-112.
jim.fr
_______________
À partir de 41 SA, inutile d'attendre
Publié le 04/03/2022
Le risque de complications au cours de l'accouchement et en période périnatale augmente graduellement à partir de 40 semaines d'aménorrhée (SA), avec un palier net à 42 SA. En 2018, l'OMS a recommandé de déclencher l'accouchement dès 41 SA. Mais quel est le meilleur moment pour déclencher le travail à partir de 41 SA ?
Au Danemark, 24 % des grossesses atteignent 41 SA, contrairement aux États-Unis où cette proportion n'est que de 6,5 %. Les recommandations nationales danoises proposent de déclencher le travail entre 41+2 et 41+5 SA afin qu'aucune naissance n'intervienne au-delà de 42 SA.
Cette étude a comparé le risque de morbidité obstétricale et néonatale selon que la naissance survenait soit entre 41+0 et 41+3 SA, soit entre 41+4 et 42+0 SA.
L'étude s'est basée sur les données du registre national ayant inclus l'ensemble des naissances uniques sans malformation congénitale majeure qui se sont produites entre 41 et 42 semaines d’aménorrhées entre 2009 et 2018 au Danemark. Les patientes pour lesquelles une césarienne était programmée ont été exclues.
Des modèles de régression logistique ont été utilisés pour calculer l'estimation du risque relatif et du risque relatif ajusté (RRa). Les résultats ont été ajustés par rapport aux facteurs confondants (âge maternel, IMC, parité, induction du travail, année de naissance pour tenir compte de l'évolution des pratiques).
Complications obstétricales et néonatales à partir de 41 SA et 4 jours
Au total, 134 877 naissances ont été incluses, 79 160 entre 41+0 et 41+3 (Groupe précoce) et 55 717 entre 41+4 et 42+0 SA (Groupe tardif).
Une incidence plus élevée de complications obstétricales et de morbidité néonatale a été observée pour les naissances du groupe tardif.
Les complications obstétricales incluaient la césarienne en urgence (RRa = 1,17 ; intervalle de confiance à 95 % IC95 : 1,14-1,21), les lésions périnéales sévères (RRa = 1,11 ; IC95 : 1,04-1,17) et les pertes sanguines après la naissance (RRa = 1,13 ; IC95 : 1,06-1,21).
La morbidité néonatale comprenait le score d'APGAR inférieur à 7 à 5 minutes (RRa = 1,17 ; IC95 : 1,01-1,34), une aspiration de méconium (RRa = 1,25 ; IC95 : 1,06-1,48), ou une assistance respiratoire en pression positive continue (RRa = 1,09 ; IC95 : 1,03-1,15) et un indicateur composite incluant la nécessité de traitements spécifiques en néonatologie ainsi que le décès néonatal (RRa = 1,65 ; IC95 : 1,29-2,11).
Les naissances au-delà de 41+4 SA ont donc été associées à un risque augmenté de morbidité néonatale et de complications obstétricales. Voilà un argument de plus pour recommander le déclenchement du travail dès 41 SA.
Dr Charles Vangeenderhuysen
Référence
Brix Andersson C et coll. : Risk of complications in the late vs early days of the 42nd week of pregnancy: a nationwide cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand., 2022 ;101(2) : 200-211. DOI : 10.1111/aogs.14299
jim.fr
__________________
Quand des maladies évitables par la vaccination conduisent des enfants en USI
Publié le 02/03/2022
La persistance de maladies infectieuses qui auraient pu être prévenues par une vaccination est plus ou moins importante selon les pays. Au sein de l’Europe, le schéma vaccinal ne montre pas de différences majeures mais le taux de vaccination varie en fonction de la prise en charge, totale par les structures de santé pour les vaccins obligatoires, diverse parmi les états pour les vaccins simplement recommandés comme le vaccin anti-méningocoque B et antigrippal chez les enfants à risques.
73 cas en dix ans, 3,5 % des admissions en USI
Des auteurs de l’hôpital d’enfants Aghia Sophia d’Athènes ont relevé les cas des patients âgés d’un mois à 16 ans, admis en 2010-2018 avec le diagnostic de maladie évitable par vaccination (MEV). En Grèce, les vaccins obligatoires sont pris en charge mais les vaccins recommandés pour les enfants à risque ne le sont pas. Tous les vaccins administrés sont indiqués dans le carnet de santé mais il n’existe pas de registre national. Avec la crise financière et les doutes sur la sécurité des vaccins, un nombre notable de parents a décidé de retarder ou refuser les vaccinations. Pendant la période retenue, 72 patients ont été admis correspondant à 73 cas de MEV (un enfant atteint à la fois de grippe HN1 et de méningite à méningocoques Y), correspondant à 3,5 % des admissions en soins intensifs (USI). La majorité des cas était due au virus influenza (33/72, 46 %) ; 16 enfants étaient des patients atteints d’une maladie neurologique (n = , hématologique (3), pulmonaire (2), cardiaque (2), métabolique (1). Aucune des mères de nourrissons de moins de 6 mois (n = 7) n’avait été immunisée pendant la grossesse. La plupart des admissions était due à une pneumonie (14), une bronchiolite (4) mais aussi un état septique (4), une myocardite (4), une encéphalite (2) et autres complications en particulier hématologiques.
, hématologique (3), pulmonaire (2), cardiaque (2), métabolique (1). Aucune des mères de nourrissons de moins de 6 mois (n = 7) n’avait été immunisée pendant la grossesse. La plupart des admissions était due à une pneumonie (14), une bronchiolite (4) mais aussi un état septique (4), une myocardite (4), une encéphalite (2) et autres complications en particulier hématologiques.
Rougeoles, pneumonies, coqueluches…
Tous les 10 cas de rougeole ont été admis pendant l’épidémie 2017-2018 et concernaient des enfants non vaccinés (2 enfants avaient reçu une dose) ; 5 ont été intubés/ventilés. Une infection à pneumocoques a été diagnostiquée pour 12 enfants : 6 avaient une pneumonie (dont 3 avec empyème), 3 un état septique et 3 une méningite ; 7 enfants ont été intubés. Le sérotypage dans 5 cas a montré 3 types 3, un 19A, un 24F. Huit enfants avaient la coqueluche ; aucune des mères n’avait été vaccinée pendant la grossesse ; 2 enfants ont été ventilés ; l’un d’eux avait un déficit immunitaire. Enfin, 6 cas d’infection à méningocoques ont été diagnostiqués (sérotype B 5, Y 1) -aucun n’avait de risque particulier- ainsi que 3 cas d’infection à Haemophilus b ; un seul avait une comorbidité. Au total, 17 décès (24 %) ont été déplorés dont 8 chez des enfants sans comorbidité. Dans 6 cas, des complications sont survenues : cardiomyopathie (1), insuffisance respiratoire (1), handicap neurologique permanent (4). Il n’a pas été constaté de différences de létalité ni de séquelles selon le sexe, l’âge, les comorbidités, le temps d’hospitalisation.
En conclusion, les maladies infectieuses sévères évitables par la vaccination ne sont pas exceptionnelles bien que le nombre de cas par maladie soit faible.
Les cas observés à Athènes reflètent probablement la réalité en France.
Pr Jean-Jacques Baudon
Référence
Kazantzi M et coll. : Admissions due to vaccine preventable diseases in a large paediatric intensive care unit in Greece over a 10-year period. J Pediatr Child Health 2022;58:312-317
jim.fr
_________________
La France en bonne place dans le classement des meilleurs hôpitaux du monde
Publié le 07/03/2022
Depuis quatre ans, le magazine américain Newsweek propose son classement des meilleurs hôpitaux du monde. A partir d’un questionnaire adressé à plus de 80 000 experts médicaux à travers le monde et en s’appuyant également sur le retour d’expérience des patients, le magazine dresse un classement des 250 hôpitaux ayant obtenu les meilleurs scores dans plus de 27 pays d’Europe, d’Asie mais aussi d’Amérique du Nord et du Sud (aucun hôpital d’Afrique n’a été étudié dans le cadre de cette enquête).
Malgré les tensions et les discours alarmistes sur l’état du système de santé, la France figure en bonne place dans ce palmarès. Si les États-Unis sont en tête (avec 33 hôpitaux) la France est le troisième pays le plus représenté avec dix hôpitaux dans le top 150, après l’Allemagne (quatorze hôpitaux).
La Pitié Salpêtrière dans le top 10 !
Onzième dans le classement de l’année 2021, l’hôpital de la Pitié Salpêtrière figure en 2022 comme le 7ème meilleur hôpital du monde, derrière les mastodontes américains que sont la Mayo Clinic ou le Massachusetts General Hospital. La Pitié constitue même le deuxième meilleur hôpital européen après celui de la Charité à Berlin.
Comptent également dans le top 150 l’Hôpital européen Georges Pompidou (18ème), le CHU de Lille Claude-Huriez (47ème), le CHU de Bordeaux Pellegrin (73ème), l’Hôpital Saint-Joseph (90ème), l’hôpital Lyon-Sud (107eme), la Polyclinique Santé Atlantique (114ème), la Timone à Marseille (117ème), le CHU de Toulouse Purpan (124ème) et le CHU Louis Pradel de Lyon (139ème).
L’hôpital Claude-Bernard-Cochin de l’AP-HP ainsi que l’Hôpital Nord de l’AP-HM se rangent pour leur part entre la 151ème et 250ème place.
Dans son palmarès annuel des établissements publics, le magazine « Le Point » avait donné les premier prix aux CHU de Bordeaux, de Lille, de Toulouse, de Nancy et de Strasbourg, la Pitié-Salpêtrière étant classée en n°8.
Capacité d’adaptation et pénurie mondiale d’infirmiers
Au cours de l’année 2021, les hôpitaux du monde entier semblent avoir fait face aux mêmes défis. David Bates, chef de médecine interne au Boston’s Brigham and Women’s Hospital évoque notamment la nécessaire augmentation des lits de réanimation et de soins intensifs pour faire face à l’épidémie de Covid-19, ainsi que la livraison à flux tendu d’équipements de protections pour les soignants.
Le Dr Christoph Meier, directeur de médecine interne à l’hôpital de Zurich souligne également les capacités d’adaptation du personnel hospitalier avec une meilleure prise en compte de l’hygiène hospitalière.
Mais des difficultés majeures semblent toucher tous les hôpitaux : pour le Dr Gary S. Kaplan, directeur du Seattle’s Virginia Mason, la pandémie a exacerbé une pénurie de personnel soignant, notamment d’infirmières.
C.H
Jim.fr
Publié le 07/03/2022
Plus de deux ans après l’émergence du SARS-CoV-2 et le début de la pandémie, l’origine du virus reste inconnue. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer son apparition chez l’Homme, principalement une transmission depuis un réservoir animal. Différentes espèces ont été étudiées, et notamment de nombreuses chauves-souris du genre Rhinolophus. Plusieurs virus proches du SARS-CoV-2 ont été identifiés en Asie ces dernières années. Le virus RaTG13 isolé chez la chauve-souris Rhinolophus affinis en Chine en 2013 reste le plus proche du SARS-CoV-2, avec lequel il partage plus de 96 % de son génome.
La compréhension de la diversité des coronavirus retrouvés chez l’animal, et en particulier chez la chauve-souris, est cruciale pour identifier l’origine du SARS-CoV-2. La recherche de séquences communes au SARS-CoV-2 et aux coronavirus animaux est un premier pas vers cette identification, notamment sur la séquence de la protéine spike. Cette séquence apparaît essentielle à l’interaction entre le virus et l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ACE2), et donc à la liaison virus-cellule, et détermine les espèces susceptibles d’être infectées. Le domaine de liaison au récepteur cellulaire du virus RaTG13 de R.affinis est très différent de celui du SARS-CoV-2, avec seulement 11 acides aminés en contact avec l’ACE2 communs sur 17, et a donc une affinité très limitée pour l’ACE2 humaine. De manière similaire, le SARS-CoV-2 n’infecte que très mal les cellules de chauve-souris.
Si vous rencontrez une chauve-souris au Nord du Laos…passez votre chemin !
Les travaux d’une équipe de l’Institut Pasteur, publiés dans la revue Nature, identifient un nouveau chaînon essentiel pour déterminer l’origine du SARS-CoV-2. Ils décrivent plusieurs coronavirus de chauves-souris du Nord du Laos dont la séquence du domaine de liaison au récepteur est extrêmement proche de celle du SARS-CoV-2. Ces virus se lient avec une forte affinité à l’ACE2 humaine, et sont capables d’infecter et de se répliquer dans des cellules humaines plus efficacement que la souche d’origine de SARS-CoV-2 identifiée à Wuhan. Ces nouveaux virus, du genre Sarbecovirus, sont les ancêtres les plus proches génétiquement du SARS-CoV-2 décrits à ce jour. Les résultats soutiennent l’hypothèse d’une recombinaison de séquences préexistantes chez les chauves-souris du genre Rhinolophus d'Asie du Sud-Est et du Sud de la Chine comme à l’origine du SARS-CoV-2. Ils montrent également qu’une sélection naturelle chez l’Homme ou un hôte intermédiaire comme le pangolin n'a pas été nécessaire pour favoriser l’interaction du virus avec l’ACE2 humaine. Les personnes en contact avec les chauves-souris Rhinolophus, les populations locales et les touristes visitant les grottes, sont particulièrement à risque d’être exposées. Si les Sarbecovirus décrits pourraient avoir contribué à l’apparition du SARS-CoV-2, le lien épidémiologique entre eux et les premiers cas humains de contamination recensés reste à démontrer. Une surveillance est toutefois nécessaire pour prévenir un futur risque de transmission à l’Homme.
Dr Remi Samain
Référence
S. Temmam et coll. : Bat coronaviruses related to SARS-CoV-2 and infectious for human cells. Nature, 2022; publication avancée en ligne le 16 février. doi: 10.1038/s41586-022-04532-4.
jim.fr
_________________
Ne pas lésiner sur l’huile d’olive pour réduire la mortalité !
Publié le 07/03/2022
Il a été montré que la consommation régulière d’huile d’olive diminuait le risque cardiovasculaire (CV) ; cependant, l’influence d’un tel régime sur la mortalité de toute cause et la mortalité liée à une cause spécifique demeurait incertaine. C’est ce qui qui a poussé Guasch-Ferré et coll. à tenter de déterminer, à partir des données de 2 cohortes prospectives suivies aux États-Unis comportant des hommes et des femmes, si la consommation d’huile d’olive était ou non associée à une réduction de la mortalité totale et spécifique.
L’étude a été menée auprès des 60 582 infirmières ayant participé à la Nurses’ Health Study, (1990-2018) et des 31 801 médecins inclus dans la Health Professionals Follow-up Study (1990-2018) ; tous les participants à ces 2 études étaient indemnes de maladie CV et de cancer à l’état basal.
Le régime alimentaire suivi était apprécié, tous les 4 ans, au moyen d’un questionnaire semi-quantitatif. Les modèles de régression multivariée des risques proportionnels de Cox ont été utilisés pour estimer le hazard ratio (HR) de la mortalité totale et de la mortalité spécifique.
Lors du suivi de 28 ans, 36 856 décès sont survenus.
Remplacer la margarine, le beurre et la mayonnaise !
Comparé au HR des sujets dont la consommation d’huile d’olive était nulle ou rare, le HR des sujets qui consommaient le plus d’huile d’olive (à savoir, > 0,5 cuillérée à soupe ou > 7 g/jour) était de 0,81 (intervalle de confiance [IC] 95 % : 0,78 à 0,84).
Une consommation plus élevée d’huile d’olive s’est trouvée associée à une diminution : de 19 % du risque de décès CV (HR 0,81; IC 95 % : 0,75 à 0,87) ; de 17 % du risque de décès par cancer (HR 0,83 ; IC 95 % : 0,78 à 0,89) ; de 29 % du risque de décès par maladie neurodégénérative (HR 0,71 ; IC 95 % : 0,64 à 0,78) ; de 18 % du risque de décès par affection respiratoire (HR 0,82 ; IC 95 % : 0,72 à 0,93).
De plus, le fait de remplacer 10 g/jour de margarine, beurre, mayonnaise et produits laitiers gras par une quantité équivalente d’huile d’olive était associé à une diminution de 8 % à 34 % de la mortalité totale et spécifique.
Il n’a pas été trouvé d’associations significatives, quand l’huile d’olive était comparée à une combinaison d’autres huiles végétales.
Ainsi, si on savait que la consommation régulière d’huile d’olive diminuait le risque CV cette étude a le mérite de montrer que l’ingestion d’huile d’olive réduit aussi significativement la mortalité totale et la mortalité liée à une cause spécifique. La substitution de la margarine, du beurre, de la mayonnaise et des produits laitiers gras par de l’huile d’olive s’est trouvée associée à un risque plus faible de décès.
Dr Robert Haïat
Référence
Guasch-Ferré M et coll. : Consumption of Olive Oil and Risk of Total and Cause-Specific Mortality Among U.S. Adults. J Am Coll Cardiol., 2022 ; 79 : 101-112.
jim.fr
_______________
À partir de 41 SA, inutile d'attendre
Publié le 04/03/2022
Le risque de complications au cours de l'accouchement et en période périnatale augmente graduellement à partir de 40 semaines d'aménorrhée (SA), avec un palier net à 42 SA. En 2018, l'OMS a recommandé de déclencher l'accouchement dès 41 SA. Mais quel est le meilleur moment pour déclencher le travail à partir de 41 SA ?
Au Danemark, 24 % des grossesses atteignent 41 SA, contrairement aux États-Unis où cette proportion n'est que de 6,5 %. Les recommandations nationales danoises proposent de déclencher le travail entre 41+2 et 41+5 SA afin qu'aucune naissance n'intervienne au-delà de 42 SA.
Cette étude a comparé le risque de morbidité obstétricale et néonatale selon que la naissance survenait soit entre 41+0 et 41+3 SA, soit entre 41+4 et 42+0 SA.
L'étude s'est basée sur les données du registre national ayant inclus l'ensemble des naissances uniques sans malformation congénitale majeure qui se sont produites entre 41 et 42 semaines d’aménorrhées entre 2009 et 2018 au Danemark. Les patientes pour lesquelles une césarienne était programmée ont été exclues.
Des modèles de régression logistique ont été utilisés pour calculer l'estimation du risque relatif et du risque relatif ajusté (RRa). Les résultats ont été ajustés par rapport aux facteurs confondants (âge maternel, IMC, parité, induction du travail, année de naissance pour tenir compte de l'évolution des pratiques).
Complications obstétricales et néonatales à partir de 41 SA et 4 jours
Au total, 134 877 naissances ont été incluses, 79 160 entre 41+0 et 41+3 (Groupe précoce) et 55 717 entre 41+4 et 42+0 SA (Groupe tardif).
Une incidence plus élevée de complications obstétricales et de morbidité néonatale a été observée pour les naissances du groupe tardif.
Les complications obstétricales incluaient la césarienne en urgence (RRa = 1,17 ; intervalle de confiance à 95 % IC95 : 1,14-1,21), les lésions périnéales sévères (RRa = 1,11 ; IC95 : 1,04-1,17) et les pertes sanguines après la naissance (RRa = 1,13 ; IC95 : 1,06-1,21).
La morbidité néonatale comprenait le score d'APGAR inférieur à 7 à 5 minutes (RRa = 1,17 ; IC95 : 1,01-1,34), une aspiration de méconium (RRa = 1,25 ; IC95 : 1,06-1,48), ou une assistance respiratoire en pression positive continue (RRa = 1,09 ; IC95 : 1,03-1,15) et un indicateur composite incluant la nécessité de traitements spécifiques en néonatologie ainsi que le décès néonatal (RRa = 1,65 ; IC95 : 1,29-2,11).
Les naissances au-delà de 41+4 SA ont donc été associées à un risque augmenté de morbidité néonatale et de complications obstétricales. Voilà un argument de plus pour recommander le déclenchement du travail dès 41 SA.
Dr Charles Vangeenderhuysen
Référence
Brix Andersson C et coll. : Risk of complications in the late vs early days of the 42nd week of pregnancy: a nationwide cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand., 2022 ;101(2) : 200-211. DOI : 10.1111/aogs.14299
jim.fr
__________________
Quand des maladies évitables par la vaccination conduisent des enfants en USI
Publié le 02/03/2022
La persistance de maladies infectieuses qui auraient pu être prévenues par une vaccination est plus ou moins importante selon les pays. Au sein de l’Europe, le schéma vaccinal ne montre pas de différences majeures mais le taux de vaccination varie en fonction de la prise en charge, totale par les structures de santé pour les vaccins obligatoires, diverse parmi les états pour les vaccins simplement recommandés comme le vaccin anti-méningocoque B et antigrippal chez les enfants à risques.
73 cas en dix ans, 3,5 % des admissions en USI
Des auteurs de l’hôpital d’enfants Aghia Sophia d’Athènes ont relevé les cas des patients âgés d’un mois à 16 ans, admis en 2010-2018 avec le diagnostic de maladie évitable par vaccination (MEV). En Grèce, les vaccins obligatoires sont pris en charge mais les vaccins recommandés pour les enfants à risque ne le sont pas. Tous les vaccins administrés sont indiqués dans le carnet de santé mais il n’existe pas de registre national. Avec la crise financière et les doutes sur la sécurité des vaccins, un nombre notable de parents a décidé de retarder ou refuser les vaccinations. Pendant la période retenue, 72 patients ont été admis correspondant à 73 cas de MEV (un enfant atteint à la fois de grippe HN1 et de méningite à méningocoques Y), correspondant à 3,5 % des admissions en soins intensifs (USI). La majorité des cas était due au virus influenza (33/72, 46 %) ; 16 enfants étaient des patients atteints d’une maladie neurologique (n =
Rougeoles, pneumonies, coqueluches…
Tous les 10 cas de rougeole ont été admis pendant l’épidémie 2017-2018 et concernaient des enfants non vaccinés (2 enfants avaient reçu une dose) ; 5 ont été intubés/ventilés. Une infection à pneumocoques a été diagnostiquée pour 12 enfants : 6 avaient une pneumonie (dont 3 avec empyème), 3 un état septique et 3 une méningite ; 7 enfants ont été intubés. Le sérotypage dans 5 cas a montré 3 types 3, un 19A, un 24F. Huit enfants avaient la coqueluche ; aucune des mères n’avait été vaccinée pendant la grossesse ; 2 enfants ont été ventilés ; l’un d’eux avait un déficit immunitaire. Enfin, 6 cas d’infection à méningocoques ont été diagnostiqués (sérotype B 5, Y 1) -aucun n’avait de risque particulier- ainsi que 3 cas d’infection à Haemophilus b ; un seul avait une comorbidité. Au total, 17 décès (24 %) ont été déplorés dont 8 chez des enfants sans comorbidité. Dans 6 cas, des complications sont survenues : cardiomyopathie (1), insuffisance respiratoire (1), handicap neurologique permanent (4). Il n’a pas été constaté de différences de létalité ni de séquelles selon le sexe, l’âge, les comorbidités, le temps d’hospitalisation.
En conclusion, les maladies infectieuses sévères évitables par la vaccination ne sont pas exceptionnelles bien que le nombre de cas par maladie soit faible.
Les cas observés à Athènes reflètent probablement la réalité en France.
Pr Jean-Jacques Baudon
Référence
Kazantzi M et coll. : Admissions due to vaccine preventable diseases in a large paediatric intensive care unit in Greece over a 10-year period. J Pediatr Child Health 2022;58:312-317
jim.fr
_________________
La France en bonne place dans le classement des meilleurs hôpitaux du monde
Publié le 07/03/2022
Depuis quatre ans, le magazine américain Newsweek propose son classement des meilleurs hôpitaux du monde. A partir d’un questionnaire adressé à plus de 80 000 experts médicaux à travers le monde et en s’appuyant également sur le retour d’expérience des patients, le magazine dresse un classement des 250 hôpitaux ayant obtenu les meilleurs scores dans plus de 27 pays d’Europe, d’Asie mais aussi d’Amérique du Nord et du Sud (aucun hôpital d’Afrique n’a été étudié dans le cadre de cette enquête).
Malgré les tensions et les discours alarmistes sur l’état du système de santé, la France figure en bonne place dans ce palmarès. Si les États-Unis sont en tête (avec 33 hôpitaux) la France est le troisième pays le plus représenté avec dix hôpitaux dans le top 150, après l’Allemagne (quatorze hôpitaux).
La Pitié Salpêtrière dans le top 10 !
Onzième dans le classement de l’année 2021, l’hôpital de la Pitié Salpêtrière figure en 2022 comme le 7ème meilleur hôpital du monde, derrière les mastodontes américains que sont la Mayo Clinic ou le Massachusetts General Hospital. La Pitié constitue même le deuxième meilleur hôpital européen après celui de la Charité à Berlin.
Comptent également dans le top 150 l’Hôpital européen Georges Pompidou (18ème), le CHU de Lille Claude-Huriez (47ème), le CHU de Bordeaux Pellegrin (73ème), l’Hôpital Saint-Joseph (90ème), l’hôpital Lyon-Sud (107eme), la Polyclinique Santé Atlantique (114ème), la Timone à Marseille (117ème), le CHU de Toulouse Purpan (124ème) et le CHU Louis Pradel de Lyon (139ème).
L’hôpital Claude-Bernard-Cochin de l’AP-HP ainsi que l’Hôpital Nord de l’AP-HM se rangent pour leur part entre la 151ème et 250ème place.
Dans son palmarès annuel des établissements publics, le magazine « Le Point » avait donné les premier prix aux CHU de Bordeaux, de Lille, de Toulouse, de Nancy et de Strasbourg, la Pitié-Salpêtrière étant classée en n°8.
Capacité d’adaptation et pénurie mondiale d’infirmiers
Au cours de l’année 2021, les hôpitaux du monde entier semblent avoir fait face aux mêmes défis. David Bates, chef de médecine interne au Boston’s Brigham and Women’s Hospital évoque notamment la nécessaire augmentation des lits de réanimation et de soins intensifs pour faire face à l’épidémie de Covid-19, ainsi que la livraison à flux tendu d’équipements de protections pour les soignants.
Le Dr Christoph Meier, directeur de médecine interne à l’hôpital de Zurich souligne également les capacités d’adaptation du personnel hospitalier avec une meilleure prise en compte de l’hygiène hospitalière.
Mais des difficultés majeures semblent toucher tous les hôpitaux : pour le Dr Gary S. Kaplan, directeur du Seattle’s Virginia Mason, la pandémie a exacerbé une pénurie de personnel soignant, notamment d’infirmières.
C.H
Jim.fr
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2511
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
L'hôpital meurt littéralement de ces nouveaux directeurs et directrices adjoints à tel ou tel poste, qui ne connaissent strictement rien à l'hôpital, qui se permettent de dire aux médecins et aux soignants, comment soigner mieux. Tout en sachant que ces deux dernières catégories professionnelles, voient en une seule journée plus de patients que n'en voient les premiers en une année.
Publié le 18/03/2022
Hôpital public : la bureaucratie m’a tué
- « Les Bureaux se hâtèrent de se rendre indispensables en se substituant à l’action vivante par l’action écrite, et ils créèrent une puissance d’inertie appelée le Rapport. (…) La France allait se ruiner malgré de si beaux rapports, et disserter au lieu d’agir. Il se faisait en France un million de rapports écrits par année ; aussi la bureaucratie régnait-elle ! ». Mais quel écrivain décrit si bien notre monde ? Un auteur contemporain ? Que nenni. Ces phrases sont celles de Balzac dans Les Employés ou la femme supérieure, paru en 1838.
Au rapport !
L’extrait a été cité il y a quelques semaines par le psychiatre Bernard Granger dans une tribune publiée dans l’Obs, qui évoque la façon dont la bureaucratie a peu à peu gangréné l’hôpital public, réduisant ses forces vives à l’inertie la plus pataude. Comme il le signale à la fin de son long texte, les armes face à l’envahisseur ne sont guère nombreuses, mais l’humour ne manque probablement pas d’atout. Il l’illustre d’ailleurs au fil de son texte qui débute ainsi : « L’hôpital public est un terrain d’observation privilégié du phénomène bureaucratique. L’opium des directions hospitalières actuelles est « le projet ». Quand un directeur ne sait plus quoi vous répondre et cherche à se débarrasser de vous, il ordonne : « Écrivez-moi un projet ! » Tout est projet : projet médical, projet managérial, projet social, projet de soins, projet d’établissement, projet financier, projet de pôle, projet de département, projet de service, projet de chefferie de service, projet pédagogique, projet des représentants des usagers, etc. Aucun projet ne se réalise comme prévu, car c’est une littérature fictionnelle qui donne l’impression d’avoir été rédigée sous l’emprise de stupéfiants. Et que dire de ces rapports annuels d’activité, enquêtes administratives, rapports d’étapes, feuilles de route, plans stratégiques, boîtes à outils, états prévisionnels, plans locaux de santé, plans globaux de financement pluriannuels, stratégie nationale de santé, pilotage de la transformation (là où il faudrait plutôt une transformation du pilotage), retours d’expérience (RETEX, dans ce verbiage bourré de sigles et d’acronymes dont plus personne ne finit par connaître la signification) ? Qui s’intéresse à ces fadaises ? Qui lit ces documents destinés à une étagère empoussiérée puis à la déchèterie ? ».
La valorisation de l’inaction
La charge ne se contente pas d’être comique : elle est une analyse de la façon dont la bureaucratie mine le fonctionnement de l’hôpital public. D’abord, parce qu’elle rend impossible toute maîtrise du temps. « La plus belle réussite de la bureaucratie, qui fait un tort considérable au monde hospitalier, est sans doute son aptitude à dilater le temps et à diluer les responsabilités. Ce qui dans la vraie vie prend une heure, prend dans la vie bureaucratique un trimestre, un semestre, une année », écrit Bernard Granger. D’autres l’ont observé, notamment à la faveur de la crise épidémique, qui de façon immédiate a réussi à faire sauter toutes les étapes de décision et de validation et de sur-validation qui semblaient auparavant indépassables. Un collectif de médecins écrivait ainsi au printemps 2020 dans le Figaro : « Cette crise a permis une réduction drastique des procédures administratives et une accélération des délais de réponse de la part de bureaux ou commissions d’ordinaire relancés des mois durant avant l’obtention d’un avis ou d’une décision. La suradministration doit s’effacer devant les principes de subsidiarité et de responsabilité des chefs de service et des représentants médicaux. On a pu sortir de cet enfer paperassier, il ne faudrait pas y retomber ».
Las, il semble que leur appel n’ait pas été entendu et que les mauvaises habitudes soient vite revenues hanter les couloirs des hôpitaux. De nouveau, le temps du remplissage de tableaux grignote celui qui devrait être consacré aux patients, l’inaction devenant plus valorisée que l’action.
Quand l’indicateur devient l’objectif
L’autre conséquence délétère de ce règne de la bureaucratie est la place donnée aux indicateurs, bientôt transformés en « objectifs ». « L’indicateur sature la langue managériale. On entend souvent politiques ou hauts fonctionnaires prononcer cette phrase appliquée à tous les domaines : « Il faudrait quelques indicateurs bien choisis, en petit nombre. » Derrière une apparence de bon sens, cette proposition de retenir quelques indicateurs « bien choisis » (on ne dit pas comment) cache une erreur conceptuelle désormais bien démontrée. La loi de Goodhart devrait pourtant être connue de nos élites : lorsqu’une mesure devient un objectif, elle cesse d’être une bonne mesure. Un indicateur manipulable transformé en objectif a immédiatement des effets pervers. Les exemples d’indicateurs pervertis ne manquent pas. Ce sont les flacons d’antiseptiques versés dans le lavabo dès que leur consommation a servi à évaluer le suivi des règles d’asepsie, ou le refus des malades difficiles par les chirurgiens cardiaques américains quand le taux de mortalité chez leurs opérés devait servir à les classer (indicateur rapidement abandonné) », énumère Bernard Granger. Si certains feront remarquer qu’une telle critique ne devrait pas conduire à renoncer à l’évaluation des performances (longtemps honnie dans l’univers hospitalier mais qui constitue pourtant un élément participant à l’amélioration de la qualité des soins), l’idée que ce diktat des « indicateurs » s’est substituée de façon délétère à une vision raisonnée et médicale de ce qu’est l’activité hospitalière est partagée par beaucoup. Ainsi, le point ultime de cette logique semble être la tarification à l’activité. « Qu’on en finisse avec cette politique de rentabilité des séjours, utiles ou non, du moment qu’ils «rapportent»! » écrivaient ainsi il y a deux ans les auteurs d’une tribune publiée dans le Figaro.
Quand l’ONDAM tue la T2A
Pire, la tarification à l’activité (T2A) pourrait elle-même être la victime d’une logique bureaucratique, c’est-à-dire d’une logique éloignée des réalités concrètes. C’est ce qu’expliquent les économistes de la santé Florence Jusot, Clémence Thébaut et Jérôme Wittwer dans Le Monde, qui remarquent que les effets pervers de la T2A sont notamment liés à la façon dont les tarifs sont fixés en France : « Si la T2A a mis en difficulté financière les établissements de santé, c’est parce qu’en France le tarif des séjours n’est pas équivalent à leur coût de production évalué par l’ATIH. En effet, il a été choisi d’ajuster les tarifs des séjours pour respecter les objectifs nationaux de dépenses d’assurance-maladie (Ondam), votés annuellement par le Parlement. (…) Dans les années qui ont suivi la mise en place de la T2A, l’Ondam était compris entre 4 % et 6 %. A partir de 2008, l’Ondam a baissé chaque année pour atteindre 1,75 % en 2016. Jusqu’en 2016, la dépense de soins hospitaliers était tirée vers le haut par les volumes dont l’augmentation annuelle était supérieure à celle de l’Ondam (environ 2 %). Pendant ce temps, les tarifs stagnaient, voire baissaient, ce qui est particulièrement remarquable dans un contexte où l’innovation technologique était constante et conduisait structurellement à une augmentation du coût de la prise en charge des patients. L’augmentation des volumes de soins hospitaliers sur cette période résulte en premier lieu du vieillissement de la population qui a augmenté ses besoins en soins. Elle résulte également des incitations adressées par les directions hospitalières à l’attention de leurs équipes. Les directions les ont incitées à augmenter les nombres de séjours pour compenser la baisse des tarifs, ce qui, à terme, était contreproductif, puisque cette augmentation des volumes a conduit à diminuer encore les tarifs des séjours. L’Ondam est une enveloppe fermée, plus le nombre de séjours augmente, plus les tarifs de ces séjours diminuent », décrivent-ils.
Vous souffrez des rapports ? Vite un rapport sur la souffrance !
Non contente d’entraîner une sclérose du système, la bureaucratie paraît également contaminer les réponses préconisées pour lutter contre ses méfaits. La lutte contre les souffrances psychosociales dans le monde hospitalier a ainsi été régulièrement mise sur le devant de la scène ces dernières. Cependant, ces actions sont-elles aussi mues par les mêmes mécaniques que celles qui sont (entre autres) à l’origine de la « souffrance des soignants », en se basant sur des indicateurs, des rapports et autres réunions de commissions. Bernard Granger citant le psychologue du travail Yves Clot remarque : « Il considère que proposer de « réparer » les conséquences psychiques des organisations de travail défaillantes par la « gestion » des risques psychosociaux est une aberration supplémentaire : « Pour tout dire, je ne crois pas que ceux qui travaillent dans ce pays soient des sinistrés à secourir. La victimologie ambiante, quand elle devient une gestion de la plainte “par en haut”, n’est souvent qu’un faux pas qui accroît, par un choc en retour, la passivité des opérateurs. […] Le monde du travail qui vient est un hybride social : une sorte de néofordisme se met en place, monté sur coussin compassionnel. La pression productiviste se dote d’amortisseurs psychologiques ». Ainsi, plutôt que de supprimer ce qui fait souffrir, on préconise d’accompagner la souffrance…
La thérapie par la rustine
Et comment ne pas penser qu’une des solutions récemment proposée par l’Agence régionale de Santé (ARS) d’Ile de France pour répondre à la pénurie d’effectifs infirmiers dans les hôpitaux franciliens n’est pas elle aussi le résultat d’une logique bureaucratique, qui refuse de prendre en compte ses propres dysfonctionnements et qui préfère la thérapie par la rustine. « Le dispositif proposé par l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, le 17 janvier, a achevé d’écœurer le personnel des hôpitaux publics de la région. Les infirmières travaillant en intérim se sont vu proposer des contrats à durée déterminée de six à neuf mois non renouvelables pour des salaires 30 % supérieurs à ceux des infirmières titulaires. S’il fallait persuader les infirmières restantes que leur engagement n’était pas reconnu, l’opération était parfaite. Pourquoi opter pour une fidélité sans valorisation salariale et avec des conditions de travail qui, chaque année, se détériorent ? (…) Pour éviter le crash complet, peut-on envisager que les thuriféraires de l’efficience entendent ce que les personnels non médicaux demandent ? » écrit en réponse à cette innovation de l’ARS un collectif de soignants dans le Monde.
Et s’il était trop tard ?
Pour certains, il pourrait être trop tard : la bureaucratie étant devenue un monstre autonome que ses « maîtres » ne parviennent plus à contrôler. Dans Libération, le consultant en santé Alexis Dussol écrit : « L’empilement des réformes et l’inflation des normes en tous genres ont transformé l’hôpital en monstre bureaucratique. Il n’est qu’à parcourir les quelque 300 pages du manuel de certification de la HAS pour s’en faire une idée. Les gouvernants ne savent plus trop comment s’y prendre pour le réformer ».
Les bureaucrates : des boucs émissaires faciles ?
Cependant, d’aucuns mettent en garde contre une critique facile de cette fameuse « bureaucratie » qui cacherait des desseins peu avouables pour l’hôpital public. Ainsi, dans Libération, le patron de la Fédération hospitalière de France (FHF), Frédéric Valletoux s’indigne des exagérations qu’il entend dans les discours de nombreux candidats à l’élection présidentielle : « Qu’a-t-on entendu ces derniers jours ? Que les hôpitaux publics seraient peuplés à 30 % de bureaucrates. Ah, la vieille rengaine… La crise n’est pas encore finie, et les décès se poursuivent, mais déjà ceux qui rêvent de livrer notre bouclier sanitaire aux mains du marché se réveillent. L’hôpital public a pris en charge plus de 80 % des patients Covid hospitalisés, a organisé des transferts sanitaires interrégionaux au plus fort de la crise, a dépêché des soignants en outre-mer (et il le fait encore aujourd’hui), a réorganisé tous ses services pour être capable de faire face à la saturation des réanimations, mais non, notre hôpital ne serait ni agile, ni réactif, ni admirable : il serait «bureaucratique». Je le redis donc avec force, les emplois administratifs à l’hôpital représentent 10 % des effectifs, pas 20 %, pas 30 %, pas 40 % : 10 %. Ce chiffre est pourtant en accès libre sur le site des statistiques du ministère de la Santé. Comme celui de 14 % d’emplois administratifs constatés dans les cliniques privées. Mais, trop soucieux d’attaquer nos hospitaliers pour respecter la vérité des faits, les habitués de l’hôpital-bashing se plaisent à intégrer la catégorie des secrétaires médicales à leurs calculs. Elles seront sans doute ravies d’apprendre qu’elles ne sont que des bureaucrates. Et une fois qu’on aura supprimé leurs postes pour débureaucratiser l’hôpital, les soignants seront ravis d’apprendre qu’ils doivent accueillir le public, gérer l’attente des patients aux urgences, organiser les agendas de tout leur service, ainsi que le suivi du dossier de leurs patients, etc ».
Difficile cependant de croire que dans les critiques formulées par Bernard Granger et beaucoup d’autres, ce sont les « secrétaires » qui soient visées, comme feint de l’assurer Frédéric Valletoux. C’est bien plus certainement le carcan des visions préformatées, du management par les seuls chiffres, symbolisés par l’hégémonie du « tableau Excel » qui sont dénoncés.
Des desseins peu avouables
Mais on retrouve également cette idée que la lutte affichée contre la bureaucratie ne pourrait être qu’un leurre sous la plume du professeur André Grimaldi. S’attaquant aux solutions proposées pour « sauver » l’hôpital public par deux anciens responsables de la FHF, il écrit ainsi dans le Journal du Dimanche : « Dans une tribune au journal Le Monde, Guy Collet et Gérard Vincent, deux anciens directeurs des hôpitaux et responsables de la Fédération hospitalière de France (FHF) prétendent sauver l’hôpital public grâce à trois mesures :1 : “confier aux régions la tutelle et la régulation du système de santé, les conseils régionaux devenant responsables des équilibres financiers” ; 2 : “inclure dans un service public de santé régional, l’ensemble des acteurs de santé, y compris les cliniques commerciales” ; 3 : “changer radicalement le statut de l’hôpital public en lui donnant celui de fondation”, c’est-à-dire, pour parler clair, d’une personne morale de droit privé à but non lucratif. Autrement dit pour défendre l’hôpital public auquel, ils déclarent “être viscéralement attachés”, ils proposent de le privatiser. (…) Au fond ils proposent d’appliquer à la santé au nom de la lutte contre la bureaucratie, le principe néolibéral : moins d’Etat, plus de marché » s’indigne André Grimaldi… Si on retrouve ici les combats de toujours du professeur de diabétologie, il est probable que les organisations managériales du privé n’ont probablement rien à envier à l’hôpital public en ce qui concerne les aberrations bureaucratiques et l’investissement disproportionné dans l’activité de reporting.
Ainsi, on le voit si la description des affres et des conséquences de la folie administrative sont aisées, il est plus difficile d’apprécier dans quelle mesure il pourrait être possible de se défaire de ce piège. Quelques pistes émergeront peut-être à la lecture de :
Bernard Granger : « Excel m’a tué » : comment la bureaucratie a asphyxié notre système hospitalier, https://www.nouvelobs.com/sante/2022012 ... alier.html#
Collectif de médecins, https://www.lefigaro.fr/vox/societe/lib ... e-20200503
Florence Jusot, Clémence Thébaut, Jérôme Wittwer
https://www.lemonde.fr/idees/article/20 ... _3232.html
Collectif de soignants : https://www.lemonde.fr/idees/article/20 ... _3232.html
Alexis Dussol : https://www.liberation.fr/idees-et-deba ... directed=1
Frédéric Valletoux :
https://www.liberation.fr/idees-et-deba ... 7NN3CMPHY/
André Grimaldi
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-la ... ic-4096114
Aurélie Haroche
jim.fr
_____________
Publié le 18/03/2022
Affaire Levothyrox : confirmation de la condamnation du laboratoire pour défaut d’information
Paris, le samedi 19 mars 2022 - C’est la fin du premier volet civil de l’affaire du Levothyrox. En 2017, le laboratoire Merck mettait sur le marché une nouvelle formule d’un médicament ancien traitant l’hypothyroïdie et nécessitant un dosage très fin (le Lévothyrox). L'un des excipients, le lactose monohydraté, avait été alors remplacé par du mannitol et de l'acide citrique.
Après avoir pris cette nouvelle formule du médicament, de très nombreux patients se sont plaints d'effets secondaires. Le débat public a été alors secoué par une « tempête parfaite » avec une controverse scientifique sur le lien de causalité entre la nouvelle formule et les troubles déclarés. Cependant en décembre 2018, l’ANSM a établi que la nouvelle formule du Levothyrox n’avait pas provoqué d’augmentation des problèmes sanitaires.
Sur le terrain judiciaire, la controverse s’inscrit dans un cadre bien différente. En juin 2020, la Cour d’Appel de Lyon faisait droit à la demande de plus de 3300 plaignants en reconnaissant l’existence d’une faute commise par le laboratoire Merck en raison du défaut (plus difficilement démontrable et contestable) d’information des patients sur les changements du produit. C’est dans ce contexte qu’un pourvoi a été formé par le laboratoire devant la Cour de cassation.
Au-delà de toute controverse scientifique, un défaut d’information
La plus haute juridiction civile devait répondre à deux questions majeures soulevées par les défendeurs.
Dans un premier temps, la société Merck soulevait que, conformément à la législation et au code de santé publique, les laboratoires avaient fait apparaitre dans le cadre de la notice et de l’étiquetage les nouveaux excipients. A partir de là, il ne serait pas possible de reprocher au fabricant et à l’exploitant un défaut d’information.
Mais pour la Cour de Cassation, si la notice répond aux exigences réglementaires (en ce qu'elle donne la nouvelle composition du médicament), la seule mention du mannitol et de l’acide citrique, dans un texte dense « et imprimé en petits caractères », est insuffisante pour faire état d’une évolution de la formule.
Un préjudice moral « temporaire »
Autre critique formulé à l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon, le fabriquant reprochait aux juges du fond d’avoir fait droit à la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral alors même que le lien entre la nouvelle formule et les effets secondaires ressentis n’était pas établi.
Or, reprenant l’idée d’autonomie du préjudice d’information, la Cour de cassation rejette également le pourvoi sur ce point. Les juges de la Haute juridiction ont considéré qu’à partir du moment où les patients n’ont pas été informés de l’évolution de la composition des médicaments, ces derniers ont perdu une chance de se tourner vers des professionnels de santé « pour faire face à ces troubles ».
La Cour précise toutefois qu’il s’agit d’un préjudice moral « temporaire » qui perdure « jusqu’à ce qu’ils aient été informés de cette modification ».
Quoi qu’il en soit la condamnation du fabricant et de l’exploitant est donc confirmée.
En fixant un préjudice moral « temporaire », les fabricants et exploitants pourraient donc être invités à l’avenir à communiquer le plus rapidement possible afin de limiter les risques en termes d’indemnisation.
Si cette procédure d'ampleur est désormais close, le dossier du Levothyrox fait l'objet au pénal d'une information judiciaire contre X pour des faits présumés de tromperie aggravée, homicide et blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui.
Charles Haroche
jim.fr
___________________
Publié le 18/03/2022
Des scientifiques qui fourmillent d’idées
Si l’on sait que le chien peut être dressé pour détecter les cancers, un animal bien plus petit ferait mieux que lui dans ce domaine.
« Développer une technique non invasive, efficace et peu chère pour détecter les cancers à un stade précoce est un défi majeur pour la santé publique » écrivent les chercheurs français issus du CNRS, de l’Inserm et l’Institut Curie à l’origine d’une étude sur la détection du cancer publiée le 21 février dernier dans la revue « iScience ». Depuis plusieurs années, les scientifiques étudient la possibilité de dépister le cancer via les composés organiques volatils (COV), ces odeurs émises par les cellules qui sont différentes selon que ces dernières sont saines ou cancéreuses. Il a notamment été démontré que les chiens, qui sont connus pour leur odorat exceptionnel (10 000 à 20 000 fois plus sensible que celui de l’homme), peuvent parvenir à détecter des cancers par leur odeur. Selon l’étude Kdog de l’Institut Curie de 2017, un chien peut atteindre un taux d’efficacité de 90 % dans le dépistage.
La fourmi bien meilleure élève que le chien
Cependant, l’entrainement d’un chien est long (entre 6 et 12 mois) et couteux, « plusieurs dizaines de milliers d’euros par chien » selon Baptiste Piqueret, principal auteur de l’étude qui nous intéresse. Lui et son équipe se sont donc intéressés aux capacités de détection d’un autre animal à l’odorat puissant : la fourmi. En effet, dans la nature, cet insecte utilise son odorat pour s’orienter et pour communiquer avec ses congénères. L’odeur est donc au centre de l’organisation sociale des fourmis.
Grâce à un protocole dit « d’apprentissage associatif » basé sur un système de récompense, les chercheurs ont pu apprendre aux fourmis à détecter les odeurs émises par les cellules cancéreuses. « Un protocole très simple qui ne nécessite pas de matériel onéreux » explique Baptiste Piqueret, qui raconte avoir réalisé ces expériences chez lui pendant le premier confinement de 2020. Au final, les insectes se révèlent être des élèves bien plus brillants que les chiens. En seulement trois sessions d’apprentissage de moins d’une heure, une fourmi est capable de distinguer cellules cancéreuses et cellules saines. Les insectes parviennent même à distinguer entre deux sous-types de cancer du sein.
Demain les chiens ou la Révolution des fourmis ?
Que ceux qui ont peur des insectes se rassurent : il est peu probable qu’un cancérologue vous prescrive un jour de vous recouvrir le corps de fourmis. « On va utiliser par exemple de l’urine, de la salive ou de la sueur d’une personne qui a potentiellement le cancer, il n’y aura pas de contact direct entre nos fourmis et les patients » explique Baptiste Piqueret. Le chercheur espère par ailleurs que l’incroyable odorat des fourmis pourra être utilisé à d’autres fins, comme la détection d’explosif ou de stupéfiants. Il reste cependant à réaliser des « tests cliniques sur un organisme humain complet » avant de pouvoir confirmer l’efficacité de cette méthode, précise le CNRS dans un communiqué. Des expériences préliminaires menés avec de l’urine de souris atteinte d’un cancer sont actuellement en cours.
Dans cette rivalité avec les fourmis, les chiens n’ont cependant pas encore dit leur dernier mot. L’Institut Curie mène depuis 2020 une étude clinique, qui doit s’achever en 2023, pour mieux mesurer la capacité de dépistage de nos amis à quatre pattes.
Rappelons par ailleurs que, jusqu’à preuve du contraire, les fourmis ne rapportent pas la balle qu’on leur lance et ne peuvent pas retrouver des personnes ensevelies sous une avalanche.
Le chien restera donc, quoi qu’il arrive, le meilleur ami de l’homme.
Nicolas Barbet
jim.fr
__________________
Publié le 18/03/2022
Cannabis « thérapeutique » : une expérimentation hors des clous ?
L’expérimentation du cannabis « thérapeutique » a débuté en France chez l’homme en 2021 après validation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire du médicament (ANSM) et doit durer 2 ans. Au total, 3000 patients doivent y participer et elle vise à établir les bénéfices thérapeutiques éventuels du cannabis dans six indications différentes : les douleurs neuropathiques réfractaires, l’épilepsie pharmaco résistante, les spasticités douloureuses de la sclérose en plaque, les symptômes neuropathiques réfractaires, les soins palliatifs et les spasticités douloureuses hors sclérose en plaque.
Un essai ouvert sans groupe contrôle
Les Académie de médecine et de pharmacie s’étaient déjà montrées très réservées. Dans un premier avis en 2010, l’Académie de médecine avait jugé une telle expérimentation dangereuse arguant que « les effets pharmacologiques sont d'une intensité modeste alors que les effets secondaires sont nombreux et très souvent adverses ». En 2019, l’Académie de pharmacie avait qualifié l’expression « cannabis thérapeutique » d’ « abus de langage ». Elle écrivait aussi : « mélange végétal composé de 200 principes actifs différents, variables en quantités et en proportions en fonction des modalités de culture, de récolte, de conservation, n’étant ni dosé ni contrôlé, le cannabis dit thérapeutique ne peut apporter les garanties d’un médicament ».
Dans un communiqué publié en début de semaine, les Académies nationales de médecine et de pharmacie estiment désormais que les travaux menés actuellement dérogent « aux exigences méthodologiques, sécuritaires et éthiques qui régissent l’évaluation de tout candidat médicament ».
Ainsi, l’essai n’est pas randomisé (il s’agit d’une étude ouverte sans groupe contrôle), seule méthode pour les Académies susceptible d’évaluer convenablement un produit de santé. « Une autre anomalie est liée au fait que l’expérimentation ne concerne pas des substances pures, mais des produits à base de fleurs séchées de cannabis et d’extraits aux composants multiples » soulignent les sages.
Une meta-analyse peu engageante…
De plus, une méta-analyse portant sur 32 essais cliniques randomisés et plus de 5000 patients atteints de douleurs chroniques non cancéreuses publiée l’an dernier dans le BMJ, concluait qu’il n’a été trouvé, avec des niveaux de preuve modérés à élevés, qu’une augmentation jugée « faible à très faible » de la proportion de patients bénéficiant d’une amélioration importante de leur douleur, de leur état physique et de la qualité de leur sommeil. « Quant aux effets indésirables, ils étaient soit transitoires, soit majorés au-delà de trois mois de traitement » détaillent les Académies.
« Cette méta-analyse ne fait que confirmer les données rapportées de façon récurrente dans des analyses internationales portant sur le traitement des douleurs neuropathiques, qui concluaient à la très faible efficacité des cannabinoïdes vis-à-vis des douleurs chroniques » soulignent-elles encore.
Cannabis thérapeutique, hydroxychloroquine : même combat ?
Les Académies s’étonnent également qu’un tel essai ait été rendu possible dans le contexte actuel.
Elles rappellent ainsi deux prises de positions fortes, des Académies (des sciences, de médecine et de pharmacie) d’une part et du CNRS d’autre part alors que « l’affaire » de l’hydroxychloroquine dans la Covid battait son plein.
Dans ces communiqués, les trois Académies estimaient qu’en « période de pandémie aussi bien qu’en situation ordinaire, les règles de l’évaluation critique des méthodes et des résultats doivent s’appliquer. Il en est de même de la déontologie scientifique et médicale, du respect de l’intégrité scientifique et de l’éthique de la communication des résultats ».
Une position qui rejoignait un avis publié par le CNRS : « On ne peut que s’inquiéter que le choix d’un traitement puisse être décidé par l’opinion publique sur la base d’une pétition ou d’un sondage et que des décisions politiques puissent être prises en se fondant sur des croyances ou des arguments irrationnels, faisant uniquement appel à la peur ou l’émotion ». Pour les Académies l’expérimentation rentre dans ce cadre : un essai soutenu par l’opinion publique sur la base de croyances…Ceux, pharmacologues, algologues et psychiatres qui soutiennent ces travaux apprécieront…
Dans ce contexte, les Académies estiment indispensables que les autorités réglementaires puissent, le moment venu, analyser « en toute indépendance scientifique » les données de l’essai afin de pouvoir déterminer la balance bénéfices/risques ainsi que le service médical rendu et « qu’en cas de mise à disposition du cannabis à des fins thérapeutiques, que le suivi des effets indésirables et des cas d’abus et/ou de détournement d’usage soit assuré, comme il est de règle, par les Centres Régionaux de Pharmacovigilance et Centres d’Évaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance-Addictovigilance ».
F.H.
jim.fr
_______________________
Covid : fin du masque obligatoire et suspension du passe vaccinal malgré la sixième vague
Publié le 14 mars 2022
Quasiment deux ans jour pour jour après la mise en place d’un confinement, totalement inédit dans la France moderne, impliquant l’arrêt d’un grand nombre d’activités et la fermeture des écoles, il n’est pas inutile de s’interroger sur ce que le gouvernement aura appris concernant la gestion de l’épidémie de Covid. A la lueur de l’évènement du jour, soit la fin de l’obligation du port du masque dans la plupart des lieux intérieurs (sauf les transports en commun et les établissements de santé) et la suspension (qui n’est pas l’annulation) du passe vaccinal, la réponse pourrait être empreinte de fatalisme. En effet, de la même manière qu’en décembre 2020, il n’avait finalement pas respecté les seuils qu’il s’était fixé pour lever les mesures alors en vigueur, aujourd’hui, masque et passe disparaissent alors que les seuils indiqués par Olivier Véran pour ce faire il y a quelques jours n’ont pas été atteints.
Incidence en hausse
Ainsi, le ministre de la Santé avait considéré que ces dispositifs pourraient disparaître si le seuil d’incidence était inférieur à 500 : il atteint aujourd’hui 629 cas pour 100 000. Il a en effet progressé dans toutes les tranches d’âge au cours de la semaine dernière, de 4 % chez les 90 ans et plus à 22 % chez les 20/29 ans. Il est le plus élevé en Bretagne, ce qui est constitue un phénomène inédit depuis le début de l’épidémie. Le ministre de la Santé avait par ailleurs fixé à 1500 le nombre de patients atteints de Covid en soins critiques (incluant les personnes hospitalisées en raison de la Covid et celles admises pour une autre raison mais infectées par SARS-CoV-2). Ce nombre était hier de 1855. En outre, la poursuite de la décrue que l’on constate à l’hôpital pourrait être liée au décalage qui existe toujours entre la hausse du nombre de contaminations et les admissions dans les établissements de santé : d’ailleurs le nombre d’admissions quotidiennes en soins classiques stagne désormais.
Sixième vague
D’une manière générale, dans plusieurs pays d’Europe de l’Ouest, une « sixième vague » est constatée sans nuance. Le nombre de cas positifs a ainsi progressé de 33 % en Grande-Bretagne, de 16 % en Allemagne ou encore de 17 % en Italie entre le 6 et le 10 mars (+ 11 % en France).
Les causes de cette nouvelle vague semblent multiples. L’abandon dans de nombreux pays des mesures dites « barrière » est mis en avant. Cependant, la temporalité de ce relâchement n’a pas été le même partout en Europe, ce qui limite un peu la portée de cette piste. Plus simplement, et comme toujours, la circulation d’un nouveau variant (BA2), dont la transmission n’est que peu évitée par la vaccination, apparaît principalement responsable de cette nouvelle vague.
Une communication éternellement ratée
Dès lors, faut-il considérer que le gouvernement aurait dû s’en tenir aux seuils qu’il avait édictés et estimer que la nouvelle « dégradation » de la situation épidémique devait le conduire à renoncer à ses promesses et à plus de prudence ? De fait, si l’on veut espérer que les seuils répondaient à une réelle logique sanitaire, ne pas en ternir compte le jour J ne peut qu’accroître la défiance des populations. Il aurait donc peut-être été préférable, si l’idée de ne pas respecter les dates annoncées était jugé impossible vis-à-vis de l’opinion publique, d’éviter toute référence à des seuils.
Même l’Institut Pasteur est optimiste…
Au-delà de ces questions de communication, la fin de l’ensemble des mesures, même à des niveaux de circulation épidémique plus élevés que ceux espérés, peut être considérée comme légitime. D’abord, parce que plus que jamais, les notions très imparfaites d’incidence, dans un contexte toujours changeant de politique de dépistage, ne semblent plus permettre de dicter les décisions sanitaires. Par ailleurs, avec des variants comme Omicron BA1 et BA2, on sait que la très grande majorité des cas détectés sont asymptomatiques ou pauci symptomatiques, avec un risque restreint de formes graves (même chez les non vaccinés). D’ailleurs, le nombre de décès a connu une baisse de 18 % au cours de la semaine écoulée (avec moins de 30 morts comptabilisés hier par exemple). Il apparaît également que si les vaccins n’ont pas permis d’empêcher la circulation du nouveaux variants, ils demeurent performants pour limiter les cas nécessitant une hospitalisation. On relèvera encore que la situation dans les hôpitaux continue à connaître une tendance encourageante (même si on l’a dit ce n’est peut-être qu’un effet de décalage). Ainsi, on compte une diminution de 12 % du nombre de patients admis en soins critiques quotidiennement, de 6 % du nombre de patients hospitalisés et de 11 % de celui de malades en soins critiques. Enfin, les modélisations de l’Institut Pasteur, que l’on a toujours connu plus alarmantes que la réalité, prédisent un maximum de 180 000 cas par jour, contre plus de 300 000 fin janvier.
Renoncer au masque : une erreur ?
D’autres arguments plaidaient cependant en faveur du maintien d’une partie des mesures, en particulier du port du masque, dont la levée de l’obligation est regrettée par beaucoup d’experts. L’épidémiologiste genevois, Antoine Flahault remarquait ainsi dans le Parisien : « Je pense que la fin du masque obligatoire en intérieur est à contretemps et que la France fait une erreur. C’est une mesure relativement bien acceptée par la population, alors qu’une nouvelle vague arrive avec le sous-variant BA.2 ». Il espérait encore ce matin sur France Inter que le choix fait par certains de continuer à porter le masque ne constituera pas un point de friction. Alors qu’avant même l’amorce de la sixième vague, beaucoup regrettaient une disposition représentant un risque accru pour les personnes immunodéprimées (répondant peu ou mal au vaccin), la déception est encore plus forte aujourd’hui. Elle est en outre teintée d’une crainte qu’un retour en arrière sera peut-être difficilement accepté (en tout cas avant la fin de l’été). Par ailleurs, si dans les hôpitaux les périodes les plus critiques sont passées, les tensions demeurent dans des établissements qui sont loin d’avoir pu résoudre leurs problèmes d’effectifs. Or, l’hiver n’est pas terminé et le pays est même confronté à une recrudescence de l’épidémie de grippe, qui conjuguée à une vague (même faible) de Covid pourrait nécessiter de nouvelles déprogrammations ponctuelles.
Continuer à miser sur le vaccin
Face à ce panorama contrasté, le gouvernement veut affirmer que malgré l’approche des élections présidentielles et la guerre en Ukraine, la Covid n’a pas été oubliée. Ainsi, Jean Castex a-t-il annoncé ce week-end, qu’un second rappel vaccinal (généralement une quatrième dose) allait être proposé à toutes les personnes de plus de 80 ans. Une telle préconisation a déjà été faite en Allemagne (pour les plus de 70 ans) et en Suède. Le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale observe dans un avis publié ce matin : « Ce second rappel devrait conférer un bénéfice individuel contre les formes graves. Il convient de noter ici qu’il n’y a pas d’argument scientifique suggérant qu’il pourrait exister un effet d’épuisement de la réponse immune du fait de la répétition de la vaccination. En ce qui concerne les autres classes d’âge, il n’y a pas d’argument pour justifier la proposition d’une dose supplémentaire, tant sur le plan individuel que collectif, dans le contexte actuel de circulation virale ». Difficile de savoir cependant quel sera le succès de cette mesure alors que le nombre de vaccinations quotidien n’a jamais été aussi bas depuis le lancement de la campagne, avec 25 000 doses administrées chaque jour.
Aurélie Haroche
jim.fr
____________________
Diagnostic de la maladie coronarienne : le coroscanner gagne des points !
Publié le 11/03/2022
Le diagnostic positif de la maladie coronarienne stable repose de plus en plus sur les examens non invasifs. Quand la probabilité prétest s’avère intermédiaire, le coroscanner constitue désormais un examen de choix du fait de sa précision qui peut lui valoir d’être utilisé à la place des tests fonctionnels, selon des stratégies souvent définies à un échelon local en fonction des compétences et des infrastructures ou vice versa. La coronarographie invasive n’en reste pas moins le gold standard dans les cas douteux ou encore quand une revascularisation myocardique s’avère nécessaire.
Cette technique d’imagerie morphologique invasive expose à des complications qui sont devenues rares mais n’en existent pas moins. Par ailleurs, son usage systématique comme ce fut longtemps le cas avant l’avènement du coroscanner ne détecte des lésions sténosantes que dans 38 % à 50 % des cas, en dépit de douleurs thoraciques évocatrices d’angor. Aucune indication de revascularisation myocardique ne découle de ces résultats qui amènent à se poser la question du rapport bénéfice/risque d’une telle stratégie. Au demeurant, une question en appelant une autre : la coronarographie invasive est-elle supérieure au coroscanner quant au pronostic cardiovasculaire à long terme ? La réponse est d’importance car elle déboucherait à revoir le rôle de cet examen invasif dans ce contexte diagnostique.
L’essai randomisé pragmatique multicentrique européen DISCHARGE (Diagnostic Imaging Strategies for Patients with Stable Chest Pain and Intermediate Risk of Coronary Artery Disease) répond à cette question. Deux stratégies diagnostiques ont été comparées chez 3 561 patients (dont 56,2 % de femmes) consultant pour des douleurs thoraciques évocatrices d’un angor d’effort stable. L’une a reposé sur le coroscanner, l’autre sur la coronarographie invasive, alors que la probabilité prétest était jugée intermédiaire. Le critère d’efficacité principal combinait les évènements cardiovasculaires majeurs (ECVM) survenus au cours d’un suivi de 3,5 années, qu’il s’agisse des décès d’origine cardiovasculaire, des infarctus du myocarde ou des accidents vasculaires cérébraux non létaux. Les critères secondaires ont inclus l’incidence de l’angor ou encore des complications procédurales.
Même performance diagnostique que la coronarographie invasive mais moins de complications procédurales
Le suivi a été complet dans la majorité des cas (n = 3523 ; 98,9 %). Dans le groupe coroscanner (n = 1 808), 38 participants (2,1 %) ont été concernés par un ECVM, versus 52/1753 (3,0 %) dans l’autre groupe, ce qui conduit à un hazard ratio (HR) de 0,70 (intervalle de confiance à 95 % IC 95%, 0,46 à 1,07 ; p= 0,10). Des complications majeures liées à la procédure ont concerné 9 patients (0,5 %) du groupe coroscanner, versus 33 (1,9 %) dans l’autre groupe, soit un HR de 0,26 (IC 95%, 0,13 à 0,55). Un angor au cours des quatre dernières semaines du suivi a été constaté chez 8,8 % des patients du groupe coroscanner, versus 7,5 % dans l’autre groupe (odds ratio, 1,17 ; IC 95%, 0,92 à 1,48).
Les résultats de cet essai randomisé pragmatique confortent l’indication du coroscanner face à une douleur thoracique qui fait évoquer le diagnostic de maladie coronarienne stable avec une probabilité prétest jugée intermédiaire. Le fait de pratiquer en lieu et place une coronarographie invasive à visée diagnostique n’apporte aucun bénéfice significatif quant au pronostic cardiovasculaire à long terme, mais multiplie par près de quatre le risque de complications procédurales majeures par rapport au coroscanner, ce qui prête à réfléchir.
Dr Philippe Tellier
Référence
Maurovich-Horvat P et coll. : CT or Invasive Coronary Angiography in Stable Chest Pain. N Engl J Med 2022 ; publication avancée en ligne le 4 mars. doi: 10.1056/NEJMoa2200963.
jim.fr
_____________
Où il suffit d’une demi-heure pour confirmer ou pas un IDM aux Urgences
Publié le 28/02/2022
L'IDM est une cause majeure de morbidité et de mortalité, avec environ 7,3 millions de cas annuels dans le monde. Bien que la douleur thoracique soit l'un des motifs de consultation les plus courants chez les patients se présentant aux Urgences, un IDM n’est diagnostiqué que chez 1 de ces patients sur 10. Il importe donc que l’évaluation diagnostique soit rapide afin de réduire la durée du séjour aux Urgences des patients sans IDM et de distinguer « le bon grain de l’ivraie ». Au cours des deux dernières décennies, la sensibilité analytique des dosages de troponine cardiaque s'est grandement améliorée, favorisant l’émergence de nouveaux algorithmes diagnostiques accélérés pour la confirmation ou l'élimination du diagnostic d’infarctus du myocarde (IDM). En 2015, les recommandations de la Société européenne de cardiologie pour la prise en charge des patients avec IDM sans sus-décalage du segment ST ont introduit pour la première fois l'algorithme 0-h/1-h, à la suite de l'essai APACE (basé sur l’évolution des taux de troponine ultrasensible à une heure d’intervalle).
L'objectif de cette étude clinique prospective, monocentrique danoise, était de déterminer si l'IDM peut être éliminé en toute sécurité en une demi-heure au lieu d'une heure. Tous les patients présentant une douleur thoracique évocatrice d'un IDM pouvaient être inclus. La troponine I ultrasensible a été mesurée à l'admission (0 heure), 30 minutes, 1 heure et 3 heures. La performance diagnostique a été évaluée à partir de la sensibilité et de la valeur prédictive négative (critères d'évaluation primaires) comme mesures de la capacité à exclure un IDM. La spécificité et la valeur prédictive positive de l'IDM ont été utilisées comme mesures de la capacité à confirmer un IDM (critères secondaires).
Bonne fiabilité de l’algorithme 0-h/30-min
Au total, 1 003 patients ont été inclus (âge médian de 64 ans - intervalle interquartile 52 à 74- 42 % de femmes). L’IDM a été confirmé chez 9 % d’entre eux. Dans la cohorte de validation (n = 503), l'algorithme 0-h/30-minutes a permis d'exclure le diagnostic chez 242 (48 %) patients, de le confirmer chez 54 (11 %) et de garder 207 (41 %) patients en observation. Il en résulte une sensibilité de 100 % (92,0 % à 100 %), une valeur prédictive négative de 100 % (intervalle de confiance à 95 % IC95 % de 98,5 % à 100 %), une spécificité de 96,7 % (94,7 % à 98,2 %) et une valeur prédictive positive de 72,2 % (58,4 % à 83,5 %). En comparaison, l'algorithme 0-h/1-h a donné une sensibilité de 100 % (92,0 % à 100 %), une valeur prédictive négative de 100 % (98,5 % à 100 %), une spécificité de 97,2 % (95,2 % à 98,5 %) et une valeur prédictive positive de 75,5 % (61,7 % à 86,2 %).
Il s'agit de la première étude clinique qui a cherché à valider un nouvel algorithme 0-h/30-min pour la troponine I ultrasensible. L’algorithme 0-h/30-min a éliminé près de la moitié des patients de la cohorte de validation tout en maintenant un niveau élevé de sécurité avec d’excellentes sensibilité et valeur prédictive négative. Si elle était validée en externe (car il ne s’agit que d’une étude monocentrique), la troponine ultrasensible pourrait être généralisée pour exclure un IDM chez les patients présentant des douleurs dans les 30 minutes suivant l’admission aux Urgences.
Dr Bernard-Alex Gaüzère
Référence
Camilla Bang et coll. : Rapid Rule-Out of Myocardial Infarction After 30 Minutes as an Alternative to 1 Hour: The RACING-MI Cohort Study, Ann Emerg Med., 2022; 79: 102-112.
jim.fr
Publié le 18/03/2022
Hôpital public : la bureaucratie m’a tué
- « Les Bureaux se hâtèrent de se rendre indispensables en se substituant à l’action vivante par l’action écrite, et ils créèrent une puissance d’inertie appelée le Rapport. (…) La France allait se ruiner malgré de si beaux rapports, et disserter au lieu d’agir. Il se faisait en France un million de rapports écrits par année ; aussi la bureaucratie régnait-elle ! ». Mais quel écrivain décrit si bien notre monde ? Un auteur contemporain ? Que nenni. Ces phrases sont celles de Balzac dans Les Employés ou la femme supérieure, paru en 1838.
Au rapport !
L’extrait a été cité il y a quelques semaines par le psychiatre Bernard Granger dans une tribune publiée dans l’Obs, qui évoque la façon dont la bureaucratie a peu à peu gangréné l’hôpital public, réduisant ses forces vives à l’inertie la plus pataude. Comme il le signale à la fin de son long texte, les armes face à l’envahisseur ne sont guère nombreuses, mais l’humour ne manque probablement pas d’atout. Il l’illustre d’ailleurs au fil de son texte qui débute ainsi : « L’hôpital public est un terrain d’observation privilégié du phénomène bureaucratique. L’opium des directions hospitalières actuelles est « le projet ». Quand un directeur ne sait plus quoi vous répondre et cherche à se débarrasser de vous, il ordonne : « Écrivez-moi un projet ! » Tout est projet : projet médical, projet managérial, projet social, projet de soins, projet d’établissement, projet financier, projet de pôle, projet de département, projet de service, projet de chefferie de service, projet pédagogique, projet des représentants des usagers, etc. Aucun projet ne se réalise comme prévu, car c’est une littérature fictionnelle qui donne l’impression d’avoir été rédigée sous l’emprise de stupéfiants. Et que dire de ces rapports annuels d’activité, enquêtes administratives, rapports d’étapes, feuilles de route, plans stratégiques, boîtes à outils, états prévisionnels, plans locaux de santé, plans globaux de financement pluriannuels, stratégie nationale de santé, pilotage de la transformation (là où il faudrait plutôt une transformation du pilotage), retours d’expérience (RETEX, dans ce verbiage bourré de sigles et d’acronymes dont plus personne ne finit par connaître la signification) ? Qui s’intéresse à ces fadaises ? Qui lit ces documents destinés à une étagère empoussiérée puis à la déchèterie ? ».
La valorisation de l’inaction
La charge ne se contente pas d’être comique : elle est une analyse de la façon dont la bureaucratie mine le fonctionnement de l’hôpital public. D’abord, parce qu’elle rend impossible toute maîtrise du temps. « La plus belle réussite de la bureaucratie, qui fait un tort considérable au monde hospitalier, est sans doute son aptitude à dilater le temps et à diluer les responsabilités. Ce qui dans la vraie vie prend une heure, prend dans la vie bureaucratique un trimestre, un semestre, une année », écrit Bernard Granger. D’autres l’ont observé, notamment à la faveur de la crise épidémique, qui de façon immédiate a réussi à faire sauter toutes les étapes de décision et de validation et de sur-validation qui semblaient auparavant indépassables. Un collectif de médecins écrivait ainsi au printemps 2020 dans le Figaro : « Cette crise a permis une réduction drastique des procédures administratives et une accélération des délais de réponse de la part de bureaux ou commissions d’ordinaire relancés des mois durant avant l’obtention d’un avis ou d’une décision. La suradministration doit s’effacer devant les principes de subsidiarité et de responsabilité des chefs de service et des représentants médicaux. On a pu sortir de cet enfer paperassier, il ne faudrait pas y retomber ».
Las, il semble que leur appel n’ait pas été entendu et que les mauvaises habitudes soient vite revenues hanter les couloirs des hôpitaux. De nouveau, le temps du remplissage de tableaux grignote celui qui devrait être consacré aux patients, l’inaction devenant plus valorisée que l’action.
Quand l’indicateur devient l’objectif
L’autre conséquence délétère de ce règne de la bureaucratie est la place donnée aux indicateurs, bientôt transformés en « objectifs ». « L’indicateur sature la langue managériale. On entend souvent politiques ou hauts fonctionnaires prononcer cette phrase appliquée à tous les domaines : « Il faudrait quelques indicateurs bien choisis, en petit nombre. » Derrière une apparence de bon sens, cette proposition de retenir quelques indicateurs « bien choisis » (on ne dit pas comment) cache une erreur conceptuelle désormais bien démontrée. La loi de Goodhart devrait pourtant être connue de nos élites : lorsqu’une mesure devient un objectif, elle cesse d’être une bonne mesure. Un indicateur manipulable transformé en objectif a immédiatement des effets pervers. Les exemples d’indicateurs pervertis ne manquent pas. Ce sont les flacons d’antiseptiques versés dans le lavabo dès que leur consommation a servi à évaluer le suivi des règles d’asepsie, ou le refus des malades difficiles par les chirurgiens cardiaques américains quand le taux de mortalité chez leurs opérés devait servir à les classer (indicateur rapidement abandonné) », énumère Bernard Granger. Si certains feront remarquer qu’une telle critique ne devrait pas conduire à renoncer à l’évaluation des performances (longtemps honnie dans l’univers hospitalier mais qui constitue pourtant un élément participant à l’amélioration de la qualité des soins), l’idée que ce diktat des « indicateurs » s’est substituée de façon délétère à une vision raisonnée et médicale de ce qu’est l’activité hospitalière est partagée par beaucoup. Ainsi, le point ultime de cette logique semble être la tarification à l’activité. « Qu’on en finisse avec cette politique de rentabilité des séjours, utiles ou non, du moment qu’ils «rapportent»! » écrivaient ainsi il y a deux ans les auteurs d’une tribune publiée dans le Figaro.
Quand l’ONDAM tue la T2A
Pire, la tarification à l’activité (T2A) pourrait elle-même être la victime d’une logique bureaucratique, c’est-à-dire d’une logique éloignée des réalités concrètes. C’est ce qu’expliquent les économistes de la santé Florence Jusot, Clémence Thébaut et Jérôme Wittwer dans Le Monde, qui remarquent que les effets pervers de la T2A sont notamment liés à la façon dont les tarifs sont fixés en France : « Si la T2A a mis en difficulté financière les établissements de santé, c’est parce qu’en France le tarif des séjours n’est pas équivalent à leur coût de production évalué par l’ATIH. En effet, il a été choisi d’ajuster les tarifs des séjours pour respecter les objectifs nationaux de dépenses d’assurance-maladie (Ondam), votés annuellement par le Parlement. (…) Dans les années qui ont suivi la mise en place de la T2A, l’Ondam était compris entre 4 % et 6 %. A partir de 2008, l’Ondam a baissé chaque année pour atteindre 1,75 % en 2016. Jusqu’en 2016, la dépense de soins hospitaliers était tirée vers le haut par les volumes dont l’augmentation annuelle était supérieure à celle de l’Ondam (environ 2 %). Pendant ce temps, les tarifs stagnaient, voire baissaient, ce qui est particulièrement remarquable dans un contexte où l’innovation technologique était constante et conduisait structurellement à une augmentation du coût de la prise en charge des patients. L’augmentation des volumes de soins hospitaliers sur cette période résulte en premier lieu du vieillissement de la population qui a augmenté ses besoins en soins. Elle résulte également des incitations adressées par les directions hospitalières à l’attention de leurs équipes. Les directions les ont incitées à augmenter les nombres de séjours pour compenser la baisse des tarifs, ce qui, à terme, était contreproductif, puisque cette augmentation des volumes a conduit à diminuer encore les tarifs des séjours. L’Ondam est une enveloppe fermée, plus le nombre de séjours augmente, plus les tarifs de ces séjours diminuent », décrivent-ils.
Vous souffrez des rapports ? Vite un rapport sur la souffrance !
Non contente d’entraîner une sclérose du système, la bureaucratie paraît également contaminer les réponses préconisées pour lutter contre ses méfaits. La lutte contre les souffrances psychosociales dans le monde hospitalier a ainsi été régulièrement mise sur le devant de la scène ces dernières. Cependant, ces actions sont-elles aussi mues par les mêmes mécaniques que celles qui sont (entre autres) à l’origine de la « souffrance des soignants », en se basant sur des indicateurs, des rapports et autres réunions de commissions. Bernard Granger citant le psychologue du travail Yves Clot remarque : « Il considère que proposer de « réparer » les conséquences psychiques des organisations de travail défaillantes par la « gestion » des risques psychosociaux est une aberration supplémentaire : « Pour tout dire, je ne crois pas que ceux qui travaillent dans ce pays soient des sinistrés à secourir. La victimologie ambiante, quand elle devient une gestion de la plainte “par en haut”, n’est souvent qu’un faux pas qui accroît, par un choc en retour, la passivité des opérateurs. […] Le monde du travail qui vient est un hybride social : une sorte de néofordisme se met en place, monté sur coussin compassionnel. La pression productiviste se dote d’amortisseurs psychologiques ». Ainsi, plutôt que de supprimer ce qui fait souffrir, on préconise d’accompagner la souffrance…
La thérapie par la rustine
Et comment ne pas penser qu’une des solutions récemment proposée par l’Agence régionale de Santé (ARS) d’Ile de France pour répondre à la pénurie d’effectifs infirmiers dans les hôpitaux franciliens n’est pas elle aussi le résultat d’une logique bureaucratique, qui refuse de prendre en compte ses propres dysfonctionnements et qui préfère la thérapie par la rustine. « Le dispositif proposé par l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, le 17 janvier, a achevé d’écœurer le personnel des hôpitaux publics de la région. Les infirmières travaillant en intérim se sont vu proposer des contrats à durée déterminée de six à neuf mois non renouvelables pour des salaires 30 % supérieurs à ceux des infirmières titulaires. S’il fallait persuader les infirmières restantes que leur engagement n’était pas reconnu, l’opération était parfaite. Pourquoi opter pour une fidélité sans valorisation salariale et avec des conditions de travail qui, chaque année, se détériorent ? (…) Pour éviter le crash complet, peut-on envisager que les thuriféraires de l’efficience entendent ce que les personnels non médicaux demandent ? » écrit en réponse à cette innovation de l’ARS un collectif de soignants dans le Monde.
Et s’il était trop tard ?
Pour certains, il pourrait être trop tard : la bureaucratie étant devenue un monstre autonome que ses « maîtres » ne parviennent plus à contrôler. Dans Libération, le consultant en santé Alexis Dussol écrit : « L’empilement des réformes et l’inflation des normes en tous genres ont transformé l’hôpital en monstre bureaucratique. Il n’est qu’à parcourir les quelque 300 pages du manuel de certification de la HAS pour s’en faire une idée. Les gouvernants ne savent plus trop comment s’y prendre pour le réformer ».
Les bureaucrates : des boucs émissaires faciles ?
Cependant, d’aucuns mettent en garde contre une critique facile de cette fameuse « bureaucratie » qui cacherait des desseins peu avouables pour l’hôpital public. Ainsi, dans Libération, le patron de la Fédération hospitalière de France (FHF), Frédéric Valletoux s’indigne des exagérations qu’il entend dans les discours de nombreux candidats à l’élection présidentielle : « Qu’a-t-on entendu ces derniers jours ? Que les hôpitaux publics seraient peuplés à 30 % de bureaucrates. Ah, la vieille rengaine… La crise n’est pas encore finie, et les décès se poursuivent, mais déjà ceux qui rêvent de livrer notre bouclier sanitaire aux mains du marché se réveillent. L’hôpital public a pris en charge plus de 80 % des patients Covid hospitalisés, a organisé des transferts sanitaires interrégionaux au plus fort de la crise, a dépêché des soignants en outre-mer (et il le fait encore aujourd’hui), a réorganisé tous ses services pour être capable de faire face à la saturation des réanimations, mais non, notre hôpital ne serait ni agile, ni réactif, ni admirable : il serait «bureaucratique». Je le redis donc avec force, les emplois administratifs à l’hôpital représentent 10 % des effectifs, pas 20 %, pas 30 %, pas 40 % : 10 %. Ce chiffre est pourtant en accès libre sur le site des statistiques du ministère de la Santé. Comme celui de 14 % d’emplois administratifs constatés dans les cliniques privées. Mais, trop soucieux d’attaquer nos hospitaliers pour respecter la vérité des faits, les habitués de l’hôpital-bashing se plaisent à intégrer la catégorie des secrétaires médicales à leurs calculs. Elles seront sans doute ravies d’apprendre qu’elles ne sont que des bureaucrates. Et une fois qu’on aura supprimé leurs postes pour débureaucratiser l’hôpital, les soignants seront ravis d’apprendre qu’ils doivent accueillir le public, gérer l’attente des patients aux urgences, organiser les agendas de tout leur service, ainsi que le suivi du dossier de leurs patients, etc ».
Difficile cependant de croire que dans les critiques formulées par Bernard Granger et beaucoup d’autres, ce sont les « secrétaires » qui soient visées, comme feint de l’assurer Frédéric Valletoux. C’est bien plus certainement le carcan des visions préformatées, du management par les seuls chiffres, symbolisés par l’hégémonie du « tableau Excel » qui sont dénoncés.
Des desseins peu avouables
Mais on retrouve également cette idée que la lutte affichée contre la bureaucratie ne pourrait être qu’un leurre sous la plume du professeur André Grimaldi. S’attaquant aux solutions proposées pour « sauver » l’hôpital public par deux anciens responsables de la FHF, il écrit ainsi dans le Journal du Dimanche : « Dans une tribune au journal Le Monde, Guy Collet et Gérard Vincent, deux anciens directeurs des hôpitaux et responsables de la Fédération hospitalière de France (FHF) prétendent sauver l’hôpital public grâce à trois mesures :1 : “confier aux régions la tutelle et la régulation du système de santé, les conseils régionaux devenant responsables des équilibres financiers” ; 2 : “inclure dans un service public de santé régional, l’ensemble des acteurs de santé, y compris les cliniques commerciales” ; 3 : “changer radicalement le statut de l’hôpital public en lui donnant celui de fondation”, c’est-à-dire, pour parler clair, d’une personne morale de droit privé à but non lucratif. Autrement dit pour défendre l’hôpital public auquel, ils déclarent “être viscéralement attachés”, ils proposent de le privatiser. (…) Au fond ils proposent d’appliquer à la santé au nom de la lutte contre la bureaucratie, le principe néolibéral : moins d’Etat, plus de marché » s’indigne André Grimaldi… Si on retrouve ici les combats de toujours du professeur de diabétologie, il est probable que les organisations managériales du privé n’ont probablement rien à envier à l’hôpital public en ce qui concerne les aberrations bureaucratiques et l’investissement disproportionné dans l’activité de reporting.
Ainsi, on le voit si la description des affres et des conséquences de la folie administrative sont aisées, il est plus difficile d’apprécier dans quelle mesure il pourrait être possible de se défaire de ce piège. Quelques pistes émergeront peut-être à la lecture de :
Bernard Granger : « Excel m’a tué » : comment la bureaucratie a asphyxié notre système hospitalier, https://www.nouvelobs.com/sante/2022012 ... alier.html#
Collectif de médecins, https://www.lefigaro.fr/vox/societe/lib ... e-20200503
Florence Jusot, Clémence Thébaut, Jérôme Wittwer
https://www.lemonde.fr/idees/article/20 ... _3232.html
Collectif de soignants : https://www.lemonde.fr/idees/article/20 ... _3232.html
Alexis Dussol : https://www.liberation.fr/idees-et-deba ... directed=1
Frédéric Valletoux :
https://www.liberation.fr/idees-et-deba ... 7NN3CMPHY/
André Grimaldi
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-la ... ic-4096114
Aurélie Haroche
jim.fr
_____________
Publié le 18/03/2022
Affaire Levothyrox : confirmation de la condamnation du laboratoire pour défaut d’information
Paris, le samedi 19 mars 2022 - C’est la fin du premier volet civil de l’affaire du Levothyrox. En 2017, le laboratoire Merck mettait sur le marché une nouvelle formule d’un médicament ancien traitant l’hypothyroïdie et nécessitant un dosage très fin (le Lévothyrox). L'un des excipients, le lactose monohydraté, avait été alors remplacé par du mannitol et de l'acide citrique.
Après avoir pris cette nouvelle formule du médicament, de très nombreux patients se sont plaints d'effets secondaires. Le débat public a été alors secoué par une « tempête parfaite » avec une controverse scientifique sur le lien de causalité entre la nouvelle formule et les troubles déclarés. Cependant en décembre 2018, l’ANSM a établi que la nouvelle formule du Levothyrox n’avait pas provoqué d’augmentation des problèmes sanitaires.
Sur le terrain judiciaire, la controverse s’inscrit dans un cadre bien différente. En juin 2020, la Cour d’Appel de Lyon faisait droit à la demande de plus de 3300 plaignants en reconnaissant l’existence d’une faute commise par le laboratoire Merck en raison du défaut (plus difficilement démontrable et contestable) d’information des patients sur les changements du produit. C’est dans ce contexte qu’un pourvoi a été formé par le laboratoire devant la Cour de cassation.
Au-delà de toute controverse scientifique, un défaut d’information
La plus haute juridiction civile devait répondre à deux questions majeures soulevées par les défendeurs.
Dans un premier temps, la société Merck soulevait que, conformément à la législation et au code de santé publique, les laboratoires avaient fait apparaitre dans le cadre de la notice et de l’étiquetage les nouveaux excipients. A partir de là, il ne serait pas possible de reprocher au fabricant et à l’exploitant un défaut d’information.
Mais pour la Cour de Cassation, si la notice répond aux exigences réglementaires (en ce qu'elle donne la nouvelle composition du médicament), la seule mention du mannitol et de l’acide citrique, dans un texte dense « et imprimé en petits caractères », est insuffisante pour faire état d’une évolution de la formule.
Un préjudice moral « temporaire »
Autre critique formulé à l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon, le fabriquant reprochait aux juges du fond d’avoir fait droit à la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral alors même que le lien entre la nouvelle formule et les effets secondaires ressentis n’était pas établi.
Or, reprenant l’idée d’autonomie du préjudice d’information, la Cour de cassation rejette également le pourvoi sur ce point. Les juges de la Haute juridiction ont considéré qu’à partir du moment où les patients n’ont pas été informés de l’évolution de la composition des médicaments, ces derniers ont perdu une chance de se tourner vers des professionnels de santé « pour faire face à ces troubles ».
La Cour précise toutefois qu’il s’agit d’un préjudice moral « temporaire » qui perdure « jusqu’à ce qu’ils aient été informés de cette modification ».
Quoi qu’il en soit la condamnation du fabricant et de l’exploitant est donc confirmée.
En fixant un préjudice moral « temporaire », les fabricants et exploitants pourraient donc être invités à l’avenir à communiquer le plus rapidement possible afin de limiter les risques en termes d’indemnisation.
Si cette procédure d'ampleur est désormais close, le dossier du Levothyrox fait l'objet au pénal d'une information judiciaire contre X pour des faits présumés de tromperie aggravée, homicide et blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui.
Charles Haroche
jim.fr
___________________
Publié le 18/03/2022
Des scientifiques qui fourmillent d’idées
Si l’on sait que le chien peut être dressé pour détecter les cancers, un animal bien plus petit ferait mieux que lui dans ce domaine.
« Développer une technique non invasive, efficace et peu chère pour détecter les cancers à un stade précoce est un défi majeur pour la santé publique » écrivent les chercheurs français issus du CNRS, de l’Inserm et l’Institut Curie à l’origine d’une étude sur la détection du cancer publiée le 21 février dernier dans la revue « iScience ». Depuis plusieurs années, les scientifiques étudient la possibilité de dépister le cancer via les composés organiques volatils (COV), ces odeurs émises par les cellules qui sont différentes selon que ces dernières sont saines ou cancéreuses. Il a notamment été démontré que les chiens, qui sont connus pour leur odorat exceptionnel (10 000 à 20 000 fois plus sensible que celui de l’homme), peuvent parvenir à détecter des cancers par leur odeur. Selon l’étude Kdog de l’Institut Curie de 2017, un chien peut atteindre un taux d’efficacité de 90 % dans le dépistage.
La fourmi bien meilleure élève que le chien
Cependant, l’entrainement d’un chien est long (entre 6 et 12 mois) et couteux, « plusieurs dizaines de milliers d’euros par chien » selon Baptiste Piqueret, principal auteur de l’étude qui nous intéresse. Lui et son équipe se sont donc intéressés aux capacités de détection d’un autre animal à l’odorat puissant : la fourmi. En effet, dans la nature, cet insecte utilise son odorat pour s’orienter et pour communiquer avec ses congénères. L’odeur est donc au centre de l’organisation sociale des fourmis.
Grâce à un protocole dit « d’apprentissage associatif » basé sur un système de récompense, les chercheurs ont pu apprendre aux fourmis à détecter les odeurs émises par les cellules cancéreuses. « Un protocole très simple qui ne nécessite pas de matériel onéreux » explique Baptiste Piqueret, qui raconte avoir réalisé ces expériences chez lui pendant le premier confinement de 2020. Au final, les insectes se révèlent être des élèves bien plus brillants que les chiens. En seulement trois sessions d’apprentissage de moins d’une heure, une fourmi est capable de distinguer cellules cancéreuses et cellules saines. Les insectes parviennent même à distinguer entre deux sous-types de cancer du sein.
Demain les chiens ou la Révolution des fourmis ?
Que ceux qui ont peur des insectes se rassurent : il est peu probable qu’un cancérologue vous prescrive un jour de vous recouvrir le corps de fourmis. « On va utiliser par exemple de l’urine, de la salive ou de la sueur d’une personne qui a potentiellement le cancer, il n’y aura pas de contact direct entre nos fourmis et les patients » explique Baptiste Piqueret. Le chercheur espère par ailleurs que l’incroyable odorat des fourmis pourra être utilisé à d’autres fins, comme la détection d’explosif ou de stupéfiants. Il reste cependant à réaliser des « tests cliniques sur un organisme humain complet » avant de pouvoir confirmer l’efficacité de cette méthode, précise le CNRS dans un communiqué. Des expériences préliminaires menés avec de l’urine de souris atteinte d’un cancer sont actuellement en cours.
Dans cette rivalité avec les fourmis, les chiens n’ont cependant pas encore dit leur dernier mot. L’Institut Curie mène depuis 2020 une étude clinique, qui doit s’achever en 2023, pour mieux mesurer la capacité de dépistage de nos amis à quatre pattes.
Rappelons par ailleurs que, jusqu’à preuve du contraire, les fourmis ne rapportent pas la balle qu’on leur lance et ne peuvent pas retrouver des personnes ensevelies sous une avalanche.
Le chien restera donc, quoi qu’il arrive, le meilleur ami de l’homme.
Nicolas Barbet
jim.fr
__________________
Publié le 18/03/2022
Cannabis « thérapeutique » : une expérimentation hors des clous ?
L’expérimentation du cannabis « thérapeutique » a débuté en France chez l’homme en 2021 après validation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire du médicament (ANSM) et doit durer 2 ans. Au total, 3000 patients doivent y participer et elle vise à établir les bénéfices thérapeutiques éventuels du cannabis dans six indications différentes : les douleurs neuropathiques réfractaires, l’épilepsie pharmaco résistante, les spasticités douloureuses de la sclérose en plaque, les symptômes neuropathiques réfractaires, les soins palliatifs et les spasticités douloureuses hors sclérose en plaque.
Un essai ouvert sans groupe contrôle
Les Académie de médecine et de pharmacie s’étaient déjà montrées très réservées. Dans un premier avis en 2010, l’Académie de médecine avait jugé une telle expérimentation dangereuse arguant que « les effets pharmacologiques sont d'une intensité modeste alors que les effets secondaires sont nombreux et très souvent adverses ». En 2019, l’Académie de pharmacie avait qualifié l’expression « cannabis thérapeutique » d’ « abus de langage ». Elle écrivait aussi : « mélange végétal composé de 200 principes actifs différents, variables en quantités et en proportions en fonction des modalités de culture, de récolte, de conservation, n’étant ni dosé ni contrôlé, le cannabis dit thérapeutique ne peut apporter les garanties d’un médicament ».
Dans un communiqué publié en début de semaine, les Académies nationales de médecine et de pharmacie estiment désormais que les travaux menés actuellement dérogent « aux exigences méthodologiques, sécuritaires et éthiques qui régissent l’évaluation de tout candidat médicament ».
Ainsi, l’essai n’est pas randomisé (il s’agit d’une étude ouverte sans groupe contrôle), seule méthode pour les Académies susceptible d’évaluer convenablement un produit de santé. « Une autre anomalie est liée au fait que l’expérimentation ne concerne pas des substances pures, mais des produits à base de fleurs séchées de cannabis et d’extraits aux composants multiples » soulignent les sages.
Une meta-analyse peu engageante…
De plus, une méta-analyse portant sur 32 essais cliniques randomisés et plus de 5000 patients atteints de douleurs chroniques non cancéreuses publiée l’an dernier dans le BMJ, concluait qu’il n’a été trouvé, avec des niveaux de preuve modérés à élevés, qu’une augmentation jugée « faible à très faible » de la proportion de patients bénéficiant d’une amélioration importante de leur douleur, de leur état physique et de la qualité de leur sommeil. « Quant aux effets indésirables, ils étaient soit transitoires, soit majorés au-delà de trois mois de traitement » détaillent les Académies.
« Cette méta-analyse ne fait que confirmer les données rapportées de façon récurrente dans des analyses internationales portant sur le traitement des douleurs neuropathiques, qui concluaient à la très faible efficacité des cannabinoïdes vis-à-vis des douleurs chroniques » soulignent-elles encore.
Cannabis thérapeutique, hydroxychloroquine : même combat ?
Les Académies s’étonnent également qu’un tel essai ait été rendu possible dans le contexte actuel.
Elles rappellent ainsi deux prises de positions fortes, des Académies (des sciences, de médecine et de pharmacie) d’une part et du CNRS d’autre part alors que « l’affaire » de l’hydroxychloroquine dans la Covid battait son plein.
Dans ces communiqués, les trois Académies estimaient qu’en « période de pandémie aussi bien qu’en situation ordinaire, les règles de l’évaluation critique des méthodes et des résultats doivent s’appliquer. Il en est de même de la déontologie scientifique et médicale, du respect de l’intégrité scientifique et de l’éthique de la communication des résultats ».
Une position qui rejoignait un avis publié par le CNRS : « On ne peut que s’inquiéter que le choix d’un traitement puisse être décidé par l’opinion publique sur la base d’une pétition ou d’un sondage et que des décisions politiques puissent être prises en se fondant sur des croyances ou des arguments irrationnels, faisant uniquement appel à la peur ou l’émotion ». Pour les Académies l’expérimentation rentre dans ce cadre : un essai soutenu par l’opinion publique sur la base de croyances…Ceux, pharmacologues, algologues et psychiatres qui soutiennent ces travaux apprécieront…
Dans ce contexte, les Académies estiment indispensables que les autorités réglementaires puissent, le moment venu, analyser « en toute indépendance scientifique » les données de l’essai afin de pouvoir déterminer la balance bénéfices/risques ainsi que le service médical rendu et « qu’en cas de mise à disposition du cannabis à des fins thérapeutiques, que le suivi des effets indésirables et des cas d’abus et/ou de détournement d’usage soit assuré, comme il est de règle, par les Centres Régionaux de Pharmacovigilance et Centres d’Évaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance-Addictovigilance ».
F.H.
jim.fr
_______________________
Covid : fin du masque obligatoire et suspension du passe vaccinal malgré la sixième vague
Publié le 14 mars 2022
Quasiment deux ans jour pour jour après la mise en place d’un confinement, totalement inédit dans la France moderne, impliquant l’arrêt d’un grand nombre d’activités et la fermeture des écoles, il n’est pas inutile de s’interroger sur ce que le gouvernement aura appris concernant la gestion de l’épidémie de Covid. A la lueur de l’évènement du jour, soit la fin de l’obligation du port du masque dans la plupart des lieux intérieurs (sauf les transports en commun et les établissements de santé) et la suspension (qui n’est pas l’annulation) du passe vaccinal, la réponse pourrait être empreinte de fatalisme. En effet, de la même manière qu’en décembre 2020, il n’avait finalement pas respecté les seuils qu’il s’était fixé pour lever les mesures alors en vigueur, aujourd’hui, masque et passe disparaissent alors que les seuils indiqués par Olivier Véran pour ce faire il y a quelques jours n’ont pas été atteints.
Incidence en hausse
Ainsi, le ministre de la Santé avait considéré que ces dispositifs pourraient disparaître si le seuil d’incidence était inférieur à 500 : il atteint aujourd’hui 629 cas pour 100 000. Il a en effet progressé dans toutes les tranches d’âge au cours de la semaine dernière, de 4 % chez les 90 ans et plus à 22 % chez les 20/29 ans. Il est le plus élevé en Bretagne, ce qui est constitue un phénomène inédit depuis le début de l’épidémie. Le ministre de la Santé avait par ailleurs fixé à 1500 le nombre de patients atteints de Covid en soins critiques (incluant les personnes hospitalisées en raison de la Covid et celles admises pour une autre raison mais infectées par SARS-CoV-2). Ce nombre était hier de 1855. En outre, la poursuite de la décrue que l’on constate à l’hôpital pourrait être liée au décalage qui existe toujours entre la hausse du nombre de contaminations et les admissions dans les établissements de santé : d’ailleurs le nombre d’admissions quotidiennes en soins classiques stagne désormais.
Sixième vague
D’une manière générale, dans plusieurs pays d’Europe de l’Ouest, une « sixième vague » est constatée sans nuance. Le nombre de cas positifs a ainsi progressé de 33 % en Grande-Bretagne, de 16 % en Allemagne ou encore de 17 % en Italie entre le 6 et le 10 mars (+ 11 % en France).
Les causes de cette nouvelle vague semblent multiples. L’abandon dans de nombreux pays des mesures dites « barrière » est mis en avant. Cependant, la temporalité de ce relâchement n’a pas été le même partout en Europe, ce qui limite un peu la portée de cette piste. Plus simplement, et comme toujours, la circulation d’un nouveau variant (BA2), dont la transmission n’est que peu évitée par la vaccination, apparaît principalement responsable de cette nouvelle vague.
Une communication éternellement ratée
Dès lors, faut-il considérer que le gouvernement aurait dû s’en tenir aux seuils qu’il avait édictés et estimer que la nouvelle « dégradation » de la situation épidémique devait le conduire à renoncer à ses promesses et à plus de prudence ? De fait, si l’on veut espérer que les seuils répondaient à une réelle logique sanitaire, ne pas en ternir compte le jour J ne peut qu’accroître la défiance des populations. Il aurait donc peut-être été préférable, si l’idée de ne pas respecter les dates annoncées était jugé impossible vis-à-vis de l’opinion publique, d’éviter toute référence à des seuils.
Même l’Institut Pasteur est optimiste…
Au-delà de ces questions de communication, la fin de l’ensemble des mesures, même à des niveaux de circulation épidémique plus élevés que ceux espérés, peut être considérée comme légitime. D’abord, parce que plus que jamais, les notions très imparfaites d’incidence, dans un contexte toujours changeant de politique de dépistage, ne semblent plus permettre de dicter les décisions sanitaires. Par ailleurs, avec des variants comme Omicron BA1 et BA2, on sait que la très grande majorité des cas détectés sont asymptomatiques ou pauci symptomatiques, avec un risque restreint de formes graves (même chez les non vaccinés). D’ailleurs, le nombre de décès a connu une baisse de 18 % au cours de la semaine écoulée (avec moins de 30 morts comptabilisés hier par exemple). Il apparaît également que si les vaccins n’ont pas permis d’empêcher la circulation du nouveaux variants, ils demeurent performants pour limiter les cas nécessitant une hospitalisation. On relèvera encore que la situation dans les hôpitaux continue à connaître une tendance encourageante (même si on l’a dit ce n’est peut-être qu’un effet de décalage). Ainsi, on compte une diminution de 12 % du nombre de patients admis en soins critiques quotidiennement, de 6 % du nombre de patients hospitalisés et de 11 % de celui de malades en soins critiques. Enfin, les modélisations de l’Institut Pasteur, que l’on a toujours connu plus alarmantes que la réalité, prédisent un maximum de 180 000 cas par jour, contre plus de 300 000 fin janvier.
Renoncer au masque : une erreur ?
D’autres arguments plaidaient cependant en faveur du maintien d’une partie des mesures, en particulier du port du masque, dont la levée de l’obligation est regrettée par beaucoup d’experts. L’épidémiologiste genevois, Antoine Flahault remarquait ainsi dans le Parisien : « Je pense que la fin du masque obligatoire en intérieur est à contretemps et que la France fait une erreur. C’est une mesure relativement bien acceptée par la population, alors qu’une nouvelle vague arrive avec le sous-variant BA.2 ». Il espérait encore ce matin sur France Inter que le choix fait par certains de continuer à porter le masque ne constituera pas un point de friction. Alors qu’avant même l’amorce de la sixième vague, beaucoup regrettaient une disposition représentant un risque accru pour les personnes immunodéprimées (répondant peu ou mal au vaccin), la déception est encore plus forte aujourd’hui. Elle est en outre teintée d’une crainte qu’un retour en arrière sera peut-être difficilement accepté (en tout cas avant la fin de l’été). Par ailleurs, si dans les hôpitaux les périodes les plus critiques sont passées, les tensions demeurent dans des établissements qui sont loin d’avoir pu résoudre leurs problèmes d’effectifs. Or, l’hiver n’est pas terminé et le pays est même confronté à une recrudescence de l’épidémie de grippe, qui conjuguée à une vague (même faible) de Covid pourrait nécessiter de nouvelles déprogrammations ponctuelles.
Continuer à miser sur le vaccin
Face à ce panorama contrasté, le gouvernement veut affirmer que malgré l’approche des élections présidentielles et la guerre en Ukraine, la Covid n’a pas été oubliée. Ainsi, Jean Castex a-t-il annoncé ce week-end, qu’un second rappel vaccinal (généralement une quatrième dose) allait être proposé à toutes les personnes de plus de 80 ans. Une telle préconisation a déjà été faite en Allemagne (pour les plus de 70 ans) et en Suède. Le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale observe dans un avis publié ce matin : « Ce second rappel devrait conférer un bénéfice individuel contre les formes graves. Il convient de noter ici qu’il n’y a pas d’argument scientifique suggérant qu’il pourrait exister un effet d’épuisement de la réponse immune du fait de la répétition de la vaccination. En ce qui concerne les autres classes d’âge, il n’y a pas d’argument pour justifier la proposition d’une dose supplémentaire, tant sur le plan individuel que collectif, dans le contexte actuel de circulation virale ». Difficile de savoir cependant quel sera le succès de cette mesure alors que le nombre de vaccinations quotidien n’a jamais été aussi bas depuis le lancement de la campagne, avec 25 000 doses administrées chaque jour.
Aurélie Haroche
jim.fr
____________________
Diagnostic de la maladie coronarienne : le coroscanner gagne des points !
Publié le 11/03/2022
Le diagnostic positif de la maladie coronarienne stable repose de plus en plus sur les examens non invasifs. Quand la probabilité prétest s’avère intermédiaire, le coroscanner constitue désormais un examen de choix du fait de sa précision qui peut lui valoir d’être utilisé à la place des tests fonctionnels, selon des stratégies souvent définies à un échelon local en fonction des compétences et des infrastructures ou vice versa. La coronarographie invasive n’en reste pas moins le gold standard dans les cas douteux ou encore quand une revascularisation myocardique s’avère nécessaire.
Cette technique d’imagerie morphologique invasive expose à des complications qui sont devenues rares mais n’en existent pas moins. Par ailleurs, son usage systématique comme ce fut longtemps le cas avant l’avènement du coroscanner ne détecte des lésions sténosantes que dans 38 % à 50 % des cas, en dépit de douleurs thoraciques évocatrices d’angor. Aucune indication de revascularisation myocardique ne découle de ces résultats qui amènent à se poser la question du rapport bénéfice/risque d’une telle stratégie. Au demeurant, une question en appelant une autre : la coronarographie invasive est-elle supérieure au coroscanner quant au pronostic cardiovasculaire à long terme ? La réponse est d’importance car elle déboucherait à revoir le rôle de cet examen invasif dans ce contexte diagnostique.
L’essai randomisé pragmatique multicentrique européen DISCHARGE (Diagnostic Imaging Strategies for Patients with Stable Chest Pain and Intermediate Risk of Coronary Artery Disease) répond à cette question. Deux stratégies diagnostiques ont été comparées chez 3 561 patients (dont 56,2 % de femmes) consultant pour des douleurs thoraciques évocatrices d’un angor d’effort stable. L’une a reposé sur le coroscanner, l’autre sur la coronarographie invasive, alors que la probabilité prétest était jugée intermédiaire. Le critère d’efficacité principal combinait les évènements cardiovasculaires majeurs (ECVM) survenus au cours d’un suivi de 3,5 années, qu’il s’agisse des décès d’origine cardiovasculaire, des infarctus du myocarde ou des accidents vasculaires cérébraux non létaux. Les critères secondaires ont inclus l’incidence de l’angor ou encore des complications procédurales.
Même performance diagnostique que la coronarographie invasive mais moins de complications procédurales
Le suivi a été complet dans la majorité des cas (n = 3523 ; 98,9 %). Dans le groupe coroscanner (n = 1 808), 38 participants (2,1 %) ont été concernés par un ECVM, versus 52/1753 (3,0 %) dans l’autre groupe, ce qui conduit à un hazard ratio (HR) de 0,70 (intervalle de confiance à 95 % IC 95%, 0,46 à 1,07 ; p= 0,10). Des complications majeures liées à la procédure ont concerné 9 patients (0,5 %) du groupe coroscanner, versus 33 (1,9 %) dans l’autre groupe, soit un HR de 0,26 (IC 95%, 0,13 à 0,55). Un angor au cours des quatre dernières semaines du suivi a été constaté chez 8,8 % des patients du groupe coroscanner, versus 7,5 % dans l’autre groupe (odds ratio, 1,17 ; IC 95%, 0,92 à 1,48).
Les résultats de cet essai randomisé pragmatique confortent l’indication du coroscanner face à une douleur thoracique qui fait évoquer le diagnostic de maladie coronarienne stable avec une probabilité prétest jugée intermédiaire. Le fait de pratiquer en lieu et place une coronarographie invasive à visée diagnostique n’apporte aucun bénéfice significatif quant au pronostic cardiovasculaire à long terme, mais multiplie par près de quatre le risque de complications procédurales majeures par rapport au coroscanner, ce qui prête à réfléchir.
Dr Philippe Tellier
Référence
Maurovich-Horvat P et coll. : CT or Invasive Coronary Angiography in Stable Chest Pain. N Engl J Med 2022 ; publication avancée en ligne le 4 mars. doi: 10.1056/NEJMoa2200963.
jim.fr
_____________
Où il suffit d’une demi-heure pour confirmer ou pas un IDM aux Urgences
Publié le 28/02/2022
L'IDM est une cause majeure de morbidité et de mortalité, avec environ 7,3 millions de cas annuels dans le monde. Bien que la douleur thoracique soit l'un des motifs de consultation les plus courants chez les patients se présentant aux Urgences, un IDM n’est diagnostiqué que chez 1 de ces patients sur 10. Il importe donc que l’évaluation diagnostique soit rapide afin de réduire la durée du séjour aux Urgences des patients sans IDM et de distinguer « le bon grain de l’ivraie ». Au cours des deux dernières décennies, la sensibilité analytique des dosages de troponine cardiaque s'est grandement améliorée, favorisant l’émergence de nouveaux algorithmes diagnostiques accélérés pour la confirmation ou l'élimination du diagnostic d’infarctus du myocarde (IDM). En 2015, les recommandations de la Société européenne de cardiologie pour la prise en charge des patients avec IDM sans sus-décalage du segment ST ont introduit pour la première fois l'algorithme 0-h/1-h, à la suite de l'essai APACE (basé sur l’évolution des taux de troponine ultrasensible à une heure d’intervalle).
L'objectif de cette étude clinique prospective, monocentrique danoise, était de déterminer si l'IDM peut être éliminé en toute sécurité en une demi-heure au lieu d'une heure. Tous les patients présentant une douleur thoracique évocatrice d'un IDM pouvaient être inclus. La troponine I ultrasensible a été mesurée à l'admission (0 heure), 30 minutes, 1 heure et 3 heures. La performance diagnostique a été évaluée à partir de la sensibilité et de la valeur prédictive négative (critères d'évaluation primaires) comme mesures de la capacité à exclure un IDM. La spécificité et la valeur prédictive positive de l'IDM ont été utilisées comme mesures de la capacité à confirmer un IDM (critères secondaires).
Bonne fiabilité de l’algorithme 0-h/30-min
Au total, 1 003 patients ont été inclus (âge médian de 64 ans - intervalle interquartile 52 à 74- 42 % de femmes). L’IDM a été confirmé chez 9 % d’entre eux. Dans la cohorte de validation (n = 503), l'algorithme 0-h/30-minutes a permis d'exclure le diagnostic chez 242 (48 %) patients, de le confirmer chez 54 (11 %) et de garder 207 (41 %) patients en observation. Il en résulte une sensibilité de 100 % (92,0 % à 100 %), une valeur prédictive négative de 100 % (intervalle de confiance à 95 % IC95 % de 98,5 % à 100 %), une spécificité de 96,7 % (94,7 % à 98,2 %) et une valeur prédictive positive de 72,2 % (58,4 % à 83,5 %). En comparaison, l'algorithme 0-h/1-h a donné une sensibilité de 100 % (92,0 % à 100 %), une valeur prédictive négative de 100 % (98,5 % à 100 %), une spécificité de 97,2 % (95,2 % à 98,5 %) et une valeur prédictive positive de 75,5 % (61,7 % à 86,2 %).
Il s'agit de la première étude clinique qui a cherché à valider un nouvel algorithme 0-h/30-min pour la troponine I ultrasensible. L’algorithme 0-h/30-min a éliminé près de la moitié des patients de la cohorte de validation tout en maintenant un niveau élevé de sécurité avec d’excellentes sensibilité et valeur prédictive négative. Si elle était validée en externe (car il ne s’agit que d’une étude monocentrique), la troponine ultrasensible pourrait être généralisée pour exclure un IDM chez les patients présentant des douleurs dans les 30 minutes suivant l’admission aux Urgences.
Dr Bernard-Alex Gaüzère
Référence
Camilla Bang et coll. : Rapid Rule-Out of Myocardial Infarction After 30 Minutes as an Alternative to 1 Hour: The RACING-MI Cohort Study, Ann Emerg Med., 2022; 79: 102-112.
jim.fr
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2511
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Publié le 22/03/2022
Direct 22 mars : Record d’hospitalisations en Ecosse | La Bretagne rattrapée par la Covid
Cette veille quotidienne vous permet de retrouver rapidement certaines des informations brèves concernant l’épidémie actuelle.
15h - Gilles Pialoux appelle les Français à garder le masque
Interrogé sur BFM TV ce lundi, le Pr Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l’hopital Tenon à Paris, appelle les Français à continuer à porter le masque bien qu’il ne soit plus obligatoire. Même s’il reconnait que les hôpitaux soient loin d’être débordés, il estime qu’il faut rester vigilant. « Les Français auront les vagues qu’ils méritent », lance-t-il sur un ton accusateur.
14h - La Bretagne rattrapée par la Covid
Généralement épargnée lors des précédentes vagues épidémiques, la Bretagne est actuellement la région la plus durement touchée par le rebond de l’épidémie. Au Finistère, le taux d’incidence est de 1 527,7 cas pour 100 000 habitants par semaine, contre 897,6 au niveau national.
13h - Un anti-masque jugé pour meurtre
Le 18 septembre 2021, un Allemand de 50 abattait un employé de station-service qui lui avait demandé de mettre un masque. 6 mois après, son procès pour meurtre s’est ouvert ce lundi au tribunal de Bad Kreuznach dans l’ouest de l’Allemagne. L’enjeu du procès sera notamment de déterminer si l’accusé était lié à des groupes d’extrémistes opposés aux mesures sanitaires
12h - Une nouvelle mégapole chinoise sous confinement
Après Shenzhen (17 millions d’habitants) et Jillin (9 millions), c’est la ville de Shenyang (9 millions), dans le nord-est de la Chine, qui a été placée sous confinement. Dans le cadre de la stratégie zéro-Covid adoptée par Pékin, au moindre foyer de contamination doit répondre un confinement ciblé. Le pays connait actuellement sa pire vague épidémique depuis début 2020.
11h - Retour du masque en intérieur en Autriche
A peine deux semaines après l’avoir abandonné, l’Autriche va de nouveau rendre obligatoire le port d’un masque FFP2 en intérieur à compter de ce mercredi. Une décision qui intervient alors que le nombre de contaminations quotidienne est passé en trois semaines de 25 000 à 45 000, un nouveau record. La levée des restrictions « a été trop étendue et trop précoce » a reconnu le ministre de la santé ce vendredi.
10h - Record d’hospitalisations en Ecosse
Plus de 2 100 Ecossais atteints du Covid-19 étaient hospitalisés au 18 mars, un record depuis le début de la pandémie. Un nombre important de ces cas sont cependant des Covid fortuits, hospitalisés pour d’autres raisons. La hausse des contaminations en Ecosse a conduit le gouvernement à maintenir l’obligation de porter un masque dans les transports publics, qui devait prendre fin ce lundi mais qui restera en vigueur jusqu’à début avril.
9h - Point sur la situation en France
Selon les données de Santé publique France arrêtées au soir du 21 mars, on comptabilise :
• 24 179 nouveaux cas de Covid-19 (vs 18 853 cas le 14 mars)
• 20 706 personnes hospitalisées pour Covid-19 (- 219 en une semaine)
• 1 632 personnes hospitalisées en soins critiques (- 194 en une semaine)
• 791 morts au cours de la semaine
• 141 085 morts depuis le début de l’épidémie (64 780 en 2020, 58 961 en 2021, 17 344 en 2022)
8h - Un point de situation dans le monde
Selon les dernières statistiques publiées par l’université John Hopkins de Baltimore, depuis le début de la pandémie 472 253 085 cas de Covid ont été identifiés dans le monde qui ont contribué à 6 094 903 décès. Ces quatre dernières semaines, les pays les plus impactés par la Covid sont, en nombre de contaminations la Corée du Sud (7 778 806), le Vietnam (5 255 388) et l’Allemagne (5 004 838) et en nombre de décès les Etats-Unis (34 659), la Russie (18 315), le Brésil (12 677).
_________
Publié le 16/03/2022
Réaction allergique grave après vaccination anti-covid, le rappel est-il possible ?
La vaccination contre le SARS-CoV-2 réduit efficacement le risque d’infection et d’évolution sévères. Ses effets secondaires graves sont peu fréquents, dont la possibilité de survenue de réactions allergiques sévères, avec une fréquence de 7,9 cas par million d’individus. Il était précédemment recommandé de ne pas injecter de dose vaccinale additionnelle chez les sujets ayant présenté une réaction allergique immédiate après une première dose de vaccin à ARNm contre la Covid-19. Cette préconisation s’oppose à la pratique courante en allergologie, qui ne contre-indique pas la ré administration d’un vaccin non Covid après une réaction ayant suivi la première dose vaccinale. L’immunologie des réactions allergiques est mal connue et le paradigme assumant qu’après une première réaction allergique post-vaccination, il y a un risque de réaction allergique grave, menaçant le pronostic vital lors de la seconde injection, est à reconsidérer de façon critique.
Derek Chu et collaborateurs ont tenté de quantifier, dans le cadre d’une revue systématique avec méta-analyse, le risque de seconde réaction allergique grave, de type, anaphylactique, lors de l’administration d’une deuxième dose de vaccin à ARNm anti Covid-19, chez les individus ayant présenté une réaction allergique immédiate après leur première dose vaccinale. Ils se sont aidés d’une recherche bibliographique dans MEDLINE, Embase, Web of Science et le World Health Organization Global Coronavirus Database, depuis leur création jusqu’ au 4 Octobre 2022. N’étaient pas incluses dans l’étude les réactions plus tardives, survenues plus de 4 heures après la revaccination. Le nombre total de revaccinations pratiquées après une première réaction allergique a été noté, leur gravité pouvant aller d’une réaction légère à une majeure menaçant le pronostic vital ainsi que l’administration ou non d’adrénaline injectable. Le principal paramètre analysé a été la fréquence des réactions allergiques précoces graves suivant la seconde injection. Les autres paramètres étaient les réactions moins sévères, objectives ou subjectives. Plusieurs analyses de sensibilité ont été menées, excluant notamment les observations incomplètes. En dernier lieu, différents sous-groupes ont été examinés, fonction de tests cutanés et d’une prémédication éventuelle, des risques de biais des publications retenues ou des dosages administrés. L’hétérogénéité des articles médicaux a aussi été prise en compte.
Bonne tolérance de la seconde injection dans la très grande majorité des cas
Vingt-deux publications ont été sélectionnées : analyses de cohorte, suivis ou rapports de cas. Elles concernent un total de 1 366 individus. L’âge moyen est de 46,1 ans ; 87,8 % sont des femmes. Tous ont présenté une réaction grave après leur première injection vaccinale. Toutes les revaccinations ont été faites sous la surveillance directe d’un allergologue et effectuées avec un vaccin à ARNm.
On déplore, globalement, 6 réactions allergiques majeures sur 1 366 injections vaccinales, soit un risque absolu de 0,16 % (intervalle de confiance à 95 % IC : 0,01 à 2,94 %), le niveau de preuves étant modéré. Les 1 360 autres vaccinés ont bien toléré la seconde injection, soit un pourcentage de 99,82 % (IC : 97,09 à 99,99 %). Il faut noter que les réactions secondaires sévères sont toutes survenues chez des personnes qui avaient déjà eu une réaction grave lors de la première administration du vaccin, le risque absolu étant de 4,94 % (IC : 0,93- 22,28%) ; 74 autres sujets, qui avaient souffert d’une réaction grave lors de la première injection, n’ont manifesté aucune symptomatologie immédiate lors de l’injection de rappel. Il n’y a eu aucun décès parmi les 6 patients victimes de réactions anaphylactiques, 5 d’entre elles s’étant rapidement amendées après injection intra musculaire d’adrénaline, le sixième patient ayant également récupéré dans de brefs délais sans avoir reçu d’adrénaline. Sur le reste de la cohorte, 232 personnes : 13,65 % (IC : 7,76- 22,9 %) ont développé une symptomatologie légère suivant leur injection de rappel. Parmi les 78 qui avaient eu une réaction grave lors de la première injection, seuls 15, soit 9,54 % ont eu une réaction immédiate secondaire d’importance modérée. Les diverses analyses de sensibilité et de sous- groupes, suivant la pratique confirment les résultats globaux.
Revacciner…avec prudence
Ainsi, avec un niveau de certitude modéré, il apparaît que l’incidence des réactions allergiques immédiates sévères, type anaphylaxie, lors d’une seconde injection d’un vaccin ARNm anti Covid-19, chez des individus ayant présenté une réaction grave lors de la première injection, est faible. La pratique d’une revaccination ne conduit pas, chez la plupart, à une réaction forte, seuls 13,5 % des individus en cause signalant la survenue de symptômes immédiats sans gravité. Ces constatations sont en opposition avec l’assertion commune qui fait redouter, lors d’une seconde injection, une réaction allergique parfois considérable, médiée par les immunoglobulines E, comme dans les cas d’allergie alimentaire. L’anaphylaxie causée par un vaccin ARNm pourrait ne pas être liée à un mécanisme IgE dépendant. Il n’existerait donc pas de contre-indication formelle à la pratique d’une revaccination après accident allergique immédiat lors de la primo-vaccination. Cette revaccination doit, cependant, être effectuée avec précaution, sous contrôle médical et dans des conditions permettant une prise en charge immédiate en cas de survenue d’une réaction de forte intensité. Une consultation préalable avec un allergologue est aussi envisageable.
Les conclusions de ce travail doivent faire l’objet de quelques réserves. Les données concernant les sites de vaccination et le type de vaccins doivent être précisées. Le nombre de sujets inclus dans la revue systématique a été relativement faible, tout comme le nombre d’articles dans la méta-analyse. Il a pu survenir des chevauchements d’observations et des biais de sélection. Enfin, dans tous les cas, la revaccination a été effectuée sous la surveillance d’un allergologue, ce qui peut rendre difficile la généralisation de la pratique.
En définitive, une revue systématique et une méta-analyse de 22 publications témoignent que le risque de réaction allergique sévère, type anaphylaxie, après deuxième injection de vaccin ARNm anti Covid-19, chez des sujets ayant fait une réaction immédiate sévère lors de la première injection, est faible, bien qu’environ un sur sept signale alors la survenue de signes modérés. Des travaux ultérieurs sont à venir pour confirmer cette bonne tolérance en cas de revaccination.
Dr Pierre Margent
Référence
Chu DK et coll. : Risk of Second Allergic Reaction to SARS-CoV-2 Vaccines. A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA Intern Med., 2022 ; publication avancée en ligne le 21 février. doi: 10.1001/jamainternmed.2021.8515.
_______________
Publié le 15/03/2022
Une histoire naturelle de l’urticaire au froid chez l’enfant
Les études sur l'urticaire au froid (UF) chez l’enfant sont rares. Pourtant, celle-ci semble responsable d'une morbidité importante et expose même à un risque de décès par anaphylaxie, ce qui a conduit Prosty et coll. à effectuer une étude prospective sur ce sujet mal connu à cet âge de la vie et à comparer les données obtenues avec celles dont nous disposons pour l'urticaire chronique spontanée (UCS).
Entre 2013 et 2021, dans deux hôpitaux de Montréal, les auteurs ont recruté de façon prospective 52 enfants présentant une UCS. Les données démographiques, les comorbidités, la gravité au moment de la présentation, la gestion et les résultats biologiques ont été recueillis au début de l'étude. Les patients ont été contactés chaque année pour évaluer l'évolution.
Les patients étaient un peu plus souvent de sexe féminin (51,9 %) avec un âge médian de 9,5 ans au moment de l'apparition des symptômes. La plupart ont été traités par des antihistaminiques H1 de deuxième génération (antiH1-2G). Une UF bien contrôlée par les antiH1-2G était négativement associée à une UCS (Odds Ratio ajusté aOR : 0,69 [intervalle de confiance à 95 % IC95 % : 0,53, 0,92]). Une hyperéosinophilie sanguine était corrélée à une anaphylaxie induite par le froid (aOR : 1,38 [IC à 95 % : 1,04, 1,83]) qui s’est manifestée chez 17,3 % des patients.
Le taux rémission des anaphylaxies induite par le froid était de 4,8 pour 100 patients/années, inférieur à celui de l'UCS (risque relatif ajusté à 0,43 [IC 95 % : 0,21, 0,89], p < 10−2). Cette étude montre que l'UF expose à un risque non négligeable d'anaphylaxie induite par le froid et que son taux de guérison est faible. L'éosinophilie sanguine et l'UCS associée peuvent être utiles pour prévoir l'évolution de l'UF.
Dans la littérature récente, on trouve plusieurs articles sur ce thème. Miles et coll. ont publié un article sur l'UCS dont il existe 3 formes : spontanée (78,5 %), la plus fréquente, inductible (14,1 %) et mixte (7,3 %), le plus souvent traitées par les anti-H1 de dernière génération alors que l'omalizumab est réservé aux formes réfractaires. Benelli et coll. ont rapporté un cas atypique d'anaphylaxie induite par le froid chez un garçon de 9 ans chaque fois qu'il nageait en mer et effectué une revue de la littérature où sont décrites les diverses formes d'urticaire chronique : une forme typique qui n'apparait que sur les sites exposés au froid et confirmée par le test de provocation au froid comme le test au glaçon, et une forme atypique où l'urticaire apparait aussi dans les zones non directement exposées au froid et où le test de provocation est négatif, davantage associée à une baisse généralisée de la température corporelle.
Pr Guy Dutau
Références
Prosty C, Gabrielli S, Mule P, Le Galle M, My Miles L, Le M, et coll. : Cold urticaria in a pediatric cohort: clinical characteristics, management, and natural history. Pediatr Allergy Immunol 2022; 33(3): e13751.
1) Miles LA et al. Clinical characteristics, management and natural history of chronic inducible urticaria in a pediatric cohort. Int Arch Allergy Immunol 2021; 182: 757-64.
2) Benelli E et al. Anaphylaxis in atypical cold urticaria : case report and review of literature. Ital J Pediatr 2018; 44:135. https://doi.org/10.1186/s13052-018-0578-6
jim.fr
Direct 22 mars : Record d’hospitalisations en Ecosse | La Bretagne rattrapée par la Covid
Cette veille quotidienne vous permet de retrouver rapidement certaines des informations brèves concernant l’épidémie actuelle.
15h - Gilles Pialoux appelle les Français à garder le masque
Interrogé sur BFM TV ce lundi, le Pr Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l’hopital Tenon à Paris, appelle les Français à continuer à porter le masque bien qu’il ne soit plus obligatoire. Même s’il reconnait que les hôpitaux soient loin d’être débordés, il estime qu’il faut rester vigilant. « Les Français auront les vagues qu’ils méritent », lance-t-il sur un ton accusateur.
14h - La Bretagne rattrapée par la Covid
Généralement épargnée lors des précédentes vagues épidémiques, la Bretagne est actuellement la région la plus durement touchée par le rebond de l’épidémie. Au Finistère, le taux d’incidence est de 1 527,7 cas pour 100 000 habitants par semaine, contre 897,6 au niveau national.
13h - Un anti-masque jugé pour meurtre
Le 18 septembre 2021, un Allemand de 50 abattait un employé de station-service qui lui avait demandé de mettre un masque. 6 mois après, son procès pour meurtre s’est ouvert ce lundi au tribunal de Bad Kreuznach dans l’ouest de l’Allemagne. L’enjeu du procès sera notamment de déterminer si l’accusé était lié à des groupes d’extrémistes opposés aux mesures sanitaires
12h - Une nouvelle mégapole chinoise sous confinement
Après Shenzhen (17 millions d’habitants) et Jillin (9 millions), c’est la ville de Shenyang (9 millions), dans le nord-est de la Chine, qui a été placée sous confinement. Dans le cadre de la stratégie zéro-Covid adoptée par Pékin, au moindre foyer de contamination doit répondre un confinement ciblé. Le pays connait actuellement sa pire vague épidémique depuis début 2020.
11h - Retour du masque en intérieur en Autriche
A peine deux semaines après l’avoir abandonné, l’Autriche va de nouveau rendre obligatoire le port d’un masque FFP2 en intérieur à compter de ce mercredi. Une décision qui intervient alors que le nombre de contaminations quotidienne est passé en trois semaines de 25 000 à 45 000, un nouveau record. La levée des restrictions « a été trop étendue et trop précoce » a reconnu le ministre de la santé ce vendredi.
10h - Record d’hospitalisations en Ecosse
Plus de 2 100 Ecossais atteints du Covid-19 étaient hospitalisés au 18 mars, un record depuis le début de la pandémie. Un nombre important de ces cas sont cependant des Covid fortuits, hospitalisés pour d’autres raisons. La hausse des contaminations en Ecosse a conduit le gouvernement à maintenir l’obligation de porter un masque dans les transports publics, qui devait prendre fin ce lundi mais qui restera en vigueur jusqu’à début avril.
9h - Point sur la situation en France
Selon les données de Santé publique France arrêtées au soir du 21 mars, on comptabilise :
• 24 179 nouveaux cas de Covid-19 (vs 18 853 cas le 14 mars)
• 20 706 personnes hospitalisées pour Covid-19 (- 219 en une semaine)
• 1 632 personnes hospitalisées en soins critiques (- 194 en une semaine)
• 791 morts au cours de la semaine
• 141 085 morts depuis le début de l’épidémie (64 780 en 2020, 58 961 en 2021, 17 344 en 2022)
8h - Un point de situation dans le monde
Selon les dernières statistiques publiées par l’université John Hopkins de Baltimore, depuis le début de la pandémie 472 253 085 cas de Covid ont été identifiés dans le monde qui ont contribué à 6 094 903 décès. Ces quatre dernières semaines, les pays les plus impactés par la Covid sont, en nombre de contaminations la Corée du Sud (7 778 806), le Vietnam (5 255 388) et l’Allemagne (5 004 838) et en nombre de décès les Etats-Unis (34 659), la Russie (18 315), le Brésil (12 677).
_________
Publié le 16/03/2022
Réaction allergique grave après vaccination anti-covid, le rappel est-il possible ?
La vaccination contre le SARS-CoV-2 réduit efficacement le risque d’infection et d’évolution sévères. Ses effets secondaires graves sont peu fréquents, dont la possibilité de survenue de réactions allergiques sévères, avec une fréquence de 7,9 cas par million d’individus. Il était précédemment recommandé de ne pas injecter de dose vaccinale additionnelle chez les sujets ayant présenté une réaction allergique immédiate après une première dose de vaccin à ARNm contre la Covid-19. Cette préconisation s’oppose à la pratique courante en allergologie, qui ne contre-indique pas la ré administration d’un vaccin non Covid après une réaction ayant suivi la première dose vaccinale. L’immunologie des réactions allergiques est mal connue et le paradigme assumant qu’après une première réaction allergique post-vaccination, il y a un risque de réaction allergique grave, menaçant le pronostic vital lors de la seconde injection, est à reconsidérer de façon critique.
Derek Chu et collaborateurs ont tenté de quantifier, dans le cadre d’une revue systématique avec méta-analyse, le risque de seconde réaction allergique grave, de type, anaphylactique, lors de l’administration d’une deuxième dose de vaccin à ARNm anti Covid-19, chez les individus ayant présenté une réaction allergique immédiate après leur première dose vaccinale. Ils se sont aidés d’une recherche bibliographique dans MEDLINE, Embase, Web of Science et le World Health Organization Global Coronavirus Database, depuis leur création jusqu’ au 4 Octobre 2022. N’étaient pas incluses dans l’étude les réactions plus tardives, survenues plus de 4 heures après la revaccination. Le nombre total de revaccinations pratiquées après une première réaction allergique a été noté, leur gravité pouvant aller d’une réaction légère à une majeure menaçant le pronostic vital ainsi que l’administration ou non d’adrénaline injectable. Le principal paramètre analysé a été la fréquence des réactions allergiques précoces graves suivant la seconde injection. Les autres paramètres étaient les réactions moins sévères, objectives ou subjectives. Plusieurs analyses de sensibilité ont été menées, excluant notamment les observations incomplètes. En dernier lieu, différents sous-groupes ont été examinés, fonction de tests cutanés et d’une prémédication éventuelle, des risques de biais des publications retenues ou des dosages administrés. L’hétérogénéité des articles médicaux a aussi été prise en compte.
Bonne tolérance de la seconde injection dans la très grande majorité des cas
Vingt-deux publications ont été sélectionnées : analyses de cohorte, suivis ou rapports de cas. Elles concernent un total de 1 366 individus. L’âge moyen est de 46,1 ans ; 87,8 % sont des femmes. Tous ont présenté une réaction grave après leur première injection vaccinale. Toutes les revaccinations ont été faites sous la surveillance directe d’un allergologue et effectuées avec un vaccin à ARNm.
On déplore, globalement, 6 réactions allergiques majeures sur 1 366 injections vaccinales, soit un risque absolu de 0,16 % (intervalle de confiance à 95 % IC : 0,01 à 2,94 %), le niveau de preuves étant modéré. Les 1 360 autres vaccinés ont bien toléré la seconde injection, soit un pourcentage de 99,82 % (IC : 97,09 à 99,99 %). Il faut noter que les réactions secondaires sévères sont toutes survenues chez des personnes qui avaient déjà eu une réaction grave lors de la première administration du vaccin, le risque absolu étant de 4,94 % (IC : 0,93- 22,28%) ; 74 autres sujets, qui avaient souffert d’une réaction grave lors de la première injection, n’ont manifesté aucune symptomatologie immédiate lors de l’injection de rappel. Il n’y a eu aucun décès parmi les 6 patients victimes de réactions anaphylactiques, 5 d’entre elles s’étant rapidement amendées après injection intra musculaire d’adrénaline, le sixième patient ayant également récupéré dans de brefs délais sans avoir reçu d’adrénaline. Sur le reste de la cohorte, 232 personnes : 13,65 % (IC : 7,76- 22,9 %) ont développé une symptomatologie légère suivant leur injection de rappel. Parmi les 78 qui avaient eu une réaction grave lors de la première injection, seuls 15, soit 9,54 % ont eu une réaction immédiate secondaire d’importance modérée. Les diverses analyses de sensibilité et de sous- groupes, suivant la pratique confirment les résultats globaux.
Revacciner…avec prudence
Ainsi, avec un niveau de certitude modéré, il apparaît que l’incidence des réactions allergiques immédiates sévères, type anaphylaxie, lors d’une seconde injection d’un vaccin ARNm anti Covid-19, chez des individus ayant présenté une réaction grave lors de la première injection, est faible. La pratique d’une revaccination ne conduit pas, chez la plupart, à une réaction forte, seuls 13,5 % des individus en cause signalant la survenue de symptômes immédiats sans gravité. Ces constatations sont en opposition avec l’assertion commune qui fait redouter, lors d’une seconde injection, une réaction allergique parfois considérable, médiée par les immunoglobulines E, comme dans les cas d’allergie alimentaire. L’anaphylaxie causée par un vaccin ARNm pourrait ne pas être liée à un mécanisme IgE dépendant. Il n’existerait donc pas de contre-indication formelle à la pratique d’une revaccination après accident allergique immédiat lors de la primo-vaccination. Cette revaccination doit, cependant, être effectuée avec précaution, sous contrôle médical et dans des conditions permettant une prise en charge immédiate en cas de survenue d’une réaction de forte intensité. Une consultation préalable avec un allergologue est aussi envisageable.
Les conclusions de ce travail doivent faire l’objet de quelques réserves. Les données concernant les sites de vaccination et le type de vaccins doivent être précisées. Le nombre de sujets inclus dans la revue systématique a été relativement faible, tout comme le nombre d’articles dans la méta-analyse. Il a pu survenir des chevauchements d’observations et des biais de sélection. Enfin, dans tous les cas, la revaccination a été effectuée sous la surveillance d’un allergologue, ce qui peut rendre difficile la généralisation de la pratique.
En définitive, une revue systématique et une méta-analyse de 22 publications témoignent que le risque de réaction allergique sévère, type anaphylaxie, après deuxième injection de vaccin ARNm anti Covid-19, chez des sujets ayant fait une réaction immédiate sévère lors de la première injection, est faible, bien qu’environ un sur sept signale alors la survenue de signes modérés. Des travaux ultérieurs sont à venir pour confirmer cette bonne tolérance en cas de revaccination.
Dr Pierre Margent
Référence
Chu DK et coll. : Risk of Second Allergic Reaction to SARS-CoV-2 Vaccines. A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA Intern Med., 2022 ; publication avancée en ligne le 21 février. doi: 10.1001/jamainternmed.2021.8515.
_______________
Publié le 15/03/2022
Une histoire naturelle de l’urticaire au froid chez l’enfant
Les études sur l'urticaire au froid (UF) chez l’enfant sont rares. Pourtant, celle-ci semble responsable d'une morbidité importante et expose même à un risque de décès par anaphylaxie, ce qui a conduit Prosty et coll. à effectuer une étude prospective sur ce sujet mal connu à cet âge de la vie et à comparer les données obtenues avec celles dont nous disposons pour l'urticaire chronique spontanée (UCS).
Entre 2013 et 2021, dans deux hôpitaux de Montréal, les auteurs ont recruté de façon prospective 52 enfants présentant une UCS. Les données démographiques, les comorbidités, la gravité au moment de la présentation, la gestion et les résultats biologiques ont été recueillis au début de l'étude. Les patients ont été contactés chaque année pour évaluer l'évolution.
Les patients étaient un peu plus souvent de sexe féminin (51,9 %) avec un âge médian de 9,5 ans au moment de l'apparition des symptômes. La plupart ont été traités par des antihistaminiques H1 de deuxième génération (antiH1-2G). Une UF bien contrôlée par les antiH1-2G était négativement associée à une UCS (Odds Ratio ajusté aOR : 0,69 [intervalle de confiance à 95 % IC95 % : 0,53, 0,92]). Une hyperéosinophilie sanguine était corrélée à une anaphylaxie induite par le froid (aOR : 1,38 [IC à 95 % : 1,04, 1,83]) qui s’est manifestée chez 17,3 % des patients.
Le taux rémission des anaphylaxies induite par le froid était de 4,8 pour 100 patients/années, inférieur à celui de l'UCS (risque relatif ajusté à 0,43 [IC 95 % : 0,21, 0,89], p < 10−2). Cette étude montre que l'UF expose à un risque non négligeable d'anaphylaxie induite par le froid et que son taux de guérison est faible. L'éosinophilie sanguine et l'UCS associée peuvent être utiles pour prévoir l'évolution de l'UF.
Dans la littérature récente, on trouve plusieurs articles sur ce thème. Miles et coll. ont publié un article sur l'UCS dont il existe 3 formes : spontanée (78,5 %), la plus fréquente, inductible (14,1 %) et mixte (7,3 %), le plus souvent traitées par les anti-H1 de dernière génération alors que l'omalizumab est réservé aux formes réfractaires. Benelli et coll. ont rapporté un cas atypique d'anaphylaxie induite par le froid chez un garçon de 9 ans chaque fois qu'il nageait en mer et effectué une revue de la littérature où sont décrites les diverses formes d'urticaire chronique : une forme typique qui n'apparait que sur les sites exposés au froid et confirmée par le test de provocation au froid comme le test au glaçon, et une forme atypique où l'urticaire apparait aussi dans les zones non directement exposées au froid et où le test de provocation est négatif, davantage associée à une baisse généralisée de la température corporelle.
Pr Guy Dutau
Références
Prosty C, Gabrielli S, Mule P, Le Galle M, My Miles L, Le M, et coll. : Cold urticaria in a pediatric cohort: clinical characteristics, management, and natural history. Pediatr Allergy Immunol 2022; 33(3): e13751.
1) Miles LA et al. Clinical characteristics, management and natural history of chronic inducible urticaria in a pediatric cohort. Int Arch Allergy Immunol 2021; 182: 757-64.
2) Benelli E et al. Anaphylaxis in atypical cold urticaria : case report and review of literature. Ital J Pediatr 2018; 44:135. https://doi.org/10.1186/s13052-018-0578-6
jim.fr
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2511
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Quand l'art s'invite au cabinet médical : témoignages
Nathalie Haidlauf
Auteurs et déclarations 14 mars 2022
Source: Medscape.fr
Peintures, sculptures, design mobilier… de nombreux médecins décorent leur cabinet d'œuvres d'art. Celles-ci peuvent avoir des effets positifs sur la santé, notamment en réduisant l’anxiété des patients ou en atténuant la douleur . Le site d’information médicale allemand Coliquio a lancé une discussion en ligne auprès de ces lecteurs : "Comment utilisez-vous les objets d'art dans votre pratique médicale ? Les exposez-vous en salle de soins ou en salles d’attente ? Quelle a été votre expérience ?" Voici les principaux témoignages des médecins qui ont participé à la discussion.
Rechercher avant tout un effet positif
Tous les médecins qui se sont exprimés sur l’utilisation d'œuvres d’art en consultation s'accordent sur une exigence simple : les patients doivent « se sentir bien ». Selon l'OMS, l'art peut avoir un effet apaisant et atténuer la peur éventuelle des actes invasifs. C’est pourquoi beaucoup de soignants ont indiqué miser sciemment sur des œuvres "apaisantes". Une gynécologue explique ainsi choisir des tableaux qui « s'intègrent bien dans l'ambiance et émettent un rayonnement positif. » Un psychothérapeute explique : « Une grande partie de mes patients souffrent de traumatismes complexes et sont très tendus. Si le choix porte sur des tableaux, je conseille qu'ils soient plutôt de genre abstrait, ou qu'ils montrent la nature (paysages ou animaux). Le cabinet doit être ressenti comme un lieu sûr, qui ne déclenche pas d'angoisse. »
L'art qui renforce la relation médecin-patient
Décorer les locaux du cabinet ou de la clinique avec des œuvres de patients est également une méthode très répandue. L'éventail des travaux réalisés en tant que loisirs est large : bricolage, crochet, poterie, décorations de Noël… Il est moins question de la valeur esthétique que de l'appréciation du cadeau fait aux soignants, selon un pédiatre. « Nous nous réjouissons de ces dons, et les artistes apprécient les félicitations. Il arrive de temps à autre qu'une petite réprimande nous soit adressée à cause d'une modification de la déco. Par exemple, lorsqu'un panier de Pâques a momentanément été rangé alors que nous sommes en automne... » précise-t-il.
La créativité de celui qui offre ne semble pas connaître de limites, comme le rapporte un médecin interniste : « Je connais un chef de service de chirurgie qui s'est vu remettre par un patient cholécystectomisé une petite image en mosaïque qu'il avait réalisée avec ses calculs biliaires. L'image a été encadrée et accrochée derrière son bureau… »
L'art comme partie intégrante du traitement
Lorsque les patients souffrent d'un manque d'estime de soi et de reconnaissance, l'exposition de leurs œuvres peut devenir une expérience marquante, comme le rapporte un soignant exerçant en psychiatrie et psychothérapie : « Dans la plupart des cas, c'est la première fois que les patients montrent leurs œuvres à un public plus large que leur entourage proche. C'est très valorisant pour eux, et certains sont encouragés à considérer leur créativité comme une ressource importante. Mon cabinet est agréable et varié. Il n'est jamais en manque d'œuvres, j'ai toujours une 'liste d'attente' de patients qui souhaitent en exposer chez moi. »
L'art qui réunit
D'autres utilisent leurs locaux pour donner un peu de visibilité à des artistes de leur région. Un neurochirurgien qui travaille dans un centre de soins médicaux, raconte avoir vécu des moments très agréables à l'occasion d'expositions temporaires. Des vernissages sont organisés tous les trois mois. C’est une bonne opportunité, pour l'équipe, de se réunir dans une atmosphère détendue avec des amis et des connaissances, ainsi qu'avec des patients. Les frais de restauration sont pris en charge par le centre médical et les recettes provenant de la vente des œuvres reviennent aux artistes et aux créateurs.
Un autre médecin approuve : « Je connais plusieurs cliniques qui font décorer leurs murs par des artistes locaux, et il y a toujours une étiquette de prix en dessous. Ainsi, tout le monde est gagnant. »
Un pédiatre s'est dit très fier des tableaux d'actionpainting grand format qui ont été réalisés spécialement pour son cabinet par des enfants de 3 à 6 ans dans le cadre d'une action lancée par une association de soutien aux personnes handicapées (Lebenshilfe) : ces tableaux « font partie du décor de mon cabinet depuis 15 ans maintenant. Le cabinet en est devenu propriétaire suite à une généreuse donation. »
Une salle d'attente en forme d'œuvre d'art total
L'effet produit par une pièce ne dépend pas seulement de la décoration des murs : un médecin interniste raconte qu'il a aménagé sa salle d'attente, il y a de nombreuses années déjà, dans le style d'un café viennois, avec des fauteuils Thonet, des magazines et une machine à expresso… Il a eu ensuite l'envie de faire quelque chose de nouveau : « À l'occasion de mon 20e anniversaire de consultation, j'ai voulu rénover entièrement cette pièce et j'ai mis en place pendant 6 mois un questionnaire avec des propositions. À ma grande joie (et surprise), 100% des personnes interrogées ont écrit que tout devait rester en l'état. Le commentaire le plus gentil d'un patient était : 'C'est dommage que le temps d'attente soit toujours assez court chez vous, je peux si bien me détendre dans votre salle d'attente'. J'ai alors simplement fait repeindre les portes et retapisser la pièce avec un papier peint similaire. »
Nathalie Haidlauf
Auteurs et déclarations 14 mars 2022
Source: Medscape.fr
Peintures, sculptures, design mobilier… de nombreux médecins décorent leur cabinet d'œuvres d'art. Celles-ci peuvent avoir des effets positifs sur la santé, notamment en réduisant l’anxiété des patients ou en atténuant la douleur . Le site d’information médicale allemand Coliquio a lancé une discussion en ligne auprès de ces lecteurs : "Comment utilisez-vous les objets d'art dans votre pratique médicale ? Les exposez-vous en salle de soins ou en salles d’attente ? Quelle a été votre expérience ?" Voici les principaux témoignages des médecins qui ont participé à la discussion.
Rechercher avant tout un effet positif
Tous les médecins qui se sont exprimés sur l’utilisation d'œuvres d’art en consultation s'accordent sur une exigence simple : les patients doivent « se sentir bien ». Selon l'OMS, l'art peut avoir un effet apaisant et atténuer la peur éventuelle des actes invasifs. C’est pourquoi beaucoup de soignants ont indiqué miser sciemment sur des œuvres "apaisantes". Une gynécologue explique ainsi choisir des tableaux qui « s'intègrent bien dans l'ambiance et émettent un rayonnement positif. » Un psychothérapeute explique : « Une grande partie de mes patients souffrent de traumatismes complexes et sont très tendus. Si le choix porte sur des tableaux, je conseille qu'ils soient plutôt de genre abstrait, ou qu'ils montrent la nature (paysages ou animaux). Le cabinet doit être ressenti comme un lieu sûr, qui ne déclenche pas d'angoisse. »
L'art qui renforce la relation médecin-patient
Décorer les locaux du cabinet ou de la clinique avec des œuvres de patients est également une méthode très répandue. L'éventail des travaux réalisés en tant que loisirs est large : bricolage, crochet, poterie, décorations de Noël… Il est moins question de la valeur esthétique que de l'appréciation du cadeau fait aux soignants, selon un pédiatre. « Nous nous réjouissons de ces dons, et les artistes apprécient les félicitations. Il arrive de temps à autre qu'une petite réprimande nous soit adressée à cause d'une modification de la déco. Par exemple, lorsqu'un panier de Pâques a momentanément été rangé alors que nous sommes en automne... » précise-t-il.
La créativité de celui qui offre ne semble pas connaître de limites, comme le rapporte un médecin interniste : « Je connais un chef de service de chirurgie qui s'est vu remettre par un patient cholécystectomisé une petite image en mosaïque qu'il avait réalisée avec ses calculs biliaires. L'image a été encadrée et accrochée derrière son bureau… »
L'art comme partie intégrante du traitement
Lorsque les patients souffrent d'un manque d'estime de soi et de reconnaissance, l'exposition de leurs œuvres peut devenir une expérience marquante, comme le rapporte un soignant exerçant en psychiatrie et psychothérapie : « Dans la plupart des cas, c'est la première fois que les patients montrent leurs œuvres à un public plus large que leur entourage proche. C'est très valorisant pour eux, et certains sont encouragés à considérer leur créativité comme une ressource importante. Mon cabinet est agréable et varié. Il n'est jamais en manque d'œuvres, j'ai toujours une 'liste d'attente' de patients qui souhaitent en exposer chez moi. »
L'art qui réunit
D'autres utilisent leurs locaux pour donner un peu de visibilité à des artistes de leur région. Un neurochirurgien qui travaille dans un centre de soins médicaux, raconte avoir vécu des moments très agréables à l'occasion d'expositions temporaires. Des vernissages sont organisés tous les trois mois. C’est une bonne opportunité, pour l'équipe, de se réunir dans une atmosphère détendue avec des amis et des connaissances, ainsi qu'avec des patients. Les frais de restauration sont pris en charge par le centre médical et les recettes provenant de la vente des œuvres reviennent aux artistes et aux créateurs.
Un autre médecin approuve : « Je connais plusieurs cliniques qui font décorer leurs murs par des artistes locaux, et il y a toujours une étiquette de prix en dessous. Ainsi, tout le monde est gagnant. »
Un pédiatre s'est dit très fier des tableaux d'actionpainting grand format qui ont été réalisés spécialement pour son cabinet par des enfants de 3 à 6 ans dans le cadre d'une action lancée par une association de soutien aux personnes handicapées (Lebenshilfe) : ces tableaux « font partie du décor de mon cabinet depuis 15 ans maintenant. Le cabinet en est devenu propriétaire suite à une généreuse donation. »
Une salle d'attente en forme d'œuvre d'art total
L'effet produit par une pièce ne dépend pas seulement de la décoration des murs : un médecin interniste raconte qu'il a aménagé sa salle d'attente, il y a de nombreuses années déjà, dans le style d'un café viennois, avec des fauteuils Thonet, des magazines et une machine à expresso… Il a eu ensuite l'envie de faire quelque chose de nouveau : « À l'occasion de mon 20e anniversaire de consultation, j'ai voulu rénover entièrement cette pièce et j'ai mis en place pendant 6 mois un questionnaire avec des propositions. À ma grande joie (et surprise), 100% des personnes interrogées ont écrit que tout devait rester en l'état. Le commentaire le plus gentil d'un patient était : 'C'est dommage que le temps d'attente soit toujours assez court chez vous, je peux si bien me détendre dans votre salle d'attente'. J'ai alors simplement fait repeindre les portes et retapisser la pièce avec un papier peint similaire. »
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2511
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Publié le 28/03/2022
Le monde s’interroge sur la quatrième dose
Les premières données scientifiques confirment l’efficacité de la 4ème dose, mais médecins et politiques restent prudent sur la question.
Comme toujours depuis l’arrivée des premiers vaccins contre la Covid-19 en décembre 2020, Israël aura été un pionnier. Le 31 décembre dernier, l’Etat hébreu est devenu le premier pays à administrer une quatrième dose de vaccin aux personnes âgées de plus de 60 ans.
Trois mois plus tard, 735 000 Israéliens ont reçu un deuxième rappel vaccinal, soit 40 % de la population âgée de plus de 60 ans.
78 % de risque de décès en moins avec quatre doses
Les scientifiques locaux sont donc déjà en mesure d’évaluer l’efficacité de la quatrième dose en population générale. A première vue, les résultats semblent sans appel. Selon une étude menée auprès de 560 000 patients (330 000 avec quatre doses et 235 000 avec trois doses), l’administration d’une quatrième dose diminue de 78 % le risque de décès comparé à seulement trois doses. Mais les auteurs de l’étude reconnaissent certaines limites à leur évaluation, notamment le fait qu’elle a été réalisé sur une période courte (seulement 40 jours) et qu’ils n’ont pas pu comparer la protection apportée par une quatrième dose et celle due à une précédente infection.
Comme souvent depuis le début de la vaccination de masse, les pays occidentaux ont suivi l’exemple israélien et ont tour à tour lancé une nouvelle campagne de vaccination de rappel à destination des personnes les plus âgées. C’est le cas notamment en Espagne, en Suède, en Australie et au Royaume-Uni. En France, l’administration d’une nouvelle dose de rappel aux personnes de plus de 80 ans et aux résidents d’Ehpad qui ont reçu leur dernière dose depuis au moins 3 mois a commencé le 14 mars après une décision gouvernementale. Dans un avis publié le 18 mars, la Haute Autorité de Santé (HAS) a en partie pris le contre-pied de cette décision, préconisant que la quatrième dose puisse être administrée à toutes personnes de plus de 65 ans à risque de forme grave, mais seulement 6 mois après la précédente injection.
Attention à la fatigue vaccinale
Alors que le nombre de contaminations augmente dans de nombreux pays en raison du variant Omicron BA2, certains se demandent s’il ne serait pas préférable d’étendre encore plus cette nouvelle vaccination. C’est le cas aux Etats-Unis, où la FDA, l’agence du médicament américaine, s’apprêterait à recommander une nouvelle injection pour tous les Américains de plus de 50 ans (contre 65 actuellement). Une décision loin de faire l’unanimité outre-Atlantique. « Nous n’avons aucune preuve définitive que donner une deuxième dose de rappel aux personnes âgés est nécessaire » estime Celine Gounder, professeur d’infectiologie à New York, qui considère que les données israéliennes ne sont pas suffisantes pour justifier cette nouvelle vaccination.
La question d’étendre le bénéfice de la quatrième dose à tous les adultes se pose cependant. Pour le moment, les scientifiques sont presque unanimes pour considérer qu’aucune donnée ne justifie une telle extension. « Il n’est pas pertinent de recommander actuellement l’administration d’une seconde dose de rappel en population générale » résume la HAS. On se souvient cependant que le même type de discours était tenu lorsqu’une troisième dose commençait à être administrée aux personnes âgées en septembre dernier, avant d’être rendu quasiment obligatoire pour tous les adultes. Le même scénario pourrait se reproduire avec la quatrième dose. Attention cependant à ne pas créer un sentiment de « fatigue vaccinale » et d’induire « un risque de désengagement à l’égard d’une vaccination perçue comme trop fréquente » prévient le Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale (COSV).
Quentin Haroche
____________
Publié le 24/03/2022
Une quatrième dose, vraiment ?
Alors que la question se pose avec de plus en plus d’insistance de l’intérêt d’une 4ème dose de vaccin contre la Covid-19, une étude israëlienne livre de nouvelles données. Cette étude avait pour objectif d’évaluer l’immunogénicité et la sécurité d’une 4ème dose de l’un des vaccins à ARNm, administrée 4 mois après la 3ème dose.
Les participants étaient tous des professionnels de santé appartenant à la cohorte Sheba (cohorte de près de 5 000 personnes de 47 ans d’âge moyen, recrutée dès le mois de décembre 2020 et à l’origine de plusieurs études sur l’efficacité vaccinale). Les uns (n = 154) ont reçu une 4ème dose du BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), les autres (n = 120) du vaccin mRNA-1273 (Moderna) une semaine plus tard. Chaque participant était « apparié » avec 2 cas-témoins du même âge, à jour des 3 doses vaccinales.
L’immunogénicité et la tolérance sont bonnes
Les données montrent que la 4ème dose entraîne une production d’anticorps dirigés contre le domaine de liaison aux récepteurs du SARS-CoV-2 et augmente les titres d’anticorps neutralisants. Chaque taux est augmenté par un facteur de 9 à 10, avec des titres très légèrement supérieurs à ceux obtenus après la 3ème dose, et sans différence significative entre les deux vaccins. Pendant ce temps, les taux d’anticorps des sujets témoins poursuivent leur décroissance. Les deux vaccins entrainent une augmentation de l’activité neutralisante contre le variant B.1.1.529 (omicron), identique à celle constatée après la 3ème dose. Les effets indésirables, symptômes locaux ou généraux, sont bénins.
Mais l’efficacité est modeste
L’étude était menée pendant une période de très forte incidence, avec une circulation considérée comme exclusive du variant omicron, et la surveillance active (test PCR hebdomadaire) a permis d’évaluer l’efficacité vaccinale. Au total 25 % des participants du groupe contrôle (3 doses) ont été infectés. Ils étaient 18,3 % parmi ceux ayant reçu la 4ème dose du vaccin Pfizer-BioNTech et 20,7 % parmi ceux ayant reçu la 4ème dose de Moderna. L’efficacité vaccinale est de 30 % pour le premier et 11 % pour le second. Si dans les 2 groupes, les personnes infectées n’ont signalé que des symptômes « négligeables », les charges virales étaient relativement élevées (Ct ≤ 25), suggérant une probable contagiosité. L’efficacité vaccinale semble supérieure vis-à-vis des formes symptomatiques (43 % pour le vaccin Pfizer-BioNTech et 31 % pour le Moderna).
Des avantages marginaux
En résumé, cet essai montre que la 4ème dose de vaccin à ARNm est immunogénique, bien tolérée, et somme toute modérément efficace. En termes de réponse humorale ou de taux des anticorps neutralisants spécifiques anti-omicron, la réponse vaccinale après la 4ème dose est sensiblement identique à ce qui est observé dans les suites de la 3ème dose. Ces résultats laissent penser que l’immunogénicité des vaccins à ARNm est atteinte après 3 doses et que la 4ème ne fait que rétablir le taux d’anticorps.
Ce constat, ajouté au fait que la charge virale élevée des professionnels de santé infectés suggère leur contagiosité et à la bénignité clinique des formes constatées, semble indiquer que la 4ème dose dans cette catégorie de population n’aurait que des avantages marginaux dans le contexte de ce variant omicron majoritaire.
Soulignons que l’étude n’incluait pas de personnes âgées ni vulnérables.
Dr Roseline Péluchon
Référence
Regev-Yochay G. et coll. : Efficacy of a Fourth Dose of Covid-19 mRNA Vaccine against Omicron. N Engl J Med. 2022 Mar 16. doi: 10.1056/NEJMc2202542.
______________
Publié le 18/03/2022
Hôpital public : la bureaucratie m’a tué
« Les Bureaux se hâtèrent de se rendre indispensables en se substituant à l’action vivante par l’action écrite, et ils créèrent une puissance d’inertie appelée le Rapport. (…) La France allait se ruiner malgré de si beaux rapports, et disserter au lieu d’agir. Il se faisait en France un million de rapports écrits par année ; aussi la bureaucratie régnait-elle ! ». Mais quel écrivain décrit si bien notre monde ? Un auteur contemporain ? Que nenni. Ces phrases sont celles de Balzac dans Les Employés ou la femme supérieure, paru en 1838.
Au rapport !
L’extrait a été cité il y a quelques semaines par le psychiatre Bernard Granger dans une tribune publiée dans l’Obs, qui évoque la façon dont la bureaucratie a peu à peu gangréné l’hôpital public, réduisant ses forces vives à l’inertie la plus pataude. Comme il le signale à la fin de son long texte, les armes face à l’envahisseur ne sont guère nombreuses, mais l’humour ne manque probablement pas d’atout. Il l’illustre d’ailleurs au fil de son texte qui débute ainsi : « L’hôpital public est un terrain d’observation privilégié du phénomène bureaucratique. L’opium des directions hospitalières actuelles est « le projet ». Quand un directeur ne sait plus quoi vous répondre et cherche à se débarrasser de vous, il ordonne : « Écrivez-moi un projet ! » Tout est projet : projet médical, projet managérial, projet social, projet de soins, projet d’établissement, projet financier, projet de pôle, projet de département, projet de service, projet de chefferie de service, projet pédagogique, projet des représentants des usagers, etc. Aucun projet ne se réalise comme prévu, car c’est une littérature fictionnelle qui donne l’impression d’avoir été rédigée sous l’emprise de stupéfiants. Et que dire de ces rapports annuels d’activité, enquêtes administratives, rapports d’étapes, feuilles de route, plans stratégiques, boîtes à outils, états prévisionnels, plans locaux de santé, plans globaux de financement pluriannuels, stratégie nationale de santé, pilotage de la transformation (là où il faudrait plutôt une transformation du pilotage), retours d’expérience (RETEX, dans ce verbiage bourré de sigles et d’acronymes dont plus personne ne finit par connaître la signification) ? Qui s’intéresse à ces fadaises ? Qui lit ces documents destinés à une étagère empoussiérée puis à la déchèterie ? ».
La valorisation de l’inaction
La charge ne se contente pas d’être comique : elle est une analyse de la façon dont la bureaucratie mine le fonctionnement de l’hôpital public. D’abord, parce qu’elle rend impossible toute maîtrise du temps. « La plus belle réussite de la bureaucratie, qui fait un tort considérable au monde hospitalier, est sans doute son aptitude à dilater le temps et à diluer les responsabilités. Ce qui dans la vraie vie prend une heure, prend dans la vie bureaucratique un trimestre, un semestre, une année », écrit Bernard Granger. D’autres l’ont observé, notamment à la faveur de la crise épidémique, qui de façon immédiate a réussi à faire sauter toutes les étapes de décision et de validation et de sur-validation qui semblaient auparavant indépassables. Un collectif de médecins écrivait ainsi au printemps 2020 dans le Figaro : « Cette crise a permis une réduction drastique des procédures administratives et une accélération des délais de réponse de la part de bureaux ou commissions d’ordinaire relancés des mois durant avant l’obtention d’un avis ou d’une décision. La suradministration doit s’effacer devant les principes de subsidiarité et de responsabilité des chefs de service et des représentants médicaux. On a pu sortir de cet enfer paperassier, il ne faudrait pas y retomber ».
Las, il semble que leur appel n’ait pas été entendu et que les mauvaises habitudes soient vite revenues hanter les couloirs des hôpitaux. De nouveau, le temps du remplissage de tableaux grignote celui qui devrait être consacré aux patients, l’inaction devenant plus valorisée que l’action.
Quand l’indicateur devient l’objectif
L’autre conséquence délétère de ce règne de la bureaucratie est la place donnée aux indicateurs, bientôt transformés en « objectifs ». « L’indicateur sature la langue managériale. On entend souvent politiques ou hauts fonctionnaires prononcer cette phrase appliquée à tous les domaines : « Il faudrait quelques indicateurs bien choisis, en petit nombre. » Derrière une apparence de bon sens, cette proposition de retenir quelques indicateurs « bien choisis » (on ne dit pas comment) cache une erreur conceptuelle désormais bien démontrée. La loi de Goodhart devrait pourtant être connue de nos élites : lorsqu’une mesure devient un objectif, elle cesse d’être une bonne mesure. Un indicateur manipulable transformé en objectif a immédiatement des effets pervers. Les exemples d’indicateurs pervertis ne manquent pas. Ce sont les flacons d’antiseptiques versés dans le lavabo dès que leur consommation a servi à évaluer le suivi des règles d’asepsie, ou le refus des malades difficiles par les chirurgiens cardiaques américains quand le taux de mortalité chez leurs opérés devait servir à les classer (indicateur rapidement abandonné) », énumère Bernard Granger. Si certains feront remarquer qu’une telle critique ne devrait pas conduire à renoncer à l’évaluation des performances (longtemps honnie dans l’univers hospitalier mais qui constitue pourtant un élément participant à l’amélioration de la qualité des soins), l’idée que ce diktat des « indicateurs » s’est substituée de façon délétère à une vision raisonnée et médicale de ce qu’est l’activité hospitalière est partagée par beaucoup. Ainsi, le point ultime de cette logique semble être la tarification à l’activité. « Qu’on en finisse avec cette politique de rentabilité des séjours, utiles ou non, du moment qu’ils «rapportent»! » écrivaient ainsi il y a deux ans les auteurs d’une tribune publiée dans le Figaro.
Quand l’ONDAM tue la T2A
Pire, la tarification à l’activité (T2A) pourrait elle-même être la victime d’une logique bureaucratique, c’est-à-dire d’une logique éloignée des réalités concrètes. C’est ce qu’expliquent les économistes de la santé Florence Jusot, Clémence Thébaut et Jérôme Wittwer dans Le Monde, qui remarquent que les effets pervers de la T2A sont notamment liés à la façon dont les tarifs sont fixés en France : « Si la T2A a mis en difficulté financière les établissements de santé, c’est parce qu’en France le tarif des séjours n’est pas équivalent à leur coût de production évalué par l’ATIH. En effet, il a été choisi d’ajuster les tarifs des séjours pour respecter les objectifs nationaux de dépenses d’assurance-maladie (Ondam), votés annuellement par le Parlement. (…) Dans les années qui ont suivi la mise en place de la T2A, l’Ondam était compris entre 4 % et 6 %. A partir de 2008, l’Ondam a baissé chaque année pour atteindre 1,75 % en 2016. Jusqu’en 2016, la dépense de soins hospitaliers était tirée vers le haut par les volumes dont l’augmentation annuelle était supérieure à celle de l’Ondam (environ 2 %). Pendant ce temps, les tarifs stagnaient, voire baissaient, ce qui est particulièrement remarquable dans un contexte où l’innovation technologique était constante et conduisait structurellement à une augmentation du coût de la prise en charge des patients. L’augmentation des volumes de soins hospitaliers sur cette période résulte en premier lieu du vieillissement de la population qui a augmenté ses besoins en soins. Elle résulte également des incitations adressées par les directions hospitalières à l’attention de leurs équipes. Les directions les ont incitées à augmenter les nombres de séjours pour compenser la baisse des tarifs, ce qui, à terme, était contreproductif, puisque cette augmentation des volumes a conduit à diminuer encore les tarifs des séjours. L’Ondam est une enveloppe fermée, plus le nombre de séjours augmente, plus les tarifs de ces séjours diminuent », décrivent-ils.
Vous souffrez des rapports ? Vite un rapport sur la souffrance !
Non contente d’entraîner une sclérose du système, la bureaucratie paraît également contaminer les réponses préconisées pour lutter contre ses méfaits. La lutte contre les souffrances psychosociales dans le monde hospitalier a ainsi été régulièrement mise sur le devant de la scène ces dernières. Cependant, ces actions sont-elles aussi mues par les mêmes mécaniques que celles qui sont (entre autres) à l’origine de la « souffrance des soignants », en se basant sur des indicateurs, des rapports et autres réunions de commissions. Bernard Granger citant le psychologue du travail Yves Clot remarque : « Il considère que proposer de « réparer » les conséquences psychiques des organisations de travail défaillantes par la « gestion » des risques psychosociaux est une aberration supplémentaire : « Pour tout dire, je ne crois pas que ceux qui travaillent dans ce pays soient des sinistrés à secourir. La victimologie ambiante, quand elle devient une gestion de la plainte “par en haut”, n’est souvent qu’un faux pas qui accroît, par un choc en retour, la passivité des opérateurs. […] Le monde du travail qui vient est un hybride social : une sorte de néofordisme se met en place, monté sur coussin compassionnel. La pression productiviste se dote d’amortisseurs psychologiques ». Ainsi, plutôt que de supprimer ce qui fait souffrir, on préconise d’accompagner la souffrance…
La thérapie par la rustine
Et comment ne pas penser qu’une des solutions récemment proposée par l’Agence régionale de Santé (ARS) d’Ile de France pour répondre à la pénurie d’effectifs infirmiers dans les hôpitaux franciliens n’est pas elle aussi le résultat d’une logique bureaucratique, qui refuse de prendre en compte ses propres dysfonctionnements et qui préfère la thérapie par la rustine. « Le dispositif proposé par l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, le 17 janvier, a achevé d’écœurer le personnel des hôpitaux publics de la région. Les infirmières travaillant en intérim se sont vu proposer des contrats à durée déterminée de six à neuf mois non renouvelables pour des salaires 30 % supérieurs à ceux des infirmières titulaires. S’il fallait persuader les infirmières restantes que leur engagement n’était pas reconnu, l’opération était parfaite. Pourquoi opter pour une fidélité sans valorisation salariale et avec des conditions de travail qui, chaque année, se détériorent ? (…) Pour éviter le crash complet, peut-on envisager que les thuriféraires de l’efficience entendent ce que les personnels non médicaux demandent ? » écrit en réponse à cette innovation de l’ARS un collectif de soignants dans le Monde.
Et s’il était trop tard ?
Pour certains, il pourrait être trop tard : la bureaucratie étant devenue un monstre autonome que ses « maîtres » ne parviennent plus à contrôler. Dans Libération, le consultant en santé Alexis Dussol écrit : « L’empilement des réformes et l’inflation des normes en tous genres ont transformé l’hôpital en monstre bureaucratique. Il n’est qu’à parcourir les quelque 300 pages du manuel de certification de la HAS pour s’en faire une idée. Les gouvernants ne savent plus trop comment s’y prendre pour le réformer ».
Les bureaucrates : des boucs émissaires faciles ?
Cependant, d’aucuns mettent en garde contre une critique facile de cette fameuse « bureaucratie » qui cacherait des desseins peu avouables pour l’hôpital public. Ainsi, dans Libération, le patron de la Fédération hospitalière de France (FHF), Frédéric Valletoux s’indigne des exagérations qu’il entend dans les discours de nombreux candidats à l’élection présidentielle : « Qu’a-t-on entendu ces derniers jours ? Que les hôpitaux publics seraient peuplés à 30 % de bureaucrates. Ah, la vieille rengaine… La crise n’est pas encore finie, et les décès se poursuivent, mais déjà ceux qui rêvent de livrer notre bouclier sanitaire aux mains du marché se réveillent. L’hôpital public a pris en charge plus de 80 % des patients Covid hospitalisés, a organisé des transferts sanitaires interrégionaux au plus fort de la crise, a dépêché des soignants en outre-mer (et il le fait encore aujourd’hui), a réorganisé tous ses services pour être capable de faire face à la saturation des réanimations, mais non, notre hôpital ne serait ni agile, ni réactif, ni admirable : il serait «bureaucratique». Je le redis donc avec force, les emplois administratifs à l’hôpital représentent 10 % des effectifs, pas 20 %, pas 30 %, pas 40 % : 10 %. Ce chiffre est pourtant en accès libre sur le site des statistiques du ministère de la Santé. Comme celui de 14 % d’emplois administratifs constatés dans les cliniques privées. Mais, trop soucieux d’attaquer nos hospitaliers pour respecter la vérité des faits, les habitués de l’hôpital-bashing se plaisent à intégrer la catégorie des secrétaires médicales à leurs calculs. Elles seront sans doute ravies d’apprendre qu’elles ne sont que des bureaucrates. Et une fois qu’on aura supprimé leurs postes pour débureaucratiser l’hôpital, les soignants seront ravis d’apprendre qu’ils doivent accueillir le public, gérer l’attente des patients aux urgences, organiser les agendas de tout leur service, ainsi que le suivi du dossier de leurs patients, etc ».
Difficile cependant de croire que dans les critiques formulées par Bernard Granger et beaucoup d’autres, ce sont les « secrétaires » qui soient visées, comme feint de l’assurer Frédéric Valletoux. C’est bien plus certainement le carcan des visions préformatées, du management par les seuls chiffres, symbolisés par l’hégémonie du « tableau Excel » qui sont dénoncés.
Des desseins peu avouables
Mais on retrouve également cette idée que la lutte affichée contre la bureaucratie ne pourrait être qu’un leurre sous la plume du professeur André Grimaldi. S’attaquant aux solutions proposées pour « sauver » l’hôpital public par deux anciens responsables de la FHF, il écrit ainsi dans le Journal du Dimanche : « Dans une tribune au journal Le Monde, Guy Collet et Gérard Vincent, deux anciens directeurs des hôpitaux et responsables de la Fédération hospitalière de France (FHF) prétendent sauver l’hôpital public grâce à trois mesures :1 : “confier aux régions la tutelle et la régulation du système de santé, les conseils régionaux devenant responsables des équilibres financiers” ; 2 : “inclure dans un service public de santé régional, l’ensemble des acteurs de santé, y compris les cliniques commerciales” ; 3 : “changer radicalement le statut de l’hôpital public en lui donnant celui de fondation”, c’est-à-dire, pour parler clair, d’une personne morale de droit privé à but non lucratif. Autrement dit pour défendre l’hôpital public auquel, ils déclarent “être viscéralement attachés”, ils proposent de le privatiser. (…) Au fond ils proposent d’appliquer à la santé au nom de la lutte contre la bureaucratie, le principe néolibéral : moins d’Etat, plus de marché » s’indigne André Grimaldi… Si on retrouve ici les combats de toujours du professeur de diabétologie, il est probable que les organisations managériales du privé n’ont probablement rien à envier à l’hôpital public en ce qui concerne les aberrations bureaucratiques et l’investissement disproportionné dans l’activité de reporting.
Ainsi, on le voit si la description des affres et des conséquences de la folie administrative sont aisées, il est plus difficile d’apprécier dans quelle mesure il pourrait être possible de se défaire de ce piège. Quelques pistes émergeront peut-être à la lecture de :
Bernard Granger : « Excel m’a tué » : comment la bureaucratie a asphyxié notre système hospitalier, https://www.nouvelobs.com/sante/2022012 ... alier.html#
Collectif de médecins, https://www.lefigaro.fr/vox/societe/lib ... e-20200503
Florence Jusot, Clémence Thébaut, Jérôme Wittwer
https://www.lemonde.fr/idees/article/20 ... _3232.html
Collectif de soignants : https://www.lemonde.fr/idees/article/20 ... _3232.html
Alexis Dussol : https://www.liberation.fr/idees-et-deba ... directed=1
Frédéric Valletoux :
https://www.liberation.fr/idees-et-deba ... 7NN3CMPHY/
André Grimaldi
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-la ... ic-4096114
Aurélie Haroche
_____________
Publié le 12/03/2022
Est-ce fou (et/ou dangereux ?) de penser Poutine fou ?
Paris, le samedi 12 mars 2022 – Les associations de patients n’aiment pas ça. Voir galvaudés les termes décrivant les maladies mentales, brandis les diagnostics à l’emporte pièce : elles y décèlent tout autant la manifestation du mépris que subissent les patients souffrant de ces pathologies et leurs proches et un risque d’aggravation de ce rejet. Cependant, ce qui se joue concernant Vladimir Poutine est un peu différent. Il s’agit bien sûr une fois encore pour certains de discréditer l’autre, de mettre à distance la peur qu’il nous inspire, de « psychiatriser » la réflexion pour s’éviter d’autres considérations, tant elles sont complexes (et angoissantes). Mais dans la gravité des paroles prononcées et dans l’implication récente de plusieurs spécialistes de la santé mentale, les « diagnostics » qui commencent à être esquissés au sujet du président russe sortent de l’habituel vacarme médiatique qui a vu de nombreux autres grands de ce monde avant lui considérés comme « fou » (tel récemment Donald Trump).
Le piège des visions « psychologisantes réductrices »
Discours « paranoïaques », « déconnectés de la raison » : ces observations sont celles depuis plusieurs jours des plus hauts responsables politiques français ou américains, quand Angela Merkel soutenait déjà il y a plusieurs années une même analyse. Aujourd’hui, le Dr Daniel Zagury, dans une tribune publiée dans Le Journal du Dimanche n’hésite pas à exploiter cette piste de la maladie mentale. Il s’aventure sur ce terrain complexe en toute conscience. « C’est à juste titre que l’on répugne généralement à donner trop d’importance à l’équation individuelle des dirigeants de ce monde, dans une vision psychologisante réductrice, et souvent ridicule. À ceux qui invoquent la folie du président russe, on oppose sa rationalité ; quand on pointe la démesure de sa fuite en avant, on convoque la grande continuité antérieure des menaces et des actions ; à des facteurs trop personnels, on objecte l’histoire. Le poids écrasant des données historiques et géopolitiques ne doit cependant pas nous conduire à sous-estimer le rôle de la pathologie mentale » écrit-il en introduction.
Comment passe-t-on de la méfiance professionnelle à la paranoïa maladive ?
L’expert auprès de la Cour de Paris considère que l’autocrate russe souffre de paranoïa et rappelle que c’est le propre de cette maladie de provoquer la confusion chez les observateurs. « Ce qui nous empêche de traiter la question avec lucidité, ce sont justement les caractéristiques propres de la paranoïa : c’est tout d’abord la continuité entre la personnalité de base et le délire. La paranoïa, c’est un caractère dont les signes cardinaux sont la psychorigidité, l’orgueil, la fausseté du jugement, l’hypertrophie du moi, et la méfiance. À partir de quel moment, dans une progressivité insensible, le caractère se prolonge-t-il en délire, l’orgueil en mégalomanie, la thématique centrale en conviction inébranlable, le mépris en destructivité et la méfiance en persécution ? À quel moment la paranoïa fonctionnelle de l’ancien dirigeant du KGB, amené professionnellement à se méfier de tout, se mue-t-elle en persécution délirante ? Poutine, même paranoïaque, n’a pas toujours été fou » remarque le psychiatre.
La fin du monde pour éviter la fin de son monde ?
Or, pour ce psychiatre, Vladimir Poutine est aujourd’hui rattrapé par la constatation de la « faillite » du système où il est enfermé. « La conduite actuelle de Vladimir Poutine n’est pas l’aboutissement logique de toute sa vie, mais l’échec de son idéalisation forcenée et de ses visées grandioses de retour à la Grande Russie. Nous le croyons fort alors qu’il est miné par la conscience pathétique de sa finitude, à l’approche de ses 70 ans. C’est le point central qu’il convient de prendre en compte si l’on veut éviter de sous-estimer l’ampleur du danger. La dimension suicidaire, celle-là même qui risque d’entraîner tant d’hommes dans sa chute, résulte d’une angoisse inassumable. Il n’est pas dans son logiciel d’accepter de vieillir, de composer avec l’ennemi interne, de mourir et de renoncer à ses illusions mégalomaniaques, en un point où sa personne et son glorieux pays se confondent. L’usure, le vieillissement, la situation économique de la Russie et la baisse de sa popularité l’ont amené au bord du gouffre, et le monde avec lui. C’est peut-être le Covid-19 qui l’y a précipité. Vladimir Poutine a été terrorisé par l’angoisse de le contracter, au point de faire construire des tunnels amovibles diffusant des produits désinfectants pour ses visiteurs et d’imposer une quarantaine à ceux qui devaient le rencontrer physiquement. Le virus est un ennemi insidieux que l’on ne peut pas bombarder. Nous sommes très au-delà de la simple peur et de mesures proportionnées », remarque encore Daniel Zagury. Il met cependant en garde : reconnaître le caractère pathologique de Vladimir Poutine ne doit pas conduire à discréditer tout ce qu’il fait et dit. « Il n’est plus temps d’accorder à sa parole la valeur que l’on attribue à la parole de ceux qui sont capables d’ajuster leur conduite à l’évolution de la situation. L’erreur inverse, tout aussi catastrophique, serait d’invalider tout ce qu’il énonce, avec ce préjugé qui ferait du délirant celui qui fait n’importe quoi. Sa rationalité est autre. Face à lui, la sobriété est de mise. Les propos de matamore ne font que faire flamber la persécution ».
Et s’il faisait semblant à dessein ?
L’analyse de Daniel Zagury, en particulier sa mise en évidence de la peur qui pourrait tenailler Vladimir Poutine de voir sa vie s’achever sans que son rêve de grandeur ne puisse être accompli, a été remarquée par beaucoup. Cependant, certains spécialistes invitent à conserver une forme de prudence. Ainsi, le Pr Antoine Pelissolo (CHU Henri Mondor de Créteil) rappelle l’impossibilité pour un praticien d’établir un diagnostic sans avoir examiné attentivement le patient. « Le président Russe montre une tendance mégalomaniaque que l'on retrouve d'ailleurs chez de très nombreux dirigeants : les politiques, les chefs d'entreprise et les chefs d'Etat, surtout les plus autoritaires. Elle se traduit par une très grande confiance en soi, une vision grandiose de soi-même ou du moins une très haute idée de sa valeur, la volonté de changer le monde. Tout cela n'est pas forcément négatif. Mais chez Vladimir Poutine, il y a en plus cette volonté d'écraser les autres, ainsi qu'un narcissisme prononcé. Cela révèle une véritable mégalomanie. On peut donc au moins dire qu'il a une personnalité mégalomaniaque. Ce trait pourrait suggérer une personnalité paranoïaque, d'autant qu'il en manifeste d'autres aspects, dont la méfiance des autres, alliés ou ennemis. Mais nous ne savons pas, par exemple, s'il a tendance à interpréter les intentions des autres comme malveillantes. Le diagnostic est donc impossible à poser, tout comme celui portant sur les délires paranoïaques. Il faudrait l'interroger au préalable, et donc passer du temps avec lui, tenter de comprendre pourquoi il agit ainsi. Sans compter que nous pourrions aussi envisager que ses déclarations s'intègrent dans une stratégie de communication, une mise en scène visant, justement, à faire croire qu'il est paranoïaque, pour faire peur » remarque le praticien. De la même manière, à propos d’une éventuelle dimension psychopathique, il constate : « Elle se traduit par la non-reconnaissance des règles (le président russe a violé les lois internationales avec cette déclaration de guerre), mais aussi par le manque d'empathie, car cette guerre va faire de nombreux morts. Mais on pourrait aussi opposer à cela qu'il a été élevé par l'armée, qu'il est bercé depuis tout petit dans un environnement fait de règles strictes qu'il a su respecter. Il reste impossible d'affirmer que Vladimir Poutine est psychopathe. Ce qui est sûr, c'est qu'il est agressif et ne semble pas avoir beaucoup de limites quant à l'atteinte de l'intégrité des autres ».
Une forme de déresponsabilisation facile
La possibilité de déterminer ou non l’état mental de Vladimir Poutine, qui on le voit suscite des interrogations et des divergences, n’intéresse pas uniquement les experts en psychiatrie, mais également les analystes politiques. Car cette conviction (ou non) que les actes du président russe sont (au moins en partie) guidés par une pathologie mentale proche de la paranoïa, peuvent influencer la manière de lui répondre. Or, cette tentation de voir d’abord en lui un « fou » pourrait s’avérer contre-productive. Elle serait en tout cas un aveu de notre faiblesse, une forme de renoncement à combattre, semble analyser Wiktor Stoczkowski, directeur d'études au laboratoire d'anthropologie sociale à l'EHESS dans le Figaro. « On parle de sa «détermination paranoïaque», de ses «obsessions», de ses «propos délirants », de sa « déraison », de sa « perte du sens des réalités », de sa « folie guerrière ». Cette explication hâtive vient à l'esprit des commentateurs avec la force de l'évidence, comme si le désir d'établir un diagnostic psychiatrique en garantissait l'adéquation et en même temps compensait l'incompétence médicale. Il y a peu on a employé le même procédé pour élucider les attentats islamistes : tout comme Poutine, les islamistes seraient des forcenés. Lorsqu'on ne parvient pas à expliquer les agissements d'autrui, on lui prête un dérèglement mental. On croit ainsi le comprendre, alors qu'en réalité on renonce à le comprendre, préférant renvoyer dans les limbes de la déraison ce qui échappe à notre entendement » avertit-il. Plus sévère, il relève que l’épouvantail de la folie est peut-être aujourd’hui dressé pour éviter à l’Occident d’admettre sa part de « laisser faire », son aveuglement, quand il conclut de façon ironique : « On aimerait croire que le seul problème soit la « folie » de Monsieur Poutine. Sans cette regrettable « folie », nous aurions pu commercer pacifiquement avec le dictateur russe, lui livrer nos technologies de pointe pour favoriser la modernisation de son pays, ouvrir nos ondes à la propagande de ses chaînes de télévision, tolérer son ingérence dans nos processus électoraux, accepter de devenir dépendants de son approvisionnement en énergie, lui verser en échange du gaz des sommes considérables qu'il emploie pour rendre puissante son armée ».
Et si c’était nous qui étions fous ?
De façon bien moins dramatique, c’est une mécanique proche qui se joue quand de façon plus cavalière (et bien moins argumentée médicalement que ce que propose le Dr Daniel Zagury) nous ironisons sur le « syndrome d’hybris » ou plus simplement la « folie » de nos dirigeants. Même s’il est certain qu’une forme d’hybris (au sens où les grecs l’entendaient et pas nécessairement les psychiatres) est sans doute indispensable pour se lancer à la conquête du pouvoir. Cataloguer ainsi les actions des tenants du pouvoir c’est oublier d’une part que nous les avons majoritairement élus et d’autre part que leurs actes sont souvent rendus possibles par l’état de la société et notre acceptation (il en est par exemple ainsi de la mise en place du passe vaccinal dont on ne peut pas uniquement attribuer la responsabilité à une « folie » du pouvoir mais à la propension de notre société à accepter voire à désirer un contrôle accru de nos vies quotidiennes).
Qu’on le croit fou, la chance de Vladimir Poutine !
Hypocrite, l’appréhension des actions de Vladimir Poutine par le biais de la psychiatrie, pourrait également être contre-productive. L’avocat William Goldnadel, qui admet-il lui-même a pourtant souvent tendance à fustiger « la folie » de ce monde, note ainsi : « Et voilà que déjà, viennent du camp adverse des conseils d'ordre psychologique de ne pas l'acculer ou le pousser à bout. Qu'il serait avisé de savoir donner à l'ours une porte de sortie pour apaiser sa folle colère. (…) Et il ne s'agit pas seulement de conseils d'ordre psychologique, mais de gestes également: ignorant la «rationalité» de Poutine, pour reprendre l'interrogation d'Isabelle Lasserre, le Pentagone a reporté un test de missiles balistiques intercontinentaux prévu pourtant de longue date.Ainsi, tandis que le président de Russie envahit un autre pays et brandit verbalement la menace de l'arme nucléaire, les États-Unis sont déjà dans l'accommodement prudent. Qu'on ne se méprenne surtout pas : je ne suis aucunement dans le jugement mais dans le constat. J'observe que l'irrationalité voire la démence prêtée à l'agresseur lui confère un avantage tactique et stratégique. «Retenez-moi ou je fais un malheur». Si j'étais un agent d'influence du FSB, je ferais tout pour faire passer mon président pour un dément », conclut-il rejoignant une hypothèse du professeur Antoine Pelissolo, quant à une possible simulation tactique.
Ces réflexions semblent en tout cas confirmer le caractère périlleux du diagnostic psychiatrique quand il sort du champ strictement médical, cette mauvaise habitude de faire de la psychiatrie une lecture du monde et non une spécialité comme une autre, et paraissent légitimer les mises en garde et même les déplorations des associations de patients. Malgré ces réserves, c’est avec une certaine forme de culpabilité que l’on relira :
Daniel Zagury
Antoine Pelissolo
Wiktor Stoczkowski
William Goldnadel
Aurélie Haroche
_____________________
Selon les données de Santé publique France arrêtées au soir du 27 mars, on comptabilise :
• 110 174 nouveaux cas de Covid-19 (vs 81 283 cas le 20 mars)
• 20 606 personnes hospitalisées pour Covid-19 (+ 40 en une semaine)
• 1 486 personnes hospitalisées en soins critiques (- 156 en une semaine)
• 739 morts au cours de la semaine
• 141 672 morts depuis le début de l’épidémie (64 780 en 2020, 58 961 en 2021, 17 931 en 2022)
- Un point de situation dans le monde
Selon les dernières statistiques publiées par l’université John Hopkins de Baltimore, depuis le début de la pandémie 480 957 051 cas de Covid ont été identifiés dans le monde qui ont contribué à 6 124 021 décès. Ces quatre dernières semaines, les pays les plus impactés par la Covid sont, en nombre de contaminations la Corée du Sud (8 868 598), le Vietnam (5 690 468) et l’Allemagne (4 712 847) et en nombre de décès les Etats-Unis (27 532), la Russie (16 087) et le Brésil (9 722).
____________
Publié le 28/03/2022
Plus de troubles neurologiques après la Covid-19 qu’après les vaccins
Actuellement, 5 vaccins contre le SARS-CoV-2 ont obtenu une autorisation conditionnelle de commercialisation en Europe : 2 vaccins à ARNm, 2 vaccins à vecteur viral et un vaccin adjuvé recombinant. Tous ont fait preuve de leur efficacité pour la prévention des formes graves de Covid-19 et ont un profil de sécurité satisfaisant. Toutefois la surveillance continue et des rapports récents d’effets indésirables ont signalé la survenue de syndromes de Guillain Barré après les vaccins à vecteur viral : 108 pour 21 millions de personnes vaccinées en juin 2021 pour le vaccin Ad.26.COV2.S (Johnson & Johnson) et 833 pour 592 millions de doses pour le ChAdOx1 nCoV19 (Astra Zeneca). Ceci a conduit l’Agence Européenne du médicament à faire figurer le syndrome de Guillain Barré comme un effet secondaire rare de ces vaccins. Des paralysies de Bell, des encéphalomyélites et des myélites transverses ont aussi été décrites dans des études de cas, après les vaccins à vecteur viral et les vaccins à ARNm. Bien que ces évènements ne soient pas obligatoirement dus aux vaccins, l’association temporelle réclame une surveillance attentive.
Incidence augmentée de la paralysie faciale, du Guillain Barré et des encéphalomyélites avec l’infection
Une équipe internationale a analysé les vastes bases de données concernant plus de 8,3 millions de personnes ayant reçu, au Royaume-Uni et en Espagne, au moins 1 dose de l’un des vaccins anti-Covid-19 autorisés dans l’Union européenne. L’étude inclut aussi une cohorte de 735 000 personnes non vaccinées, ayant été infectées par le SARS-CoV-2, et 14 millions de participants de la population générale. L’objectif était d’étudier l’association entre les vaccins, l’infection et le risque de maladie neurologique auto-immune.
Les données confirment la survenue possible de syndromes de Guillain Barré, de paralysie de Bell et d’encéphalomyélites, après la vaccination, mais à des taux attendus et conformes aux données déjà connues, ne constituant pas un nouveau signal d’alerte. En revanche, après une infection par le SARS-CoV-2, ces troubles neurologiques sont plus fréquents que ce qui était attendu en se référant aux études déjà publiées. L’incidence de la paralysie de Bell est augmentée de 30 %, celle des encéphalomyélites et multiplié par près de 7 et celle du syndrome de Guillain Barré par plus de 3. Les myélites transverses sont rares.
Dr Roseline Péluchon
Références
Li X. et coll. : Association between covid-19 vaccination, SARS-CoV-2 infection, and risk of immune mediated neurological events: population based cohort and self-controlled case series analysis.
BMJ2022;376:e068373. doi.org/10.1136/BMJ-2021-068373
______________
Publié le 25/03/2022
La Covid-19, même légère, touche le cerveau
Deux ans après l’apparition de la pandémie de SARS-CoV-2, des centaines de millions de personnes ont été atteintes par la Covid-19 et de nombreux travaux cherchent à identifier les effets à long terme de la maladie. L’anosmie et l’agueusie transitoires, ainsi que différents types de troubles psychiques et neurologiques, ont très vite suggéré un impact de la Covid-19 sur le cerveau, par neurotropisme du virus ou par neuroinflammation induite par l’infection.
Une équipe britannique a réalisé la première étude longitudinale majeure comparant les IRM de cerveaux de patients avant et après leur contamination par le SARS-CoV-2. Ils ont analysé les images de 785 patients, âgés de 51 à 81 ans, parmi lesquels 401 ont contracté la Covid-19. En moyenne, 141 jours séparaient le diagnostic et le second IRM. Leurs résultats, publiés dans la revue Nature, font apparaître plusieurs atteintes cérébrales en comparant les deux groupes. Par rapport à celles non contaminés, les personnes ayant été testées positives pour la Covid-19 présentent une réduction de la taille globale du cerveau et des marques de lésions tissulaires dans les régions fonctionnellement connectées au cortex olfactif primaire. Cette perte de matière grise n'était pas homogène pour tous les patients contaminés, et était plus marquée chez les patients ayant été hospitalisés.
De moins bons scores à certains tests neuropsychologiques pour les personnes contaminées
Les chercheurs ont aussi constaté une atteinte du cortex orbitofrontal et du gyrus parahippocampique, deux régions du cerveau impliquées dans la mémoire et la prise de décision. Si les patients infectés ne montraient pas de signe de déficience de la mémoire, ils obtenaient des scores inférieurs à un test d’aptitude neuropsychologique d’attention visuelle et d’exécution de tâche. Ce déclin cognitif persistait même après exclusion des quelques patients atteints d’une forme grave de la maladie et hospitalisés, ce qui confirme l’incidence de ces troubles même avec des formes légères de la Covid-19.
Ces travaux mettent pour la première fois en évidence une atteinte délétère du cerveau à la suite de l’infection par le SARS-CoV-2. Le caractère longitudinal de l’étude permet d’affirmer que ces atteintes sont très probablement consécutives à la contamination. Le suivi des patients permettra de déterminer la réversibilité des modifications, et si elles pourraient être à l’origine d’une vulnérabilité du cerveau à plus long terme. Enfin, il est important de mentionner que tous les variants du virus ne provoquent pas nécessairement ces dommages, puisque les examens d’IRM ont été réalisés lorsque le variant Alpha était largement majoritaire au Royaume-Uni. Les perturbations de l’odorat et du goût ne sont que rarement retrouvées avec le variant Omicron, maintenant majoritaire, ce qui suggère une atteinte différente du système nerveux central.
Dr Rémi Samain
Référence
Douaud G et coll., : SARS-CoV-2 is associated with changes in brain structure in UK Biobank. Nature, 2022; publication avancée en ligne le 7 mars. doi: 10.1038/s41586-022-04569-5.
__________
Une étude intéressante et finalement assez pertinente
Publié le 28/03/2022
Soutiens-gorge de sport : peut-on les laver ?
Pendant le sport, les seins sont exposés à des lésions anatomiques du fait du ballottement qu’ils subissent dans les trois dimensions, quel que soit leur volume. Un soutien-gorge de sport limite ces mouvements, réduisant ainsi l’inconfort et, surtout, les douleurs mammaires. Son efficacité tient à sa forme et à sa composition. Élasticité, capacité d’absorption et durabilité comptent parmi ses caractéristiques essentielles. De fait, l’élasthanne, le lycra, le polyester et autres tissus tricotés entrent couramment dans la fabrication de ces pièces de vêtement.
La recherche générale sur les textiles suggère que l’usage et le lavage répétés altèrent les propriétés de ces divers matériaux. Par exemple, les fibres perdent leur élasticité, tandis que les tissus tricotés rétrécissent. Se fondant sur ces constats, certains fabricants recommandent de remplacer les soutiens-gorge de sport tous les trois à six mois, ou après 25 lavages. Pourtant, les données spécifiques à ces vêtements font défaut, privant l’industrie du soutien-gorge, comme les professionnels de la santé ou du sport, de la possibilité de délivrer des conseils avisés aux usagères.
Pour en savoir plus, une équipe de l’université de Portsmouth (UK) a recruté 22 volontaires, âgées en moyenne de 21,6 ans, périmètre thoracique 75 cm, volume total de la poitrine 1 482 cm3, valeur de bonnet la plus fréquente : D. Elles ont reçu un même modèle de soutien-gorge de sport, noté comme très performant par la presse sportive.
Vers un manque de soutien
Au cours d’un test dynamique initial, sur tapis roulant à la vitesse de 10 km/h, les mouvements des seins ont été mesurés par microcapteurs électromagnétiques fixés sur le vêtement. Les femmes ont ensuite pratiqué leur sport (athlétisme, gymnastique, trampoline, tennis, etc.). Lorsqu’elles avaient atteint 25 lavages, en moyenne au bout de 85 jours (fréquence et températures conformes aux recommandations du fabricant), un test final était réalisé.
Ont été comparés : des soutiens-gorge utilisés et lavés (SUL), seulement lavés (SL) et ni utilisés ni lavés (témoins).
Par rapport aux témoins, SL et surtout SUL entraînaient une nette augmentation des déplacements latéraux ou verticaux des seins : + 20 % et 16 % pour les premiers, + 32 % et 25 % pour les seconds. Toutefois, la différence absolue était inférieure à 4,2 mm. Aucune variation n’a été notée dans le sens antéro-postérieur. Enfin, les femmes ont déclaré que le soutien des SL et SUL était amoindri, et que les SL étaient moins confortables que les SUL.
Les auteurs appellent à des recommandations objectives pour les soutiens-gorge de sport.
Dr Patrick Laure
Référence
Wakefield-Scurr J, Hamilton C, et coll. : The effect of washing and wearing on sports bra function, Sports Biomechanics, 2022. DOI: 10.1080/14763141.2022.2046147
_________________
Publié le 24/03/2022
Le nombre de pas quotidien, c’est l’espérance de vie en marche !
L’activité physique a des impacts positifs sur la mortalité de toutes causes, sur les maladies cardiovasculaire, l’hypertension, les cancers, le diabète de type 2, l’anxiété, la dépression, les troubles du sommeil (OMS) [1].
Les nouvelles recommandations de l’OMS sur la sédentarité et l’activité physique pour être en bonne santé préconisent, pour les adultes de 18 à 64 ans, au moins 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée par semaine, soit 30 minutes par jour, ou au moins 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue hebdomadaire, ou un mélange des deux [1].
La simple marche paraît la solution la plus simple et la plus facile à réaliser pour pratiquer une activité physique.
La recommandation de marcher 10 000 pas tous les jours pas/jour) pour être en bonne santé est souvent promue par les médias mais aussi des spécialistes de la santé. Mais, ce n’est pas si simple d’y parvenir. Cela correspond en effet à environ 7,5 km en 1h 30’ à 1h 45’ (environ 4,5 km/h pour un adulte en bonne santé, avec un pas en moyenne d’environ 75 cm). Or, selon les données des applications, les adultes français font entre 2 000 et 4 000 pas par jour, et pour eux, ce chiffre de 10 000 peut sembler un objectif inatteignable [2].
« 10 000 pas par jour », quelle origine ?
Il s’agit en fait d’une origine purement marketing. En 1964, une entreprise japonaise, « Yamasa Clock » lance le podomètre « Manpo-Kei » à l’occasion des Jeux de Tokyo, puis le commercialise un an plus tard ; (littéralement : la « jauge des 10 000 pas », avec Man pour « 10 000 », po pour « pas » et kei pour « mètre » ou « jauge »). Les 10 000 pas étaient nés [3].
Après ces jeux, Yoshiro Hatano, un chercheur japonais, pour promouvoir l’activité physique, avait établi que ses compatriotes devaient atteindre au moins ce chiffre rond pour maintenir un poids de forme, et cela sans aucune preuve scientifique. A noter que même si les conclusions de Yoshiro Hatano avaient été prouvées scientifiquement, elles étaient fondées sur l’homme japonais « moyen », très différent de l’Occidental « moyen », avec par exemple un Indice de masse corporel plus élevé chez les « occidentaux » [3].
Pour conclure sur ces « 10 000 pas/jour qu’il faudrait faire pour être en bonne santé », le message continue d’être diffusé par les fabricants d’appareils connectès (podomètres, GPS, applications de smartphone) et les médias, mais aussi par les autorités de santé ; c’est un chiffre que tout le monde peut retenir ; c’est le marketing qui a décidé. C’est un slogan, au même titre par exemple que de « manger cinq fruits et légumes par jour ».
Cependant marcher 10 000 pas/jour pour rester en bonne santé n’a jamais été scientifiquement démontré.
Des preuves scientifiques sur le lien entre « marche quotidienne » et mortalité
En 2019, une étude de la Harvard Medical School a remis en cause ce nombre 10 000 pour le revoir à la baisse [4].
Son objectif était de connaître les effets de la marche quotidienne sur le taux de mortalité. Pendant plus de quatre ans, les chercheurs ont suivi 16 741 Américains en bonne santé, (âge moyen de 72 ans) en les équipant d'un accéléromètre (pour la marche, l'accéléromètre est capable d'indiquer le nombre de pas effectués en mesurant la vitesse de marche à plat ; c’est l'un des composants essentiels des montres connectées et des podomètres). Les résultats ont montré que plus le nombre de pas augmentait, plus le taux de mortalité diminuait, avant de se stabiliser autour de 7 500 pas/j. Au-delà de ce nombre, l’impact sur la mortalité n’apas été démontré. Il s’agissait plus de tendances car l’échantillon n’était pas représentatif.
Une autre étude prospective a été conduite chez plus de 5 000 adultes de 18 à 30 ans avec un suivi de 11 ans de la mortalité (l’étude CARDIA -Artery Risk Developpment in Young Adults) [5]. Les résultats, présentés sur JIM.fr montrent qu’un minimum de 7 000 pas/jour conduit à une baisse de 50 à 70 % de la mortalité et que la vitesse d’exécution de la marche ne semble pas intervenir [6].
Or voici qu’une nouvelle étude vient d’être publiée en 2022 dans la Revue « The Lancet Public Health ». L’objectif principal en était de d’étudier l'association entre le nombre de pas quotidien, mais aussi la fréquence des pas (rythme de la marche), avec la mortalité toutes causes confondues, chez des adultes (≥18 ans).
Il s’agit d’une méta-analyse portant sur 15 publications de cohortes internationales avec des dates de début d’étude s’étalant de 1999 à 2018. La mortalité, toutes causes confondues, a été recueillie à partir des certificats de décès et des registres nationaux. Des analyses de régression selon le modèle des risques proportionnels de Cox en utilisant les quartiles (*) de pas/jour ont été effectuées ; les rapports de risque (Hazard ratios HR) ont été calculés avec des modèles d'effets aléatoires pondérés par la variance inverse.
Diminution progressive de la mortalité avec le nombre de pas jusqu’à un niveau variable avec l’âge
Au total 47 471 adultes ont été recrutés. Le total du suivi pour les 15 cohortes était de 297 837 années-personnes ; 3 013 décès (10,1 pour 1 000 années-participants) ont été enregistrés sur un suivi médian (*) de 7,1 ans ([IQR 4,3-9,9] ; la médiane (**) des quartiles de pas par jour était de 3 553 pour le quartile 1, 5 801 pour le quartile 2, 7 842 pour le quartile 3, et 10 901 pour le quartile 4. Comparé au quartile le plus bas, le rapport de risque (HR) ajusté pour la mortalité toutes causes confondues était de 0,60 (intervalle de confiance à 95 % IC 95% 0-51-0-71) pour le quartile 2, de 0,55 (0,49-0,62) pour le quartile 3, et de 0,47 (0,39-0,57) pour le quartile 4. Une diminution progressive du risque de mortalité a été démontrée chez les adultes âgés de 60 ans et plus avec l'augmentation du nombre de pas par jour jusqu'à 6 000-8 000 et chez les adultes de moins de 60 ans jusqu'à 8000-10 000 pas/jour. En ajustant sur le nombre de pas/jour, en comparant le quartile 1 au quartile 4, l'association entre des taux de pas plus élevés et la mortalité a été diminuée mais est restée significative pour un pic de 30 minutes (HR 0-67 [IC 95% 0-56-0-83]) et un pic de 60 minutes (0-67 [0-50-0-90]), mais non significative pour le temps (min par jour) passé à marcher à 40 pas par minute ou plus (1,12 [0-96-1-32]) et à 100 pas par minute ou plus (0,86 [0,58-1,28]).
Les auteurs concluent que le nombre de pas/jour est lié à une diminution progressive du risque de mortalité toutes causes confondues, jusqu'à un niveau variant selon l’âge ; par ailleurs, la vitesse de marche n'aurait qu’un faible impact. Ils proposent que les résultats de cette méta-analyse soient utilisés pour informer les directives sur les pas pour la promotion de l'activité physique en santé publique.
Le slogan « marcher » 10 000 pas /jour ne doit plus être un élément décourageant pour ceux qui marchent moins, les plus nombreux. Le slogan devrait être « marcher est bénéfique pour la santé » ; la diminution du risque de mortalité est progressive avec l’augmentation du nombre de cas/jour. Plus on marche plus on augmente l’espérance de vie, mais au-delà de 8 000 pas/jour chez les adultes de plus de 60 ans et plus, et de 10 000 pas/jour chez les moins de 60 ans, il n’y a plus de gain sur la mortalité. Rien ne sert de forcer le rythme ; cela n’a pas d’impact sur la mortalité.
(*) Les quartiles permettent de séparer une série statistique en quatre groupes de même effectif (à une unité près)
(**) La médiane sépare une série statistique en deux groupes de même effectif, l'un contient les valeurs les plus petites et l'autre les valeurs les plus grandes.
Pr Dominique Baudon
Références
[1] Organisation mondiale de la Santé 2020-Lignes directrices de l’OMS sur l’activité physique et la sédentarité : en un coup d’œil - WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour: at a glance- https://apps.who.int/iris/bitstream/han ... 62-fre.pdf
[2] https://www.lequipe.fr/Coaching/Conseil ... our/741810
[3] https://www.lemonde.fr/sciences/article ... 50684.html
[4] https://myeasysante.fr/news/10-000-pas- ... -beaucoup/
https://www.lepoint.fr/sante/faut-il-vr ... 435_40.php
[5] Paluch A E et coll. : Steps per Day And All-Cause Mortality in Middle-Aged Adults in the Coronary Artery Risk Developpment I n Young Adults Study. JAMA Netw Open. 2021, 4 (9), e : 2124516.
[6] In JIM.fr, publié le 16/10/2021 https://www.jim.fr/medecin/jimplus/chif ... plus.phtml
Paluch AE et coll. : Daily steps and all-cause mortality: a meta-analysis of 15 international cohorts. Lancet Public Health 2022; 7: e219–28. doi: 10.1016/S2468-2667(21)00302-9.
Source jim.fr pour tous les articles.
Le monde s’interroge sur la quatrième dose
Les premières données scientifiques confirment l’efficacité de la 4ème dose, mais médecins et politiques restent prudent sur la question.
Comme toujours depuis l’arrivée des premiers vaccins contre la Covid-19 en décembre 2020, Israël aura été un pionnier. Le 31 décembre dernier, l’Etat hébreu est devenu le premier pays à administrer une quatrième dose de vaccin aux personnes âgées de plus de 60 ans.
Trois mois plus tard, 735 000 Israéliens ont reçu un deuxième rappel vaccinal, soit 40 % de la population âgée de plus de 60 ans.
78 % de risque de décès en moins avec quatre doses
Les scientifiques locaux sont donc déjà en mesure d’évaluer l’efficacité de la quatrième dose en population générale. A première vue, les résultats semblent sans appel. Selon une étude menée auprès de 560 000 patients (330 000 avec quatre doses et 235 000 avec trois doses), l’administration d’une quatrième dose diminue de 78 % le risque de décès comparé à seulement trois doses. Mais les auteurs de l’étude reconnaissent certaines limites à leur évaluation, notamment le fait qu’elle a été réalisé sur une période courte (seulement 40 jours) et qu’ils n’ont pas pu comparer la protection apportée par une quatrième dose et celle due à une précédente infection.
Comme souvent depuis le début de la vaccination de masse, les pays occidentaux ont suivi l’exemple israélien et ont tour à tour lancé une nouvelle campagne de vaccination de rappel à destination des personnes les plus âgées. C’est le cas notamment en Espagne, en Suède, en Australie et au Royaume-Uni. En France, l’administration d’une nouvelle dose de rappel aux personnes de plus de 80 ans et aux résidents d’Ehpad qui ont reçu leur dernière dose depuis au moins 3 mois a commencé le 14 mars après une décision gouvernementale. Dans un avis publié le 18 mars, la Haute Autorité de Santé (HAS) a en partie pris le contre-pied de cette décision, préconisant que la quatrième dose puisse être administrée à toutes personnes de plus de 65 ans à risque de forme grave, mais seulement 6 mois après la précédente injection.
Attention à la fatigue vaccinale
Alors que le nombre de contaminations augmente dans de nombreux pays en raison du variant Omicron BA2, certains se demandent s’il ne serait pas préférable d’étendre encore plus cette nouvelle vaccination. C’est le cas aux Etats-Unis, où la FDA, l’agence du médicament américaine, s’apprêterait à recommander une nouvelle injection pour tous les Américains de plus de 50 ans (contre 65 actuellement). Une décision loin de faire l’unanimité outre-Atlantique. « Nous n’avons aucune preuve définitive que donner une deuxième dose de rappel aux personnes âgés est nécessaire » estime Celine Gounder, professeur d’infectiologie à New York, qui considère que les données israéliennes ne sont pas suffisantes pour justifier cette nouvelle vaccination.
La question d’étendre le bénéfice de la quatrième dose à tous les adultes se pose cependant. Pour le moment, les scientifiques sont presque unanimes pour considérer qu’aucune donnée ne justifie une telle extension. « Il n’est pas pertinent de recommander actuellement l’administration d’une seconde dose de rappel en population générale » résume la HAS. On se souvient cependant que le même type de discours était tenu lorsqu’une troisième dose commençait à être administrée aux personnes âgées en septembre dernier, avant d’être rendu quasiment obligatoire pour tous les adultes. Le même scénario pourrait se reproduire avec la quatrième dose. Attention cependant à ne pas créer un sentiment de « fatigue vaccinale » et d’induire « un risque de désengagement à l’égard d’une vaccination perçue comme trop fréquente » prévient le Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale (COSV).
Quentin Haroche
____________
Publié le 24/03/2022
Une quatrième dose, vraiment ?
Alors que la question se pose avec de plus en plus d’insistance de l’intérêt d’une 4ème dose de vaccin contre la Covid-19, une étude israëlienne livre de nouvelles données. Cette étude avait pour objectif d’évaluer l’immunogénicité et la sécurité d’une 4ème dose de l’un des vaccins à ARNm, administrée 4 mois après la 3ème dose.
Les participants étaient tous des professionnels de santé appartenant à la cohorte Sheba (cohorte de près de 5 000 personnes de 47 ans d’âge moyen, recrutée dès le mois de décembre 2020 et à l’origine de plusieurs études sur l’efficacité vaccinale). Les uns (n = 154) ont reçu une 4ème dose du BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), les autres (n = 120) du vaccin mRNA-1273 (Moderna) une semaine plus tard. Chaque participant était « apparié » avec 2 cas-témoins du même âge, à jour des 3 doses vaccinales.
L’immunogénicité et la tolérance sont bonnes
Les données montrent que la 4ème dose entraîne une production d’anticorps dirigés contre le domaine de liaison aux récepteurs du SARS-CoV-2 et augmente les titres d’anticorps neutralisants. Chaque taux est augmenté par un facteur de 9 à 10, avec des titres très légèrement supérieurs à ceux obtenus après la 3ème dose, et sans différence significative entre les deux vaccins. Pendant ce temps, les taux d’anticorps des sujets témoins poursuivent leur décroissance. Les deux vaccins entrainent une augmentation de l’activité neutralisante contre le variant B.1.1.529 (omicron), identique à celle constatée après la 3ème dose. Les effets indésirables, symptômes locaux ou généraux, sont bénins.
Mais l’efficacité est modeste
L’étude était menée pendant une période de très forte incidence, avec une circulation considérée comme exclusive du variant omicron, et la surveillance active (test PCR hebdomadaire) a permis d’évaluer l’efficacité vaccinale. Au total 25 % des participants du groupe contrôle (3 doses) ont été infectés. Ils étaient 18,3 % parmi ceux ayant reçu la 4ème dose du vaccin Pfizer-BioNTech et 20,7 % parmi ceux ayant reçu la 4ème dose de Moderna. L’efficacité vaccinale est de 30 % pour le premier et 11 % pour le second. Si dans les 2 groupes, les personnes infectées n’ont signalé que des symptômes « négligeables », les charges virales étaient relativement élevées (Ct ≤ 25), suggérant une probable contagiosité. L’efficacité vaccinale semble supérieure vis-à-vis des formes symptomatiques (43 % pour le vaccin Pfizer-BioNTech et 31 % pour le Moderna).
Des avantages marginaux
En résumé, cet essai montre que la 4ème dose de vaccin à ARNm est immunogénique, bien tolérée, et somme toute modérément efficace. En termes de réponse humorale ou de taux des anticorps neutralisants spécifiques anti-omicron, la réponse vaccinale après la 4ème dose est sensiblement identique à ce qui est observé dans les suites de la 3ème dose. Ces résultats laissent penser que l’immunogénicité des vaccins à ARNm est atteinte après 3 doses et que la 4ème ne fait que rétablir le taux d’anticorps.
Ce constat, ajouté au fait que la charge virale élevée des professionnels de santé infectés suggère leur contagiosité et à la bénignité clinique des formes constatées, semble indiquer que la 4ème dose dans cette catégorie de population n’aurait que des avantages marginaux dans le contexte de ce variant omicron majoritaire.
Soulignons que l’étude n’incluait pas de personnes âgées ni vulnérables.
Dr Roseline Péluchon
Référence
Regev-Yochay G. et coll. : Efficacy of a Fourth Dose of Covid-19 mRNA Vaccine against Omicron. N Engl J Med. 2022 Mar 16. doi: 10.1056/NEJMc2202542.
______________
Publié le 18/03/2022
Hôpital public : la bureaucratie m’a tué
« Les Bureaux se hâtèrent de se rendre indispensables en se substituant à l’action vivante par l’action écrite, et ils créèrent une puissance d’inertie appelée le Rapport. (…) La France allait se ruiner malgré de si beaux rapports, et disserter au lieu d’agir. Il se faisait en France un million de rapports écrits par année ; aussi la bureaucratie régnait-elle ! ». Mais quel écrivain décrit si bien notre monde ? Un auteur contemporain ? Que nenni. Ces phrases sont celles de Balzac dans Les Employés ou la femme supérieure, paru en 1838.
Au rapport !
L’extrait a été cité il y a quelques semaines par le psychiatre Bernard Granger dans une tribune publiée dans l’Obs, qui évoque la façon dont la bureaucratie a peu à peu gangréné l’hôpital public, réduisant ses forces vives à l’inertie la plus pataude. Comme il le signale à la fin de son long texte, les armes face à l’envahisseur ne sont guère nombreuses, mais l’humour ne manque probablement pas d’atout. Il l’illustre d’ailleurs au fil de son texte qui débute ainsi : « L’hôpital public est un terrain d’observation privilégié du phénomène bureaucratique. L’opium des directions hospitalières actuelles est « le projet ». Quand un directeur ne sait plus quoi vous répondre et cherche à se débarrasser de vous, il ordonne : « Écrivez-moi un projet ! » Tout est projet : projet médical, projet managérial, projet social, projet de soins, projet d’établissement, projet financier, projet de pôle, projet de département, projet de service, projet de chefferie de service, projet pédagogique, projet des représentants des usagers, etc. Aucun projet ne se réalise comme prévu, car c’est une littérature fictionnelle qui donne l’impression d’avoir été rédigée sous l’emprise de stupéfiants. Et que dire de ces rapports annuels d’activité, enquêtes administratives, rapports d’étapes, feuilles de route, plans stratégiques, boîtes à outils, états prévisionnels, plans locaux de santé, plans globaux de financement pluriannuels, stratégie nationale de santé, pilotage de la transformation (là où il faudrait plutôt une transformation du pilotage), retours d’expérience (RETEX, dans ce verbiage bourré de sigles et d’acronymes dont plus personne ne finit par connaître la signification) ? Qui s’intéresse à ces fadaises ? Qui lit ces documents destinés à une étagère empoussiérée puis à la déchèterie ? ».
La valorisation de l’inaction
La charge ne se contente pas d’être comique : elle est une analyse de la façon dont la bureaucratie mine le fonctionnement de l’hôpital public. D’abord, parce qu’elle rend impossible toute maîtrise du temps. « La plus belle réussite de la bureaucratie, qui fait un tort considérable au monde hospitalier, est sans doute son aptitude à dilater le temps et à diluer les responsabilités. Ce qui dans la vraie vie prend une heure, prend dans la vie bureaucratique un trimestre, un semestre, une année », écrit Bernard Granger. D’autres l’ont observé, notamment à la faveur de la crise épidémique, qui de façon immédiate a réussi à faire sauter toutes les étapes de décision et de validation et de sur-validation qui semblaient auparavant indépassables. Un collectif de médecins écrivait ainsi au printemps 2020 dans le Figaro : « Cette crise a permis une réduction drastique des procédures administratives et une accélération des délais de réponse de la part de bureaux ou commissions d’ordinaire relancés des mois durant avant l’obtention d’un avis ou d’une décision. La suradministration doit s’effacer devant les principes de subsidiarité et de responsabilité des chefs de service et des représentants médicaux. On a pu sortir de cet enfer paperassier, il ne faudrait pas y retomber ».
Las, il semble que leur appel n’ait pas été entendu et que les mauvaises habitudes soient vite revenues hanter les couloirs des hôpitaux. De nouveau, le temps du remplissage de tableaux grignote celui qui devrait être consacré aux patients, l’inaction devenant plus valorisée que l’action.
Quand l’indicateur devient l’objectif
L’autre conséquence délétère de ce règne de la bureaucratie est la place donnée aux indicateurs, bientôt transformés en « objectifs ». « L’indicateur sature la langue managériale. On entend souvent politiques ou hauts fonctionnaires prononcer cette phrase appliquée à tous les domaines : « Il faudrait quelques indicateurs bien choisis, en petit nombre. » Derrière une apparence de bon sens, cette proposition de retenir quelques indicateurs « bien choisis » (on ne dit pas comment) cache une erreur conceptuelle désormais bien démontrée. La loi de Goodhart devrait pourtant être connue de nos élites : lorsqu’une mesure devient un objectif, elle cesse d’être une bonne mesure. Un indicateur manipulable transformé en objectif a immédiatement des effets pervers. Les exemples d’indicateurs pervertis ne manquent pas. Ce sont les flacons d’antiseptiques versés dans le lavabo dès que leur consommation a servi à évaluer le suivi des règles d’asepsie, ou le refus des malades difficiles par les chirurgiens cardiaques américains quand le taux de mortalité chez leurs opérés devait servir à les classer (indicateur rapidement abandonné) », énumère Bernard Granger. Si certains feront remarquer qu’une telle critique ne devrait pas conduire à renoncer à l’évaluation des performances (longtemps honnie dans l’univers hospitalier mais qui constitue pourtant un élément participant à l’amélioration de la qualité des soins), l’idée que ce diktat des « indicateurs » s’est substituée de façon délétère à une vision raisonnée et médicale de ce qu’est l’activité hospitalière est partagée par beaucoup. Ainsi, le point ultime de cette logique semble être la tarification à l’activité. « Qu’on en finisse avec cette politique de rentabilité des séjours, utiles ou non, du moment qu’ils «rapportent»! » écrivaient ainsi il y a deux ans les auteurs d’une tribune publiée dans le Figaro.
Quand l’ONDAM tue la T2A
Pire, la tarification à l’activité (T2A) pourrait elle-même être la victime d’une logique bureaucratique, c’est-à-dire d’une logique éloignée des réalités concrètes. C’est ce qu’expliquent les économistes de la santé Florence Jusot, Clémence Thébaut et Jérôme Wittwer dans Le Monde, qui remarquent que les effets pervers de la T2A sont notamment liés à la façon dont les tarifs sont fixés en France : « Si la T2A a mis en difficulté financière les établissements de santé, c’est parce qu’en France le tarif des séjours n’est pas équivalent à leur coût de production évalué par l’ATIH. En effet, il a été choisi d’ajuster les tarifs des séjours pour respecter les objectifs nationaux de dépenses d’assurance-maladie (Ondam), votés annuellement par le Parlement. (…) Dans les années qui ont suivi la mise en place de la T2A, l’Ondam était compris entre 4 % et 6 %. A partir de 2008, l’Ondam a baissé chaque année pour atteindre 1,75 % en 2016. Jusqu’en 2016, la dépense de soins hospitaliers était tirée vers le haut par les volumes dont l’augmentation annuelle était supérieure à celle de l’Ondam (environ 2 %). Pendant ce temps, les tarifs stagnaient, voire baissaient, ce qui est particulièrement remarquable dans un contexte où l’innovation technologique était constante et conduisait structurellement à une augmentation du coût de la prise en charge des patients. L’augmentation des volumes de soins hospitaliers sur cette période résulte en premier lieu du vieillissement de la population qui a augmenté ses besoins en soins. Elle résulte également des incitations adressées par les directions hospitalières à l’attention de leurs équipes. Les directions les ont incitées à augmenter les nombres de séjours pour compenser la baisse des tarifs, ce qui, à terme, était contreproductif, puisque cette augmentation des volumes a conduit à diminuer encore les tarifs des séjours. L’Ondam est une enveloppe fermée, plus le nombre de séjours augmente, plus les tarifs de ces séjours diminuent », décrivent-ils.
Vous souffrez des rapports ? Vite un rapport sur la souffrance !
Non contente d’entraîner une sclérose du système, la bureaucratie paraît également contaminer les réponses préconisées pour lutter contre ses méfaits. La lutte contre les souffrances psychosociales dans le monde hospitalier a ainsi été régulièrement mise sur le devant de la scène ces dernières. Cependant, ces actions sont-elles aussi mues par les mêmes mécaniques que celles qui sont (entre autres) à l’origine de la « souffrance des soignants », en se basant sur des indicateurs, des rapports et autres réunions de commissions. Bernard Granger citant le psychologue du travail Yves Clot remarque : « Il considère que proposer de « réparer » les conséquences psychiques des organisations de travail défaillantes par la « gestion » des risques psychosociaux est une aberration supplémentaire : « Pour tout dire, je ne crois pas que ceux qui travaillent dans ce pays soient des sinistrés à secourir. La victimologie ambiante, quand elle devient une gestion de la plainte “par en haut”, n’est souvent qu’un faux pas qui accroît, par un choc en retour, la passivité des opérateurs. […] Le monde du travail qui vient est un hybride social : une sorte de néofordisme se met en place, monté sur coussin compassionnel. La pression productiviste se dote d’amortisseurs psychologiques ». Ainsi, plutôt que de supprimer ce qui fait souffrir, on préconise d’accompagner la souffrance…
La thérapie par la rustine
Et comment ne pas penser qu’une des solutions récemment proposée par l’Agence régionale de Santé (ARS) d’Ile de France pour répondre à la pénurie d’effectifs infirmiers dans les hôpitaux franciliens n’est pas elle aussi le résultat d’une logique bureaucratique, qui refuse de prendre en compte ses propres dysfonctionnements et qui préfère la thérapie par la rustine. « Le dispositif proposé par l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, le 17 janvier, a achevé d’écœurer le personnel des hôpitaux publics de la région. Les infirmières travaillant en intérim se sont vu proposer des contrats à durée déterminée de six à neuf mois non renouvelables pour des salaires 30 % supérieurs à ceux des infirmières titulaires. S’il fallait persuader les infirmières restantes que leur engagement n’était pas reconnu, l’opération était parfaite. Pourquoi opter pour une fidélité sans valorisation salariale et avec des conditions de travail qui, chaque année, se détériorent ? (…) Pour éviter le crash complet, peut-on envisager que les thuriféraires de l’efficience entendent ce que les personnels non médicaux demandent ? » écrit en réponse à cette innovation de l’ARS un collectif de soignants dans le Monde.
Et s’il était trop tard ?
Pour certains, il pourrait être trop tard : la bureaucratie étant devenue un monstre autonome que ses « maîtres » ne parviennent plus à contrôler. Dans Libération, le consultant en santé Alexis Dussol écrit : « L’empilement des réformes et l’inflation des normes en tous genres ont transformé l’hôpital en monstre bureaucratique. Il n’est qu’à parcourir les quelque 300 pages du manuel de certification de la HAS pour s’en faire une idée. Les gouvernants ne savent plus trop comment s’y prendre pour le réformer ».
Les bureaucrates : des boucs émissaires faciles ?
Cependant, d’aucuns mettent en garde contre une critique facile de cette fameuse « bureaucratie » qui cacherait des desseins peu avouables pour l’hôpital public. Ainsi, dans Libération, le patron de la Fédération hospitalière de France (FHF), Frédéric Valletoux s’indigne des exagérations qu’il entend dans les discours de nombreux candidats à l’élection présidentielle : « Qu’a-t-on entendu ces derniers jours ? Que les hôpitaux publics seraient peuplés à 30 % de bureaucrates. Ah, la vieille rengaine… La crise n’est pas encore finie, et les décès se poursuivent, mais déjà ceux qui rêvent de livrer notre bouclier sanitaire aux mains du marché se réveillent. L’hôpital public a pris en charge plus de 80 % des patients Covid hospitalisés, a organisé des transferts sanitaires interrégionaux au plus fort de la crise, a dépêché des soignants en outre-mer (et il le fait encore aujourd’hui), a réorganisé tous ses services pour être capable de faire face à la saturation des réanimations, mais non, notre hôpital ne serait ni agile, ni réactif, ni admirable : il serait «bureaucratique». Je le redis donc avec force, les emplois administratifs à l’hôpital représentent 10 % des effectifs, pas 20 %, pas 30 %, pas 40 % : 10 %. Ce chiffre est pourtant en accès libre sur le site des statistiques du ministère de la Santé. Comme celui de 14 % d’emplois administratifs constatés dans les cliniques privées. Mais, trop soucieux d’attaquer nos hospitaliers pour respecter la vérité des faits, les habitués de l’hôpital-bashing se plaisent à intégrer la catégorie des secrétaires médicales à leurs calculs. Elles seront sans doute ravies d’apprendre qu’elles ne sont que des bureaucrates. Et une fois qu’on aura supprimé leurs postes pour débureaucratiser l’hôpital, les soignants seront ravis d’apprendre qu’ils doivent accueillir le public, gérer l’attente des patients aux urgences, organiser les agendas de tout leur service, ainsi que le suivi du dossier de leurs patients, etc ».
Difficile cependant de croire que dans les critiques formulées par Bernard Granger et beaucoup d’autres, ce sont les « secrétaires » qui soient visées, comme feint de l’assurer Frédéric Valletoux. C’est bien plus certainement le carcan des visions préformatées, du management par les seuls chiffres, symbolisés par l’hégémonie du « tableau Excel » qui sont dénoncés.
Des desseins peu avouables
Mais on retrouve également cette idée que la lutte affichée contre la bureaucratie ne pourrait être qu’un leurre sous la plume du professeur André Grimaldi. S’attaquant aux solutions proposées pour « sauver » l’hôpital public par deux anciens responsables de la FHF, il écrit ainsi dans le Journal du Dimanche : « Dans une tribune au journal Le Monde, Guy Collet et Gérard Vincent, deux anciens directeurs des hôpitaux et responsables de la Fédération hospitalière de France (FHF) prétendent sauver l’hôpital public grâce à trois mesures :1 : “confier aux régions la tutelle et la régulation du système de santé, les conseils régionaux devenant responsables des équilibres financiers” ; 2 : “inclure dans un service public de santé régional, l’ensemble des acteurs de santé, y compris les cliniques commerciales” ; 3 : “changer radicalement le statut de l’hôpital public en lui donnant celui de fondation”, c’est-à-dire, pour parler clair, d’une personne morale de droit privé à but non lucratif. Autrement dit pour défendre l’hôpital public auquel, ils déclarent “être viscéralement attachés”, ils proposent de le privatiser. (…) Au fond ils proposent d’appliquer à la santé au nom de la lutte contre la bureaucratie, le principe néolibéral : moins d’Etat, plus de marché » s’indigne André Grimaldi… Si on retrouve ici les combats de toujours du professeur de diabétologie, il est probable que les organisations managériales du privé n’ont probablement rien à envier à l’hôpital public en ce qui concerne les aberrations bureaucratiques et l’investissement disproportionné dans l’activité de reporting.
Ainsi, on le voit si la description des affres et des conséquences de la folie administrative sont aisées, il est plus difficile d’apprécier dans quelle mesure il pourrait être possible de se défaire de ce piège. Quelques pistes émergeront peut-être à la lecture de :
Bernard Granger : « Excel m’a tué » : comment la bureaucratie a asphyxié notre système hospitalier, https://www.nouvelobs.com/sante/2022012 ... alier.html#
Collectif de médecins, https://www.lefigaro.fr/vox/societe/lib ... e-20200503
Florence Jusot, Clémence Thébaut, Jérôme Wittwer
https://www.lemonde.fr/idees/article/20 ... _3232.html
Collectif de soignants : https://www.lemonde.fr/idees/article/20 ... _3232.html
Alexis Dussol : https://www.liberation.fr/idees-et-deba ... directed=1
Frédéric Valletoux :
https://www.liberation.fr/idees-et-deba ... 7NN3CMPHY/
André Grimaldi
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-la ... ic-4096114
Aurélie Haroche
_____________
Publié le 12/03/2022
Est-ce fou (et/ou dangereux ?) de penser Poutine fou ?
Paris, le samedi 12 mars 2022 – Les associations de patients n’aiment pas ça. Voir galvaudés les termes décrivant les maladies mentales, brandis les diagnostics à l’emporte pièce : elles y décèlent tout autant la manifestation du mépris que subissent les patients souffrant de ces pathologies et leurs proches et un risque d’aggravation de ce rejet. Cependant, ce qui se joue concernant Vladimir Poutine est un peu différent. Il s’agit bien sûr une fois encore pour certains de discréditer l’autre, de mettre à distance la peur qu’il nous inspire, de « psychiatriser » la réflexion pour s’éviter d’autres considérations, tant elles sont complexes (et angoissantes). Mais dans la gravité des paroles prononcées et dans l’implication récente de plusieurs spécialistes de la santé mentale, les « diagnostics » qui commencent à être esquissés au sujet du président russe sortent de l’habituel vacarme médiatique qui a vu de nombreux autres grands de ce monde avant lui considérés comme « fou » (tel récemment Donald Trump).
Le piège des visions « psychologisantes réductrices »
Discours « paranoïaques », « déconnectés de la raison » : ces observations sont celles depuis plusieurs jours des plus hauts responsables politiques français ou américains, quand Angela Merkel soutenait déjà il y a plusieurs années une même analyse. Aujourd’hui, le Dr Daniel Zagury, dans une tribune publiée dans Le Journal du Dimanche n’hésite pas à exploiter cette piste de la maladie mentale. Il s’aventure sur ce terrain complexe en toute conscience. « C’est à juste titre que l’on répugne généralement à donner trop d’importance à l’équation individuelle des dirigeants de ce monde, dans une vision psychologisante réductrice, et souvent ridicule. À ceux qui invoquent la folie du président russe, on oppose sa rationalité ; quand on pointe la démesure de sa fuite en avant, on convoque la grande continuité antérieure des menaces et des actions ; à des facteurs trop personnels, on objecte l’histoire. Le poids écrasant des données historiques et géopolitiques ne doit cependant pas nous conduire à sous-estimer le rôle de la pathologie mentale » écrit-il en introduction.
Comment passe-t-on de la méfiance professionnelle à la paranoïa maladive ?
L’expert auprès de la Cour de Paris considère que l’autocrate russe souffre de paranoïa et rappelle que c’est le propre de cette maladie de provoquer la confusion chez les observateurs. « Ce qui nous empêche de traiter la question avec lucidité, ce sont justement les caractéristiques propres de la paranoïa : c’est tout d’abord la continuité entre la personnalité de base et le délire. La paranoïa, c’est un caractère dont les signes cardinaux sont la psychorigidité, l’orgueil, la fausseté du jugement, l’hypertrophie du moi, et la méfiance. À partir de quel moment, dans une progressivité insensible, le caractère se prolonge-t-il en délire, l’orgueil en mégalomanie, la thématique centrale en conviction inébranlable, le mépris en destructivité et la méfiance en persécution ? À quel moment la paranoïa fonctionnelle de l’ancien dirigeant du KGB, amené professionnellement à se méfier de tout, se mue-t-elle en persécution délirante ? Poutine, même paranoïaque, n’a pas toujours été fou » remarque le psychiatre.
La fin du monde pour éviter la fin de son monde ?
Or, pour ce psychiatre, Vladimir Poutine est aujourd’hui rattrapé par la constatation de la « faillite » du système où il est enfermé. « La conduite actuelle de Vladimir Poutine n’est pas l’aboutissement logique de toute sa vie, mais l’échec de son idéalisation forcenée et de ses visées grandioses de retour à la Grande Russie. Nous le croyons fort alors qu’il est miné par la conscience pathétique de sa finitude, à l’approche de ses 70 ans. C’est le point central qu’il convient de prendre en compte si l’on veut éviter de sous-estimer l’ampleur du danger. La dimension suicidaire, celle-là même qui risque d’entraîner tant d’hommes dans sa chute, résulte d’une angoisse inassumable. Il n’est pas dans son logiciel d’accepter de vieillir, de composer avec l’ennemi interne, de mourir et de renoncer à ses illusions mégalomaniaques, en un point où sa personne et son glorieux pays se confondent. L’usure, le vieillissement, la situation économique de la Russie et la baisse de sa popularité l’ont amené au bord du gouffre, et le monde avec lui. C’est peut-être le Covid-19 qui l’y a précipité. Vladimir Poutine a été terrorisé par l’angoisse de le contracter, au point de faire construire des tunnels amovibles diffusant des produits désinfectants pour ses visiteurs et d’imposer une quarantaine à ceux qui devaient le rencontrer physiquement. Le virus est un ennemi insidieux que l’on ne peut pas bombarder. Nous sommes très au-delà de la simple peur et de mesures proportionnées », remarque encore Daniel Zagury. Il met cependant en garde : reconnaître le caractère pathologique de Vladimir Poutine ne doit pas conduire à discréditer tout ce qu’il fait et dit. « Il n’est plus temps d’accorder à sa parole la valeur que l’on attribue à la parole de ceux qui sont capables d’ajuster leur conduite à l’évolution de la situation. L’erreur inverse, tout aussi catastrophique, serait d’invalider tout ce qu’il énonce, avec ce préjugé qui ferait du délirant celui qui fait n’importe quoi. Sa rationalité est autre. Face à lui, la sobriété est de mise. Les propos de matamore ne font que faire flamber la persécution ».
Et s’il faisait semblant à dessein ?
L’analyse de Daniel Zagury, en particulier sa mise en évidence de la peur qui pourrait tenailler Vladimir Poutine de voir sa vie s’achever sans que son rêve de grandeur ne puisse être accompli, a été remarquée par beaucoup. Cependant, certains spécialistes invitent à conserver une forme de prudence. Ainsi, le Pr Antoine Pelissolo (CHU Henri Mondor de Créteil) rappelle l’impossibilité pour un praticien d’établir un diagnostic sans avoir examiné attentivement le patient. « Le président Russe montre une tendance mégalomaniaque que l'on retrouve d'ailleurs chez de très nombreux dirigeants : les politiques, les chefs d'entreprise et les chefs d'Etat, surtout les plus autoritaires. Elle se traduit par une très grande confiance en soi, une vision grandiose de soi-même ou du moins une très haute idée de sa valeur, la volonté de changer le monde. Tout cela n'est pas forcément négatif. Mais chez Vladimir Poutine, il y a en plus cette volonté d'écraser les autres, ainsi qu'un narcissisme prononcé. Cela révèle une véritable mégalomanie. On peut donc au moins dire qu'il a une personnalité mégalomaniaque. Ce trait pourrait suggérer une personnalité paranoïaque, d'autant qu'il en manifeste d'autres aspects, dont la méfiance des autres, alliés ou ennemis. Mais nous ne savons pas, par exemple, s'il a tendance à interpréter les intentions des autres comme malveillantes. Le diagnostic est donc impossible à poser, tout comme celui portant sur les délires paranoïaques. Il faudrait l'interroger au préalable, et donc passer du temps avec lui, tenter de comprendre pourquoi il agit ainsi. Sans compter que nous pourrions aussi envisager que ses déclarations s'intègrent dans une stratégie de communication, une mise en scène visant, justement, à faire croire qu'il est paranoïaque, pour faire peur » remarque le praticien. De la même manière, à propos d’une éventuelle dimension psychopathique, il constate : « Elle se traduit par la non-reconnaissance des règles (le président russe a violé les lois internationales avec cette déclaration de guerre), mais aussi par le manque d'empathie, car cette guerre va faire de nombreux morts. Mais on pourrait aussi opposer à cela qu'il a été élevé par l'armée, qu'il est bercé depuis tout petit dans un environnement fait de règles strictes qu'il a su respecter. Il reste impossible d'affirmer que Vladimir Poutine est psychopathe. Ce qui est sûr, c'est qu'il est agressif et ne semble pas avoir beaucoup de limites quant à l'atteinte de l'intégrité des autres ».
Une forme de déresponsabilisation facile
La possibilité de déterminer ou non l’état mental de Vladimir Poutine, qui on le voit suscite des interrogations et des divergences, n’intéresse pas uniquement les experts en psychiatrie, mais également les analystes politiques. Car cette conviction (ou non) que les actes du président russe sont (au moins en partie) guidés par une pathologie mentale proche de la paranoïa, peuvent influencer la manière de lui répondre. Or, cette tentation de voir d’abord en lui un « fou » pourrait s’avérer contre-productive. Elle serait en tout cas un aveu de notre faiblesse, une forme de renoncement à combattre, semble analyser Wiktor Stoczkowski, directeur d'études au laboratoire d'anthropologie sociale à l'EHESS dans le Figaro. « On parle de sa «détermination paranoïaque», de ses «obsessions», de ses «propos délirants », de sa « déraison », de sa « perte du sens des réalités », de sa « folie guerrière ». Cette explication hâtive vient à l'esprit des commentateurs avec la force de l'évidence, comme si le désir d'établir un diagnostic psychiatrique en garantissait l'adéquation et en même temps compensait l'incompétence médicale. Il y a peu on a employé le même procédé pour élucider les attentats islamistes : tout comme Poutine, les islamistes seraient des forcenés. Lorsqu'on ne parvient pas à expliquer les agissements d'autrui, on lui prête un dérèglement mental. On croit ainsi le comprendre, alors qu'en réalité on renonce à le comprendre, préférant renvoyer dans les limbes de la déraison ce qui échappe à notre entendement » avertit-il. Plus sévère, il relève que l’épouvantail de la folie est peut-être aujourd’hui dressé pour éviter à l’Occident d’admettre sa part de « laisser faire », son aveuglement, quand il conclut de façon ironique : « On aimerait croire que le seul problème soit la « folie » de Monsieur Poutine. Sans cette regrettable « folie », nous aurions pu commercer pacifiquement avec le dictateur russe, lui livrer nos technologies de pointe pour favoriser la modernisation de son pays, ouvrir nos ondes à la propagande de ses chaînes de télévision, tolérer son ingérence dans nos processus électoraux, accepter de devenir dépendants de son approvisionnement en énergie, lui verser en échange du gaz des sommes considérables qu'il emploie pour rendre puissante son armée ».
Et si c’était nous qui étions fous ?
De façon bien moins dramatique, c’est une mécanique proche qui se joue quand de façon plus cavalière (et bien moins argumentée médicalement que ce que propose le Dr Daniel Zagury) nous ironisons sur le « syndrome d’hybris » ou plus simplement la « folie » de nos dirigeants. Même s’il est certain qu’une forme d’hybris (au sens où les grecs l’entendaient et pas nécessairement les psychiatres) est sans doute indispensable pour se lancer à la conquête du pouvoir. Cataloguer ainsi les actions des tenants du pouvoir c’est oublier d’une part que nous les avons majoritairement élus et d’autre part que leurs actes sont souvent rendus possibles par l’état de la société et notre acceptation (il en est par exemple ainsi de la mise en place du passe vaccinal dont on ne peut pas uniquement attribuer la responsabilité à une « folie » du pouvoir mais à la propension de notre société à accepter voire à désirer un contrôle accru de nos vies quotidiennes).
Qu’on le croit fou, la chance de Vladimir Poutine !
Hypocrite, l’appréhension des actions de Vladimir Poutine par le biais de la psychiatrie, pourrait également être contre-productive. L’avocat William Goldnadel, qui admet-il lui-même a pourtant souvent tendance à fustiger « la folie » de ce monde, note ainsi : « Et voilà que déjà, viennent du camp adverse des conseils d'ordre psychologique de ne pas l'acculer ou le pousser à bout. Qu'il serait avisé de savoir donner à l'ours une porte de sortie pour apaiser sa folle colère. (…) Et il ne s'agit pas seulement de conseils d'ordre psychologique, mais de gestes également: ignorant la «rationalité» de Poutine, pour reprendre l'interrogation d'Isabelle Lasserre, le Pentagone a reporté un test de missiles balistiques intercontinentaux prévu pourtant de longue date.Ainsi, tandis que le président de Russie envahit un autre pays et brandit verbalement la menace de l'arme nucléaire, les États-Unis sont déjà dans l'accommodement prudent. Qu'on ne se méprenne surtout pas : je ne suis aucunement dans le jugement mais dans le constat. J'observe que l'irrationalité voire la démence prêtée à l'agresseur lui confère un avantage tactique et stratégique. «Retenez-moi ou je fais un malheur». Si j'étais un agent d'influence du FSB, je ferais tout pour faire passer mon président pour un dément », conclut-il rejoignant une hypothèse du professeur Antoine Pelissolo, quant à une possible simulation tactique.
Ces réflexions semblent en tout cas confirmer le caractère périlleux du diagnostic psychiatrique quand il sort du champ strictement médical, cette mauvaise habitude de faire de la psychiatrie une lecture du monde et non une spécialité comme une autre, et paraissent légitimer les mises en garde et même les déplorations des associations de patients. Malgré ces réserves, c’est avec une certaine forme de culpabilité que l’on relira :
Daniel Zagury
Antoine Pelissolo
Wiktor Stoczkowski
William Goldnadel
Aurélie Haroche
_____________________
Selon les données de Santé publique France arrêtées au soir du 27 mars, on comptabilise :
• 110 174 nouveaux cas de Covid-19 (vs 81 283 cas le 20 mars)
• 20 606 personnes hospitalisées pour Covid-19 (+ 40 en une semaine)
• 1 486 personnes hospitalisées en soins critiques (- 156 en une semaine)
• 739 morts au cours de la semaine
• 141 672 morts depuis le début de l’épidémie (64 780 en 2020, 58 961 en 2021, 17 931 en 2022)
- Un point de situation dans le monde
Selon les dernières statistiques publiées par l’université John Hopkins de Baltimore, depuis le début de la pandémie 480 957 051 cas de Covid ont été identifiés dans le monde qui ont contribué à 6 124 021 décès. Ces quatre dernières semaines, les pays les plus impactés par la Covid sont, en nombre de contaminations la Corée du Sud (8 868 598), le Vietnam (5 690 468) et l’Allemagne (4 712 847) et en nombre de décès les Etats-Unis (27 532), la Russie (16 087) et le Brésil (9 722).
____________
Publié le 28/03/2022
Plus de troubles neurologiques après la Covid-19 qu’après les vaccins
Actuellement, 5 vaccins contre le SARS-CoV-2 ont obtenu une autorisation conditionnelle de commercialisation en Europe : 2 vaccins à ARNm, 2 vaccins à vecteur viral et un vaccin adjuvé recombinant. Tous ont fait preuve de leur efficacité pour la prévention des formes graves de Covid-19 et ont un profil de sécurité satisfaisant. Toutefois la surveillance continue et des rapports récents d’effets indésirables ont signalé la survenue de syndromes de Guillain Barré après les vaccins à vecteur viral : 108 pour 21 millions de personnes vaccinées en juin 2021 pour le vaccin Ad.26.COV2.S (Johnson & Johnson) et 833 pour 592 millions de doses pour le ChAdOx1 nCoV19 (Astra Zeneca). Ceci a conduit l’Agence Européenne du médicament à faire figurer le syndrome de Guillain Barré comme un effet secondaire rare de ces vaccins. Des paralysies de Bell, des encéphalomyélites et des myélites transverses ont aussi été décrites dans des études de cas, après les vaccins à vecteur viral et les vaccins à ARNm. Bien que ces évènements ne soient pas obligatoirement dus aux vaccins, l’association temporelle réclame une surveillance attentive.
Incidence augmentée de la paralysie faciale, du Guillain Barré et des encéphalomyélites avec l’infection
Une équipe internationale a analysé les vastes bases de données concernant plus de 8,3 millions de personnes ayant reçu, au Royaume-Uni et en Espagne, au moins 1 dose de l’un des vaccins anti-Covid-19 autorisés dans l’Union européenne. L’étude inclut aussi une cohorte de 735 000 personnes non vaccinées, ayant été infectées par le SARS-CoV-2, et 14 millions de participants de la population générale. L’objectif était d’étudier l’association entre les vaccins, l’infection et le risque de maladie neurologique auto-immune.
Les données confirment la survenue possible de syndromes de Guillain Barré, de paralysie de Bell et d’encéphalomyélites, après la vaccination, mais à des taux attendus et conformes aux données déjà connues, ne constituant pas un nouveau signal d’alerte. En revanche, après une infection par le SARS-CoV-2, ces troubles neurologiques sont plus fréquents que ce qui était attendu en se référant aux études déjà publiées. L’incidence de la paralysie de Bell est augmentée de 30 %, celle des encéphalomyélites et multiplié par près de 7 et celle du syndrome de Guillain Barré par plus de 3. Les myélites transverses sont rares.
Dr Roseline Péluchon
Références
Li X. et coll. : Association between covid-19 vaccination, SARS-CoV-2 infection, and risk of immune mediated neurological events: population based cohort and self-controlled case series analysis.
BMJ2022;376:e068373. doi.org/10.1136/BMJ-2021-068373
______________
Publié le 25/03/2022
La Covid-19, même légère, touche le cerveau
Deux ans après l’apparition de la pandémie de SARS-CoV-2, des centaines de millions de personnes ont été atteintes par la Covid-19 et de nombreux travaux cherchent à identifier les effets à long terme de la maladie. L’anosmie et l’agueusie transitoires, ainsi que différents types de troubles psychiques et neurologiques, ont très vite suggéré un impact de la Covid-19 sur le cerveau, par neurotropisme du virus ou par neuroinflammation induite par l’infection.
Une équipe britannique a réalisé la première étude longitudinale majeure comparant les IRM de cerveaux de patients avant et après leur contamination par le SARS-CoV-2. Ils ont analysé les images de 785 patients, âgés de 51 à 81 ans, parmi lesquels 401 ont contracté la Covid-19. En moyenne, 141 jours séparaient le diagnostic et le second IRM. Leurs résultats, publiés dans la revue Nature, font apparaître plusieurs atteintes cérébrales en comparant les deux groupes. Par rapport à celles non contaminés, les personnes ayant été testées positives pour la Covid-19 présentent une réduction de la taille globale du cerveau et des marques de lésions tissulaires dans les régions fonctionnellement connectées au cortex olfactif primaire. Cette perte de matière grise n'était pas homogène pour tous les patients contaminés, et était plus marquée chez les patients ayant été hospitalisés.
De moins bons scores à certains tests neuropsychologiques pour les personnes contaminées
Les chercheurs ont aussi constaté une atteinte du cortex orbitofrontal et du gyrus parahippocampique, deux régions du cerveau impliquées dans la mémoire et la prise de décision. Si les patients infectés ne montraient pas de signe de déficience de la mémoire, ils obtenaient des scores inférieurs à un test d’aptitude neuropsychologique d’attention visuelle et d’exécution de tâche. Ce déclin cognitif persistait même après exclusion des quelques patients atteints d’une forme grave de la maladie et hospitalisés, ce qui confirme l’incidence de ces troubles même avec des formes légères de la Covid-19.
Ces travaux mettent pour la première fois en évidence une atteinte délétère du cerveau à la suite de l’infection par le SARS-CoV-2. Le caractère longitudinal de l’étude permet d’affirmer que ces atteintes sont très probablement consécutives à la contamination. Le suivi des patients permettra de déterminer la réversibilité des modifications, et si elles pourraient être à l’origine d’une vulnérabilité du cerveau à plus long terme. Enfin, il est important de mentionner que tous les variants du virus ne provoquent pas nécessairement ces dommages, puisque les examens d’IRM ont été réalisés lorsque le variant Alpha était largement majoritaire au Royaume-Uni. Les perturbations de l’odorat et du goût ne sont que rarement retrouvées avec le variant Omicron, maintenant majoritaire, ce qui suggère une atteinte différente du système nerveux central.
Dr Rémi Samain
Référence
Douaud G et coll., : SARS-CoV-2 is associated with changes in brain structure in UK Biobank. Nature, 2022; publication avancée en ligne le 7 mars. doi: 10.1038/s41586-022-04569-5.
__________
Une étude intéressante et finalement assez pertinente
Publié le 28/03/2022
Soutiens-gorge de sport : peut-on les laver ?
Pendant le sport, les seins sont exposés à des lésions anatomiques du fait du ballottement qu’ils subissent dans les trois dimensions, quel que soit leur volume. Un soutien-gorge de sport limite ces mouvements, réduisant ainsi l’inconfort et, surtout, les douleurs mammaires. Son efficacité tient à sa forme et à sa composition. Élasticité, capacité d’absorption et durabilité comptent parmi ses caractéristiques essentielles. De fait, l’élasthanne, le lycra, le polyester et autres tissus tricotés entrent couramment dans la fabrication de ces pièces de vêtement.
La recherche générale sur les textiles suggère que l’usage et le lavage répétés altèrent les propriétés de ces divers matériaux. Par exemple, les fibres perdent leur élasticité, tandis que les tissus tricotés rétrécissent. Se fondant sur ces constats, certains fabricants recommandent de remplacer les soutiens-gorge de sport tous les trois à six mois, ou après 25 lavages. Pourtant, les données spécifiques à ces vêtements font défaut, privant l’industrie du soutien-gorge, comme les professionnels de la santé ou du sport, de la possibilité de délivrer des conseils avisés aux usagères.
Pour en savoir plus, une équipe de l’université de Portsmouth (UK) a recruté 22 volontaires, âgées en moyenne de 21,6 ans, périmètre thoracique 75 cm, volume total de la poitrine 1 482 cm3, valeur de bonnet la plus fréquente : D. Elles ont reçu un même modèle de soutien-gorge de sport, noté comme très performant par la presse sportive.
Vers un manque de soutien
Au cours d’un test dynamique initial, sur tapis roulant à la vitesse de 10 km/h, les mouvements des seins ont été mesurés par microcapteurs électromagnétiques fixés sur le vêtement. Les femmes ont ensuite pratiqué leur sport (athlétisme, gymnastique, trampoline, tennis, etc.). Lorsqu’elles avaient atteint 25 lavages, en moyenne au bout de 85 jours (fréquence et températures conformes aux recommandations du fabricant), un test final était réalisé.
Ont été comparés : des soutiens-gorge utilisés et lavés (SUL), seulement lavés (SL) et ni utilisés ni lavés (témoins).
Par rapport aux témoins, SL et surtout SUL entraînaient une nette augmentation des déplacements latéraux ou verticaux des seins : + 20 % et 16 % pour les premiers, + 32 % et 25 % pour les seconds. Toutefois, la différence absolue était inférieure à 4,2 mm. Aucune variation n’a été notée dans le sens antéro-postérieur. Enfin, les femmes ont déclaré que le soutien des SL et SUL était amoindri, et que les SL étaient moins confortables que les SUL.
Les auteurs appellent à des recommandations objectives pour les soutiens-gorge de sport.
Dr Patrick Laure
Référence
Wakefield-Scurr J, Hamilton C, et coll. : The effect of washing and wearing on sports bra function, Sports Biomechanics, 2022. DOI: 10.1080/14763141.2022.2046147
_________________
Publié le 24/03/2022
Le nombre de pas quotidien, c’est l’espérance de vie en marche !
L’activité physique a des impacts positifs sur la mortalité de toutes causes, sur les maladies cardiovasculaire, l’hypertension, les cancers, le diabète de type 2, l’anxiété, la dépression, les troubles du sommeil (OMS) [1].
Les nouvelles recommandations de l’OMS sur la sédentarité et l’activité physique pour être en bonne santé préconisent, pour les adultes de 18 à 64 ans, au moins 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée par semaine, soit 30 minutes par jour, ou au moins 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue hebdomadaire, ou un mélange des deux [1].
La simple marche paraît la solution la plus simple et la plus facile à réaliser pour pratiquer une activité physique.
La recommandation de marcher 10 000 pas tous les jours pas/jour) pour être en bonne santé est souvent promue par les médias mais aussi des spécialistes de la santé. Mais, ce n’est pas si simple d’y parvenir. Cela correspond en effet à environ 7,5 km en 1h 30’ à 1h 45’ (environ 4,5 km/h pour un adulte en bonne santé, avec un pas en moyenne d’environ 75 cm). Or, selon les données des applications, les adultes français font entre 2 000 et 4 000 pas par jour, et pour eux, ce chiffre de 10 000 peut sembler un objectif inatteignable [2].
« 10 000 pas par jour », quelle origine ?
Il s’agit en fait d’une origine purement marketing. En 1964, une entreprise japonaise, « Yamasa Clock » lance le podomètre « Manpo-Kei » à l’occasion des Jeux de Tokyo, puis le commercialise un an plus tard ; (littéralement : la « jauge des 10 000 pas », avec Man pour « 10 000 », po pour « pas » et kei pour « mètre » ou « jauge »). Les 10 000 pas étaient nés [3].
Après ces jeux, Yoshiro Hatano, un chercheur japonais, pour promouvoir l’activité physique, avait établi que ses compatriotes devaient atteindre au moins ce chiffre rond pour maintenir un poids de forme, et cela sans aucune preuve scientifique. A noter que même si les conclusions de Yoshiro Hatano avaient été prouvées scientifiquement, elles étaient fondées sur l’homme japonais « moyen », très différent de l’Occidental « moyen », avec par exemple un Indice de masse corporel plus élevé chez les « occidentaux » [3].
Pour conclure sur ces « 10 000 pas/jour qu’il faudrait faire pour être en bonne santé », le message continue d’être diffusé par les fabricants d’appareils connectès (podomètres, GPS, applications de smartphone) et les médias, mais aussi par les autorités de santé ; c’est un chiffre que tout le monde peut retenir ; c’est le marketing qui a décidé. C’est un slogan, au même titre par exemple que de « manger cinq fruits et légumes par jour ».
Cependant marcher 10 000 pas/jour pour rester en bonne santé n’a jamais été scientifiquement démontré.
Des preuves scientifiques sur le lien entre « marche quotidienne » et mortalité
En 2019, une étude de la Harvard Medical School a remis en cause ce nombre 10 000 pour le revoir à la baisse [4].
Son objectif était de connaître les effets de la marche quotidienne sur le taux de mortalité. Pendant plus de quatre ans, les chercheurs ont suivi 16 741 Américains en bonne santé, (âge moyen de 72 ans) en les équipant d'un accéléromètre (pour la marche, l'accéléromètre est capable d'indiquer le nombre de pas effectués en mesurant la vitesse de marche à plat ; c’est l'un des composants essentiels des montres connectées et des podomètres). Les résultats ont montré que plus le nombre de pas augmentait, plus le taux de mortalité diminuait, avant de se stabiliser autour de 7 500 pas/j. Au-delà de ce nombre, l’impact sur la mortalité n’apas été démontré. Il s’agissait plus de tendances car l’échantillon n’était pas représentatif.
Une autre étude prospective a été conduite chez plus de 5 000 adultes de 18 à 30 ans avec un suivi de 11 ans de la mortalité (l’étude CARDIA -Artery Risk Developpment in Young Adults) [5]. Les résultats, présentés sur JIM.fr montrent qu’un minimum de 7 000 pas/jour conduit à une baisse de 50 à 70 % de la mortalité et que la vitesse d’exécution de la marche ne semble pas intervenir [6].
Or voici qu’une nouvelle étude vient d’être publiée en 2022 dans la Revue « The Lancet Public Health ». L’objectif principal en était de d’étudier l'association entre le nombre de pas quotidien, mais aussi la fréquence des pas (rythme de la marche), avec la mortalité toutes causes confondues, chez des adultes (≥18 ans).
Il s’agit d’une méta-analyse portant sur 15 publications de cohortes internationales avec des dates de début d’étude s’étalant de 1999 à 2018. La mortalité, toutes causes confondues, a été recueillie à partir des certificats de décès et des registres nationaux. Des analyses de régression selon le modèle des risques proportionnels de Cox en utilisant les quartiles (*) de pas/jour ont été effectuées ; les rapports de risque (Hazard ratios HR) ont été calculés avec des modèles d'effets aléatoires pondérés par la variance inverse.
Diminution progressive de la mortalité avec le nombre de pas jusqu’à un niveau variable avec l’âge
Au total 47 471 adultes ont été recrutés. Le total du suivi pour les 15 cohortes était de 297 837 années-personnes ; 3 013 décès (10,1 pour 1 000 années-participants) ont été enregistrés sur un suivi médian (*) de 7,1 ans ([IQR 4,3-9,9] ; la médiane (**) des quartiles de pas par jour était de 3 553 pour le quartile 1, 5 801 pour le quartile 2, 7 842 pour le quartile 3, et 10 901 pour le quartile 4. Comparé au quartile le plus bas, le rapport de risque (HR) ajusté pour la mortalité toutes causes confondues était de 0,60 (intervalle de confiance à 95 % IC 95% 0-51-0-71) pour le quartile 2, de 0,55 (0,49-0,62) pour le quartile 3, et de 0,47 (0,39-0,57) pour le quartile 4. Une diminution progressive du risque de mortalité a été démontrée chez les adultes âgés de 60 ans et plus avec l'augmentation du nombre de pas par jour jusqu'à 6 000-8 000 et chez les adultes de moins de 60 ans jusqu'à 8000-10 000 pas/jour. En ajustant sur le nombre de pas/jour, en comparant le quartile 1 au quartile 4, l'association entre des taux de pas plus élevés et la mortalité a été diminuée mais est restée significative pour un pic de 30 minutes (HR 0-67 [IC 95% 0-56-0-83]) et un pic de 60 minutes (0-67 [0-50-0-90]), mais non significative pour le temps (min par jour) passé à marcher à 40 pas par minute ou plus (1,12 [0-96-1-32]) et à 100 pas par minute ou plus (0,86 [0,58-1,28]).
Les auteurs concluent que le nombre de pas/jour est lié à une diminution progressive du risque de mortalité toutes causes confondues, jusqu'à un niveau variant selon l’âge ; par ailleurs, la vitesse de marche n'aurait qu’un faible impact. Ils proposent que les résultats de cette méta-analyse soient utilisés pour informer les directives sur les pas pour la promotion de l'activité physique en santé publique.
Le slogan « marcher » 10 000 pas /jour ne doit plus être un élément décourageant pour ceux qui marchent moins, les plus nombreux. Le slogan devrait être « marcher est bénéfique pour la santé » ; la diminution du risque de mortalité est progressive avec l’augmentation du nombre de cas/jour. Plus on marche plus on augmente l’espérance de vie, mais au-delà de 8 000 pas/jour chez les adultes de plus de 60 ans et plus, et de 10 000 pas/jour chez les moins de 60 ans, il n’y a plus de gain sur la mortalité. Rien ne sert de forcer le rythme ; cela n’a pas d’impact sur la mortalité.
(*) Les quartiles permettent de séparer une série statistique en quatre groupes de même effectif (à une unité près)
(**) La médiane sépare une série statistique en deux groupes de même effectif, l'un contient les valeurs les plus petites et l'autre les valeurs les plus grandes.
Pr Dominique Baudon
Références
[1] Organisation mondiale de la Santé 2020-Lignes directrices de l’OMS sur l’activité physique et la sédentarité : en un coup d’œil - WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour: at a glance- https://apps.who.int/iris/bitstream/han ... 62-fre.pdf
[2] https://www.lequipe.fr/Coaching/Conseil ... our/741810
[3] https://www.lemonde.fr/sciences/article ... 50684.html
[4] https://myeasysante.fr/news/10-000-pas- ... -beaucoup/
https://www.lepoint.fr/sante/faut-il-vr ... 435_40.php
[5] Paluch A E et coll. : Steps per Day And All-Cause Mortality in Middle-Aged Adults in the Coronary Artery Risk Developpment I n Young Adults Study. JAMA Netw Open. 2021, 4 (9), e : 2124516.
[6] In JIM.fr, publié le 16/10/2021 https://www.jim.fr/medecin/jimplus/chif ... plus.phtml
Paluch AE et coll. : Daily steps and all-cause mortality: a meta-analysis of 15 international cohorts. Lancet Public Health 2022; 7: e219–28. doi: 10.1016/S2468-2667(21)00302-9.
Source jim.fr pour tous les articles.
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2511
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
More Than 1 in 4 Anesthesiologists Are Clinically Depressed
Lucy Hicks February 18, 2022
More than one quarter of anesthesiologists (28%) report being clinically depressed, according to the Medscape Anesthesiologist Physician Lifestyle, Happiness, and Burnout Report 2022.
Nearly half of anesthesiologists (47%) said they were burned-out, similar to physicians across all specialties. The specialties that most frequently reported burnout were emergency medicine (60%) and critical care (59%), while dermatology (33%) and public health and preventive medicine (26%) ranked lowest on the list.
This new report was compiled from an online survey that included more than 13,000 physicians from 29 specialties, of which 6% of respondents were anesthesiologists. Most respondents (61%) were male; 38% were female. The most common age of respondents was 55–64 (31%), followed by 45–54 (25%) and those 65 years or older (20%). The survey was available from June 29, 2021, to September 26, 2021.
Female anesthesiologists more frequently reported burnout compared to their male peers (53% vs 45%). Lack of respect from colleagues (57%) and lack of control in life (54%) were the most common contributors to burnout. Other factors included too many work hours (44%), insufficient pay (31%), and too many bureaucratic tasks (31%). More than half (54%) of anesthesiologists said they were more burned out now than in the first few months of the pandemic, which matched with the proportion of physicians overall (55%).
Reducing work hours (30%) and participating in meditation or other stress-reduction techniques (28%) were the most popular ways of combating burnout, followed by changing their work settlings (21%) and speaking with the hospital administration about productivity pressure (11%). About 6 out of 10 respondents (59%) said that they would be willing to accept a decrease in their salary if that meant a better work-life balance.
Feelings of depression, or "colloquial depression," were common among anesthesiologists, with 62% reporting feeling down, blue, or sad. The proportion of anesthesiologists with clinical depression (28%) was slightly higher than that of physicians across all specialties (24%). More than half (56%) of anesthesiologists said their depression did not affect patient interactions, while 27% said they were easily exasperated with patients. A quarter of respondents (25%) said they were less motivated to take patient notes carefully, 13% reported expressing their frustration in front of patients, and 9% said they made errors that they may not ordinarily have made.
Most anesthesiologists reported being married (81%), and 4% reported living with a partner. In the married group, 82% said their marriage was "very good" or "good," placing anesthesiologists toward the middle of all specialties regarding marital happiness. Allergists and otolaryngologists topped the list (91%), while plastic surgeons ranked last (75%).
Prior to the pandemic, 82% of anesthesiologists reported being "very happy" or "somewhat happy" outside of work, but that proportion has now dropped to 57%. Exercising (68%), spending time with family and friends (67%), and participating in non–work-related hobbies (66%) were the most popular activities to help promote happiness and mental health. Getting enough sleep (45%) and eating healthy (42%) were also common, while just 8% of anesthesiologists said therapy helped maintain their well-being.
Lucy Hicks February 18, 2022
More than one quarter of anesthesiologists (28%) report being clinically depressed, according to the Medscape Anesthesiologist Physician Lifestyle, Happiness, and Burnout Report 2022.
Nearly half of anesthesiologists (47%) said they were burned-out, similar to physicians across all specialties. The specialties that most frequently reported burnout were emergency medicine (60%) and critical care (59%), while dermatology (33%) and public health and preventive medicine (26%) ranked lowest on the list.
This new report was compiled from an online survey that included more than 13,000 physicians from 29 specialties, of which 6% of respondents were anesthesiologists. Most respondents (61%) were male; 38% were female. The most common age of respondents was 55–64 (31%), followed by 45–54 (25%) and those 65 years or older (20%). The survey was available from June 29, 2021, to September 26, 2021.
Female anesthesiologists more frequently reported burnout compared to their male peers (53% vs 45%). Lack of respect from colleagues (57%) and lack of control in life (54%) were the most common contributors to burnout. Other factors included too many work hours (44%), insufficient pay (31%), and too many bureaucratic tasks (31%). More than half (54%) of anesthesiologists said they were more burned out now than in the first few months of the pandemic, which matched with the proportion of physicians overall (55%).
Reducing work hours (30%) and participating in meditation or other stress-reduction techniques (28%) were the most popular ways of combating burnout, followed by changing their work settlings (21%) and speaking with the hospital administration about productivity pressure (11%). About 6 out of 10 respondents (59%) said that they would be willing to accept a decrease in their salary if that meant a better work-life balance.
Feelings of depression, or "colloquial depression," were common among anesthesiologists, with 62% reporting feeling down, blue, or sad. The proportion of anesthesiologists with clinical depression (28%) was slightly higher than that of physicians across all specialties (24%). More than half (56%) of anesthesiologists said their depression did not affect patient interactions, while 27% said they were easily exasperated with patients. A quarter of respondents (25%) said they were less motivated to take patient notes carefully, 13% reported expressing their frustration in front of patients, and 9% said they made errors that they may not ordinarily have made.
Most anesthesiologists reported being married (81%), and 4% reported living with a partner. In the married group, 82% said their marriage was "very good" or "good," placing anesthesiologists toward the middle of all specialties regarding marital happiness. Allergists and otolaryngologists topped the list (91%), while plastic surgeons ranked last (75%).
Prior to the pandemic, 82% of anesthesiologists reported being "very happy" or "somewhat happy" outside of work, but that proportion has now dropped to 57%. Exercising (68%), spending time with family and friends (67%), and participating in non–work-related hobbies (66%) were the most popular activities to help promote happiness and mental health. Getting enough sleep (45%) and eating healthy (42%) were also common, while just 8% of anesthesiologists said therapy helped maintain their well-being.
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2511
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Publié le 05/04/2022
Améliorer la survie des victimes d'avalanche, une expérience qui ne manque pas d’air !
La physiologie des victimes d'avalanche complètement ensevelies peut être influencée par le traumatisme, l'asphyxie (hypoxie et hypercapnie) et l'hypothermie. L'hypothermie est rarement le seul mécanisme de la mort, mais devient un facteur de plus en plus important au fil du temps. Environ 10 % des décès sont causés par le traumatisme, principalement pendant les 10 premières minutes. Au cours des 35 minutes suivantes, la mortalité peut augmenter jusqu'à 75 % en raison de l'asphyxie, ce qui souligne l'importance pronostique de la présence d'une poche d'air devant les voies respiratoires, d'une identification et d'un accès rapides au lieu de l'accident et d'une désincarcération accélérée. Les dépôts de neige entourant les victimes d'avalanche peuvent entraver la respiration en raison de la pression thoracique et de l'obstruction des voies respiratoires qui entraîne rapidement un arrêt cardiaque hypoxique. Deux victimes d'avalanche sur trois ayant une poche d'air survivent, contre 4 % sans poche d'air. La première respiration de la victime dans la poche d'air est constituée d'air atmosphérique piégé. La ré-inhalation commence immédiatement, la disponibilité de l'oxygène et l'accumulation de dioxyde de carbone atteignant rapidement des niveaux délétères, en fonction du volume de la poche d'air et du taux de diffusion des gaz. Un petit volume de poche d'air, combiné à une densité de neige élevée, à une profondeur d'ensevelissement et à un temps d'ensevelissement accru, augmente la mortalité.
L'efficacité des dispositifs d'appoint conduisant l'air expiré loin de la bouche/du nez pour éviter la ré-inhalation est documentée. L’objectif de cette étude prospective randomisée croisée sur le terrain, avec un scénario d'avalanche contrôlé et simulé, menée auprès de sujets sains, était d'évaluer l'impact du concept d'alimentation en air de la poche à air par un tube fixé au menton des victimes d'avalanches respirant dans une poche à air. Comment l'apport d'air par un tube placé devant le sujet influençait-il la ré-inhalation de CO2 (intervention) par rapport à l'absence d'air (contrôle) en combinaison avec une hypoxie légère ?
Le site de l’essai était constitué d'un tas de neige aplani à la machine et d'une paroi verticale lisse (2 × 45 m). Dans la paroi de neige, quarante poches d'air normalisées avaient été creusées. Les propriétés des dépôts de neige ont été explorées par des échantillons prélevés entre les poches d'air et dans la même couche relative que celles-ci, comme le recommandent Fierz C. et al.
Vingt sujets (des deux sexes) en bonne santé (classe 1 de l'American Society of Anaesthesiologists, âge : 24,4 ± 3,5 ans, IMC : 23,6 ± 2,0) ont été répartis au hasard entre le groupe témoin et le groupe d'intervention. Chaque sujet a suivi les deux scénarios avec une restitution de plus d'une heure et une observation individuelle entre les deux scénarios. L’hypothèse de cette étude menée en Norvège, était que l'apport d'air supplémentaire vers le visage de la victime dans la poche d'air prolongerait la fenêtre de survie potentielle.
Les sujets ont reçu au premier ou au deuxième passage 2 litres d'air brut par minute devant la bouche/le nez pendant l'intervention et rien pendant le contrôle, sans savoir s'ils recevaient de l'air ou non. La durée du test était de 25 minutes maximum ou se terminait si la saturation périphérique en oxygène (SpO2) atteignait 80 %, si le CO2 de fin d'expiration (EtCO2) atteignait 60 mmHg, ou si le sujet signalait qu'il souhaitait sortir.
La preuve de concept
Sous apport d’air, il a été noté de meilleurs résultats pour les paramètres EtCO2 minimum et maximum, fréquence respiratoire, volume courant, ventilation minute, fréquence cardiaque, pression artérielle invasive, oxymétrie périphérique et cérébrale. Moins de sujets du groupe témoin sont parvenus au terme de l’étude par rapport au groupe d'intervention (26 % vs 74 %), ainsi que le nombre de minutes passées dans la poche d'air avant l'interruption (13,1 ± 8,1 contre 22,4 ± 5,6), respectivement.
Cette étude a montré que l’administration d'un débit de 1,5 L/min devant les voies respiratoires réduisait de manière significative la ré-inhalation de CO2, permettait de maintenir les paramètres physiologiques à des niveaux normaux pendant une période significativement plus longue et donc de gagner du temps jusqu'à la désincarcération et la survie éventuelle. Si le concept d'intégration d'air pressurisé dans les sacs à dos airbag (ballons d'avalanche) est connu, l'utilisation d'air pressurisé ou d'une pompe intégrée dans le sac à dos pour fournir de l'air frais près de la bouche/du nez des victimes doit être explorée.
Quelques limitations
Pour des raisons d'éthique et de sécurité, il n'a pas été possible d'inclure les effets de l'hypothermie sur les mesures physiologiques, ni la réduction de la capacité à respirer (c'est-à-dire la pression thoracique supplémentaire causée par la neige, l'obstruction des voies respiratoires, la position aléatoire du corps). La pression thoracique externe aurait probablement un impact négatif sur la capacité de compensation respiratoire de l'asphyxie. La mesure de la température corporelle n'a pas été effectuée ou jugée nécessaire, car les sujets portaient des vêtements d'hiver et étaient placés sur un matelas isolant. Une fuite d'air ambiant dans la poche à air a pu se produire. Le capteur de gaz n'a pas signalé de valeurs de CO2 supérieures à 5 %. Étant donné que le capteur de gaz a retiré à la fois de l'O2 et du CO2 de la poche à air, cela peut avoir influencé les résultats. Enfin, les mesures de spirométrie n'ont pas pu être effectuées pendant le test.
Dr Bernard-Alex Gaüzère
Référence
Lars Wik et coll. : Physiological effects of providing supplemental air for avalanche victims. A randomised trial, Resuscitation, 2022, 172 : 38-46.
______________
Direct 5 avril : Situation stable en soins critiques | Bientôt la 87ème dose ? | Confinement total à Shanghai
13h - Confinement total à Shanghai
Face à l’échec du confinement tournant (isolement de l’est puis de l’ouest de la ville), les autorités chinoises ont décidé de confiner la totalité des 26 millions d’habitants de Shanghai pour tenter de freiner la circulation du virus. Plus de 13 000 contaminations ont été recensées ce lundi en Chine, un record depuis la première vague de l’hiver 2020.
12h – Fin prochaine de l’isolement obligatoire en Allemagne
A compter du 1er mai prochain, les Allemands testés positifs n’auront plus l’obligation de s’isoler pendant 5 jours. Respecter une quarantaine restera tout de même « fortement recommandé » a précisé le ministère de la Santé. Actuellement, environ 200 000 Allemands sont contaminés chaque jour.
11h - Bientôt la 87ème dose ?
Un Allemand de 61 ans originaire de Saxe s’est fait vacciné à 87 reprises en l’espace de neuf mois rapporte la presse allemande. L’individu, qui s’est parfois fait vacciné trois fois en une journée, revendait ses certificats de vaccination en trop à des antivaccins. Le fraudeur a été arrêté alors qu’il tentait de se faire vacciner pour la 88ème fois à Leipzig. A l’heure de la 4ème dose, espérons qu’il ne soit pas un précurseur.
10h - Lien possible entre vaccination et perte d’audition
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a annoncé dans un communiqué ce lundi qu’elle allait enquêter sur un lien éventuel entre la vaccination contre la Covid-19 et la survenance d’acouphène et de perte auditive. 37 500 cas ont été signalés dans le monde (sur 11 milliards de doses injectés), les symptômes disparaissant généralement quelques heures après la vaccination.
9h - Situation stable en soins critiques
Selon les données de Santé publique France arrêtées au soir du 4 avril, on comptabilise :
• 27 648 nouveaux cas de Covid-19 (vs 29 455 cas le 28 mars)
• 22 835 personnes hospitalisées pour Covid-19 (+ 1 762 en une semaine)
• 1 541 personnes hospitalisées en soins critiques (+ 8 en une semaine)
• 834 morts au cours de la semaine
• 142 655 morts depuis le début de l’épidémie (64 780 en 2020, 58 961 en 2021, 18 914 en 2022)
8h - Un point de situation dans le monde
Selon les dernières statistiques publiées par l’université John Hopkins de Baltimore, depuis le début de la pandémie 493 904 579 cas de Covid ont été identifiés dans le monde qui ont contribué à 6 170 945 décès. Ces quatre dernières semaines, les pays les plus impactés par la Covid sont, en nombre de contaminations la Corée du Sud (9 397 710), l’Allemagne (5 641 305) et le Vietnam (5 284 987) et en nombre de décès les Etats-Unis (35 859), la Russie (12 728) et la Corée du Sud (8 380).
Source : jim.fr
Améliorer la survie des victimes d'avalanche, une expérience qui ne manque pas d’air !
La physiologie des victimes d'avalanche complètement ensevelies peut être influencée par le traumatisme, l'asphyxie (hypoxie et hypercapnie) et l'hypothermie. L'hypothermie est rarement le seul mécanisme de la mort, mais devient un facteur de plus en plus important au fil du temps. Environ 10 % des décès sont causés par le traumatisme, principalement pendant les 10 premières minutes. Au cours des 35 minutes suivantes, la mortalité peut augmenter jusqu'à 75 % en raison de l'asphyxie, ce qui souligne l'importance pronostique de la présence d'une poche d'air devant les voies respiratoires, d'une identification et d'un accès rapides au lieu de l'accident et d'une désincarcération accélérée. Les dépôts de neige entourant les victimes d'avalanche peuvent entraver la respiration en raison de la pression thoracique et de l'obstruction des voies respiratoires qui entraîne rapidement un arrêt cardiaque hypoxique. Deux victimes d'avalanche sur trois ayant une poche d'air survivent, contre 4 % sans poche d'air. La première respiration de la victime dans la poche d'air est constituée d'air atmosphérique piégé. La ré-inhalation commence immédiatement, la disponibilité de l'oxygène et l'accumulation de dioxyde de carbone atteignant rapidement des niveaux délétères, en fonction du volume de la poche d'air et du taux de diffusion des gaz. Un petit volume de poche d'air, combiné à une densité de neige élevée, à une profondeur d'ensevelissement et à un temps d'ensevelissement accru, augmente la mortalité.
L'efficacité des dispositifs d'appoint conduisant l'air expiré loin de la bouche/du nez pour éviter la ré-inhalation est documentée. L’objectif de cette étude prospective randomisée croisée sur le terrain, avec un scénario d'avalanche contrôlé et simulé, menée auprès de sujets sains, était d'évaluer l'impact du concept d'alimentation en air de la poche à air par un tube fixé au menton des victimes d'avalanches respirant dans une poche à air. Comment l'apport d'air par un tube placé devant le sujet influençait-il la ré-inhalation de CO2 (intervention) par rapport à l'absence d'air (contrôle) en combinaison avec une hypoxie légère ?
Le site de l’essai était constitué d'un tas de neige aplani à la machine et d'une paroi verticale lisse (2 × 45 m). Dans la paroi de neige, quarante poches d'air normalisées avaient été creusées. Les propriétés des dépôts de neige ont été explorées par des échantillons prélevés entre les poches d'air et dans la même couche relative que celles-ci, comme le recommandent Fierz C. et al.
Vingt sujets (des deux sexes) en bonne santé (classe 1 de l'American Society of Anaesthesiologists, âge : 24,4 ± 3,5 ans, IMC : 23,6 ± 2,0) ont été répartis au hasard entre le groupe témoin et le groupe d'intervention. Chaque sujet a suivi les deux scénarios avec une restitution de plus d'une heure et une observation individuelle entre les deux scénarios. L’hypothèse de cette étude menée en Norvège, était que l'apport d'air supplémentaire vers le visage de la victime dans la poche d'air prolongerait la fenêtre de survie potentielle.
Les sujets ont reçu au premier ou au deuxième passage 2 litres d'air brut par minute devant la bouche/le nez pendant l'intervention et rien pendant le contrôle, sans savoir s'ils recevaient de l'air ou non. La durée du test était de 25 minutes maximum ou se terminait si la saturation périphérique en oxygène (SpO2) atteignait 80 %, si le CO2 de fin d'expiration (EtCO2) atteignait 60 mmHg, ou si le sujet signalait qu'il souhaitait sortir.
La preuve de concept
Sous apport d’air, il a été noté de meilleurs résultats pour les paramètres EtCO2 minimum et maximum, fréquence respiratoire, volume courant, ventilation minute, fréquence cardiaque, pression artérielle invasive, oxymétrie périphérique et cérébrale. Moins de sujets du groupe témoin sont parvenus au terme de l’étude par rapport au groupe d'intervention (26 % vs 74 %), ainsi que le nombre de minutes passées dans la poche d'air avant l'interruption (13,1 ± 8,1 contre 22,4 ± 5,6), respectivement.
Cette étude a montré que l’administration d'un débit de 1,5 L/min devant les voies respiratoires réduisait de manière significative la ré-inhalation de CO2, permettait de maintenir les paramètres physiologiques à des niveaux normaux pendant une période significativement plus longue et donc de gagner du temps jusqu'à la désincarcération et la survie éventuelle. Si le concept d'intégration d'air pressurisé dans les sacs à dos airbag (ballons d'avalanche) est connu, l'utilisation d'air pressurisé ou d'une pompe intégrée dans le sac à dos pour fournir de l'air frais près de la bouche/du nez des victimes doit être explorée.
Quelques limitations
Pour des raisons d'éthique et de sécurité, il n'a pas été possible d'inclure les effets de l'hypothermie sur les mesures physiologiques, ni la réduction de la capacité à respirer (c'est-à-dire la pression thoracique supplémentaire causée par la neige, l'obstruction des voies respiratoires, la position aléatoire du corps). La pression thoracique externe aurait probablement un impact négatif sur la capacité de compensation respiratoire de l'asphyxie. La mesure de la température corporelle n'a pas été effectuée ou jugée nécessaire, car les sujets portaient des vêtements d'hiver et étaient placés sur un matelas isolant. Une fuite d'air ambiant dans la poche à air a pu se produire. Le capteur de gaz n'a pas signalé de valeurs de CO2 supérieures à 5 %. Étant donné que le capteur de gaz a retiré à la fois de l'O2 et du CO2 de la poche à air, cela peut avoir influencé les résultats. Enfin, les mesures de spirométrie n'ont pas pu être effectuées pendant le test.
Dr Bernard-Alex Gaüzère
Référence
Lars Wik et coll. : Physiological effects of providing supplemental air for avalanche victims. A randomised trial, Resuscitation, 2022, 172 : 38-46.
______________
Direct 5 avril : Situation stable en soins critiques | Bientôt la 87ème dose ? | Confinement total à Shanghai
13h - Confinement total à Shanghai
Face à l’échec du confinement tournant (isolement de l’est puis de l’ouest de la ville), les autorités chinoises ont décidé de confiner la totalité des 26 millions d’habitants de Shanghai pour tenter de freiner la circulation du virus. Plus de 13 000 contaminations ont été recensées ce lundi en Chine, un record depuis la première vague de l’hiver 2020.
12h – Fin prochaine de l’isolement obligatoire en Allemagne
A compter du 1er mai prochain, les Allemands testés positifs n’auront plus l’obligation de s’isoler pendant 5 jours. Respecter une quarantaine restera tout de même « fortement recommandé » a précisé le ministère de la Santé. Actuellement, environ 200 000 Allemands sont contaminés chaque jour.
11h - Bientôt la 87ème dose ?
Un Allemand de 61 ans originaire de Saxe s’est fait vacciné à 87 reprises en l’espace de neuf mois rapporte la presse allemande. L’individu, qui s’est parfois fait vacciné trois fois en une journée, revendait ses certificats de vaccination en trop à des antivaccins. Le fraudeur a été arrêté alors qu’il tentait de se faire vacciner pour la 88ème fois à Leipzig. A l’heure de la 4ème dose, espérons qu’il ne soit pas un précurseur.
10h - Lien possible entre vaccination et perte d’audition
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a annoncé dans un communiqué ce lundi qu’elle allait enquêter sur un lien éventuel entre la vaccination contre la Covid-19 et la survenance d’acouphène et de perte auditive. 37 500 cas ont été signalés dans le monde (sur 11 milliards de doses injectés), les symptômes disparaissant généralement quelques heures après la vaccination.
9h - Situation stable en soins critiques
Selon les données de Santé publique France arrêtées au soir du 4 avril, on comptabilise :
• 27 648 nouveaux cas de Covid-19 (vs 29 455 cas le 28 mars)
• 22 835 personnes hospitalisées pour Covid-19 (+ 1 762 en une semaine)
• 1 541 personnes hospitalisées en soins critiques (+ 8 en une semaine)
• 834 morts au cours de la semaine
• 142 655 morts depuis le début de l’épidémie (64 780 en 2020, 58 961 en 2021, 18 914 en 2022)
8h - Un point de situation dans le monde
Selon les dernières statistiques publiées par l’université John Hopkins de Baltimore, depuis le début de la pandémie 493 904 579 cas de Covid ont été identifiés dans le monde qui ont contribué à 6 170 945 décès. Ces quatre dernières semaines, les pays les plus impactés par la Covid sont, en nombre de contaminations la Corée du Sud (9 397 710), l’Allemagne (5 641 305) et le Vietnam (5 284 987) et en nombre de décès les Etats-Unis (35 859), la Russie (12 728) et la Corée du Sud (8 380).
Source : jim.fr
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2511
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
En attenant un procès, quasi inéluctable sur ce groupe et les autres.
Publié le 06/04/2022
Le rapport de l’IGAS et de l’IGF pointent du doigt de nombreuses irrégularités dans la gestion des Ehpad du groupe Orpea.
Finalement, le rapport a bien été publié. « En toute transparence » selon les termes de la ministre déléguée à l’Autonomie Brigitte Bourguignon, les conclusions de l’enquête de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) et de l’Inspection Générale des Finances (IGF) sur le groupe Orpea, leader mondial des Ehpad, ont finalement été mises en ligne sur le site du Ministère de la Santé ce mardi. Le 26 mars, le gouvernement avait pourtant annoncé dans un premier temps que ce rapport ne serait pas rendu public, au nom de la protection du secret des affaires. Mais face aux protestations suscitées par cette opacité, l’exécutif a fait machine arrière, expliquant trois jours plus tard avoir toujours été favorable à la publication du rapport. Finalement, seules les parties portant atteinte à la vie privée des résidents ou révélant l’identité des fournisseurs d’Orpea ont été « caviardés ».
Des fonds publics détournés de leur objet initial
Plus de deux mois après la publication du livre-enquête « Les Fossoyeurs », qui a lancé le scandale Orpea, le rapport de l’IGAS et de l’IGF confirment en grande partie les accusations portées par Victor Castanet dans son ouvrage. « Le doute n’a plus sa place dans cette affaire » se permet même de commenter le ministre de la Santé Olivier Véran. L’enquête démontre bel et bien l’existence d’un « système Orpea », où la direction « donne la priorité à la performance financière » au détriment de l’intérêt des employés et résidents des établissements du groupe
De nombreuses anomalies dans la gestion des Ehpad sont mises en lumière par le rapport, à commencer par des irrégularités comptables. Une partie importante des fonds publics adressés au groupe Orpea seraient en effet détournés. 50 millions d’euros normalement destinés au financement de la prise en charge médicale des résidents sont ainsi alloués à des dépenses non-sanitaires, comme la rémunération des auxiliaires de vie, le paiement des charges sociales ou la prise en charge de l’assurance civile, dépenses qui doivent en principe être supportées par le groupe Orpea sur ses fonds propres. Pire encore, entre 2017 et 2020, la société Orpea a dégagé 20 millions d’euros d’excédents sur ces dotations publiques.
Un problème récurrent de malnutrition
Les Ehpad gérés par Orpea sont également affectés par un manque important de personnel. Le taux d’encadrement des établissements Orpea (61,6 salariés pour 100 lits) est ainsi légèrement inférieur au taux moyen dans le secteur privé lucratif (62,1 salariés). Un manque de moyens humains qui est aggravé par un important turn-over : le taux de rotation du personnel est de 346 % à Orpea contre 195 % dans le reste du secteur. Une précarité de l’emploi qui touche même les cadres de l’entreprise : entre 10 et 15 % des directeurs d’établissements quittent leur poste chaque année.
Le « détournement » des fonds destinés aux Ehpad, le manque de personnel et l’instabilité des équipes ont évidemment un impact très négatif sur la prise en charge des résidents. Le rapport note notamment « des fragilités spécifiques dans le domaine de la nutrition », comme l’avait déjà souligné l’enquête de Victor Castanet. Les « grammages » utilisés par les cuisiniers des Ehpad Orpea sont ainsi significativement inférieur à ceux préconisés par les nutritionnistes pour les personnes âgées (jusqu’à 42 % pour la viande). Plus de 52 % des résidents des Ehpad Orpea seraient en dénutrition modérée ou sévère.
Selon les enquêteurs de l’IGAS et de l’IGF, les dysfonctionnements qu’ils relèvent avaient déjà été mis à jour lors des 64 inspections menées par les Agences Régionales de Santé (ARS) dans des Ehpad du groupe Orpea ces trois dernières années. Mais si Orpea a fait l’objet de nombreuses recommandations et injonctions de la part des autorités sanitaires pour améliorer la prise en charge des résidents, peu semblent avoir été suivies d’effets. Au-delà du cas d’Orpea, c’est donc la question de l’insuffisance du contrôle des Ehpad par l’administration que pose ce rapport.
Nicolas Barbet
jim.fr
Pour télécharger les rapports
Publié le 06/04/2022
Le rapport de l’IGAS et de l’IGF pointent du doigt de nombreuses irrégularités dans la gestion des Ehpad du groupe Orpea.
Finalement, le rapport a bien été publié. « En toute transparence » selon les termes de la ministre déléguée à l’Autonomie Brigitte Bourguignon, les conclusions de l’enquête de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) et de l’Inspection Générale des Finances (IGF) sur le groupe Orpea, leader mondial des Ehpad, ont finalement été mises en ligne sur le site du Ministère de la Santé ce mardi. Le 26 mars, le gouvernement avait pourtant annoncé dans un premier temps que ce rapport ne serait pas rendu public, au nom de la protection du secret des affaires. Mais face aux protestations suscitées par cette opacité, l’exécutif a fait machine arrière, expliquant trois jours plus tard avoir toujours été favorable à la publication du rapport. Finalement, seules les parties portant atteinte à la vie privée des résidents ou révélant l’identité des fournisseurs d’Orpea ont été « caviardés ».
Des fonds publics détournés de leur objet initial
Plus de deux mois après la publication du livre-enquête « Les Fossoyeurs », qui a lancé le scandale Orpea, le rapport de l’IGAS et de l’IGF confirment en grande partie les accusations portées par Victor Castanet dans son ouvrage. « Le doute n’a plus sa place dans cette affaire » se permet même de commenter le ministre de la Santé Olivier Véran. L’enquête démontre bel et bien l’existence d’un « système Orpea », où la direction « donne la priorité à la performance financière » au détriment de l’intérêt des employés et résidents des établissements du groupe
De nombreuses anomalies dans la gestion des Ehpad sont mises en lumière par le rapport, à commencer par des irrégularités comptables. Une partie importante des fonds publics adressés au groupe Orpea seraient en effet détournés. 50 millions d’euros normalement destinés au financement de la prise en charge médicale des résidents sont ainsi alloués à des dépenses non-sanitaires, comme la rémunération des auxiliaires de vie, le paiement des charges sociales ou la prise en charge de l’assurance civile, dépenses qui doivent en principe être supportées par le groupe Orpea sur ses fonds propres. Pire encore, entre 2017 et 2020, la société Orpea a dégagé 20 millions d’euros d’excédents sur ces dotations publiques.
Un problème récurrent de malnutrition
Les Ehpad gérés par Orpea sont également affectés par un manque important de personnel. Le taux d’encadrement des établissements Orpea (61,6 salariés pour 100 lits) est ainsi légèrement inférieur au taux moyen dans le secteur privé lucratif (62,1 salariés). Un manque de moyens humains qui est aggravé par un important turn-over : le taux de rotation du personnel est de 346 % à Orpea contre 195 % dans le reste du secteur. Une précarité de l’emploi qui touche même les cadres de l’entreprise : entre 10 et 15 % des directeurs d’établissements quittent leur poste chaque année.
Le « détournement » des fonds destinés aux Ehpad, le manque de personnel et l’instabilité des équipes ont évidemment un impact très négatif sur la prise en charge des résidents. Le rapport note notamment « des fragilités spécifiques dans le domaine de la nutrition », comme l’avait déjà souligné l’enquête de Victor Castanet. Les « grammages » utilisés par les cuisiniers des Ehpad Orpea sont ainsi significativement inférieur à ceux préconisés par les nutritionnistes pour les personnes âgées (jusqu’à 42 % pour la viande). Plus de 52 % des résidents des Ehpad Orpea seraient en dénutrition modérée ou sévère.
Selon les enquêteurs de l’IGAS et de l’IGF, les dysfonctionnements qu’ils relèvent avaient déjà été mis à jour lors des 64 inspections menées par les Agences Régionales de Santé (ARS) dans des Ehpad du groupe Orpea ces trois dernières années. Mais si Orpea a fait l’objet de nombreuses recommandations et injonctions de la part des autorités sanitaires pour améliorer la prise en charge des résidents, peu semblent avoir été suivies d’effets. Au-delà du cas d’Orpea, c’est donc la question de l’insuffisance du contrôle des Ehpad par l’administration que pose ce rapport.
Nicolas Barbet
jim.fr
Pour télécharger les rapports
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2511
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Publié le 21/04/2022
AP-HP : déluge de critiques contre Noé Santé
L’AP-HP essuie les critiques des médecins et des syndicats pour avoir confié la gestion du retour des patients à domicile à une start-up privée.
La « start-up nation » au cœur de l’AP-HP (Assistance Publique Hôpitaux de Paris). Face à un nombre toujours plus important de patients et des effectifs toujours plus faible, les hôpitaux publics français sont tentés de faire appel à des solutions innovantes et pourquoi pas à des acteurs privés pour diminuer la durée des hospitalisations et réduire l’occupation des lits. C’est le choix très discutable fait par l’AP-HP qui a conclu en août 2021 un contrat avec la start-up Noé Santé, qui promet sur son site « d’accompagner les patients pour leur retour à domicile » et « d’optimiser la durée moyenne de séjour des patients ». En clair, la société aide les établissements de santé à faire partir leurs patients le plus vite possible.
150 euros par patient « foutu dehors »
D’abord limité au service orthopédie de l’hôpital européen Georges Pompidou (HEGP), le « dispositif Noé Santé » a ensuite été étendu à cinq établissements parisiens. Au total, la start-up touche 4 000 euros pour chaque hôpital dont elle gère le flux de patients, plus une prime de 150 euros pour chaque patient « foutu dehors » ironise un médecin interrogé par les journalistes du Canard enchainé (qui révèle l’affaire). Le tout dans la limite de 960 000 euros par an.
Une somme qui parait exorbitante quand on sait qu’il existe déjà des dispositifs publics qui prennent en charge le retour à domicile des patients, comme le service « Prado », qui dépend de l’Assurance maladie. Ainsi, c’est désormais, dans les hôpitaux concernés, Noé Santé qui organise la visite d’infirmiers et de kinésithérapeutes au domicile des patients, alors que ce service était déjà assuré par les assistantes sociales de l’hôpital. Ces dernières ne sont d’ailleurs pas convaincues par les méthodes de Noé Santé. « Contrairement à cette start-up, on fait d’abord une évaluation visant à savoir si les patients sont suffisamment entourés » explique l’une d’elle au Canard. « Pour le portage des repas, on cherche en priorité les services gratuits mis en place par les mairies ou les départements alors que Noé Santé se tourne vers des acteurs privés ».
Le culte de la sous-traitance
Malgré les critiques des médecins et des syndicats, Noé Santé est un acteur qui prend de plus en plus de place au sein de l’AP-HP, y compris physiquement, puisque la société a même installé ses bureaux au sein de l’HEGP et de l’hôpital Cochin. L’entreprise a également accès au logiciel Orbis, qui contient le dossier médical de tous les patients pris en charge par l’AP-HP. Du « délire » s’indigne le syndicat Force Ouvrière, auquel la direction de l’AP-HP répond que tout cela est encadré par un « accord RGPD » qui assure que les données personnelles des patients sont protégées. Pas suffisant pour les syndicats, qui rappellent que Noé Santé travaille également pour des mutuelles et des assurances complémentaires et ne devraient donc pas avoir accès à des données médicales.
Cette affaire Noé Santé, si elle n’est sans doute pas d’une importance considérable, est en réalité symptomatique d’un mouvement paradoxal, où pour « faire des économies », des services publics dépensent des fortunes afin de faire sous-traiter à des acteurs privés ce qu’il pourrait faire eux-mêmes sans doute pour trois fois moins.
Quentin Haroche
jim.fr
_____________________
Publié le 17/04/2022
Production d’aérosols au cours de l’anesthésie générale, c’est comme quand on tousse !
L'intubation, la laryngoscopie et l'extubation sont considérées comme des procédures fortement génératrices d'aérosols, et ceci a conduit à mettre en place des protocoles de sécurité supplémentaires pendant cette pandémie de Covid-19. Cependant, les études qui ont inspiré ces nouvelles démarches sont principalement expérimentales et n'ont ni analysé l'exposition du personnel à la génération d'aérosols dans l'environnement réel de la salle d'opération, ni comparé l'exposition aux concentrations d'aérosols générées pendant les soins habituels aux patients. Il n’existe pas de consensus sur les procédures qui sont significativement génératrices d'aérosols et actuellement les CDC rappellent « qu’il n'existe ni consensus d'experts, ni données justificatives suffisantes pour créer une liste définitive et complète des procédures générant des aérosols pour les établissements de santé. »
Les concentrations de particules générées lors de l’AG et de la toux sont comparables
Afin d’évaluer l'exposition du personnel des blocs à la génération de particules potentiellement infectieuses pendant l'anesthésie générale, cette étude observationnelle multidisciplinaire monocentrique menée à l'hôpital universitaire d'Helsinki auprès de 39 patients adultes (56 % d'hommes, 44 % de femmes, âge médian 55 ans (intervalle 19-85), IMC moyen de 26,7 (intervalle 15,6 - 44,9), a mesuré la concentration et la distribution de la taille des particules à l'aide d'un calibreur optique de particules, chez les patients lors d’une intervention chirurgicale avec intubation trachéale. Les concentrations moyennes de particules pendant les différentes procédures d'anesthésie ont été comparées statistiquement aux données de contrôle de la toux recueillies auprès de 37 volontaires pour évaluer les différences dans la génération de particules.
Les mesures ont concerné 25 pré-oxygénations, 30 ventilations au masque, 28 intubations et 24 extubations. La concentration totale d'aérosols la plus élevée, de 1 153 particules (p)/cm³, a été observée pendant la ventilation au masque. Les pré-oxygénations, les ventilations au masque et les extubations ainsi que les intubations non compliquées ont généré des concentrations moyennes d'aérosol statistiquement comparables à la toux. Il convient de noter que, curieusement, l'intubation difficile a généré significativement moins d'aérosols que l'intubation simple (p = 0,007) ou la toux (p = 0,006).
Ne pas baisser la garde pour autant
Toutes les procédures effectuées au cours d'une anesthésie générale génèrent principalement des particules aérosols de petite taille (< 1 µm) qui peuvent rester en suspension dans l'air pendant de longues périodes et peuvent être inhalés jusqu'au niveau alvéolaire. D'après ces résultats, l'inscription de la pré-oxygénation, de la ventilation au masque, de l'intubation et de l'extubation sur la liste des procédures générant des aérosols à haut risque devrait être reconsidérée. En outre, en raison des grandes différences interindividuelles, des quantités élevées d'aérosol ont été observées pour certains patients. Ces résultats peuvent être appliqués à l'évaluation du risque d'infection par voie aérienne dans les salles d'opération.
Dr Bernard-Alex Gaüzère
Référence
Oksanen L-M, Sanmark E, Sofieva S, et coll. : Aerosol generation during general anesthesia is comparable to coughing: An observational clinical study. Acta Anaesthesiol Scand., 2022; 66: 463– 472. doi:10.1111/aas.14022
En savoir plus sur l'article sofia
Prise en charge des patients suspects d’infections dues au nouveau coronavirus (HcoV-EMC, ou NCoV- Sars Cov 2 Covid-19)
AP-HP : déluge de critiques contre Noé Santé
L’AP-HP essuie les critiques des médecins et des syndicats pour avoir confié la gestion du retour des patients à domicile à une start-up privée.
La « start-up nation » au cœur de l’AP-HP (Assistance Publique Hôpitaux de Paris). Face à un nombre toujours plus important de patients et des effectifs toujours plus faible, les hôpitaux publics français sont tentés de faire appel à des solutions innovantes et pourquoi pas à des acteurs privés pour diminuer la durée des hospitalisations et réduire l’occupation des lits. C’est le choix très discutable fait par l’AP-HP qui a conclu en août 2021 un contrat avec la start-up Noé Santé, qui promet sur son site « d’accompagner les patients pour leur retour à domicile » et « d’optimiser la durée moyenne de séjour des patients ». En clair, la société aide les établissements de santé à faire partir leurs patients le plus vite possible.
150 euros par patient « foutu dehors »
D’abord limité au service orthopédie de l’hôpital européen Georges Pompidou (HEGP), le « dispositif Noé Santé » a ensuite été étendu à cinq établissements parisiens. Au total, la start-up touche 4 000 euros pour chaque hôpital dont elle gère le flux de patients, plus une prime de 150 euros pour chaque patient « foutu dehors » ironise un médecin interrogé par les journalistes du Canard enchainé (qui révèle l’affaire). Le tout dans la limite de 960 000 euros par an.
Une somme qui parait exorbitante quand on sait qu’il existe déjà des dispositifs publics qui prennent en charge le retour à domicile des patients, comme le service « Prado », qui dépend de l’Assurance maladie. Ainsi, c’est désormais, dans les hôpitaux concernés, Noé Santé qui organise la visite d’infirmiers et de kinésithérapeutes au domicile des patients, alors que ce service était déjà assuré par les assistantes sociales de l’hôpital. Ces dernières ne sont d’ailleurs pas convaincues par les méthodes de Noé Santé. « Contrairement à cette start-up, on fait d’abord une évaluation visant à savoir si les patients sont suffisamment entourés » explique l’une d’elle au Canard. « Pour le portage des repas, on cherche en priorité les services gratuits mis en place par les mairies ou les départements alors que Noé Santé se tourne vers des acteurs privés ».
Le culte de la sous-traitance
Malgré les critiques des médecins et des syndicats, Noé Santé est un acteur qui prend de plus en plus de place au sein de l’AP-HP, y compris physiquement, puisque la société a même installé ses bureaux au sein de l’HEGP et de l’hôpital Cochin. L’entreprise a également accès au logiciel Orbis, qui contient le dossier médical de tous les patients pris en charge par l’AP-HP. Du « délire » s’indigne le syndicat Force Ouvrière, auquel la direction de l’AP-HP répond que tout cela est encadré par un « accord RGPD » qui assure que les données personnelles des patients sont protégées. Pas suffisant pour les syndicats, qui rappellent que Noé Santé travaille également pour des mutuelles et des assurances complémentaires et ne devraient donc pas avoir accès à des données médicales.
Cette affaire Noé Santé, si elle n’est sans doute pas d’une importance considérable, est en réalité symptomatique d’un mouvement paradoxal, où pour « faire des économies », des services publics dépensent des fortunes afin de faire sous-traiter à des acteurs privés ce qu’il pourrait faire eux-mêmes sans doute pour trois fois moins.
Quentin Haroche
jim.fr
_____________________
Publié le 17/04/2022
Production d’aérosols au cours de l’anesthésie générale, c’est comme quand on tousse !
L'intubation, la laryngoscopie et l'extubation sont considérées comme des procédures fortement génératrices d'aérosols, et ceci a conduit à mettre en place des protocoles de sécurité supplémentaires pendant cette pandémie de Covid-19. Cependant, les études qui ont inspiré ces nouvelles démarches sont principalement expérimentales et n'ont ni analysé l'exposition du personnel à la génération d'aérosols dans l'environnement réel de la salle d'opération, ni comparé l'exposition aux concentrations d'aérosols générées pendant les soins habituels aux patients. Il n’existe pas de consensus sur les procédures qui sont significativement génératrices d'aérosols et actuellement les CDC rappellent « qu’il n'existe ni consensus d'experts, ni données justificatives suffisantes pour créer une liste définitive et complète des procédures générant des aérosols pour les établissements de santé. »
Les concentrations de particules générées lors de l’AG et de la toux sont comparables
Afin d’évaluer l'exposition du personnel des blocs à la génération de particules potentiellement infectieuses pendant l'anesthésie générale, cette étude observationnelle multidisciplinaire monocentrique menée à l'hôpital universitaire d'Helsinki auprès de 39 patients adultes (56 % d'hommes, 44 % de femmes, âge médian 55 ans (intervalle 19-85), IMC moyen de 26,7 (intervalle 15,6 - 44,9), a mesuré la concentration et la distribution de la taille des particules à l'aide d'un calibreur optique de particules, chez les patients lors d’une intervention chirurgicale avec intubation trachéale. Les concentrations moyennes de particules pendant les différentes procédures d'anesthésie ont été comparées statistiquement aux données de contrôle de la toux recueillies auprès de 37 volontaires pour évaluer les différences dans la génération de particules.
Les mesures ont concerné 25 pré-oxygénations, 30 ventilations au masque, 28 intubations et 24 extubations. La concentration totale d'aérosols la plus élevée, de 1 153 particules (p)/cm³, a été observée pendant la ventilation au masque. Les pré-oxygénations, les ventilations au masque et les extubations ainsi que les intubations non compliquées ont généré des concentrations moyennes d'aérosol statistiquement comparables à la toux. Il convient de noter que, curieusement, l'intubation difficile a généré significativement moins d'aérosols que l'intubation simple (p = 0,007) ou la toux (p = 0,006).
Ne pas baisser la garde pour autant
Toutes les procédures effectuées au cours d'une anesthésie générale génèrent principalement des particules aérosols de petite taille (< 1 µm) qui peuvent rester en suspension dans l'air pendant de longues périodes et peuvent être inhalés jusqu'au niveau alvéolaire. D'après ces résultats, l'inscription de la pré-oxygénation, de la ventilation au masque, de l'intubation et de l'extubation sur la liste des procédures générant des aérosols à haut risque devrait être reconsidérée. En outre, en raison des grandes différences interindividuelles, des quantités élevées d'aérosol ont été observées pour certains patients. Ces résultats peuvent être appliqués à l'évaluation du risque d'infection par voie aérienne dans les salles d'opération.
Dr Bernard-Alex Gaüzère
Référence
Oksanen L-M, Sanmark E, Sofieva S, et coll. : Aerosol generation during general anesthesia is comparable to coughing: An observational clinical study. Acta Anaesthesiol Scand., 2022; 66: 463– 472. doi:10.1111/aas.14022
En savoir plus sur l'article sofia
Prise en charge des patients suspects d’infections dues au nouveau coronavirus (HcoV-EMC, ou NCoV- Sars Cov 2 Covid-19)
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2511
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Publié le 25/04/2022
Qui pour remplacer Olivier Véran ?
Les urnes ont parlé : le Président de la République a été réélu ce dimanche 24 avril avec 58,5 % des suffrages exprimés. Un nouveau Premier ministre sera rapidement nommé et un gouvernement formé. Le grand mercato politique a déjà commencé : trombinoscope des possibles futurs locataires de l’avenue de Ségur.
Bis repetita ?
Une hypothèse n’est pas à négliger : qu’Oliver Véran se succède à lui-même. Le neurologue, député de l’Isère, s’est imposé comme un poids lourd de la Macronie pendant la crise sanitaire. Certains évoquent même son nom pour Matignon. Il est, cependant, devenu un épouvantail pour les opposants aux restrictions sanitaires et le corps médical lui voue également une certaine inimitié. Il souffre également d’une image de « monsieur mauvaise nouvelle » et de père fouettard qui pourrait lui coûter les ors de la république et lui valoir de retourner sur les bancs du Palais Bourbon ou même à ses chères études.
Petit ministre deviendra grand
Si Olivier Véran est sur le départ, trois personnalités politiques seront dans les startings block, car elles occupent déjà des fonctions gouvernementales sous la responsabilité du ministre de la santé : Brigitte Bourguignon, Adrien Taquet, et Laurent Pietraszewski.
Dans cet attelage, c’est sans doute Brigitte Bourguignon qui tient la corde, députée durant 9 ans (socialiste puis LREM), ancienne présidente de la commission des affaires sociales, ministre chargée de l’autonomie, Brigitte Bourguignon coche toutes les cases (sans oublier la case parité homme-femme). En outre, venue de la gauche, elle pourrait facilement soutenir la proposition du Président de la République d’instaurer le tiers-payant généralisé (TPG).
Les hommes du président
Durant la campagne, Emmanuel Macron s’est adjoint trois référents santé : le Dr François Braun, le Dr Sebastien Mirek et Pascale Mathieu (présidente de l’Ordre des kinésithérapeutes). Si nommer une kinésithérapeute, profession pour laquelle on est en train de créer un accès direct serait un symbole important, c’est le Dr François Braun qui semble s’être imposé dans ce trio. Il a été invité régulièrement à défendre le bilan et le programme du président-candidat, ce qu’il a fait avec un certain brio, tout en apparaissant comme un homme resté libre. Président du syndicat SAMU-Urgences de France depuis 8 ans et chef du service des urgences du CHR de Metz, le Dr Braun jouit d’une certaine popularité auprès des médecins et n’a pas terni son image durant la crise Covid malgré ses nombreuses interventions. Néanmoins, son absence de vraie expérience politique pourrait l’écarter du poste. Peut-être pour un secrétariat d’Etat ?
Le vivier de l’Assemblée
La commission des affaires sociales a toujours été un vivier de futurs ministres. Deux de ses membres se sont particulièrement fait remarquer ces dernières années : les docteurs Thomas Mesnier et Stéphanie Rist. Médecins, députés, membre de la commission ils ont toutes les qualités requises pour occuper le poste.
C’est sans doute le Dr Thomas Mesnier, l’actuel rapporteur, qui est le plus proche des deux de l’Avenue de Ségur. Il a ainsi largement contribué à plusieurs réformes du quinquennat : le service d’accès aux soins, le plan Ma santé 2022, etc.
Reste que ces deux postulants pâtissent d’une certaine hostilité du corps médical, en particulier par leur défense résolue des transferts de compétences et de l’accès direct à certaines professions.
Où est le ministre ? Au cabinet
Comme cela arrive parfois, le futur ministre de la santé pourrait également être issu d’un cabinet gouvernemental. Le choix se porterait alors, par exemple, sûr, Jérôme Marchand-Arvier, ancien directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et chef de cabinet d’Olivier Véran. Il pourrait s’agir également d’Anne-Marie Armenteras, ancienne directrice de l’offre de soins et conseillère santé du Président de la république, comme Annelore Courry, énarque et ancienne directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des soins de la caisse nationale de l’assurance maladie.
Dans ce panel de hauts fonctionnaires, un homme pourrait faire la différence : Nicolas Revel.
Considéré comme un très proche du président, diplômé de l’ENA, il a dirigé la CNAM pendant 6 ans avant d’être nommé directeur de cabinet de Jean Castex. Il avait même été pressenti pour remplacer Gérard Collomb comme ministre de l'Intérieur en 2018 mais avait décliné pour « raisons personnelles ».
Il a néanmoins pour handicap de ne pas être médecin. Or, rappelons que par deux fois Emmanuel Macron a choisi un praticien à ce poste.
Un ministre d’ouverture ?
Elu par une majorité de non-macroniste, Emmanuel Macron pourrait aussi faire le choix de l’ouverture. Pourquoi pas en nommant Marisol Touraine, figure idéale pour soutenir le tiers-payant et qui apparaît de plus en plus souvent dans les cercles de la macronie et qu’on a vu dimanche, tout sourire, pour saluer la victoire du Président. Mais la défiance, voir la répulsion qu’elle inspire aux médecins est sans doute un handicap trop important.
Un homme, en revanche, bien qu’outsider, pourrait se voir propulser membre du gouvernement : le Pr Philippe Juvin.
Candidat malheureux à la primaire de la droite, figure de la crise Covid, Monsieur Santé des LR, le Pr Philippe Juvin est peut-être le candidat idéal d’un gouvernement élargi. Mais parviendrait-il à soutenir le TPG ? On a bien vu de vieux barons socialistes soutenir la retraite à 65 ans et la suppression de l’ISF…
La surprise du chef
Mais Emmanuel Macron est coutumier des nominations inattendues : n’a-t-il pas choisi par deux fois des premiers ministres que personne ne pressentait et quasiment inconnus. Il pourrait par exemple choisir un profil du type de celui d’Agnès Buzyn et sélectionner le Pr Dominique Le Guludec qui lui a succédé à la tête de la HAS. On connaît également l’appétence du Chef de l’état pour les énarques (ses deux premiers ministres l’étaient), pourquoi pas alors chercher dans le tout petit milieu des énarques-médecins, un profil à la Laurent Alexandre en somme, qui n’a d’ailleurs, il le sait, aucune chance d’être nommé ministre de la santé !
Frédéric Haroche
Jim.fr
Qui pour remplacer Olivier Véran ?
Les urnes ont parlé : le Président de la République a été réélu ce dimanche 24 avril avec 58,5 % des suffrages exprimés. Un nouveau Premier ministre sera rapidement nommé et un gouvernement formé. Le grand mercato politique a déjà commencé : trombinoscope des possibles futurs locataires de l’avenue de Ségur.
Bis repetita ?
Une hypothèse n’est pas à négliger : qu’Oliver Véran se succède à lui-même. Le neurologue, député de l’Isère, s’est imposé comme un poids lourd de la Macronie pendant la crise sanitaire. Certains évoquent même son nom pour Matignon. Il est, cependant, devenu un épouvantail pour les opposants aux restrictions sanitaires et le corps médical lui voue également une certaine inimitié. Il souffre également d’une image de « monsieur mauvaise nouvelle » et de père fouettard qui pourrait lui coûter les ors de la république et lui valoir de retourner sur les bancs du Palais Bourbon ou même à ses chères études.
Petit ministre deviendra grand
Si Olivier Véran est sur le départ, trois personnalités politiques seront dans les startings block, car elles occupent déjà des fonctions gouvernementales sous la responsabilité du ministre de la santé : Brigitte Bourguignon, Adrien Taquet, et Laurent Pietraszewski.
Dans cet attelage, c’est sans doute Brigitte Bourguignon qui tient la corde, députée durant 9 ans (socialiste puis LREM), ancienne présidente de la commission des affaires sociales, ministre chargée de l’autonomie, Brigitte Bourguignon coche toutes les cases (sans oublier la case parité homme-femme). En outre, venue de la gauche, elle pourrait facilement soutenir la proposition du Président de la République d’instaurer le tiers-payant généralisé (TPG).
Les hommes du président
Durant la campagne, Emmanuel Macron s’est adjoint trois référents santé : le Dr François Braun, le Dr Sebastien Mirek et Pascale Mathieu (présidente de l’Ordre des kinésithérapeutes). Si nommer une kinésithérapeute, profession pour laquelle on est en train de créer un accès direct serait un symbole important, c’est le Dr François Braun qui semble s’être imposé dans ce trio. Il a été invité régulièrement à défendre le bilan et le programme du président-candidat, ce qu’il a fait avec un certain brio, tout en apparaissant comme un homme resté libre. Président du syndicat SAMU-Urgences de France depuis 8 ans et chef du service des urgences du CHR de Metz, le Dr Braun jouit d’une certaine popularité auprès des médecins et n’a pas terni son image durant la crise Covid malgré ses nombreuses interventions. Néanmoins, son absence de vraie expérience politique pourrait l’écarter du poste. Peut-être pour un secrétariat d’Etat ?
Le vivier de l’Assemblée
La commission des affaires sociales a toujours été un vivier de futurs ministres. Deux de ses membres se sont particulièrement fait remarquer ces dernières années : les docteurs Thomas Mesnier et Stéphanie Rist. Médecins, députés, membre de la commission ils ont toutes les qualités requises pour occuper le poste.
C’est sans doute le Dr Thomas Mesnier, l’actuel rapporteur, qui est le plus proche des deux de l’Avenue de Ségur. Il a ainsi largement contribué à plusieurs réformes du quinquennat : le service d’accès aux soins, le plan Ma santé 2022, etc.
Reste que ces deux postulants pâtissent d’une certaine hostilité du corps médical, en particulier par leur défense résolue des transferts de compétences et de l’accès direct à certaines professions.
Où est le ministre ? Au cabinet
Comme cela arrive parfois, le futur ministre de la santé pourrait également être issu d’un cabinet gouvernemental. Le choix se porterait alors, par exemple, sûr, Jérôme Marchand-Arvier, ancien directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et chef de cabinet d’Olivier Véran. Il pourrait s’agir également d’Anne-Marie Armenteras, ancienne directrice de l’offre de soins et conseillère santé du Président de la république, comme Annelore Courry, énarque et ancienne directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des soins de la caisse nationale de l’assurance maladie.
Dans ce panel de hauts fonctionnaires, un homme pourrait faire la différence : Nicolas Revel.
Considéré comme un très proche du président, diplômé de l’ENA, il a dirigé la CNAM pendant 6 ans avant d’être nommé directeur de cabinet de Jean Castex. Il avait même été pressenti pour remplacer Gérard Collomb comme ministre de l'Intérieur en 2018 mais avait décliné pour « raisons personnelles ».
Il a néanmoins pour handicap de ne pas être médecin. Or, rappelons que par deux fois Emmanuel Macron a choisi un praticien à ce poste.
Un ministre d’ouverture ?
Elu par une majorité de non-macroniste, Emmanuel Macron pourrait aussi faire le choix de l’ouverture. Pourquoi pas en nommant Marisol Touraine, figure idéale pour soutenir le tiers-payant et qui apparaît de plus en plus souvent dans les cercles de la macronie et qu’on a vu dimanche, tout sourire, pour saluer la victoire du Président. Mais la défiance, voir la répulsion qu’elle inspire aux médecins est sans doute un handicap trop important.
Un homme, en revanche, bien qu’outsider, pourrait se voir propulser membre du gouvernement : le Pr Philippe Juvin.
Candidat malheureux à la primaire de la droite, figure de la crise Covid, Monsieur Santé des LR, le Pr Philippe Juvin est peut-être le candidat idéal d’un gouvernement élargi. Mais parviendrait-il à soutenir le TPG ? On a bien vu de vieux barons socialistes soutenir la retraite à 65 ans et la suppression de l’ISF…
La surprise du chef
Mais Emmanuel Macron est coutumier des nominations inattendues : n’a-t-il pas choisi par deux fois des premiers ministres que personne ne pressentait et quasiment inconnus. Il pourrait par exemple choisir un profil du type de celui d’Agnès Buzyn et sélectionner le Pr Dominique Le Guludec qui lui a succédé à la tête de la HAS. On connaît également l’appétence du Chef de l’état pour les énarques (ses deux premiers ministres l’étaient), pourquoi pas alors chercher dans le tout petit milieu des énarques-médecins, un profil à la Laurent Alexandre en somme, qui n’a d’ailleurs, il le sait, aucune chance d’être nommé ministre de la santé !
Frédéric Haroche
Jim.fr
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2511
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Publié le 30/04/2022
Soigner les bobos des doudous
Au moment de choisir leur spécialité après avoir passé leur ECN en juin prochain, peut être certains futur internes se tourneront vers une spécialité en plein essor : la nounoursologie. Comme chacun sait, la nounoursologie est la spécialité consacrée à la prise en charge des animaux en peluche et des doudous. Une spécialité qui ne peut s’exercer que dans le cadre d’un hôpital des nounours.
Inspiré du concept de Teddy Bear Hospitals créé par des étudiants en médecine allemands en 2000, l’hôpital des nounours est organisé par l’Association nationale des étudiants en médecine de France (ANEMF) depuis 2004. Ce programme consiste à amener des enfants âgés de 3 à 6 ans dans un service hospitalier ou un lieu transformé en hôpital fictif pour y faire soigner leurs peluches préférées. L’ours en peluche ou le doudou sont alors pris en charge par des étudiants en 2ème ou 3ème année de médecine qui endossent provisoirement le statut de nounoursologue titulaire.
Des patients un peu mutiques
Les enfants ont alors la possibilité de suivre leur compagnon en peluche tout au long de son parcours de soins, de la consultation au passage en pharmacie en passant par d’éventuels examens approfondis ou des interventions chirurgicales. Les doudous ont une vie tourmentée et peuvent souffrir de maux bien différents, tels des déchirures, des tâches diverses et variés voire des morsures d’animaux de compagnie.
Les nounours ne sont pas forcément les patients les plus faciles, en raison de leur mutisme, mais les enfants sont là pour traduire leurs symptômes pour les médecins. La nournoursologie est fort heureusement prise en charge à 100 % par l’Assurance Maladie depuis que le Ministère de la Santé a commencé à soutenir l’hôpital des nounours en 2010. Les ours en peluche sont également épargnés par les aspects les moins agréables de notre système hospitalier, comme l’attente interminable, les plateaux repas de piètre qualité et surtout le passage à la caisse.
La nounoursologie, une spécialité en plein essor
Selon l’ANEMF, l’hôpital des nounours poursuit un triple objectif. Tout d’abord, il permet de réduire l’angoisse des enfants face aux hôpitaux et aux médecins dans le cas où ils doivent un jour être hospitalisés. En second lieu, un passage à l’hôpital des nounours permet aux enfants d’en savoir plus sur leur corps et leur santé (et peut être susciter de futurs vocations). Enfin, l’expérience permet aux futurs médecins d’apprendre à se confronter à de jeunes patients.
Désormais organisé en Allemagne, en France et en Suisse, l’hôpital des nounours prend de plus en plus d’ampleur avec les années. Lors de sa première édition en 2004, seulement six hôpitaux en France ont pu prendre en charge des animaux en peluche. Mais face au succès de l’opération, ce sont désormais 38 facultés de médecine à travers la France qui accueillent plus de 10 000 enfants et leurs doudous chaque année. Notre pays est donc désormais en pointe dans le domaine de la nounoursologie.
Nicolas Barbet
____________
Publié le 29/04/2022
Enfin des ratios soignants/patients…inapplicables ?
Répondant à une revendication de longue date des professionnels, un décret paru au Journal Officiel fixe un ratio entre nombre de lits et nombre d'infirmiers et d'aides-soignants dans les unités de réanimation et de soins intensifs.
Le texte fixe les conditions techniques de fonctionnement de ces services (nombre minimal de lits, composition des équipes, formation nécessaire…), et définit pour chaque type de services hospitaliers un nombre de lits par infirmiers et aides-soignants. Le texte prévoit ainsi deux infirmiers pour cinq lits ouverts et un aide-soignant pour quatre lits ouverts pour les services de réanimation. Les unités de soins intensifs polyvalentes ou de spécialité, de cardiologie, d’hématologie et de neurologie vasculaire doivent, elles, disposer d’un infirmier pour 4 lits, et d’un aide-soignant pour 4 lits le jour et 8 lits la nuit.
Si on ne peut que louer cette nouvelle réglementation, elle intervient à un moment critique et est sans doute inapplicable.
Des ratios à l’heure des plans blanc !
Partout en France depuis plusieurs semaines, les établissements de santé déclenchent les plans blancs, faute de personnels.
A l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), première institution hospitalière de France, 15 % des lits sont actuellement fermés et il manque 8% d’infirmiers.
« On est perpétuellement sur la brèche. La situation est vraiment difficile pour tout le monde. On ne tourne pas comme on devrait tourner. Les professionnels font un énorme travail pour ne pas refuser de patients, pour fonctionner 24h/24, mais dans des conditions anormalement difficiles » indiquait Martin Hirsch, le directeur général de l’AP-HP ce mercredi sur franceinfo. « Il nous manque 8 % d’infirmières depuis six mois » détaillait-il déplorant « une sorte de désaffection, de ras-le-bol, de difficultés, de fatigue depuis cet été ». « D’habitude on a à peu près 4 ou 5 % des lits qui ne sont pas ouverts parce qu’il y a un problème ponctuel ou qu’on désinfecte, etc. Depuis six mois, ça oscille entre 14 et 16 %. On a 10% de lits de plus fermés » constatait-il.
Le diagnostic est simple : « depuis le début des années 2000 et le passage aux 35 heures, il y a un dérochage des salaires à l’hôpital qui m’a fait dire depuis des années que ça craquerait si on n’augmentait pas les infirmières » rappelle-t-il.
Dans ce contexte, appliquer des ratios soignants/patients reviendrait donc à fermer encore davantage de lit.
Comme l’écrivait les signataires d’une tribune dans le journal Le Monde en novembre dernier « un choc d’attractivité » à l’hôpital est plus que jamais nécessaire et il ne pourra se traduire que par de très substantielle augmentation de salaires pour les infirmiers et les aides-soignants.
Gabriel Poteau
_________________
Publié le 29/04/2022
14h - Trois professionnels de santé pas très professionnel
Un médecin, un pharmacien et un biologiste exerçant dans un laboratoire à Nice ont été mis en examen pour avoir, à l’automne 2020, délivré environ 500 certificatifs négatifs à des patients testés contre la Covid-19 mais dont ils n’avaient en réalité pas analyser les résultats. Les trois individus expliquent avoir voulu gagner du temps face à l’afflux de patients. Ils seront jugés en décembre.
13h - Le gouvernement britannique sur le banc des accusés
La Haute Cour de Justice de Londres a condamné le gouvernement britannique pour n’avoir pas su protéger les résidents de maisons de retraite durant la première vague de l’épidémie au printemps 2020. Les juges reprochent à l’exécutif de n’avoir pas mis en place un système de test ou de quarantaine obligatoire lorsqu’une personne âgée rentrait dans son établissement après une hospitalisation. 20 000 résidents d’Ehpad sont mortes au Royaume-Uni au printemps 2020.
12h - Les Français abandonnent les gestes barrières
Selon la dernière enquête Covi Prev de Santé Publique France sur l’attitude des Français face au Covid-19, de plus en plus de nos compatriotes abandonnent progressivement les gestes barrières. Ils sont ainsi 47 % parmi les sondés à ne plus porter de masque dans les lieux publics fermés, dont 19 % à l’avoir abandonné y compris dans les transports publics (où il est pourtant obligatoire). Le phénomène touche essentiellement les jeunes et les personnes diplômés.
11h - La Nouvelle-Zélande condamnée pour sa stratégie zéro-Covid
La Cour suprême de Nouvelle-Zélande a jugé ce mercredi que la décision du gouvernement de fermer totalement les frontières du pays durant la pandémie était illégale. Les juges reprochent à l’exécutif ne n’avoir pas prévu d’exception pour les citoyens néo-zélandais vivant à l’étranger et devant impérativement revenir dans l’archipel. Plusieurs cas d’individus n’ayant pas pu se rendre à l’enterrement d’un proche ou venir en aide à leurs familles à cause des restrictions aux frontières ont ému la société néo-zélandaise.
10h - Point de situation en France
Selon les données de Santé publique France arrêtées au soir du 28 avril, on comptabilise :
• 59 760 nouveaux cas de Covid-19 (vs 104 007 cas le 21 avril)
• 24 130 personnes hospitalisées pour Covid-19 (- 888 en une semaine)
• 1 629 personnes hospitalisées en soins critiques (- 55 en une semaine)
• 912 morts au cours de la semaine
• 145 711 morts depuis le début de l’épidémie (64 780 en 2020, 58 961 en 2021, 21 970 en 2022)
9h - Un point de situation dans le monde
Selon les dernières statistiques publiées par l’université John Hopkins de Baltimore, depuis le début de la pandémie 512 505 316 cas de Covid ont été identifiés dans le monde qui ont contribué à 6 231 930 décès. Ces quatre dernières semaines, les pays les plus impactés par la Covid sont, en nombre de contaminations la Corée du Sud (3 818 798), l’Allemagne (3 353 674) et la France (2 930 261) et en nombre de décès les Etats-Unis (12 212), le Royaume-Uni (9 353) et la Russie (6 663).
source jim.fr
Soigner les bobos des doudous
Au moment de choisir leur spécialité après avoir passé leur ECN en juin prochain, peut être certains futur internes se tourneront vers une spécialité en plein essor : la nounoursologie. Comme chacun sait, la nounoursologie est la spécialité consacrée à la prise en charge des animaux en peluche et des doudous. Une spécialité qui ne peut s’exercer que dans le cadre d’un hôpital des nounours.
Inspiré du concept de Teddy Bear Hospitals créé par des étudiants en médecine allemands en 2000, l’hôpital des nounours est organisé par l’Association nationale des étudiants en médecine de France (ANEMF) depuis 2004. Ce programme consiste à amener des enfants âgés de 3 à 6 ans dans un service hospitalier ou un lieu transformé en hôpital fictif pour y faire soigner leurs peluches préférées. L’ours en peluche ou le doudou sont alors pris en charge par des étudiants en 2ème ou 3ème année de médecine qui endossent provisoirement le statut de nounoursologue titulaire.
Des patients un peu mutiques
Les enfants ont alors la possibilité de suivre leur compagnon en peluche tout au long de son parcours de soins, de la consultation au passage en pharmacie en passant par d’éventuels examens approfondis ou des interventions chirurgicales. Les doudous ont une vie tourmentée et peuvent souffrir de maux bien différents, tels des déchirures, des tâches diverses et variés voire des morsures d’animaux de compagnie.
Les nounours ne sont pas forcément les patients les plus faciles, en raison de leur mutisme, mais les enfants sont là pour traduire leurs symptômes pour les médecins. La nournoursologie est fort heureusement prise en charge à 100 % par l’Assurance Maladie depuis que le Ministère de la Santé a commencé à soutenir l’hôpital des nounours en 2010. Les ours en peluche sont également épargnés par les aspects les moins agréables de notre système hospitalier, comme l’attente interminable, les plateaux repas de piètre qualité et surtout le passage à la caisse.
La nounoursologie, une spécialité en plein essor
Selon l’ANEMF, l’hôpital des nounours poursuit un triple objectif. Tout d’abord, il permet de réduire l’angoisse des enfants face aux hôpitaux et aux médecins dans le cas où ils doivent un jour être hospitalisés. En second lieu, un passage à l’hôpital des nounours permet aux enfants d’en savoir plus sur leur corps et leur santé (et peut être susciter de futurs vocations). Enfin, l’expérience permet aux futurs médecins d’apprendre à se confronter à de jeunes patients.
Désormais organisé en Allemagne, en France et en Suisse, l’hôpital des nounours prend de plus en plus d’ampleur avec les années. Lors de sa première édition en 2004, seulement six hôpitaux en France ont pu prendre en charge des animaux en peluche. Mais face au succès de l’opération, ce sont désormais 38 facultés de médecine à travers la France qui accueillent plus de 10 000 enfants et leurs doudous chaque année. Notre pays est donc désormais en pointe dans le domaine de la nounoursologie.
Nicolas Barbet
____________
Publié le 29/04/2022
Enfin des ratios soignants/patients…inapplicables ?
Répondant à une revendication de longue date des professionnels, un décret paru au Journal Officiel fixe un ratio entre nombre de lits et nombre d'infirmiers et d'aides-soignants dans les unités de réanimation et de soins intensifs.
Le texte fixe les conditions techniques de fonctionnement de ces services (nombre minimal de lits, composition des équipes, formation nécessaire…), et définit pour chaque type de services hospitaliers un nombre de lits par infirmiers et aides-soignants. Le texte prévoit ainsi deux infirmiers pour cinq lits ouverts et un aide-soignant pour quatre lits ouverts pour les services de réanimation. Les unités de soins intensifs polyvalentes ou de spécialité, de cardiologie, d’hématologie et de neurologie vasculaire doivent, elles, disposer d’un infirmier pour 4 lits, et d’un aide-soignant pour 4 lits le jour et 8 lits la nuit.
Si on ne peut que louer cette nouvelle réglementation, elle intervient à un moment critique et est sans doute inapplicable.
Des ratios à l’heure des plans blanc !
Partout en France depuis plusieurs semaines, les établissements de santé déclenchent les plans blancs, faute de personnels.
A l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), première institution hospitalière de France, 15 % des lits sont actuellement fermés et il manque 8% d’infirmiers.
« On est perpétuellement sur la brèche. La situation est vraiment difficile pour tout le monde. On ne tourne pas comme on devrait tourner. Les professionnels font un énorme travail pour ne pas refuser de patients, pour fonctionner 24h/24, mais dans des conditions anormalement difficiles » indiquait Martin Hirsch, le directeur général de l’AP-HP ce mercredi sur franceinfo. « Il nous manque 8 % d’infirmières depuis six mois » détaillait-il déplorant « une sorte de désaffection, de ras-le-bol, de difficultés, de fatigue depuis cet été ». « D’habitude on a à peu près 4 ou 5 % des lits qui ne sont pas ouverts parce qu’il y a un problème ponctuel ou qu’on désinfecte, etc. Depuis six mois, ça oscille entre 14 et 16 %. On a 10% de lits de plus fermés » constatait-il.
Le diagnostic est simple : « depuis le début des années 2000 et le passage aux 35 heures, il y a un dérochage des salaires à l’hôpital qui m’a fait dire depuis des années que ça craquerait si on n’augmentait pas les infirmières » rappelle-t-il.
Dans ce contexte, appliquer des ratios soignants/patients reviendrait donc à fermer encore davantage de lit.
Comme l’écrivait les signataires d’une tribune dans le journal Le Monde en novembre dernier « un choc d’attractivité » à l’hôpital est plus que jamais nécessaire et il ne pourra se traduire que par de très substantielle augmentation de salaires pour les infirmiers et les aides-soignants.
Gabriel Poteau
_________________
Publié le 29/04/2022
14h - Trois professionnels de santé pas très professionnel
Un médecin, un pharmacien et un biologiste exerçant dans un laboratoire à Nice ont été mis en examen pour avoir, à l’automne 2020, délivré environ 500 certificatifs négatifs à des patients testés contre la Covid-19 mais dont ils n’avaient en réalité pas analyser les résultats. Les trois individus expliquent avoir voulu gagner du temps face à l’afflux de patients. Ils seront jugés en décembre.
13h - Le gouvernement britannique sur le banc des accusés
La Haute Cour de Justice de Londres a condamné le gouvernement britannique pour n’avoir pas su protéger les résidents de maisons de retraite durant la première vague de l’épidémie au printemps 2020. Les juges reprochent à l’exécutif de n’avoir pas mis en place un système de test ou de quarantaine obligatoire lorsqu’une personne âgée rentrait dans son établissement après une hospitalisation. 20 000 résidents d’Ehpad sont mortes au Royaume-Uni au printemps 2020.
12h - Les Français abandonnent les gestes barrières
Selon la dernière enquête Covi Prev de Santé Publique France sur l’attitude des Français face au Covid-19, de plus en plus de nos compatriotes abandonnent progressivement les gestes barrières. Ils sont ainsi 47 % parmi les sondés à ne plus porter de masque dans les lieux publics fermés, dont 19 % à l’avoir abandonné y compris dans les transports publics (où il est pourtant obligatoire). Le phénomène touche essentiellement les jeunes et les personnes diplômés.
11h - La Nouvelle-Zélande condamnée pour sa stratégie zéro-Covid
La Cour suprême de Nouvelle-Zélande a jugé ce mercredi que la décision du gouvernement de fermer totalement les frontières du pays durant la pandémie était illégale. Les juges reprochent à l’exécutif ne n’avoir pas prévu d’exception pour les citoyens néo-zélandais vivant à l’étranger et devant impérativement revenir dans l’archipel. Plusieurs cas d’individus n’ayant pas pu se rendre à l’enterrement d’un proche ou venir en aide à leurs familles à cause des restrictions aux frontières ont ému la société néo-zélandaise.
10h - Point de situation en France
Selon les données de Santé publique France arrêtées au soir du 28 avril, on comptabilise :
• 59 760 nouveaux cas de Covid-19 (vs 104 007 cas le 21 avril)
• 24 130 personnes hospitalisées pour Covid-19 (- 888 en une semaine)
• 1 629 personnes hospitalisées en soins critiques (- 55 en une semaine)
• 912 morts au cours de la semaine
• 145 711 morts depuis le début de l’épidémie (64 780 en 2020, 58 961 en 2021, 21 970 en 2022)
9h - Un point de situation dans le monde
Selon les dernières statistiques publiées par l’université John Hopkins de Baltimore, depuis le début de la pandémie 512 505 316 cas de Covid ont été identifiés dans le monde qui ont contribué à 6 231 930 décès. Ces quatre dernières semaines, les pays les plus impactés par la Covid sont, en nombre de contaminations la Corée du Sud (3 818 798), l’Allemagne (3 353 674) et la France (2 930 261) et en nombre de décès les Etats-Unis (12 212), le Royaume-Uni (9 353) et la Russie (6 663).
source jim.fr
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
-
Arnaud BASSEZ
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2511
- Enregistré le : sam. nov. 04, 2006 4:43 pm
- Localisation : Paris
- Contact :
Re: Articles sur la santé
Publié le 14/05/2022
Réintégrer les soignants non vaccinés ou l’utopie de la science
A peine six mois avant les élections présidentielles, la situation épidémiologique concernant la Covid laissait craindre que la gestion de la crise sanitaire constituerait un sujet incontournable de ce scrutin.
Qu’elle en perturbe l’organisation ou qu’elle impose aux candidats de se positionner sur différents sujets (passe sanitaire et vaccinal, confinements, vaccination obligatoire…), la Covid semblait devoir être partout. Mais comme souvent, les prophéties ont été déjouées et d’autres sujets ont devancé SARS-CoV-2 dans les « débats » et les discours, même si certains indicateurs épidémiques continuaient en mars à connaître des niveaux qui en d’autres temps auraient entraîné une préoccupation majeure des dirigeants politiques.
Un sujet manqué du débat présidentiel
Loin d’être omniprésente, la Covid et plus certainement l’attitude vis-à-vis de la vaccination a néanmoins pu constituer une grille de lecture pour comprendre certaines fractures au sein de l’électorat, notamment entre les deux candidats en tête du premier tour.
D’ailleurs, de façon incidente, au cours du débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, cette dernière a tenté de marquer sa différence en évoquant la réintégration des personnels soignants qui ont refusé de se faire vacciner contre la Covid et qui sont aujourd’hui suspendus.
Si au cours de leur dialogue, le Président de la République n’a pas répondu sur ce sujet, il y a quelques jours, peu après sa réélection, il a estimé qu’une telle évolution n’était pas impossible. Il a observé : « Quand on ne sera plus en phase aiguë, on le fera, mais vis-à-vis des autres soignants, qui se sont fait vacciner et ont fait l'effort déontologique, (...) on ne peut pas, alors qu'il y a encore des cas, les réintégrer tout de suite ».
La science complètement occultée
Cette allusion à la déontologie n’est peut-être pas uniquement un stratagème destiné à gagner du temps, mais signale que le chef de l’Etat a probablement conscience des enjeux que suscite cette question de la réintégration des personnels non vaccinés dans la communauté médicale. Ces enjeux font écho à ceux qui ont jalonné la crise.
Ainsi certains continuent à espérer (en vain) que la décision résulte d’un avis scientifique avant d’être politique. Et la Fédération hospitalière de France (FHF) a indiqué qu’elle « s’en tiendrait » aux avis des conseils scientifiques. Difficile cependant de prétendre qu’une telle mesure puisse n’être dictée que par la « science », compte tenu des antécédents en la matière.
En effet, beaucoup de partisans de la réintégration des soignants non vaccinés remarquent que toute cohérence scientifique a été oubliée quand on a préféré que des soignants vaccinés mais infectés par SARS-Cov-2 puissent être autorisés à travailler plutôt que des soignants non vaccinés mais non infectés et acceptant de se faire tester tous les jours.
Quand l’appréciation de l’évolution de la situation est perçue comme de l’opportunisme
Pourtant c’est tout de même en usant d’arguments scientifiques que certains plaident en faveur de la réintégration des soignants non vaccinés. C’est le cas par exemple sur Twitter du professeur Yonathan Freund qui remarque : « Il n’y a désormais plus aucune raison d’exclure les soignants non vaccinés (…). Ce qui était vrai avec les variants précédents ne l’est plus. La contagiosité ne diminue probablement pas si on est vacciné et d’ailleurs on autorise les soignants à travailler même positifs. Il n’y a pas d’argument objectif qui tienne la route » a-t-il insisté à plusieurs reprises ces derniers jours. Cette prise de position lui a valu de nombreux commentaires acerbes d’opposants radicaux à l’obligation vaccinale des soignants, qui ont raillé ce qu’ils ont voulu prendre pour un opportuniste changement d’avis (critique qu’essuiera probablement également le futur gouvernement d’E. Macron s’il entérine le choix d’un retour des non vaccinés). Pourtant, Yonathan Freund s’en défend : « Je n’ai pas changé d’avis : l’exclusion des soignants non vaccinés était une excellente idée. Le passe vaccinal aussi. Il fallait une sacrée couche de… (bêtise ? ignorance ? rébellion à bas coût ?) pour refuser de se faire vacciner il y a un an. Les soignants non vaccinés avaient beaucoup plus de chances de transmettre le virus et il fallait les écarter » argumente-t-il.
Stigmatisation
Yonathan Freund n’est pas le seul qui après avoir soutenu l’obligation vaccinale et l’exclusion des non vaccinés souhaite aujourd’hui leur réintégration. Mais certains s’interrogent plus clairement sur les erreurs qui ont été commises.
Ainsi, le président de l’Association des praticiens hospitaliers (APH), le docteur Jean-François Cibien observe cité par le Quotidien du médecin : « Ces soignants n'ont pas fauté, le vaccin obligatoire était une mesure nécessaire, mais peut-être que nous n'avons pas su être assez persuasifs avec ceux qui doutaient. J'espère que ces soignants ne seront pas stigmatisés ».
Le vœu pourrait être pieu : les démarches juridiques de certains soignants suspendus, qui pour quelques-uns ont choisi des procédures pénales, témoignent de l’ampleur de la fêlure ressentie. Ce risque de stigmatisation était déjà évoqué au moment de la mise en œuvre de l’obligation par Gérard Kierzeck qui s’inquiétait : « La seule logique est celle de l'exemplarité mais je ne tolère pas que les soignants au sens large, applaudis au printemps 2020 soient maintenant pointés du doigt et stigmatisés. Les soignants sont des gens responsables et dévoués et ne pas être vacciné n'est pas un acte criminel ! Sur le fond, le vaccin n'empêche pas d'être contaminé et contaminant ; il ne dispense pas des gestes barrières que nous appliquons tous au quotidien et cela bien avant le Covid d'ailleurs. (…) Il faut aussi s'interroger sur la forme et sur les motivations de ces soignants qui refusent la vaccination. Donner ou déposer ses informations médicales de vaccination dans un portail administratif de déclaration est inadmissible sur un plan déontologique ; où est le secret médical ? Cela prouve aussi que le dialogue est rompu à l'hôpital (ou dans le système de santé d'ailleurs) entre le « management » et les acteurs du soin, entre ceux qui décident et ceux qui font ».
Aujourd’hui, sa position n’a pas évolué et il clame : « Leur réintégration relève d’une triple nécessité : un médicale (la suspension n’a aucun sens, le vaccin n’empêche pas la transmission virale), deux confraternelle (par respect et dignité des collèges suspendus), trois ressources humaines (manque de soignants) ».
Le retour des complotistes
Ces discours qui plaident pour une « réconciliation », qui pour certains vont même jusqu’à reconnaître sinon une « faute » au moins des « erreurs », irritent profondément une grande partie de la communauté médicale. Ainsi, le professeur Yonathan Freund a également été critiqué par ses confrères partisans de l’obligation vaccinale.
Le docteur Matthias Wargon a ainsi ironisé en soulevant l'épineuse question de l'avenir de la crise : « Quelle bonne idée de réintégrer des gens qui croient aux complots et pensent que leurs collègues médecins sont payés par Big pharma. Et puis pour les rappels, on va faire comment ? ». Même tonalité pour le compte médical « Doc Amine » : « Je suis favorable à la réintégration des soignants non vaccinés et tant qu’on y est peut-être il faudrait remplacer les médecins et les infirmiers par des coupeurs de feu et soigner à base de prière, d’urine, d’eau et de sucre ».
Cette remarque ironique rappelle les commentaires de ceux qui au moment de l’entrée en vigueur de l’interdiction avaient estimé qu’il était préférable que des personnes méconnaissant l’importance et l’intérêt des vaccins ne soient plus autorisées à soigner. « A l’heure où les soignants les plus méritants sont justement applaudis pour leurs efforts par la société tout entière, alors même que beaucoup font leurs métiers, nonobstant l’absence de considération et leurs médiocres conditions salariales, il faut que les familles, les aidants, et les autres acteurs de santé voient partir avec soulagement ceux qui brûlent leurs diplômes vers d’autres destinations professionnelles », écrivait ainsi un collectif de praticiens dans le Quotidien du médecin, faisant écho à des messages du même ordre beaucoup plus acerbes sur les réseaux sociaux.
Bon débarras
Aujourd’hui, le médecin qui utilise le compte twitter NightHaunter tient le même discours en énumérant : « Le soignant qui refuse jusqu’au bout, niant science et réalité, n’est plus un soignant. Je le dis haut et fort, si l’obligation vaccinale a permis de virer tous ceux qui ne se conformaient pas à la science c’est une victoire. Si c’est pour voir revenir Jean-Jacques, médecin homéopathe qui soigne aux granules des angines, bon débarras. Si c’est pour voir revenir Jeanine, l’infirmière qui conseille de l’ostéopathie infantile et des colliers d’ambre aux familles, bon débarras. Je pense toujours à un certain médecin qui a quitté son poste de médecin généraliste et qui joue les victimes. Lui que j’ai connu anti vax (et je ne parle pas de ceux contre la Covid) ultra-droite, tendance catho, anti IVG et j’en passe. Bah, mon neveu, bon débarras ».
La science, cette utopie (surtout en médecine !)
Cette litanie révèle en elle-même les limites d’un tel raisonnement. Yonathan Freund répond d’ailleurs à ce type d’arguments : « Il y a l’argument de l’éthique, de l’incompétence, de la logique, de la cohérence, etc. Oui, je suis d’accord. Mais c’est difficile à justifier de manière objective. Ça serait un changement car au départ, c’était pour le risque de transmission ».
Outre le fait qu’il est complexe d’opposer aux soignants ayant refusé de se faire vacciner que leur exclusion est justifiée par leur position « anti-science » après avoir mis en avant la question bien plus factuelle de la transmission, une telle démarche semble utopique.
Car jusqu’où aller dans la « chasse » aux idées non scientifiques qui en outre sont (hélas) si nombreuses et si diverses dans la communauté médicale ? Jusqu’au médecin catholique convaincu qui refuse l’IVG comme le suggère NightHaunter, au risque de s’opposer à la liberté de conscience ? Jusqu’au praticien qui recommande l’ostéopathie dont l’efficacité reste très contestée mais qui s’est pourtant quasiment imposée comme une pratique de routine aujourd’hui ? Jusqu’à celui qui refuse la prescription de statines considérant sincèrement (ou non) les études favorables comme biaisées par des conflits d’intérêts ?
On le voit, même si évidemment le refus de la vaccination contre la Covid a rappelé comment de nombreux professionnels de santé pouvaient soutenir un discours non scientifique, il apparaît difficile d’ériger la foi entière et absolue en cette dernière comme une condition sine qua non pour exercer, au risque de voir les déserts s’accroître encore davantage et la pureté de la médecine fortement remise en question
Tristes rustines pour les déserts
Cependant, concernant cet argument de la pénurie de professionnels de santé utilisée par beaucoup de partisans (politiques et médicaux) de la réintégration des soignants vaccinés, là encore, la question de la science entre en jeu dans la réponse de NightHaunter. Il remarque : « On peut faire du populisme. Comme les déserts médicaux occupent un peu plus les médias ces derniers temps, on peut dire qu’il faut réintégrer ces soignants parce que nous sommes en pénurie. Mais je suis contre. On ne réintègre pas un mauvais soignant. On n’apporte pas de mauvaise solution aux patients qui payent des années d’inaction sur les moyens médicaux, sur le manque de la médecine de ville et le manque de médecins tout court. Imagine-t-on reprendre des flics qui ne respectent pas la loi pour colmater le vide ? ».
Cette dernière question montre combien l’espoir du docteur Jean-François Cibien est probablement une utopie.
Pour mesurer la fracture irrésoluble sur ce sujet au sein de la communauté médicale et au-delà peut-être sur ce qui doit d’abord animer un soignant, on relira :
Le compte Twitter de Yonathan Freund
https://twitter.com/FreundYonathan
La contribution d’un collectif de soignants
https://www.lequotidiendumedecin.fr/opi ... l%C3%B4mes.
Le compte de NightHaunter
https://twitter.com/NightHaunter/status ... 2253235211
La prise de position de Gérald Kierzeck
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/cri ... n-20210914
Léa Crébat
jim.fr
___________
Covid : voici que répondre aux patients qui nous interpellent sur les intox des ‘Pfizer documents‘ ?
Depuis plusieurs semaines, circulent tweets ou posts Facebook ou articles de blog relayant de prétendues révélations sur la "dangerosité" du vaccin anti-Covid, qui seraient issues des "Pfizer documents". Si ces documents existent bien, ils ont été déformés et décontextualisés. Voilà ce que vous pourrez répondre à vos patients sceptiques…
"On vous a vendu une efficacité de 95% de l'injection, mais les #pfizerdocuments révèlent 12% d'efficacité sur les 7 premiers jours puis 1%", "Donc les documents #Pfizer montrent que leur vaccin est déconseillé pour les femmes enceintes et allaitantes", "Pfizer savait que ses vaccins allaient tuer"... Voilà quelques-unes des innombrables publications qui pullulent en anglais, serbe, français, finnois, néerlandais ou allemand sur internet.
D'où viennent ces Pfizerdocuments ?
L'Agence américaine du médicament, la FDA, publie de façon progressive des dizaines de milliers de pages relatives au vaccin de Pfizer/BioNTech, autorisé à partir de fin 2020. Contrainte par une décision de justice, elle devait rendre publiques 330 000 pages à raison de "plus de 12.000 pages" avant le 31 janvier 2022 puis "55 000 pages tous les 30 jours", depuis du 1er mars.
A chaque fournée de "Pfizer documents", moult allégations trompeuses ressurgissent bien que la plupart aient déjà été réfutées par de nombreux scientifiques du monde entier et fait l'objet de quantités d'articles de vérification. Certaines sont bâties sur ces documents, d'autres sont de simples recyclages, affublées de l’hashtag #pfizerdocuments pour leur assurer une viralité maximale.
Les effets secondaires
De très nombreuses publications affirment que ces documents listent d'innombrables effets secondaires inquiétants, certains internautes évoquant 8 ou 9 pages de troubles et maladies.
En réalité, cette liste est celle "d’événements indésirables d'intérêt particulier" (AESI) théoriquement possibles (par exemple parce qu'ils ont été relevés dans le cas de vaccins précédents) et donc qui doivent faire l'objet d'une surveillance particulière après la mise sur le marché du produit. Il ne s'agit pas de la liste d'effets rapportés pour ce vaccin, comme l'ont confirmé plusieurs experts de pharmacovigilance à l'AFP.
"3% de mortalité" pendant les essais ?
Certaines publications prétendent aussi que les documents de Pfizer révèleraient que lors des essais du vaccin, plus de 1 200 personnes - "3%" des participants - seraient mortes.
Le document fait état de 1 223 décès signalés parmi des personnes qui ont été vaccinées. C'est en rapportant ce chiffre au nombre total de signalements d'effets secondaires mentionnés (un peu plus de 42 000) que plusieurs internautes sont ainsi parvenus à la conclusion de "3% de mortalité" liée à la vaccination.
Comme le stipule le document lui-même, les données utilisées proviennent notamment de signalements, de personnes décédées, à Pfizer, par les autorités sanitaires de plusieurs pays, sans qu'un lien causal avec le vaccin ait été établi.
"1% d'efficacité" ?
Pfizer avait avancé à l'issue de ses essais cliniques une efficacité de son vaccin à 95%, ce qui signifie que parmi les personnes vaccinées lors de l'essai clinique, celles qui ont reçu le vaccin ont eu un risque de développer la maladie inférieur de 95% à celui du groupe qui n'ont pas reçu le produit (mais un placebo).
Mais de nombreuses publications avancent d'autres chiffres, notamment "1%".
Il y a en réalité deux façons de calculer le taux d'efficacité d'un vaccin : la "réduction relative du risque" (les fameux 95%) et la "réduction absolue du risque", qui bien que statistiquement valable, est peu lisible puisqu'elle tourne pour le vaccin Pfizer autour de 0,85 point. C'est de là que semble venir le chiffre de 1% avancé par les internautes.
Depuis le début des campagnes de vaccination dans le monde, plus de 10 milliards de doses de vaccin (toutes marques confondues) ont été administrées. Scientifiques indépendants comme autorités sanitaires continuent d'affirmer que l'efficacité reste élevée et le rapport bénéfices-risques largement favorable, même si "en vie réelle", le taux d'efficacité est inférieur au taux de 95% observé lors des essais.
Femmes enceintes et allaitantes
Bien que les publications sur internet citent les "Pfizer documents", les captures d'écran à l'appui de ces affirmations ne viennent pas de l'entreprise mais de l'Agence britannique du médicament (MHRA). Dans une note du 8 décembre 2020 (début de la campagne de vaccination au Royaume-Uni), cette autorité écrit bien que le vaccin de Pfizer "n'est pas recommandé pendant la grossesse" et "ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement".
Mais il est expliqué que ces précautions sont dues au manque de données à ce moment-là. Et pour cause, les essais de phase 3 du vaccin ont exclu les femmes enceintes, ce qui est connu depuis le début.
Comme dans de nombreux pays, le Royaume-Uni n'a donc d'abord, par principe de précaution, pas recommandé le vaccin aux femmes enceintes et allaitantes.
La plupart des pays ont depuis non seulement autorisé le vaccin pour les femmes enceintes mais le recommandent en raison des risques particuliers du Covid pour cette population (risque de naissances prématurées par exemple).
Avec AFP
source what'sup doc
Réintégrer les soignants non vaccinés ou l’utopie de la science
A peine six mois avant les élections présidentielles, la situation épidémiologique concernant la Covid laissait craindre que la gestion de la crise sanitaire constituerait un sujet incontournable de ce scrutin.
Qu’elle en perturbe l’organisation ou qu’elle impose aux candidats de se positionner sur différents sujets (passe sanitaire et vaccinal, confinements, vaccination obligatoire…), la Covid semblait devoir être partout. Mais comme souvent, les prophéties ont été déjouées et d’autres sujets ont devancé SARS-CoV-2 dans les « débats » et les discours, même si certains indicateurs épidémiques continuaient en mars à connaître des niveaux qui en d’autres temps auraient entraîné une préoccupation majeure des dirigeants politiques.
Un sujet manqué du débat présidentiel
Loin d’être omniprésente, la Covid et plus certainement l’attitude vis-à-vis de la vaccination a néanmoins pu constituer une grille de lecture pour comprendre certaines fractures au sein de l’électorat, notamment entre les deux candidats en tête du premier tour.
D’ailleurs, de façon incidente, au cours du débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, cette dernière a tenté de marquer sa différence en évoquant la réintégration des personnels soignants qui ont refusé de se faire vacciner contre la Covid et qui sont aujourd’hui suspendus.
Si au cours de leur dialogue, le Président de la République n’a pas répondu sur ce sujet, il y a quelques jours, peu après sa réélection, il a estimé qu’une telle évolution n’était pas impossible. Il a observé : « Quand on ne sera plus en phase aiguë, on le fera, mais vis-à-vis des autres soignants, qui se sont fait vacciner et ont fait l'effort déontologique, (...) on ne peut pas, alors qu'il y a encore des cas, les réintégrer tout de suite ».
La science complètement occultée
Cette allusion à la déontologie n’est peut-être pas uniquement un stratagème destiné à gagner du temps, mais signale que le chef de l’Etat a probablement conscience des enjeux que suscite cette question de la réintégration des personnels non vaccinés dans la communauté médicale. Ces enjeux font écho à ceux qui ont jalonné la crise.
Ainsi certains continuent à espérer (en vain) que la décision résulte d’un avis scientifique avant d’être politique. Et la Fédération hospitalière de France (FHF) a indiqué qu’elle « s’en tiendrait » aux avis des conseils scientifiques. Difficile cependant de prétendre qu’une telle mesure puisse n’être dictée que par la « science », compte tenu des antécédents en la matière.
En effet, beaucoup de partisans de la réintégration des soignants non vaccinés remarquent que toute cohérence scientifique a été oubliée quand on a préféré que des soignants vaccinés mais infectés par SARS-Cov-2 puissent être autorisés à travailler plutôt que des soignants non vaccinés mais non infectés et acceptant de se faire tester tous les jours.
Quand l’appréciation de l’évolution de la situation est perçue comme de l’opportunisme
Pourtant c’est tout de même en usant d’arguments scientifiques que certains plaident en faveur de la réintégration des soignants non vaccinés. C’est le cas par exemple sur Twitter du professeur Yonathan Freund qui remarque : « Il n’y a désormais plus aucune raison d’exclure les soignants non vaccinés (…). Ce qui était vrai avec les variants précédents ne l’est plus. La contagiosité ne diminue probablement pas si on est vacciné et d’ailleurs on autorise les soignants à travailler même positifs. Il n’y a pas d’argument objectif qui tienne la route » a-t-il insisté à plusieurs reprises ces derniers jours. Cette prise de position lui a valu de nombreux commentaires acerbes d’opposants radicaux à l’obligation vaccinale des soignants, qui ont raillé ce qu’ils ont voulu prendre pour un opportuniste changement d’avis (critique qu’essuiera probablement également le futur gouvernement d’E. Macron s’il entérine le choix d’un retour des non vaccinés). Pourtant, Yonathan Freund s’en défend : « Je n’ai pas changé d’avis : l’exclusion des soignants non vaccinés était une excellente idée. Le passe vaccinal aussi. Il fallait une sacrée couche de… (bêtise ? ignorance ? rébellion à bas coût ?) pour refuser de se faire vacciner il y a un an. Les soignants non vaccinés avaient beaucoup plus de chances de transmettre le virus et il fallait les écarter » argumente-t-il.
Stigmatisation
Yonathan Freund n’est pas le seul qui après avoir soutenu l’obligation vaccinale et l’exclusion des non vaccinés souhaite aujourd’hui leur réintégration. Mais certains s’interrogent plus clairement sur les erreurs qui ont été commises.
Ainsi, le président de l’Association des praticiens hospitaliers (APH), le docteur Jean-François Cibien observe cité par le Quotidien du médecin : « Ces soignants n'ont pas fauté, le vaccin obligatoire était une mesure nécessaire, mais peut-être que nous n'avons pas su être assez persuasifs avec ceux qui doutaient. J'espère que ces soignants ne seront pas stigmatisés ».
Le vœu pourrait être pieu : les démarches juridiques de certains soignants suspendus, qui pour quelques-uns ont choisi des procédures pénales, témoignent de l’ampleur de la fêlure ressentie. Ce risque de stigmatisation était déjà évoqué au moment de la mise en œuvre de l’obligation par Gérard Kierzeck qui s’inquiétait : « La seule logique est celle de l'exemplarité mais je ne tolère pas que les soignants au sens large, applaudis au printemps 2020 soient maintenant pointés du doigt et stigmatisés. Les soignants sont des gens responsables et dévoués et ne pas être vacciné n'est pas un acte criminel ! Sur le fond, le vaccin n'empêche pas d'être contaminé et contaminant ; il ne dispense pas des gestes barrières que nous appliquons tous au quotidien et cela bien avant le Covid d'ailleurs. (…) Il faut aussi s'interroger sur la forme et sur les motivations de ces soignants qui refusent la vaccination. Donner ou déposer ses informations médicales de vaccination dans un portail administratif de déclaration est inadmissible sur un plan déontologique ; où est le secret médical ? Cela prouve aussi que le dialogue est rompu à l'hôpital (ou dans le système de santé d'ailleurs) entre le « management » et les acteurs du soin, entre ceux qui décident et ceux qui font ».
Aujourd’hui, sa position n’a pas évolué et il clame : « Leur réintégration relève d’une triple nécessité : un médicale (la suspension n’a aucun sens, le vaccin n’empêche pas la transmission virale), deux confraternelle (par respect et dignité des collèges suspendus), trois ressources humaines (manque de soignants) ».
Le retour des complotistes
Ces discours qui plaident pour une « réconciliation », qui pour certains vont même jusqu’à reconnaître sinon une « faute » au moins des « erreurs », irritent profondément une grande partie de la communauté médicale. Ainsi, le professeur Yonathan Freund a également été critiqué par ses confrères partisans de l’obligation vaccinale.
Le docteur Matthias Wargon a ainsi ironisé en soulevant l'épineuse question de l'avenir de la crise : « Quelle bonne idée de réintégrer des gens qui croient aux complots et pensent que leurs collègues médecins sont payés par Big pharma. Et puis pour les rappels, on va faire comment ? ». Même tonalité pour le compte médical « Doc Amine » : « Je suis favorable à la réintégration des soignants non vaccinés et tant qu’on y est peut-être il faudrait remplacer les médecins et les infirmiers par des coupeurs de feu et soigner à base de prière, d’urine, d’eau et de sucre ».
Cette remarque ironique rappelle les commentaires de ceux qui au moment de l’entrée en vigueur de l’interdiction avaient estimé qu’il était préférable que des personnes méconnaissant l’importance et l’intérêt des vaccins ne soient plus autorisées à soigner. « A l’heure où les soignants les plus méritants sont justement applaudis pour leurs efforts par la société tout entière, alors même que beaucoup font leurs métiers, nonobstant l’absence de considération et leurs médiocres conditions salariales, il faut que les familles, les aidants, et les autres acteurs de santé voient partir avec soulagement ceux qui brûlent leurs diplômes vers d’autres destinations professionnelles », écrivait ainsi un collectif de praticiens dans le Quotidien du médecin, faisant écho à des messages du même ordre beaucoup plus acerbes sur les réseaux sociaux.
Bon débarras
Aujourd’hui, le médecin qui utilise le compte twitter NightHaunter tient le même discours en énumérant : « Le soignant qui refuse jusqu’au bout, niant science et réalité, n’est plus un soignant. Je le dis haut et fort, si l’obligation vaccinale a permis de virer tous ceux qui ne se conformaient pas à la science c’est une victoire. Si c’est pour voir revenir Jean-Jacques, médecin homéopathe qui soigne aux granules des angines, bon débarras. Si c’est pour voir revenir Jeanine, l’infirmière qui conseille de l’ostéopathie infantile et des colliers d’ambre aux familles, bon débarras. Je pense toujours à un certain médecin qui a quitté son poste de médecin généraliste et qui joue les victimes. Lui que j’ai connu anti vax (et je ne parle pas de ceux contre la Covid) ultra-droite, tendance catho, anti IVG et j’en passe. Bah, mon neveu, bon débarras ».
La science, cette utopie (surtout en médecine !)
Cette litanie révèle en elle-même les limites d’un tel raisonnement. Yonathan Freund répond d’ailleurs à ce type d’arguments : « Il y a l’argument de l’éthique, de l’incompétence, de la logique, de la cohérence, etc. Oui, je suis d’accord. Mais c’est difficile à justifier de manière objective. Ça serait un changement car au départ, c’était pour le risque de transmission ».
Outre le fait qu’il est complexe d’opposer aux soignants ayant refusé de se faire vacciner que leur exclusion est justifiée par leur position « anti-science » après avoir mis en avant la question bien plus factuelle de la transmission, une telle démarche semble utopique.
Car jusqu’où aller dans la « chasse » aux idées non scientifiques qui en outre sont (hélas) si nombreuses et si diverses dans la communauté médicale ? Jusqu’au médecin catholique convaincu qui refuse l’IVG comme le suggère NightHaunter, au risque de s’opposer à la liberté de conscience ? Jusqu’au praticien qui recommande l’ostéopathie dont l’efficacité reste très contestée mais qui s’est pourtant quasiment imposée comme une pratique de routine aujourd’hui ? Jusqu’à celui qui refuse la prescription de statines considérant sincèrement (ou non) les études favorables comme biaisées par des conflits d’intérêts ?
On le voit, même si évidemment le refus de la vaccination contre la Covid a rappelé comment de nombreux professionnels de santé pouvaient soutenir un discours non scientifique, il apparaît difficile d’ériger la foi entière et absolue en cette dernière comme une condition sine qua non pour exercer, au risque de voir les déserts s’accroître encore davantage et la pureté de la médecine fortement remise en question
Tristes rustines pour les déserts
Cependant, concernant cet argument de la pénurie de professionnels de santé utilisée par beaucoup de partisans (politiques et médicaux) de la réintégration des soignants vaccinés, là encore, la question de la science entre en jeu dans la réponse de NightHaunter. Il remarque : « On peut faire du populisme. Comme les déserts médicaux occupent un peu plus les médias ces derniers temps, on peut dire qu’il faut réintégrer ces soignants parce que nous sommes en pénurie. Mais je suis contre. On ne réintègre pas un mauvais soignant. On n’apporte pas de mauvaise solution aux patients qui payent des années d’inaction sur les moyens médicaux, sur le manque de la médecine de ville et le manque de médecins tout court. Imagine-t-on reprendre des flics qui ne respectent pas la loi pour colmater le vide ? ».
Cette dernière question montre combien l’espoir du docteur Jean-François Cibien est probablement une utopie.
Pour mesurer la fracture irrésoluble sur ce sujet au sein de la communauté médicale et au-delà peut-être sur ce qui doit d’abord animer un soignant, on relira :
Le compte Twitter de Yonathan Freund
https://twitter.com/FreundYonathan
La contribution d’un collectif de soignants
https://www.lequotidiendumedecin.fr/opi ... l%C3%B4mes.
Le compte de NightHaunter
https://twitter.com/NightHaunter/status ... 2253235211
La prise de position de Gérald Kierzeck
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/cri ... n-20210914
Léa Crébat
jim.fr
___________
Covid : voici que répondre aux patients qui nous interpellent sur les intox des ‘Pfizer documents‘ ?
Depuis plusieurs semaines, circulent tweets ou posts Facebook ou articles de blog relayant de prétendues révélations sur la "dangerosité" du vaccin anti-Covid, qui seraient issues des "Pfizer documents". Si ces documents existent bien, ils ont été déformés et décontextualisés. Voilà ce que vous pourrez répondre à vos patients sceptiques…
"On vous a vendu une efficacité de 95% de l'injection, mais les #pfizerdocuments révèlent 12% d'efficacité sur les 7 premiers jours puis 1%", "Donc les documents #Pfizer montrent que leur vaccin est déconseillé pour les femmes enceintes et allaitantes", "Pfizer savait que ses vaccins allaient tuer"... Voilà quelques-unes des innombrables publications qui pullulent en anglais, serbe, français, finnois, néerlandais ou allemand sur internet.
D'où viennent ces Pfizerdocuments ?
L'Agence américaine du médicament, la FDA, publie de façon progressive des dizaines de milliers de pages relatives au vaccin de Pfizer/BioNTech, autorisé à partir de fin 2020. Contrainte par une décision de justice, elle devait rendre publiques 330 000 pages à raison de "plus de 12.000 pages" avant le 31 janvier 2022 puis "55 000 pages tous les 30 jours", depuis du 1er mars.
A chaque fournée de "Pfizer documents", moult allégations trompeuses ressurgissent bien que la plupart aient déjà été réfutées par de nombreux scientifiques du monde entier et fait l'objet de quantités d'articles de vérification. Certaines sont bâties sur ces documents, d'autres sont de simples recyclages, affublées de l’hashtag #pfizerdocuments pour leur assurer une viralité maximale.
Les effets secondaires
De très nombreuses publications affirment que ces documents listent d'innombrables effets secondaires inquiétants, certains internautes évoquant 8 ou 9 pages de troubles et maladies.
En réalité, cette liste est celle "d’événements indésirables d'intérêt particulier" (AESI) théoriquement possibles (par exemple parce qu'ils ont été relevés dans le cas de vaccins précédents) et donc qui doivent faire l'objet d'une surveillance particulière après la mise sur le marché du produit. Il ne s'agit pas de la liste d'effets rapportés pour ce vaccin, comme l'ont confirmé plusieurs experts de pharmacovigilance à l'AFP.
"3% de mortalité" pendant les essais ?
Certaines publications prétendent aussi que les documents de Pfizer révèleraient que lors des essais du vaccin, plus de 1 200 personnes - "3%" des participants - seraient mortes.
Le document fait état de 1 223 décès signalés parmi des personnes qui ont été vaccinées. C'est en rapportant ce chiffre au nombre total de signalements d'effets secondaires mentionnés (un peu plus de 42 000) que plusieurs internautes sont ainsi parvenus à la conclusion de "3% de mortalité" liée à la vaccination.
Comme le stipule le document lui-même, les données utilisées proviennent notamment de signalements, de personnes décédées, à Pfizer, par les autorités sanitaires de plusieurs pays, sans qu'un lien causal avec le vaccin ait été établi.
"1% d'efficacité" ?
Pfizer avait avancé à l'issue de ses essais cliniques une efficacité de son vaccin à 95%, ce qui signifie que parmi les personnes vaccinées lors de l'essai clinique, celles qui ont reçu le vaccin ont eu un risque de développer la maladie inférieur de 95% à celui du groupe qui n'ont pas reçu le produit (mais un placebo).
Mais de nombreuses publications avancent d'autres chiffres, notamment "1%".
Il y a en réalité deux façons de calculer le taux d'efficacité d'un vaccin : la "réduction relative du risque" (les fameux 95%) et la "réduction absolue du risque", qui bien que statistiquement valable, est peu lisible puisqu'elle tourne pour le vaccin Pfizer autour de 0,85 point. C'est de là que semble venir le chiffre de 1% avancé par les internautes.
Depuis le début des campagnes de vaccination dans le monde, plus de 10 milliards de doses de vaccin (toutes marques confondues) ont été administrées. Scientifiques indépendants comme autorités sanitaires continuent d'affirmer que l'efficacité reste élevée et le rapport bénéfices-risques largement favorable, même si "en vie réelle", le taux d'efficacité est inférieur au taux de 95% observé lors des essais.
Femmes enceintes et allaitantes
Bien que les publications sur internet citent les "Pfizer documents", les captures d'écran à l'appui de ces affirmations ne viennent pas de l'entreprise mais de l'Agence britannique du médicament (MHRA). Dans une note du 8 décembre 2020 (début de la campagne de vaccination au Royaume-Uni), cette autorité écrit bien que le vaccin de Pfizer "n'est pas recommandé pendant la grossesse" et "ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement".
Mais il est expliqué que ces précautions sont dues au manque de données à ce moment-là. Et pour cause, les essais de phase 3 du vaccin ont exclu les femmes enceintes, ce qui est connu depuis le début.
Comme dans de nombreux pays, le Royaume-Uni n'a donc d'abord, par principe de précaution, pas recommandé le vaccin aux femmes enceintes et allaitantes.
La plupart des pays ont depuis non seulement autorisé le vaccin pour les femmes enceintes mais le recommandent en raison des risques particuliers du Covid pour cette population (risque de naissances prématurées par exemple).
Avec AFP
source what'sup doc
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade
https://www.facebook.com/SOFIA-soci%C3% ... _todo_tour
https://mobile.twitter.com/SOFIA_iade